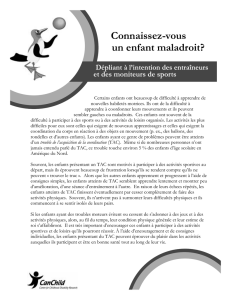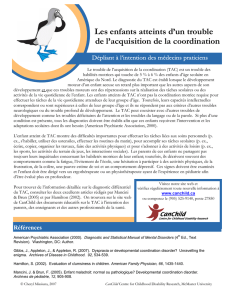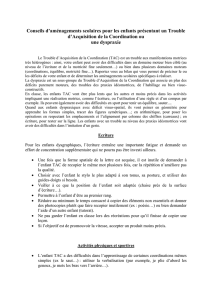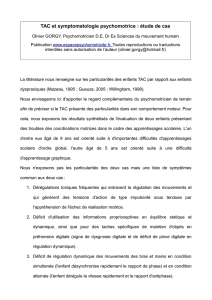L Traitements alternatifs et complémentaires dans les MICI É D

ÉDITORIAL
Traitements alternatifs et complémentaires dans les MICI
●M. Bensoussan*
* Service d’hépato-gastroentérologie, hôpital européen Georges-Pompidou, Paris.
L
es traitements alternatifs et complémentaires (TAC)
répondent à une définition qui, jusqu’à présent, ne fait
pas l’objet d’un consensus. Ce sont en partie les traite-
ments qu’on appelait autrefois (un peu ironiquement d’ailleurs)
les “médecines parallèles” mais également les médecines prati-
quées par des civilisations lointaines, dans le temps ou dans l’es-
pace, telles l’acupuncture ou la médecine ayurvédique. Certains
incluent encore dans cette famille des thérapies dorénavant ensei-
gnées dans certaines universités françaises telles l’homéopathie,
l’aromathérapie ou la réflexologie. Finalement, une définition
assez consensuelle est de considérer que les TAC sont “l’ensemble
des pratiques médicales qui ne sont pas en conformité avec les
standards des sociétés savantes” (1).
Le recours à ces traitements est en progression constante depuis
20 ans, davantage dans les pays nordiques et anglo-saxons qu’en
Europe continentale (2). Par ailleurs, l’utilisation de TAC est par-
ticulièrement fréquente chez les patients atteints de maladies chro-
niques ayant un retentissement sur leur qualité de vie. On retrouve
notamment depuis 10 ans de très nombreuses publications sur
l’utilisation des TAC chez des patients atteints de cancer, la mala-
die chronique par excellence, qui a un retentissement sur la qua-
lité de vie, y compris dans certains centres prestigieux comme le
Sloan-Kettering Cancer Center de New York, où l’acupuncture
est utilisée pour la prise en charge des vomissements postchimio-
thérapie (3, 4).
En ce qui concerne la pratique des gastroentérologues, parmi les
maladies les plus invalidantes, il y a bien entendu les maladies
inflammatoires chroniques de l’intestin (MICI). C’est donc parmi
les patients atteints de MICI que l’on trouve une importante pré-
valence du recours aux TAC. En effet, certaines études ont mon-
tré que ce chiffre atteignait 40 % en Amérique du Nord (États-
Unis et Canada) (5, 6). Ces données sont à peu près comparables
à celles retrouvées dans des cohortes de patients suisses, anglais
ou encore suédois (2).
Cependant, aucune étude portant sur le recours aux TAC par les
patients atteints de MICI n’était encore disponible en France.
C’est ce qui a motivé la réalisation de notre travail au sein de
l’équipe du service d’hépato-gastroentérologie du Pr G. Thiefin,
au CHU de Reims (7). Pour réaliser ce travail, le Pr G. Cadiot et
moi-même nous sommes très fortement inspirés de la méthodo-
logie d’une étude similaire, de type enquête postale, menée au
Canada par l’équipe de Calgary de R.J.Hilsden (8). Nous avons
donc envoyé un questionnaire anonyme à 447 patients de la région
de Reims recrutés parmi les patients suivis au CHU et dans une
importante clinique privée.
Le taux de réponse était très élevé, puisque 63,3 % des patients
ont répondu au questionnaire, ce qui était une première indica-
tion de l’importance qu’ils attachaient à l’attention portée par le
monde médical à leur qualité de vie et à leur ressenti de la MICI.
Parmi les patients qui ont répondu, 21,2 % ont rapporté avoir déjà
eu recours à des TAC. Ce chiffre était donc nettement inférieur à
ceux retrouvés dans d’autres populations, mais n’était pas négli-
geable. En effet, il nous a paru primordial de réaliser pour la pre-
mière fois qu’un patient sur cinq atteints de MICI en France uti-
lise des TAC. Parmi ces patients, une minorité les utilisait à la
place des traitements conventionnels (corticoïdes, azathioprine,
5-aminosalicylés, etc.), mais les TAC venaient le plus souvent
compléter ces traitements. Par ailleurs, les patients qui utilisaient
des TAC exprimaient avoir ressenti des effets positifs sur leur état
de forme générale et leur niveau de stress, bien plus que sur
les symptômes directs de la MICI, ce qui était un autre résultat
important.
Les trois TAC les plus utilisés étaient, dans l’ordre : l’homéopa-
thie, le magnétisme et l’acupuncture. Ces résultats étaient encore
différents de ceux des études nord-américaines, probablement en
raison des différences culturelles, des types différents de popula-
tions immigrées et de la facilité d’accès à certains TAC aux États-
Unis. En particulier, dans la plupart des études américaines, ce
sont les compléments multivitaminés et les thérapies à base
d’herbes qui sont les plus utilisés, alors qu’ils ne figuraient qu’en
quatrième position dans notre travail.
Certains autres résultats étaient surprenants, en tout cas différents
des autres études disponibles sur le sujet. En effet, l’analyse sta-
tistique ne nous a pas permis de mettre en évidence une relation
significative entre la gravité de la maladie et le recours aux TAC,
ni avec le niveau social ou d’éducation des patients. Dans notre
travail, après avoir introduit tous les facteurs de la cohorte dans
une analyse multivariée, les trois seuls facteurs significativement
associés au recours aux TAC étaient : le fait d’être une femme, le
faible niveau de confiance envers le médecin et le fait d’avoir
cherché des informations sur la MICI (livres, revues, Internet,
La lettre de l’hépato-gastroentérologue - n° 2 - vol. IX - mars-avril 2006 67

ÉDITORIAL
télévision, etc.). Enfin et surtout, les trois quarts des patients uti-
lisant des TAC n’en parlent pas à leur médecin, le plus souvent
par peur de sa réaction. Ce sont ces résultats qui nous ont paru les
plus importants.
L’enseignement principal de notre travail réside donc dans la
manière dont les patients se sentent écoutés et considérés par leur
médecin. Nous savons que l’accès à l’information est devenu très
facile et que les patients se renseignent beaucoup plus aujourd’hui
sur leur maladie. Ils souhaitent par ailleurs être considérés dans
leur globalité, plutôt qu’évalués par le gastroentérologue en termes
de gravité de leur maladie liée aux signes physiques de cette der-
nière. Par ailleurs, ils voudraient également partager avec le méde-
cin les décisions tout au long de l’évolution de leur maladie. Toutes
ces données sont nouvelles et ont été clairement exprimées par
les patients de notre étude. Cela devra de plus en plus être pris en
compte par les médecins.
Finalement, la question n’était pas tant de savoir si les TAC sont
efficaces sur la MICI ou pas. Aucune donnée de la littérature ne
permet de l’affirmer, en dehors des épiphénomènes de la mala-
die, tels les troubles fonctionnels intestinaux, le stress ou le niveau
de forme. De plus, tous les TAC ne sont pas totalement inoffen-
sifs ; certains ont une interaction avec les traitements conven-
tionnels, comme le jus de pamplemousse, qui abaisse les taux
sériques d’azathioprine (9) ; d’autres peuvent même être mortels.
Par exemple, des cas d’hépatite fulminante après prise de décoc-
tions de plantes ont été décrits dans la littérature (10).
Ainsi, les données de notre travail (7) et de la revue de la littéra-
ture nous laissent à penser que le recours aux TAC par les patients
français atteints de MICI est important, puisque un patient sur
cinq en utilise, même si cela est deux fois moins qu’en Amérique
du Nord. Ce recours est au moins partiellement lié à une carence
de la relation médecin-malade, bien plus qu’à la sévérité de la
maladie, tout au moins celle ressentie par le malade. Les trois
quarts des patients qui utilisent des TAC le font à l’insu de leur
médecin et c’est à cela qu’il conviendrait de remédier, principa-
lement en apportant une écoute des plus attentives sur le vécu de
la maladie par les malades et accessoirement en se renseignant
un minimum sur ces TAC, ne fût-ce que pour pouvoir informer
les patients sur leurs effets indésirables potentiels. ■
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
1. Guiraud GG. Le recours aux médecines parallèles au XXesiècle. Presse Med
2003;32:1638-41.
2. Rawsthorne P, Shanahan F, Cronin NC et al. An international survey of the use
and attitudes regarding alternative medicine by patients with inflammatory bowel
disease. Am J Gastroenterol 1999;94:1298-303.
3. Dilhuydy JM. L’attrait pour les médecines complémentaires et alternatives en
cancérologie : une réalité que les médecins ne peuvent ni ignorer, ni réfuter. Bull
Cancer 2003;90:623-8.
4. Ernst E. The current position of complementary/alternative medicine in can-
cer. Eur J Cancer 2003;39:2273-7.
5. Eisenberg DM, Kessler RC, Foster C et al. Unconventional medicine in the Uni-
ted States. Prevalence, costs, and patterns of use. N Engl J Med 1993;328:246-52.
6. Hilsden RJ, Scott CM, Verhoef MJ. Complementary medicine use by patients
with inflammatory bowel disease. Am J Gastroenterol 1998;93:697-701.
7. Bensoussan M, Jovenin N, Garcia B et al. Complementary and alternative
medicine use by patients with inflammatory bowel disease. Gastroenterol Clin
Biol 2006;30:14-23.
8. Hilsden RJ, Verhoef MJ, Best A, Pocobelli G. Complementary and alternative
medicine use by Canadian patients with inflammatory bowel disease: results from
a national survey. Am J Gastroenterol 2003;98:1563-8.
9. Neuman M. Effets métaboliques et interactions médicamenteuses provoquées
par certaines substances d’origine végétale : pamplemousse, millepertuis et ail.
Presse Med 2002;31:1416-22.
10. Durazo FA, Lassman C, Han SH et al. Fulminant liver failure due to usnic
acid for weight loss. Am J Gastroenterol 2004;99:950-2.
La lettre de l’hépato-gastroentérologue - n° 2 - vol. IX - mars-avril 2006
68
1
/
2
100%