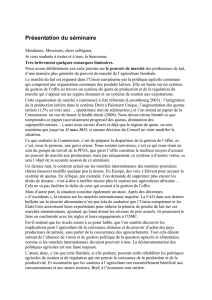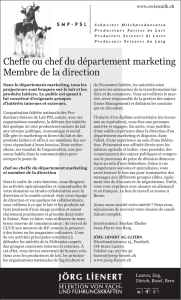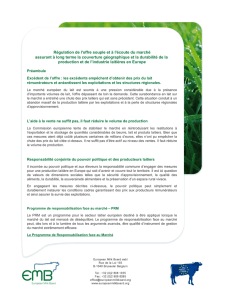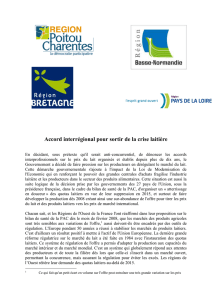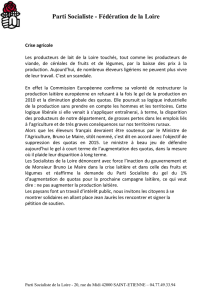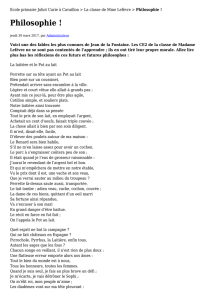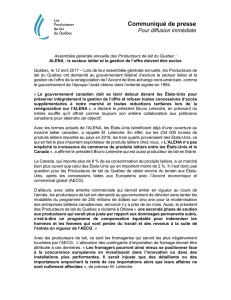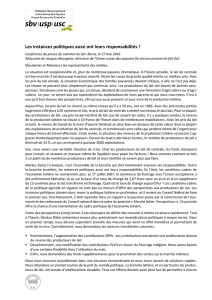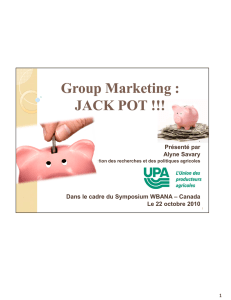Télécharger Rapport sur la contractualisation dans le secteur agricole (Article L631-24 du Code rural et de la pêche maritime) au format PDF, poids 1.16 Mo

Conseil général de l’alimentation,
de l’agriculture et des espaces ruraux
RAPPORT
sur la contractualisation
dans le secteur agricole
(Article L631-24 du Code rural et de la pêche maritime)
établi par
Jean-Baptiste DANEL
Ingénieur général
des ponts, des eaux et des forêts
Georges-Pierre MALPEL
Inspecteur général de l’agriculture
Pierre-Henri TEXIER
Ingénieur général
des ponts, des eaux et des forêts
CGAAER n° 12100
Juillet 2012

Page 2/57

Sommaire
Résumé..................................................................................................................................5
Liste des recommandations...................................................................................................7
. 1 Introduction...............................................................................................................11
. 2 L’état des lieux..........................................................................................................13
.2.1. En France...........................................................................................................13
.2.1.1. Rappel du cadre juridique général........................................................................13
.2.1.2. La loi de modernisation agricole et son contexte..................................................13
.2.1.3. Application de la loi de modernisation...................................................................15
.2.2. Dans l’Union européenne...................................................................................17
.2.2.1. Le droit de la concurrence et le projet d’OCM unique : les OP et les
interprofessions................................................................................................................17
.2.2.2. L’analyse du « paquet lait »..................................................................................17
. 3 Accompagnement de la politique de contractualisation dans le domaine agricole
.........................................................................................................................................19
.3.1. La médiation des relations commerciales agricoles .........................................19
.3.1.1. Création................................................................................................................19
.3.1.2. Les attributions du médiateur : .............................................................................19
.3.1.3. Les saisines pour le lait: .......................................................................................20
.3.1.4. Les saisines pour les fruits et légumes : ..............................................................21
.3.1.5. Conclusion............................................................................................................21
.3.2. L'observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires
.....................................................................................................................................21
.3.2.1. Conclusion ...........................................................................................................22
.3.3. Conclusion générale ..........................................................................................22
. 4 La contractualisation dans le secteur laitier.........................................................23
.4.1. Les motifs propres au secteur laitier..................................................................23
.4.2. Le rôle des organisations de producteurs..........................................................25
.4.3. Bilan quantitatif...................................................................................................25
.4.4. Bilan qualitatif.....................................................................................................27
.4.4.1. Transition vers l’après-quotas...............................................................................27
.4.4.2. Régulation des volumes........................................................................................27
.4.4.3. Régulation des prix...............................................................................................28
.4.4.4. Localisation de la production et déprise laitière....................................................29
.4.5. Autres éléments du contrat pouvant faire l’objet d’améliorations .....................29
.4.5.1. La durée du contrat...............................................................................................30
.4.5.2. Les conditions de cession.....................................................................................30
.4.5.3. Le traitement des jeunes agriculteurs...................................................................30
.4.6. Le cas des coopératives.....................................................................................30
. 5 L’extension à d’autres filières.................................................................................33
Page 3/57

.5.1. La filière du lait de chèvre..................................................................................33
.5.2. La filière de la viande bovine..............................................................................34
.5.3. Les filières des viandes blanches (porc et volailles)..........................................34
. 6 Conclusions..............................................................................................................35
Annexes...............................................................................................................................37
Annexe 1 : Lettre de mission.......................................................................................38
Annexe 2 : Liste des personnes rencontrées............................................................40
Annexe 3 : Liste des sigles utilisés............................................................................42
Annexe 4 : Les SIPMM (Section interprofessionnelle de première mise en marché)43
Annexe 5 : Accord interprofessionnel filière ovine...................................................44
Annexe 6: Le marché du lait vu par l’Observatoire des marges et des prix
alimentaires....................................................................................................................47
Annexe 7 : La contractualisation laitière au 10 juillet 2012......................................49
Annexe 8 : Avis n° 2012-15 de la CIPC du 31 mai 2012.............................................52
Annexe 9 : Liste des textes de références.................................................................56
Annexe 10 : Bibliographie............................................................................................57
Page 4/57

Résumé
Mots clés : loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche ;
contractualisation ; contrat ; organisation de producteurs ; quotas ; filière laitière
Les agriculteurs ont été protégés pendant longtemps de la volatilité par des mécanismes
de soutiens publics, essentiellement communautaires.
La disparition de ces mécanismes, et en général le renforcement des premiers acheteurs
industriels ou commerciaux, met les agriculteurs en situation de plus grande faiblesse
dans la négociation de la cession de leurs produits.
Pour renforcer la position des agriculteurs, la Loi de modernisation de l’agriculture du 27
juillet 2010 a prévu la formalisation de contrats écrits, proposés à l’agriculteur par
l’acheteur des produits agricoles, et les clauses minimales de ces contrats. Cette loi a par
ailleurs prévu la possibilité de rendre obligatoire la proposition de contrat par extension
d’accords interprofessionnels, ou par décret. Deux décrets du 30 décembre 2010 rendent
les contrats obligatoires pour les fruits et légumes frais et le lait de vache à compter du
1er avril 2011. Un arrêté du 15 février 2011 rend applicable l’accord interprofessionnel
signé spécifiquement dans le secteur de la viande ovine.
Si ces dispositions n’ont pas été mises en œuvre pour les fruits et légumes, elles le sont
désormais, sauf exception, dans la filière laitière. Leur application a été renforcée par la
publication le 14 mars 2012 d’un règlement communautaire (le « Paquet lait ») permettant
dans le secteur laitier la reconnaissance d’organisations de producteurs pour négocier
collectivement des contrats avec les collecteurs, fixant les conditions et limites de taille de
ces organisations et précisant la place des interprofessions dans le dispositif.
Ce rapport analyse dans quelles conditions les contrats ont été proposés et signés dans la
filière laitière, leurs contenus, leurs forces (première période de cinq années, références
de prix, transparence des transactions, …), leurs insuffisances (durée et conditions de
renouvellement, clauses de sauvegarde, particularismes de la coopération agricole, …).
Le contrat ainsi mis en œuvre, notamment dans le secteur laitier, présente de nombreux
avantages pour la filière et le renforcement de la protection des producteurs. Il permet
d’améliorer le rééquilibrage et la transparence de la négociation entre les éleveurs et les
entreprises, il s’inscrit nettement dans la durée, il favorise le partage des informations sur
le marché. Pour avoir tous ses effets, le contrat peut être amélioré et consolidé sur
certains points évoqués dans le rapport : détermination des volumes, motifs de résiliation,
durées d’engagements spécifiques. Il sera conforté par le développement de la diffusion
d’informations partagées sur l’état et les prévisions d’évolution du marché, et ne pourra
que bénéficier de la construction d’organisations de producteurs solides ou du
renforcement de la participation des producteurs au sein des coopératives.
Il doit être utilisé pour les intérêts qu’il représente plutôt que comme un remplaçant de la
totalité des instruments de gestion des marchés. Le contrat est d’abord un instrument
dans la négociation. Il est de construction récente et doit maintenant s’adapter dans la
Page 5/57
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
1
/
57
100%