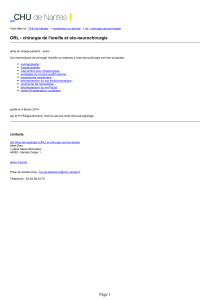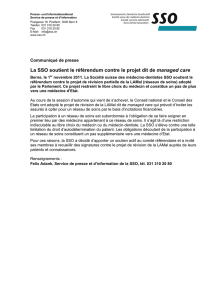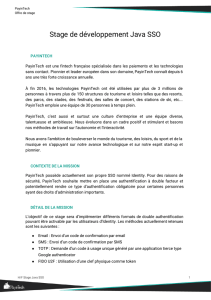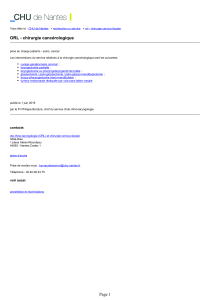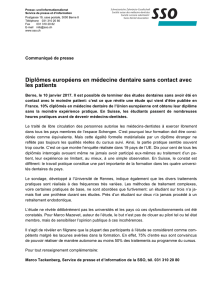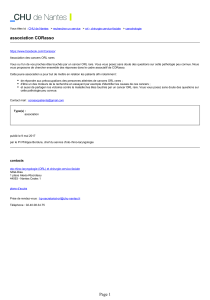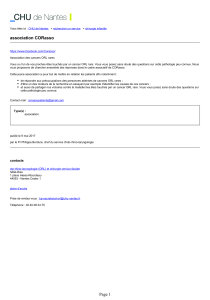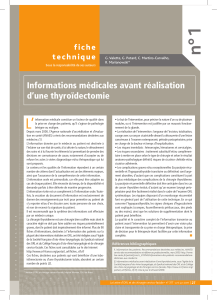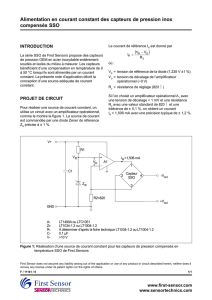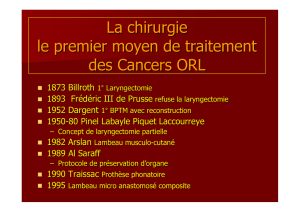L 104 Congrès de la Société française d’ORL et de chirurgie

Actualité
Actualité
12
Actualité
12
La Lettre d’ORL et de chirurgie cervico-faciale - n° 311 - octobre-décembre 2007
104e Congrès de la Société française d’ORL et de chirurgie
de la face et du cou
104th Congress of the French ENT Society
M. François*
Le 104e congrès de la Société française d’ORL et de chirur-
gie cervico-faciale s’est déroulé à Paris, les 14, 15 et 16 oc-
tobre 2007, sous la présidence du Pr J.J. Pessey (Toulouse).
Comme les années précédentes, tables rondes, présentation des
rapports, recommandations professionnelles, ateliers technolo-
giques et sessions de communications orales se sont succédé à
un rythme soutenu. Impossible d’aller partout ! Nous vous pré-
sentons ici le résumé de quelques tables rondes.
Table ronde transversale sur l’hygiène en consultation
ORL, sous l’égide de la SFORL, du Syndicat national
d’ORL (SNORL) et du collège français d’ORL, modérée par le
Pr F. Denoyelle (hôpital Trousseau, Paris) et le Dr P. Lerault
(SNORL).
Désinfection des mains et intérêt des solutés
hydralcooliques (F. Denoyelle)
Sous réserve que les mains ne soient pas macroscopiquement
souillées, la friction avec une solution hydralcoolique a démontré
sa supériorité sur le lavage en ce qui concerne la décontamination
bactérienne des mains. Par ailleurs, elle est associée à une meilleure
compliance, car il est possible d’avoir un fl acon de ces solutions
dans la poche, alors qu’il n’est pas toujours facile de trouver un
lavabo et des essuie-mains à proximité immédiate de l’endroit où
l’on se trouve. Le Comité technique national de lutte contre les
infections nosocomiales (CTIN) a donné le 5 décembre 2001 un
avis sur la place de la friction des mains par une solution hydral-
coolique dans l’hygiène des mains. La consommation de soluté
hydralcoolique dans une clinique ou un hôpital est actuellement
retenue comme le deuxième indicateur de lutte contre les infec-
tions nosocomiales. Pour le lavage des mains avant intervention
chirurgicale, les opérateurs ont actuellement le choix entre le
lavage classique avec une solution antiseptique ou le lavage au
savon doux suivi de deux frictions avec une solution hydralcoo-
lique. Il faut attendre que la solution sèche et ne pas essuyer.
Préparation de l’opéré en chirurgie ORL (B. Barry, Paris)
Cette préparation a pour objectif de prévenir l’infection du site
opératoire. Une particularité des interventions en ORL est la proxi-
mité des muqueuses (conjonctive, bouche, fosses nasales) pouvant
contre-indiquer l’utilisation de solutés alcooliques, et l’importance
du système pileux.
En ce qui concerne les cheveux, le mieux est en fait de ne pas
y toucher : ni tonte, ni rasage. S’il était nécessaire d’avoir une
surface de peau glabre, il ne faut rien faire la veille, et, juste avant
l’intervention, mais pas dans la salle d’opération, procéder à une
tonte (qui laisse 2 à 3 mm de cheveux) plutôt qu’à un rasage,
qui provoque de mini-excoriations cutanées.
Le patient ne doit pas porter de bijoux en salle d’opération. Il
doit prendre une douche avant l’intervention. La douche se fait
avec un antiseptique (povidone iodée ou chlorhexidine) ou un
savon doux.
La zone du champ opératoire est ensuite détergée par la panseuse
avec une solution antiseptique moussante, puis rincée à l’eau
stérile et séchée.
Le chirurgien procède alors à l’application d’un antiseptique de la
même gamme que celui utilisé pour la détersion et doit attendre
que le produit sèche avant de mettre en place les champs.
Conférence du Pr B. Fauroux (hôpital Trousseau, Paris)
sur le syndrome d’apnées obstructives du sommeil de
l’enfant et la ventilation non invasive.
Il existe une balance entre l’eff ort nécessaire pour respirer et la
capacité des muscles respiratoires. Si l’eff ort augmente il apparaît
une dyspnée, mais si la capacité des muscles respiratoires est
dépassée, il se produit une hypoxie avec hypercapnie.
Par opposition à l’état de veille, lors du sommeil, l’inspiration est
moins importante, la sensibilité aux chémorécepteurs diminue,
l’activité du diaphragme reste la même, mais l’activité des muscles
respirateurs accessoires diminue, il y a une inégalité du rapport
ventilation/perfusion, avec une augmentation des résistances
des voies aériennes et une diminution de la capacité résiduelle
fonctionnelle.
L’examen clé du diagnostic de syndrome des apnées du sommeil
est la polysomnographie, mais cet examen est très lourd et les
délais d’attente importants. Certains examens ont donc été déve-
loppés pour trier les patients qui devront absolument bénéfi cier
d’une polysomnographie :
– Sentec™qui se met comme une pince sur le lobule de l’oreille
et qui enregistre la SpO2, la PcO2 transcutanée et la fréquence
cardiaque ;
– Actiwatch™qui se présente comme une montre-bracelet et
qui permet d’enregistrer les mouvements qui sont corrélés à la
fragmentation du sommeil par de microréveils.
La mesure du travail respiratoire peut être approchée par la
mesure des pressions intraœsophagienne et intragastrique.
* Hôpital Robert-Debré, Paris.

Actualité
Actualité
13
La Lettre d’ORL et de chirurgie cervico-faciale - n° 311 - octobre-décembre 2007
Normalement, quand le diaphragme descend, à l’inspiration, il y
a une dépression intraœsophagienne de 5 cm H
2
O. La pression
intragastrique augmente un peu. La diff érence entre les deux
est la pression transdiaphragmatique. Or, l’aire sous la courbe
de la variation de la pression transdiaphragmatique au cours de
l’inspiration est liée à la consommation en O
2
par les muscles
respiratoires.
Les pathologies responsables de syndrome des apnées obstruc-
tives du sommeil (SAOS) chez l’enfant sont dominées par
l’hypertrophie amygdalienne, éventuellement associée à une
hypertrophie des végétations adénoïdes, et dans une moindre
mesure l’obésité. Les autres causes sont plus rares : laryngo-
et trachéomalacie, syndrome de Pierre Robin, sténose sous
glottique, syndrome de Beckwith-Wiedemann, trisomie 21,
malformation faciale, etc.
Tout SAOS doit être traité en cas d’hypercapnie diurne ou d’hypo-
ventilation alvéolaire nocturne. Les symptômes évocateurs sont
les éveils nocturnes, le sommeil agité, les terreurs nocturnes,
l’énurésie, la somnolence diurne, la fatigue, les céphalées mati-
nales, les troubles de l’humeur et de la concentration.
En cas d’hypertrophie amygdalienne, il ne faut pas hésiter à
proposer une amygdalectomie. Pour attendre la date de l’inter-
vention, ou en cas de persistance des troubles après amygdalec-
tomie, certains auteurs proposent un traitement de 1 à 3 mois par
un antileucotriène, le montélukast (Singulair
®
), éventuellement
associé à une corticothérapie nasale, s’il y a obstruction nasale
au décubitus. En eff et, l’hypertrophie amygdalienne serait due
à l’infl ammation locale, avec une augmentation de l’expression
des récepteurs des leucotriènes.
S’il n’y a pas d’hypertrophie amygdalienne, plutôt que de recourir à
la trachéotomie qui a une morbidité/mortalité importante chez l’en-
fant, il faut essayer la ventilation nasale non invasive, soit par pression
positive continue, soit en bilevel PAP. Les risques à court terme sont
les fuites autour du masque, la réinhalation de CO
2
quand l’espace
mort est trop grand et les lésions cutanées, surtout chez l’enfant
avec les masques industriels. Il est donc préférable d’avoir recours
à des masques moulés faits sur mesure. Le risque à long terme est
celui d’un aplatissement facial, voire d’une rétrognathie.
Table ronde sur la prise en charge de la pathologie du
sphincter supérieur de l’œsophage (SSO), sous l’égide de
l’association des chirurgiens cervicofaciaux, modérée par le
Pr J. Lacau Saint Guily (hôpital Tenon, Paris).
Anatomie de la bouche de l’œsophage et du sphincter
supérieur de l’œsophage (J.M. Prades, Saint-Étienne)
La bouche œsophagienne chez l’adulte est située au niveau de C6-
C7. Il y a une cascade musculaire latérale le long du cricoïde. La
musculature est plus épaisse au niveau de la bouche œsophagienne
qu’au-dessus, au niveau des sinus piriformes, ou au-dessous, au
niveau de l’œsophage cervical. L’innervation est complexe, assurée
par le glossopharyngien, le pneumogastrique (X) et le parasym-
pathique, avec une distribution nerveuse en peigne.
La bouche œsophagienne est fermée au repos.
Physiologie et explorations fonctionnelles du SSO
(P. Pouderoux, Nîmes)
La déglutition fait intervenir beaucoup d’événements en cascade,
avec une phase préparatoire, une phase orale, une phase pharyngée
qui comporte un mouvement de la base de langue, un raccourcis-
sement du pharynx, la fermeture du nasopharynx et du larynx,
la relaxation puis l’ouverture du SSO, la propulsion du bolus
alimentaire et le retour à la confi guration initiale. Le SSO associe
un ensemble de muscles striés et le cartilage cricoïde. Le crico-
pharyngien est un petit muscle d’environ 1 cm de hauteur. Sa
mobilité avec le pharynx (2 cm en hauteur et 1 cm en avant) et
les caractéristiques de sa contraction, brève et de forte amplitude,
imposent des contraintes pour la mesure par des capteurs électro-
niques. Le tonus de repos est géré par le X. Il y a une composante
passive de 8 à 10 mmHg (attention, les normes sont variables
selon la technique et le type de capteur employé). La contrac-
tion est sous la dépendance du X. La relaxation est secondaire à
l’inhibition centrale de l’activité du X. La pression basale du SSO
n’est pas infl uencée par le repas ni par un éventuel refl ux gastro-
œsophagien ; elle est augmentée lors de l’inspiration, du stress,
d’une distension de l’œsophage, d’une stimulation pharyngée ;
elle est diminuée lors de l’expiration, du sommeil, de l’anesthésie.
L’amplitude de l’ouverture du SSO est fonction de la relaxation
musculaire, mais aussi du mouvement antérieur du larynx, du
volume du bolus alimentaire et de l’élasticité musculaire.
L’exploration du SSO se fait essentiellement par vidéoradiogra-
phie, à ne pas confondre avec le transit pharyngo-œsophagien.
Elle permet de visualiser l’ensemble des phases orale, pharyngée
et œsophagienne de la déglutition, de vérifi er la clairance du
pharynx et l’existence ou non d’une inhalation, ainsi que le
diamètre du SSO. Cet examen n’est malheureusement pas acces-
sible partout. La vidéonasofi broscopie a l’avantage de pouvoir se
faire au lit et de ne pas être irradiante. Cependant, elle ne voit pas
directement le SSO, mais seulement ce qui se passe au-dessus :
stase dans les sinus piriformes, mauvaise clairance de la base de
langue, rumination, etc. Les autres examens (vidéomanométrie,
manométrie haute résolution, électromyographie de la dégluti-
tion) sont essentiellement des outils de recherche, sans intérêt
prouvé pour la prise en charge des patients.
Pathologie du SSO : achalasie, myopathies, myosite
(S. Périé, Paris)
L’achalasie du SSO est une atteinte musculaire isolée. Elle est
due à une involution du muscle cricopharyngien liée au vieillis-
sement et apparaît vers l’âge de 80-90 ans. Elle se manifeste par
des blocages aux solides, avec de nombreux eff orts pour déglutir,
et, dans un deuxième temps, par l’apparition de fausses routes et
d’un amaigrissement. La fi broscopie permet de s’assurer de l’ab-
sence d’obstacle tumoral au niveau du pharynx ou de l’œsophage
et de voir des signes indirects de l’achalasie, essentiellement une
stase hypopharyngée. La manométrie met en évidence un défaut
de relaxation du SSO. Le radiocinéma montre une ouverture
incomplète, suivie d’une fermeture précoce du SSO, d’un pharynx
de lutte et des fausses routes secondaires. Le traitement de choix
est la myotomie extramuqueuse du SSO.

Actualité
Actualité
14
La Lettre d’ORL et de chirurgie cervico-faciale - n° 311 - octobre-décembre 2007
Les dystrophies musculaires, comme la dystrophie musculaire
oculopharyngée, et les myosites par atteinte des muscles striés
du pharynx, du larynx et de l’œsophage cervical se traduisent par
un défaut de propulsion linguale et pharyngée en plus du défaut
d’ouverture du SSO. La dystrophie musculaire oculopharyngée
est de transmission autosomique dominante (chromosome 14)
à expressivité variable. Elle se manifeste vers 50-60 ans par un
ptosis, une dysphagie, sans atteinte laryngée. Le traitement
repose actuellement sur la myotomie extramuqueuse du crico-
pharyngien dont les résultats sont transitoires : l’avenir sera
peut-être dans la greff e de myoblastes.
Les myopathies mitochondriales comportent une atteinte oculaire,
des troubles de la déglutition, accompagnés d’une fatigue, de
douleurs en fi n de repas et d’une dysphonie.
Les dermatopolymyosites comportent une atteinte de la muscu-
lature lisse et striée.
Les myosites à inclusions sont souvent associées à une atteinte du
SSO. La myotomie du cricopharyngien peut être bénéfi que, car le
SSO constitue un obstacle majeur ou relatif à la déglutition.
Dysfonctions du SSO dans les maladies
neurovasculaires et dégénératives
(B. Guerrier, Montpellier)
Dans les syndromes extrapyramidaux et la maladie de Parkinson,
les troubles digestifs sont rarement révélateurs, l’ORL est sollicité
pour éliminer une pathologie associée.
Dans les maladies neurovasculaires, tels les accidents vascu-
laires cérébraux ou le syndrome pseudobulbaire, l’atteinte du
SSO est rarement isolée et ses troubles sont rarement révé-
lateurs. Le bilan ORL a pour but de juger des possibilités
thérapeutiques.
Le traitement comporte un volet diététique (choix des aliments
[texture, goût], apport calorique), un volet de rééducation par
une orthophoniste et la kinésithérapie bronchique. Le traitement
chirurgical peut comporter des injections de toxine botulique
ou une myotomie du cricopharyngien. La gastrostomie est le
traitement palliatif.
Myotomie extramuqueuse
du cricopharyngien ou du SSO (G. Le Clech, Rennes)
Cette intervention a été décrite par Kaplan en 1951. Elle a
pour but d’améliorer la dysphagie et de diminuer les fausses
routes. Elle se pratique sous anesthésie générale par cervico-
tomie latérale gauche, avec section de l’omo-hyoïdien puis des
veines thyroïdiennes moyennes, rotation du larynx permet-
tant l’abord de la partie postérieure du sphincter en préservant
les récurrents. Le muscle est sectionné sur 4 cm de hauteur,
on peut y associer un prélèvement musculaire pour examen
anatomopathologique.
La myotomie transmuqueuse se pratique par voie endoscopique
avec diverses techniques (diathermie, électrocoagulation, laser
CO2 ou KTP, agrafage). Le risque est dans l’immédiat l’emphysème
sous-cutané et, à distance, la récidive de la symptomatologie.
À noter que le refl ux gastro-œsophagien ne contre-indique pas
ces interventions.
Diverticules de Zenker
(J. Lacau Saint Guily, E. Reyt, Grenoble)
Quelle que soit la technique envisagée, le traitement du diverti-
cule de Zenker commence par une vidange du diverticule, par la
mise en place d’un packing dans le diverticule pour le matéria-
liser, et par la mise en place d’une sonde nasogastrique ou d’une
sonde d’intubation dans l’œsophage. Le diverticule peut être
traité par voie endoscopique, ou par voie cervicale, en général
avec exérèse de la poche, mais certains auteurs font une diver-
ticulopexie associée à une myotomie du cricopharyngien.
Le Pr J. Lacau Saint Guily a fait part de l’expérience de l’équipe
ORL de l’hôpital Tenon dans le traitement du diverticule de
Zenker. En 18 mois, 35 patients ont été traités (ce qui montre
indirectement la très grande fréquence de cette pathologie). La
moyenne d’âge était de 78 ans, avec des extrêmes de 51 et 94 ans.
Le signe le plus évocateur en fi broscopie est le signe de la marée
qui correspond à la remontée de la crème du diverticule vers le
pharynx. Le traitement a été fait par voie endoscopique dans
28 cas et par voie cervicale dans 7 cas, parce que l’exposition
du collet du diverticule était impossible du fait d’une arthrose
cervicale ou de la brièveté du cou. Les patients n’ont pas de sonde
en postopératoire et ont repris leur alimentation à J1 ou J2, sous
couvert d’une antibiothérapie per- et postopératoire. Il n’y a eu
qu’une complication : une fi stule médiastinale qui a été reprise
chirurgicalement avec succès.
Sténoses œsophagiennes hautes précoces et tardives
postradiochimiothérapiques (P. Marandas, Villejuif)
La radiothérapie du cavum, de l’oro- ou de l’hypopharynx n’en-
traîne pas de troubles de déglutition précoce ni tardif, autres que
ceux dus à l’hyposialie, lorsque la radiothérapie est isolée. Il en est
tout autrement de l’association radiothérapie et chimiothérapie
qui provoque une sténose de la partie haute de l’œsophage et du
pharynx dans 5 à 20 % des cas. Pour diminuer ces complications,
les radiothérapeutes proposent d’autres schémas d’irradiation
que les schémas classiques qui permettraient, par exemple, en
cas d’irradiation pour un cancer du cavum de réduire de 67 Gy
à 26 Gy l’irradiation au niveau de la bouche œsophagienne.
En cas de sténose constituée, le traitement commence par des
dilatations, avec ou sans application de mitomycine. Dans les
formes plus graves on peut proposer la pose de stents. Enfi n,
le dernier recours est la greff e de jéjunum, très diffi cile sur ces
tissus irradiés.
Table ronde d’otologie sur le thème de la prothèse audi-
tive, sous l’égide de l’Association française d’otologie et
oto-neurologie, présidée par le Pr. A Robier (Tours).
Prescription et aspects de l’examen otologique
(C. Dubreuil, Lyon)
Avant de prescrire une prothèse, il faut faire des tests audio-
métriques, mais aussi un examen otologique. En eff et, une
sténose du conduit auditif externe est source de diffi cultés

Actualité
Actualité
15
La Lettre d’ORL et de chirurgie cervico-faciale - n° 311 - octobre-décembre 2007
d’appareillage et d’adaptation d’un embout, d’où du Larsen
fort gênant pour le patient (et l’entourage), mais aussi des
bouchons de cérumen répétés. Un isthme rétréci empêche
la bonne contention de l’embout. Des mouvements impor-
tants du conduit cartilagineux vont faire préférer des embouts
souples ou un open fi t. Les ostéomes et une sténose acquise
posent des problèmes de stabilité de l’embout. Les poussées
d’otorrhée empêchent le port de la prothèse, car l’otorrhée
obstrue le microphone, le microtube ou l’embout. On peut
alors proposer un embout ouvert, si la surdité le permet, un
tube fl exible, et s’il faut un embout fermé, des évents larges.
L’allergie cutanée aux composants des embouts et les poussées
d’eczéma doivent faire envisager un implant d’oreille moyenne.
Après intervention sur une oreille, l’embout doit être réadapté.
Les cavités d’évidement sont très diffi ciles à appareiller, il faut
parfois proposer une prothèse à ancrage osseux (BAHA) ou
une prothèse d’oreille moyenne.
Prescription et aspects audiologiques
(O. Sterkers, Clichy)
En théorie, n’importe quel docteur en médecine peut prescrire
une prothèse. En pratique, il faut au minimum un examen otolo-
gique et des tests en cabine audiométrique, tonaux et vocaux,
éventuellement complétés par un test dans le bruit.
Le rôle de l’ORL est de vérifi er qu’il n’y a pas de facteur limi-
tant l’amplifi cation : capacités résiduelles de la transduction,
état des voies auditives, intégration centrale. L’audiogramme
tonal et vocal, l’impédancemétrie avec recherche des réfl exes
stapédiens précisent le diagnostic, l’importance et le type de
surdité et peuvent éventuellement faire poser l’indication d’un
enregistrement de potentiels évoqués auditifs ou d’une imagerie.
Avant de prescrire un renouvellement, il est fondamental d’éva-
luer l’intelligibilité dans le bruit, par l’examen audiométrique
vocal en champ libre avec les prothèses.
Les indications de l’appareillage sont classiquement un seuil
supérieur à 30 dB sur les fréquences 2 et 4 kHz. En pratique, il
faut apprécier le retentissement socioprofessionnel et défi nir ce
que veut le patient, ainsi que le bénéfi ce potentiel des prothèses. Il
faut se méfi er de l’eff et masquant des acouphènes. Les alternatives
aux prothèses conventionnelles sont l’implant d’oreille moyenne et
l’implant électroacoustique, dans certaines surdités de perception.
Pour les surdités asymétriques, il faut se méfi er des acouphènes,
prévoir peut-être un transfert vers l’oreille la moins atteinte par
système cross ou BAHA. Il faut aussi proposer une rééducation
orthophonique en cas de défi cience des suppléances centrales.
La consultation de suivi doit faire préciser le bénéfi ce audio-
prothétique, vérifi er si l’atteinte auditive n’est pas évolutive,
une altération rapide de l’audition devant faire craindre une
pathologie associée. Si la surdité devient trop importante, il
faut envisager une implantation cochléaire.
De la prescription à l’essai prothétique (C. Vincent, Lille)
À la diff érence de l’ORL qui pratique essentiellement des tests
liminaires, l’audioprothésiste fait passer des tests supralimi-
naires permettant entre autres de défi nir un seuil de confort
et un seuil d’inconfort, d’apprécier la dynamique résiduelle de
l’audition. Les essais sont variables d’un prothésiste à l’autre,
certains ne les proposent pas d’emblée, les autres font faire un
essai pendant 15 jours à 1 mois. Le problème est que ces essais
ne sont pas cotés à la CCAM. Il serait souhaitable aussi qu’il y
ait une normalisation du compte-rendu de l’essai prothétique
et des tests eff ectués.
Spécifi cités de l’appareillage de l’enfant
(E.N. Garabédian, Paris)
La précocité de l’appareillage est fondamentale chez l’enfant, car
l’audition est nécessaire à la maturation des voies auditives, à l’acqui-
sition du langage, à la constitution de la boucle audiophonatoire.
À la naissance, un enfant sur mille a une surdité de perception
bilatérale sévère ou profonde. Mais un quart des surdités s’ag-
gravent, et à 4 ans, environ 2 enfants sur mille ont une surdité
sévère ou profonde.
Le gain est augmenté progressivement et il faut un port régulier
le plus tôt possible. Le pronostic n’est pas seulement fonction de
l’audition, mais surtout des troubles associés moteurs, sensoriels,
intellectuels, et de l’existence ou non d’une dysphasie. Il faut un
minimum de 6 mois de port de prothèses avant d’envisager un
implant cochléaire.
État actuel de l’appareillage prothétique :
évolutions récentes
(E. Bizaguet, Paris)
L’appareillage est proposé de plus en plus tôt, chez l’enfant grâce
au dépistage, chez l’adulte, grâce aux campagnes d’information.
Il est proposé pour des surdités moins importantes, avec une
exigence plus grande de la part des patients.
La gêne occasionnée par le port d’un appareil a été réduite
grâce à de nouvelles techniques : le nombre de canaux est
passé de 1 à 16 puis à 20, les informations sont traitées plus
rapidement en parallèle et non en série, il y a une reconnais-
sance de forme, un renforcement des traits pertinents, une
diminution du bruit ambiant, des microphones directionnels
adaptatifs, des liaisons Wifi multimédia (pour le téléphone,
la radio, etc.). Si les graves sont encore bons et les aigus pas
trop altérés, le prothésiste peut proposer un open fi t, avec des
écouteurs déportés ou pas, qui donne un meilleur confort et
supprime le Larsen.
L’audioprothésiste dans l’équipe
de prise en charge du patient appareillé
(B. Roy)
Chez l’enfant, les BAHA et les implants d’oreille moyenne ou
cochléaires résultent de décisions multidisciplinaires. Chez l’en-
fant comme chez l’adulte, le rôle de l’entourage est très important
pour une utilisation optimale des prothèses.
Le médecin prescripteur doit transmettre le maximum d’infor-
mations à l’audioprothésiste et, réciproquement, le prothésiste
doit faire un compte-rendu d’appareillage à l’ORL et un autre
au médecin traitant du patient. Il serait souhaitable d’avoir des
outils pour mesurer la satisfaction des patients. ■
1
/
4
100%