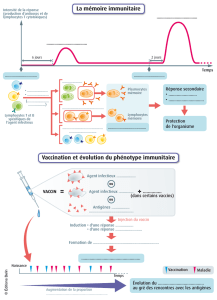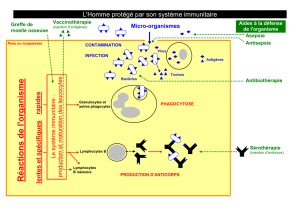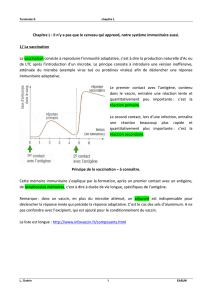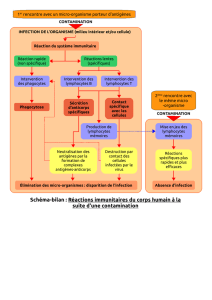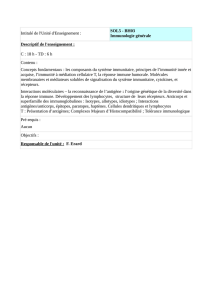Applications de la vaccination en oncologie hématologique

Correspondances en Onco-Hématologie - Vol. VII - n° 2 - avril-mai-juin 2012
67
Immunologie
et onco-hématologie
dossier thématique
Applications de la vaccination
en oncologie hématologique
Vaccination in onco-hematology: from bench to bedside
É. Daguindau*, C. Vauchy**, Y. Godet**, C. Ferrand**, O. Adotevi***, C. Borg***
RÉSUMÉ
Summary
»
Depuis 1796 et les premiers travaux d’Edward Jenner sur la
variolisation, le développement de stratégies de vaccination
fait toujours face à des enjeux scientifiques importants,
notamment dans le domaine de l’onco-hématologie. Ainsi, les
avancées réalisées parallèlement en immunologie et dans la
compréhension des mécanismes d’oncogenèse en hématologie
ont ouvert la voie à la promotion de programmes de recherche
dédiés au ciblage immunologique des antigènes de tumeur. Par
ailleurs, l’espoir né de l’efficacité clinique du transfert adoptif de
lymphocytes du donneur après allogreffe dans les leucémies
myéloïdes chroniques en rechute a largement encouragé
l’effort de recherche dans le domaine de l’immunothérapie et,
en particulier, le développement de procédés de vaccination.
»
Après avoir rappelé de façon synthétique les bases
immunologiques de la vaccination, nous présenterons les
principaux résultats qui soutiennent le développement de cette
stratégie d’immunothérapie spécifique dans les hémopathies
malignes.
Mots-clés : Vaccination – Immunothérapie active – Cross-
présentation – Antigène tumoral.
Since the initial work of Edward Jenner about variolation in
1796, the development of vaccination strategies still confronts
significant scientific challenges, particularly in the field of
oncology and hematology. Parallel advances in immunology
and in the knowledge of oncogenesis in hematology, paved
the way for the promotion of research dedicated to targeting
immunologically tumor antigens. Moreover, the clinical
efficacy of the adoptive transfer of donor lymphocytes after
allogeneic transplantation for chronic myeloid leukemia
in relapse has greatly encouraged research efforts in the
field of immunotherapy, notably for the development of
vaccination. After summarizing the immunological basis of
vaccination, we present here the major results which support
the development of this strategy of specific immunotherapy
in hematologic malignancies.
Keywords: Vaccination – Active immunotherapy – Cross-
presentation – Tumoral antigene.
S
i le procédé de vaccination contre la variole a été
salvateur en termes de santé publique au début
du XXe siècle, sa mise en œuvre a également
été une étape fondamentale dans l’appréhension des
capacités adaptatives du système immunitaire.
Ensuite, la documentation d’une réponse naturelle cyto-
toxique T reconnaissant des antigènes tumoraux bien
caractérisés a justifié le développement des approches
de vaccination antitumorale. La mise en évidence de
lymphocytes T antitumoraux dans les rares observations
de régressions spontanées de tumeurs chez l’homme, et
aussi le bon pronostic généralement associé aux tumeurs
où il existe une infiltration par des lymphocytes T, ont
renforcé l’intérêt porté à la vaccination antitumorale (1).
Si c’est bien dans le cadre des mélanomes que le rôle
positif des lymphocytes T a été validé lors de nombreux
protocoles d’immunothérapie adoptive (2, 3) où des
lymphocytes T autologues de patients, activés et ampli-
fiés in vitro, étaient réadministrés in vivo, l’hématolo-
gie n’est pas en reste, puisque, à travers l’allogreffe de
cellules hématopoïétiques, l’efficacité du transfert de
lymphocytes T antitumoraux a été largement démontrée.
L’effort développé par les immunothérapeutes dans les
approches de vaccination vise donc à définir les meil-
leurs antigènes tumoraux, puis à optimiser la réponse
autologue spécifique vis-à-vis de ces antigènes.
Malgré plus de 20 années de recherche, un seul vaccin
antitumoral est aujourd’hui commercialisé dans le
monde après avoir démontré un intérêt dans des essais
de phase III : le sipuleucel-T, destiné aux patients atteints
d’un cancer de la prostate résistant aux androgènes et
non métastatique.
*Service d’hématologie,
CHU de Besançon.
** UMR Inserm 1098,
thérapeutiques immuno-
logiques des cancers,
CHU de Besançon.
*** Service d’oncologie,
CHU de Besançon.

Correspondances en Onco-Hématologie - Vol. VII - n° 2 - avril-mai-juin 2012
68
Immunologie
et onco-hématologie
dossier thématique
Dans cet article, les fondements de l’immunothérapie
vaccinale seront passés en revue, puis il sera montré que
l’effort de recherche dans ce domaine, en hématologie,
est largement développé et laisse entrevoir d’authen-
tiques espoirs thérapeutiques.
Bases immunologiques de la vaccination
Définitions et concepts immunologiques
de la vaccination
L’immunité adaptative (ou acquise) complète le système
de défense de l’immunité naturelle par la reconnais-
sance spécifique d’antigènes (ou épitopes) apparte-
nant au domaine du non-soi. Cette réponse spécifique
met en jeu des récepteurs hautement diversifiés et qui
jouent un rôle central dans les actions effectrices des
lymphocytes B et T.
Le principe de la vaccination est de manipuler la
réponse immune adaptative pour l’orienter contre un
antigène donné afin de générer une réponse mémoire
susceptible d’être rapidement réactivée et efficace
en cas de nouveau contact avec l’antigène. Dans le
développement historique de la vaccination, l’objectif
était l’éradication de maladies infectieuses : l’antigène
choisi était donc issu d’un agent infectieux. Dans une
approche de vaccination en oncologie, l’antigène peut
également être issu de cellules tumorales.
La génération de lymphocytes T mémoires après vacci-
nation commence dans les organes lymphoïdes secon-
daires où les lymphocytes T naïfs résident. Lors de la
survenue d’une infection intracellulaire (par analogie
à une cellule subissant une transformation tumorale),
la genèse d’une réponse immunitaire lymphocytaire
cytotoxique efficace (lymphocytes T CD8) repose en
amont sur un processus de capture et d’apprêtement
des antigènes sur le site pathologique. Lors de cette
étape, les cellules présentatrices d’antigène (CPA)
intègrent le matériel cellulaire contenant les antigènes
(corps apoptotiques par exemple) et les transforment
en peptides capables d’être présentés par les molé-
cules du complexe majeur d’histocompatibilité (CMH)
de classe I (CMH I, pour les lymphocytes T CD8) ou de
classe II (CMH II, pour les lymphocytes T CD4). Les CPA
exercent également une fonction de reconnaissance
des signaux de danger qui surviennent dans le microen-
vironnement dans lequel les antigènes sont délivrés.
En l’absence de ces signaux de danger, les réponses
immunitaires peuvent rester inertes ou aboutir à une
tolérance vis-à-vis des antigènes. Ces signaux de danger
peuvent dériver directement des agents pathogènes
(ADN ou ARN viral reconnus par les récepteurs TLR 3
ou 9, par exemple) ou résulter de la lyse des cellules
pathologiques ou de l’activation du système immuni-
taire inné (interféron α ou γ). La réception de ces signaux
de danger par les CPA aboutit à l’expression de molé-
cules de costimulation (CD80, CD86) membranaires
qui seront ultérieurement présentées avec les peptides
antigéniques aux lymphocytes T. Les signaux de dan-
ger induisent également la migration des CPA dans les
organes lymphoïdes secondaires et la production de
cytokines, comme l’IL-12, qui contribuent à la spécifi-
cation des fonctions effectrices des lymphocytes et à
une polarisation Th1 (réponse immune cytotoxique)
[figure 1].
Dans le contexte des approches de vaccination, les
signaux de danger sont reconstitués artificiellement
par l’association des antigènes à des adjuvants capables
d’activer les CPA.
Après interaction avec les CPA complètement activées,
les lymphocytes T s’engagent d’abord dans une phase
d’expansion clonale et expriment alors des fonctions
effectrices (cytotoxicité ou production de cytokines).
Dans un deuxième temps, ces lymphocytes entrent
dans une phase de contraction où les cellules effectrices
terminales subissent un processus d’apoptose et où
seuls les effecteurs mémoires survivent.
Au final, seule une faible proportion de cellules en
expansion après stimulation antigénique survit en
cellules mémoires (4). Des modèles murins ont montré
Figure 1. Initiation des réponses immunitaires.
DC mature
DC mature
CMH classe I
TCR
TCR
CD8
CD4
CD28
CD44L
CD40 CMH classe II
LT CD8
CD80
ou CD86
IL-12
IL-18
IFN-γ
OX40 OX40L
Ly.Th1
Immunité cellulaire
Une majorité devient :
lymphocyte T effecteur
(courte durée de vie)
Certaines cellules activées et/ou effectrices
deviennent :
lymphocyte T mémoire
(survie assurée notamment
par les cytokines)

Correspondances en Onco-Hématologie - Vol. VII - n° 2 - avril-mai-juin 2012
69
Applications de la vaccination en oncologie hématologique
que le ratio entre les cellules effectrices et les cellules
“précurseurs mémoires” est sous la dépendance de
facteurs de transcription tels que T-bet et Eomes notam-
ment (5, 6). Ces facteurs de transcription sont activés
par l’intensité de la stimulation antigénique, certaines
cytokines et la voie de signalisation Wnt (7). Les IL-10 et
15 comptent également parmi les cytokines influençant
la qualité des lymphocytes T CD8 mémoires.
Alors que les cellules mémoires T CD8 quiescentes réac-
tivent leurs fonctions cytotoxiques lors d’une stimula-
tion antigénique, les plasmocytes à longue durée de
vie sécrètent continuellement un taux constant d’anti-
corps. Une équipe allemande a récemment identifié
l’existence d’une population sessile de lymphocytes T
CD4+ mémoires occupant une niche spécifique dans
l’os, à l’image des plasmocytes résidant dans la niche
hématopoïétique (8).
Plusieurs travaux ont démontré que les stimulations
répétées (boost) généraient des réponses immunitaires
dites secondaire, tertiaire, etc., et étaient capables
d’orienter les lymphocytes T mémoires vers une dif-
férenciation que l’on appelle terminale. Les réponses
immunitaires secondaires et les réponses suivantes
sont caractérisées par des lymphocytes exprimant une
affinité de plus en plus importante pour l’antigène.
Les lymphocytes T CD8+ mémoires ont des fonctions
cytotoxiques plus importantes que les lymphocytes T
CD8 issus de la sensibilisation et sont le plus souvent
localisés en dehors des organes lymphoïdes secon-
daires, notamment à cause de la perte d’expression
des sélectines (9, 10). Ces données permettent de com-
prendre les principes de sensibilisation puis de rappel
dans les approches de vaccination anti-infectieuse.
Pour déterminer le meilleur délai pour le rappel vacci-
nal, il est nécessaire de considérer les voies (et délais)
de différenciation des lymphocytes B et T. Ainsi, les
lymphocytes T ayant un fort potentiel prolifératif ne se
forment que 2 à 3 mois après la sensibilisation (figure 2).
L’objectif des rappels de vaccination est donc d’amélio-
rer la réponse T spécifique, voire de la délocaliser vers
les muqueuses pour une lutte anti-infectieuse plus
précoce. Cependant, ces boosts peuvent ne recruter
qu’une partie des lymphocytes T mémoires déjà géné-
rés, aboutissant ainsi à une population de lympho-
cytes T mémoires hétérogène à différents niveaux de
différenciation (figure 2). Les piliers d’un processus de
vaccination sont donc :
✓
un antigène capable de générer une réponse T et/ ou
B spécifique et affine ;
✓
un moyen d’expression de cet antigène dans l’or-
ganisme (vecteur d’expression antigénique) pour
la phase de sensibilisation de la réponse adaptative.
Une multitude de vecteurs d’expression antigénique
(ADN, bactérie, virus inactivé, etc.) ont été développés
ces 20 dernières années, dans la perspective de la vac-
cination anti-infectieuse (11). Concernant la vaccination
Cellule naïve Cellules effectrices Cellules mémoires
avec potentiel de réplication ++
Stimulation
antigénique + Disparition de l’antigène
Développement
des cellules effectrices
Apoptose des effecteurs terminaux
Différenciation des lymphocytes T mémoires
Potentiel réplicatif des effecteurs T
Au moins 2 mois
Temps
Figure 2. Cinétique des réponses immunitaires mémoires.
Mémoire
Mémoire
Mémoire
Mémoire
Naïve
Mémoire
Mémoire
Mémoire
Mémoire
Naïve
Plus large hétérogénéité
Cellule T naïve
LTm après 1re stimulation
LTm après 2e stimulation
LTm après 3e stimulation
LTm après 4e stimulation
Immunisation
1re 2e3e4e
LT
mémoire LT
mémoire LT
mémoire LT
mémoire
Potentiel prolifératif
Fonctions effectrices
A.
B. C.

Correspondances en Onco-Hématologie - Vol. VII - n° 2 - avril-mai-juin 2012
70
Immunologie
et onco-hématologie
dossier thématique
antitumorale, le choix de l’antigène vaccinal et de son
vecteur d’expression est large et conditionne l’efficacité
d’une telle méthode d’immunothérapie active.
La cross-présentation : processus inducteur
d’une immunité cytotoxique
Les molécules du CMH de classe I présentent habituel-
lement des peptides issus des protéines endogènes ou
d’un agent pathogène intracellulaire. Ces protéines sont
dégradées en peptides sous l’action du protéasome.
Ces peptides sont ensuite transportés par les molécules
TAP (Transporter of Antigen-Processing) dans le réticulum
endoplasmique pour être chargés sur les molécules du
CMH I. Les cellules dendritiques ont la possibilité de
réaliser l’endocytose d’antigènes exogènes pour pré-
senter ces antigènes aux CD8+ cytotoxiques. Ce procédé
s’appelle la cross-présentation (13, 14), il est représenté
dans la figure 3.
La cross-présentation a d’abord été découverte en raison
de son rôle dans l’immunisation cellulaire T contre des
antigènes mineurs d’histocompatibilité exprimés dans
des cellules allogéniques (15). Depuis, le phénomène de
cross-présentation a été mis en évidence pour d’autres
antigènes, comme des antigènes viraux, mais aussi des
antigènes tumoraux. Une démonstration élégante de
l’induction d’une immunité cellulaire spécifique via la
cross-présentation a été donnée par l’équipe de L.J. Sigal
et al. (16). Ces auteurs ont utilisé des souris ne pouvant
contracter la poliomyélite du fait de l’absence constitu-
tionnelle d’une protéine de liaison au virus indispensable
pour l’infection. Chez ces souris transgéniques, l’émer-
gence de lymphocytes T cytotoxiques (CTL) spécifiques
du peptide de poliovirus n’est possible qu’en présence
de CPA compétentes et initialement non infectées. La
cross-présentation est donc le mécanisme obligatoire
pour initier la réponse T CD8 contre un virus n’infectant
que les cellules mésenchymateuses.
Ainsi, la génération de CTL antitumoraux peut résulter
de la reconnaissance directe de l’antigène sur les cellules
tumorales, ou de la cross-présentation des antigènes
tumoraux par une CPA (17-19). Parmi les arguments forts
en faveur de la cross-présentation, il y a la démonstration
que la chimiothérapie systémique, en provoquant la lyse/
apoptose tumorale, permet aux CPA d’intégrer des anti-
gènes tumoraux protéiques qui sont ensuite présentés
via le processus de cross-présentation pour l’induction
d’une réponse T CD8 cytotoxique spécifique (19-21).
Le vaccin dans l’histoire
L’infection est la principale cause de décès chez l’homme.
Ainsi, les contributions les plus importantes apportées à
la santé publique durant le dernier siècle ont été l’amélio-
ration des conditions d’hygiène et la vaccination. Au-delà
du succès des expériences pionnières d’E. Jenner et de
Figure 3. Différents modes de présentation de l’antigène via le CMH de classes I et II (12).
Peptides
antigéniques
Agent pathogène
Transporteur
de peptide
Membrane
plasmatique
CMH I-peptide
CMH I-peptide
CMH classe I
CMH II-peptide
CD8
CD4
Endocytose
des peptides exogènes
Déviation
des antigènes
exogènes
Endosome
Peptides
antigéniques
CMH II-CLIP
CMH II-li
CMH II-li
Réticulum
endoplasmique
CMH I
Compartiment
d’endocytose
Golgi
Antigènes cytosoliques
Protéasome
a
c
b

Correspondances en Onco-Hématologie - Vol. VII - n° 2 - avril-mai-juin 2012
71
Applications de la vaccination en oncologie hématologique
Pasteur sur l’éradication de la variole et du choléra du
poulet, la découverte de la vaccination par ces hommes
est à la base des concepts de l’immunologie moderne.
Il est possible d’induire de plusieurs façons une immu-
nité adaptative envers un agent infectieux donné. La
première stratégie a été de provoquer délibérément
une infection bénigne avec le pathogène non modifié.
C’est sur ce principe qu’était fondée la variolisation,
dans laquelle l’inoculation d’une faible quantité de
matière séchée provenant d’une pustule variolique
causait une infection modérée suivie d’une protec-
tion durable contre toute réinfection. Cependant, la
variolisation peut être suivie d’une infection grave, une
variole fatale survenant dans 3 % des cas. E. Jenner a
été à l’origine d’un progrès considérable en montrant
qu’une infection avec un analogue bovin de la variole
(la vaccine : variole bovine) procurait une immunité
protectrice contre la variole humaine sans faire courir
le risque d’une maladie grave (22).
Les premières expériences du x
i
x
e
siècle ont permis
d’établir les principes généraux d’une vaccination sûre
et efficace. Le développement des vaccins au début
du xxe siècle a ensuite suivi 2 voies empiriques : la pre-
mière a été la recherche d’organismes atténués ayant
un pouvoir pathogène réduit pour stimuler l’immu-
nité adaptative ; la seconde a été le développement de
vaccins fondés sur des organismes tués, puis sur des
composants purifiés issus de ces pathogènes. Cette
seconde voie est particulièrement séduisante pour les
patients immunodéprimés, chez qui l’injection d’un
vaccin vivant peut causer une infection mortelle.
Le BCG comme adjuvant de l’immunothérapie
antitumorale
En 1904, Mycobacterium bovis est isolé chez une vache
atteinte de tuberculose mammaire. Dès 1908, Calmette
et Guérin cultivent, à l’institut Pasteur de Lille, cette bac-
térie afin d’obtenir des cultures homogènes avec une
meilleure dispersion des bacilles. Après 231 passages
pendant 13 ans, Calmette et Guérin observent, à la fin
de la Première Guerre mondiale, que cette mycobactérie
a perdu sa virulence pour devenir une mycobactérie
“atténuée”. Le bacille de Calmette-Guérin était né. C’est
en 1921 que, pour la première fois, un enfant est vacciné
contre la tuberculose au moyen de cette mycobactérie
atténuée. À cette époque, cette souche bactérienne ne
pouvait être utilisée qu’à partir de cultures fraîches de
mycobactéries. C’est pourquoi différentes souches ont
été développées à partir de la souche française et distri-
buées à travers le monde. Les conditions de culture et la
propagation des souches à travers le monde expliquent
la dérive génétique des différents “BCG”. Sous la directive
de l’OMS, afin de limiter la dérive des souches, les prépa-
rations de bacilles sont actuellement lyophilisées à partir
de stocks issus de la souche mère. Par ailleurs, il a été
clairement démontré que seuls les bacilles vivants ont la
possibilité d’induire une réponse immune antitumorale.
L’effet antitumoral lié aux mycobactéries a été observé
pour la première fois par Pearl en 1929, qui, lors de
l’analyse d’une série nécropsique, notait que les patients
atteints de tuberculose développaient moins de
tumeurs malignes que la population générale. En 1953,
un chirurgien américain, après avoir constaté la régres-
sion d’un lymphosarcome chez un patient atteint d’un
érysipèle, introduit l’utilisation d’extraits bactériens
comme traitement adjuvant des tumeurs (23). En 1966,
J.E. Coe et al. démontrent que la vessie peut être le
site de réactions d’hypersensibilité retardées au même
titre que la peau (24). Et, en 1969, G. Mathé utilise pour
la première fois le BCG en thérapeutique humaine
antitumorale dans le cadre de leucémies aiguës (25).
Dans l’expérience de G. Mathé, 30 patients souffrant
d’une leucémie aiguë lymphoblastique (LAL) ont reçu
une chimiothérapie d’induction, puis 20 patients ont
bénéficié, dès la rémission clinique et hématologique
atteinte, d’une injection de BCG avec ou sans cellules
leucémiques irradiées. La figure 4 illustre la durée de la
Figure 4. Immunothérapie active par injection de BCG
dans les LAL. Le BCG est injecté chez des patients en rémis-
sion après la phase d’induction. Dans le groupe “témoins”,
le BCG est injecté seul, dans le groupe “immunothérapie”,
le BCG est injecté avec des cellules leucémiques irradiées
(D’après G. Mathé et al., Lancet 1969).
100
80
60
40
20
0
15
30
60
120
240
480
960
1 150
Jours après chimiothérapie
Témoins
(n = 10)
Immunothérapie
(n = 20)
Rémission (%)
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
1
/
13
100%