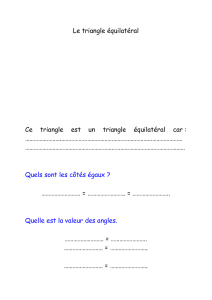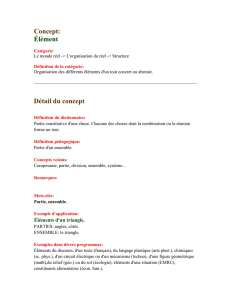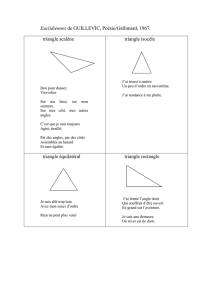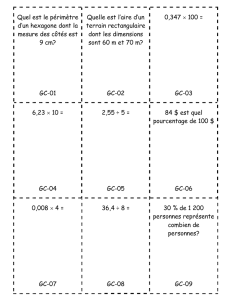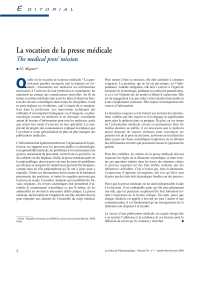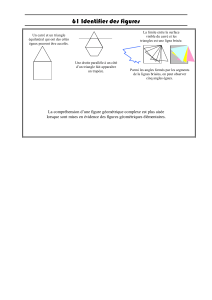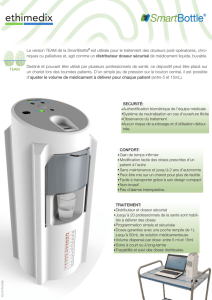L’ Méthodologie et optimisation des études cliniques chez l’enfant

6 | La Lettre du Pharmacologue • Vol. 27 - n° 1 - janvier-février-mars 2013
DOSSIER THÉMATIQUE
Pharmacopédiatrie
Méthodologie et optimisation
des études cliniques
chez l’enfant
Methodology and optimization of clinical studies
in children
G. Pons*, S. Chhun*, C. Chiron*
* Université Paris-Descartes, UMR,
Inserm 663, hôpital Necker-Enfants
Malades, Paris.
L’utilisation des médicaments chez l’enfant
est caractérisée par l’insuffisance de leur
évaluation en termes de recherche de
dose, d’efficacité et de sécurité, ainsi que par
le manque de formes galéniques adaptées. La
conséquence en est le grand nombre de pres-
criptions hors autorisation de mise sur le mar-
ché (AMM), dont le nombre estimé, d’après
différentes études européennes, s’élève à 90 %
des prescriptions faites pour les nouveau-nés en
unités de soins intensifs.
Le constat de cette situation a amené la Commis-
sion européenne à élaborer un règlement pédia-
trique
1
(1). Publié en décembre 2006, il a pour
but de faciliter l’évaluation des médicaments chez
l’enfant afin de remédier à cette situation, notam-
ment en obligeant les industriels qui demandent
une AMM pour un nouveau médicament à fournir
un plan d’investigation pédiatrique qui devra être
validé par le comité pédiatrique des médicaments
de l’Agence européenne des médicaments. Il en
est de même lorsqu’ils soumettent une demande
d’AMM dans une nouvelle indication ou pour une
nouvelle forme galénique d’un produit déjà sur
le marché. Pour les médicaments qui sont déjà
sur le marché mais qui ne bénéficient plus d’au-
cune protection industrielle et sont donc dans le
domaine public, le règlement prévoit des mesures
incitatives pour que soient soumis des plans d’in-
vestigations pédiatriques ayant pour but d’aboutir
à une autorisation spécifiquement pédiatrique
de mise sur le marché (PUMA [Paediatric Use
Marketing Authorization]). Cela concerne parti-
culièrement les médicaments orphelins et ceux
inscrits sur la liste prioritaire de l’EMA (Priority
List) [2] correspondant aux besoins pédiatriques
officiellement identifiés. Ce règlement encourage
et facilite le développement des médicaments
tout en respectant les règles de l’éthique visant
notamment à éviter les doublons, inutiles, et à ce
que les études cliniques soient le moins invasives
possible pour chaque enfant individuellement,
et pour la population pédiatrique concernée en
général.
Dans cet esprit, une réflexion a été entreprise pour
trouver des moyens permettant de rendre les études
chez l’enfant plus faciles à réaliser, notamment en
essayant de contourner les obstacles de l’invasi-
vité des procédures dans le respect de l’éthique,
à plusieurs niveaux : celui des études pharmaco-
cinétiques, pour lesquelles les études de population,
la modélisation mathématique et l’extrapolation
représentent des méthodes dont l’utilisation
continue actuellement de se développer (3) ; et
celui des études de recherche de dose et des études
comparatives d’efficacité et de sécurité.
1. Le règlement est l’instrument le plus puissant de l’arsenal
législatif de la Commission européenne. Il implique l’appli-
cation immédiate, en l’état, et dans tous les États membres,
de son contenu aussitôt après le vote du Parlement européen.
Ces caractéristiques opposent point par point le règlement à la
directive. Après le vote du Parlement, le contenu d’une direc-
tive (par exemple, la directive sur les essais cliniques) suppose
une adaptation au droit national de chaque État membre. Cela
implique une application différée et avec un contenu différent
dans chacun de ces États, aboutissant à une mosaïque d’appli-
cations aux antipodes de l’harmonisation.

La Lettre du Pharmacologue • Vol. 27 - n° 1 - janvier-février-mars 2013 | 7
Points forts
»Approches méthodologiques innovantes des études cliniques chez l’enfant
»Facilitation de l’évaluation des médicaments chez l’enfant
»Protection accrue des enfants participant à des études cliniques
Mots-clés
Enfants
Études cliniques
Méthodologie
Pédiatrie
Highlights
»
Innovation in method-
ological approaches of clinical
studies in children
»
Facilitation of drug evalua-
tion in children
»
Increased protection of chil-
dren undergoing clinical studies
Keywords
Children
Clinical studies
Methodology
Paediatrics
Études pharmacocinétiques
de population
Une étude pharmacocinétique “classique” ou en
“données riches” consiste à mesurer la concentration
plasmatique du médicament à l’étude à plusieurs
reprises à des instants différents après son admi-
nistration, de manière à décrire avec suffisamment
de précision la courbe des concentrations plasma-
tiques en fonction du temps, pour pouvoir calculer de
manière fiable les paramètres pharmacocinétiques
individuels de chaque patient : l’aire sous la courbe
des concentrations plasmatiques, la demi-vie d’éli-
mination, la clairance plasmatique et le volume de
distribution.
Une étude pharmacocinétique de population sur des
prélèvements épars ne permet pas de calculer ces
paramètres pharmacocinétiques individuels sur ces
seules données. Un nombre limité de prélèvements
est alors recueilli chez chaque patient à des instants
différents. Les données obtenues pour chaque patient
sont regroupées, comme sur un seul graphique, non
plus pour un seul patient, mais pour l’ensemble de
la population. Les paramètres pharmacocinétiques
calculés sont les paramètres moyens pour la popula-
tion. L’essentiel des calculs porte sur l’identification
des paramètres expliquant le plus la variabilité des
paramètres pharmacocinétiques, qui prennent alors
le nom de “covariables” et sont pris en compte dans
le modèle pharmacocinétique. Les résultats ainsi
calculés, obtenus à partir d’un plus grand nombre de
patients, sont davantage représentatifs de la popula-
tion cible. En pédiatrie, l’influence de la maturation
peut être modélisée à partir de connaissances anté-
rieurement acquises sur l’ontogenèse du système
biologique concerné. Le modèle obtenu permet
d’estimer, par extrapolation (simulation), les valeurs
attendues des paramètres pharmacocinétiques chez
des enfants plus jeunes ou plus âgés chez lesquels
aucune donnée n’a été recueillie, ou, par interpola-
tion (simulation), dans des sous-groupes d’âge de
patients non étudiés intercalés entre 2 groupes d’âge
pour lesquels des données ont été recueillies (3).
Cette approche permet d’estimer les paramètres
pharmacocinétiques d’enfants n’ayant eu que peu ou
pas de prélèvements, à partir de données regroupées
provenant d’autres enfants appartenant en moyenne
à la même population, et de leur épargner ainsi une
investigation plus invasive.
Méthodologie innovante pour
les études de recherche de dose
(phase II du développement
du médicament)
Les études de recherche de dose se font habituelle-
ment par comparaison de groupes parallèles avec
une dose différente dans chaque groupe, dont une
dose de placebo. L’importante variabilité interindivi-
duelle nécessite le recrutement d’un grand nombre
de patients, mais cela ne permet pas toujours
d’obtenir une puissance statistique suffisante pour
distinguer les effets de chaque dose, les unes des
autres. Une autre approche a été proposée pour
remplacer cette méthode difficile et frustrante :
l’analyse séquentielle bayésienne (Continuous
Reassessment Method [CRM]). L’objectif n’est plus
de décrire la relation dose-effet en testant l’effet
de doses différentes qui sont comparées les unes
aux autres, mais de rechercher une seule dose qui
permette d'obtenir le niveau d’efficacité choisi, par
exemple la dose efficace 90 assurant une guérison
à 90 % ou chez 90 % des patients. Cinq ou 6 doses
sont habituellement testées. Leur choix est très
important : il doit s’appuyer sur une expérience
empirique antérieure pour que l’on soit sûr que la
dose recherchée se situe bien dans l’intervalle des
doses choisies. À chacune de ces doses sont affectées
a priori, sur la base de ces connaissances antérieures,
des probabilités de succès (tableau). La méthode
est dite séquentielle parce qu’une analyse statis-
tique est faite soit après le recrutement de chaque
patient, soit après chaque recrutement d’un petit
nombre de patients, défini à l’avance. L’analyse
statistique permet de calculer la nouvelle distri-
bution des probabilités de succès en fonction des
doses, cette fois a posteriori, en tenant compte de la
réponse obtenue (succès ou échec) chez ce patient
ou dans ce petit groupe de patients. Cette méthode
est dite bayésienne parce que le calcul statistique de
la distribution des probabilités de succès a posteriori
de l’ensemble des doses s’appuie à chaque étape sur

8 | La Lettre du Pharmacologue • Vol. 27 - n° 1 - janvier-février-mars 2013
Méthodologie et optimisation des études cliniques chez l’enfant
DOSSIER THÉMATIQUE
Pharmacopédiatrie
les résultats recueillis chez l’ensemble des patients
qui ont été recrutés depuis le début de l’étude. La
dose administrée au patient suivant entrant dans
l’étude est celle qui, dans la nouvelle distribution
des probabilités calculées, a la probabilité la plus
proche de la probabilité cible (90 %, dans l’exemple
choisi). Cette méthode s’applique à chaque étape
jusqu’au recrutement de 20 à 25 patients seulement.
Ce nombre de patients n’est pas calculé mais a été
établi empiriquement par l’expérience antérieure
obtenue avec la méthode CRM, qui montre que,
au-delà de ce chiffre, la précision de l’estimation
de la réponse à la dose cible (ici, 90 %) ne s’accroît
pas significativement et que l’intervalle de crédibi-
lité encadrant la réponse moyenne à cette dose ne
diminue pas significativement. Il faut noter que l’on
parle ici d’intervalle de crédibilité et non d’intervalle
de confiance, car il s’agit de statistiques bayésiennes
et non fréquentistes.
Cette méthode a l’avantage majeur de ne nécessiter
qu’un groupe limité de patients, contrairement à
la méthode classique de comparaison de groupes
parallèles, de ne pas nécessiter de groupe placebo
et de faire en sorte que chaque nouveau patient ou
chaque nouveau groupe de patients reçoive une
dose dont la probabilité de succès est toujours plus
proche de la probabilité recherchée compte tenu du
fait que la dose administrée est déterminée par la
somme des informations accumulées au cours du
recrutement de tous les patients précédents.
Elle a l’inconvénient de s’appuyer sur un paramètre
qualitatif, si bien que, lorsque le paramètre est quan-
titatif, on est amené à choisir une limite dans l’échelle
quantitative pour séparer les succès des échecs,
sur des arguments de pertinence clinique. Cette
méthode suppose un recueil rapide de la réponse,
car la dose attribuée aux patients suivants dépend de
la réponse de l’ensemble des patients recrutés depuis
le début de l’étude. Cette méthode ne peut donc
pas s’appuyer sur un critère de jugement clinique
qui serait obtenu après plusieurs jours, semaines ou
mois, mais elle est adaptée aux critères permettant
un recueil rapide de la réponse, comme les critères
dits “intermédiaires”. Cette approche suppose une
organisation relativement sophistiquée, avec une
grande réactivité, pour communiquer rapidement la
réponse au centre de calcul et que celui-ci transmette
en retour très rapidement aux investigateurs la dose
à administrer au patient suivant. Cette organisation
n’est en pratique réalisable que dans le cadre d’une
étude monocentrique ou ne comprenant qu’un petit
nombre de centres.
Cette méthode a été utilisée chez le nouveau-né (4,
5), notamment dans une étude qui a été acceptée
pour le dossier de demande d’AMM par l’Agence
européenne des médicaments : l’étude de recherche
de dose de l’ibuprofène intraveineux dans la ferme-
ture du canal artériel (4).
Études d’efficacité et
de sécurité (études de phase III)
Test triangulaire
C’est une méthode séquentielle, car une analyse
statistique est faite non pas seulement à la fin de
l’essai, mais après chaque recrutement d’un petit
nombre de patients. À chaque analyse sont calculées
2 statistiques : la statistique Z, qui est une estima-
tion de la différence d’effet entre les 2 traitements
comparés, et la statistique V, en rapport avec la
somme d’informations accumulées depuis le début
de l’essai, et donc avec le nombre de patients inclus.
Les statistiques Z et V sont représentées respective-
ment en ordonnée et en abscisse d’un graphique qui
permet d’obtenir un point à chaque analyse statistique
(figure). Ce point est relié sur le graphique à une
valeur 0 qui se situe au milieu de l’axe des ordon-
nées. Chaque point est relié au précédent, si bien
que l’on obtient une ligne brisée appelée “chemin
de l’échantillon” (sample path). Cette ligne brisée
s’inscrit dans un triangle, qui donne son nom au
test. La base du triangle est l’axe des ordonnées et
Tableau. Méthode de réévaluation séquentielle pour la recherche de la dose efficace 90 dans
une gamme de 6 doses testées. Sont présentées, de haut en bas, la distribution des probabilités
de succès estimées a priori pour chacune de ces doses, puis, ligne par ligne, les probabilités de
succès estimées a posteriori pour chacune de ces doses en fonction du résultat clinique (succès
ou échec) pour chaque dose nouvellement testée (approche séquentielle) combiné aux résultats
de chacune des doses testées chez les patients précédemment inclus (approche bayésienne). La
dose attribuée à chaque nouveau patient est la dose dont la probabilité de succès a posteriori
était la plus proche de la probabilité cible (90 %) pour le patient précédent.
Patient
dose administrée
Réponse
clinique Gamme de doses testées
(n°) 1 2 3 4 5 6
Probabilité de succès estimée a priori (%)
35 50 70 90 95 100
Probabilité de succès estimée a posteriori (%)
1 3 Échec 3 4 6 9 12 21
2 6 Succès 9 12 19 35 64 70
3 6 Succès 12 18 28 59 62 84
9 6 Succès 23 33 51 77 86 96
10 5 Succès 25 37 56 81 89 97
13 5 Succès 31 45 65 87 93 99
14 4 Succès 35 47 67 88 94 99

La Lettre du Pharmacologue • Vol. 27 - n° 1 - janvier-février-mars 2013 | 9
DOSSIER THÉMATIQUE
est centrée sur la valeur 0 de Z, le côté supérieur du
triangle est la limite inférieure de la zone de différence
statistiquement significative entre les 2 traitements,
le côté inférieur est la limite supérieure de la zone
de différence significative entre les 2 traitements. À
l’intérieur du triangle se situe la zone d’incertitude.
Tant que chaque nouveau point correspondant à la
dernière analyse statistique en date se situe à l’inté-
rieur du triangle, il faut poursuivre le recrutement des
patients jusqu’à ce que la ligne brisée, le sample path,
croise l’un des 2 côtés du triangle. Si la ligne brisée
croise le côté supérieur, l’essai peut être arrêté, et la
différence entre les 2 traitements est significative. Si,
à l’inverse, cette ligne brisée croise le côté inférieur,
l’essai peut être arrêté, mais la différence est alors
jugée non significative. Les équations des droites
constituant les 2 côtés du triangle sont calculées en
fonction des hypothèses de départ sur le risque α,
le risque β, la variabilité du critère (quantitatif) de
jugement principal et la différence attendue entre les
2 traitements. On comprend que, si les hypothèses
de départ sont modifiées, notamment l’importance
de la différence attendue entre les 2 traitements, le
triangle sera orienté différemment dans le graphique
tout en conservant sa base sur l’axe des ordonnées. Un
ajustement de ces frontières après le recrutement de
chaque nouveau groupe de patients peut être dessiné
à l'intérieur du triangle. Il représente une sorte d’arbre
de Noël couché qui définit ainsi de nouvelles limites
inférieures et supérieures selon 2 lignes brisées au
lieu de 2 lignes droites.
Contrairement aux essais comparatifs classiques avec
une seule analyse à la fin de l’étude, cette méthode
a l’avantage de permettre l’arrêt du recrutement des
patients dès que le nombre suffisant pour conclure a
été atteint. Elle vise à limiter le nombre de patients
recrutés. Cet avantage n’est toutefois constaté que
lorsque la différence entre les 2 traitements est rela-
tivement importante. Si cette différence est minime,
le nombre de patients nécessaire pour conclure peut
même être légèrement supérieur à celui d’un essai
comparatif classique avec 2 groupes parallèles et
1 seule analyse statistique.
Cette méthode a été utilisée en pédiatrie dans
l’étude de l’efficacité du métoclopramide dans le
reflux gastro-œsophagien du nourrisson (6).
Méthode d’enrichissement
en répondeurs
Cette méthode consiste à sélectionner, préalable-
ment à l’essai, un sous-groupe de patients répondant
au traitement selon une approche observationnelle
non comparative (étude “ouverte”) et à faire ensuite
un essai clinique comparatif classique en groupes
parallèles comparant le traitement et un placebo
dans le seul sous-groupe des patients qui se sont
montrés répondeurs en ouvert. Cette approche a
pour avantage de diminuer la variabilité de la réponse
au traitement, grâce à la plus grande homogénéité
du sous-groupe, d’augmenter la puissance statis-
tique et, in fine, de réduire le nombre de patients
à recruter. Cette méthode a été utilisée à plusieurs
reprises en pédiatrie, par exemple dans l’étude de
l’efficacité du stiripentol dans l’épilepsie partielle
de l’enfant (7).
Méthodes observationnelles
de type épidémiologique
Les méthodes interventionnelles utilisant une
comparaison, un tirage au sort pour l’attribution
des 2 traitements comparés, le double aveugle et
un placebo assurent la meilleure comparabilité entre
les 2 groupes de traitement et le plus haut niveau
de preuve. Ce type d’approche est surtout utilisé
pour les études d’efficacité, beaucoup plus rarement
pour les études de sécurité. Il est particulièrement
inadapté pour la comparaison de la survenue d’un
effet indésirable de faible incidence.
Les méthodes observationnelles sont, par définition,
non interventionnelles et n’assurent pas la meilleure
Figure. Représentation graphique des résultats d’analyse, selon un test triangulaire
(approche séquentielle), des résultats d’un essai clinique en double aveugle comparant
le métoclopramide p.o. à un placebo dans le reflux gastro-œsophagien du nourrisson (6).
0
0
Statistique V
Statistique Z
15
Z = 5,495 + 0,2726 V
Z = 5,495 + 0,28177 V
(V = 20,16 ; Z = 10,99)
1052015
-5
0
5
10

10 | La Lettre du Pharmacologue • Vol. 27 - n° 1 - janvier-février-mars 2013
Méthodologie et optimisation des études cliniques chez l’enfant
DOSSIER THÉMATIQUE
Pharmacopédiatrie
comparabilité entre 2 groupes, en raison de la possi-
bilité d’introduction de biais qui tiennent en grande
partie à l’absence de tirage au sort. Elles sont surtout
utilisées pour évaluer la sécurité des médicaments
mais presque jamais pour évaluer leur efficacité.
Néanmoins, lorsqu’un essai clinique comparatif en
double aveugle contre placebo n’est pas possible –
comme cela peut être le cas pour des médicaments
déjà très largement utilisés hors AMM par des prati-
ciens convaincus de l’efficacité du produit et qui
n’imaginent pas pensable de faire une comparaison
contre placebo –, ou quand la maladie est très rare,
la démonstration de l’efficacité du traitement est
hors de portée par les méthodes de référence (8).
Dans ce cas, que peuvent apporter les méthodes
observationnelles ? Quand l’effet du traitement est
très important, l’expérience, par simple observa-
tion, permet de constater qu’il n’est pas nécessaire
de faire un essai comparatif versus placebo pour
juger de l’efficacité du traitement en question. C’est
le cas notamment pour l’étude d’efficacité du para-
chute. La méthode observationnelle, dans ce cas
d’effet du traitement très important, permet de
juger de l’efficacité avec un bon niveau de preuve
malgré l’impossibilité de faire une comparaison et
de démontrer une différence statistiquement signi-
ficative (9). Les études observationnelles dans la
démonstration de l’efficacité d’un médicament ne
sont pas utilisées pour apporter un niveau de preuve
suffisant pour obtenir l’AMM. Néanmoins, chez
l’enfant, dans les 2 situations citées précédemment
(impossibilité de faire l’essai ou effet du traitement
très important), conduisant à l’impossibilité de faire
une évaluation méthodologiquement rassurante,
il ne faut pas exclure la possibilité d’examiner les
données d’observation. Cela est, bien entendu,
un important sujet de controverse qui appelle à
davantage de recherche pour mieux définir la place
de cette approche dans un nombre de cas limité
et bien défini.
Conclusion
Ces différentes approches, dites “innovantes”,
permettent, dans un certain nombre de cas, de
limiter le nombre de patients recrutés et, du même
coup, de limiter l’invasivité de la procédure auprès de
la population pédiatrique. Leur utilisation est encore
relativement restreinte et elles doivent faire l’objet
de davantage de recherches, notamment au cours
du développement des médicaments. ■
1. Regulation (EC) no 1902/2006 of the European Parlia-
ment and of the Council of 20 December 2006 amending
Regulation 1901/2006 on medicinal products for paedia-
tric use. http://ec.europa.eu/health/files/eudralex/vol-1/
reg_2006_1902/reg_2006_1902_en.pdf
2. Revised priority list for studies into off-patent paediatric
medicinal products. http://www.ema.europa.eu/docs/en_
GB/document_library/Other/2009/10/WC500004017.pdf
3. Manolis E, Pons G. Proposals for model-based paediatric
medicinal development within the current European Union
regulatory framework. Br J Clin Pharmacol 2009;68:493-501.
4. Desfrere L, Zohar S, Morville P et al. Dose-finding study
of ibuprofen in patent ductus arteriosus using the continual
reassessment method. J Clin Pharm Ther 2005;30:121-32.
5. Treluyer JM, Zohar S, Rey E et al. Minimum effective
dose of midazolam for sedation of mechanically ventilated
neonates. Clin Pharm Ther 2005;30:479-85.
6. Bellissant E, Duhamel JF, Guillot M, Pariente-Khayat A,
Olive G, Pons G. The triangular test to assess the efficacy of
metoclopramide in gastroesophageal reflux. Clin Pharmacol
Ther 1997;61:377-84.
7. Chiron C, Tonnelier S, Rey E et al. Stiripentol in child-
hood partial epilepsy: randomized placebo-controlled trial
with enrichment and withdrawal design. J Child Neurol
2006;21:496-502.
8. Bensouda-Grimaldi L, Chalumeau M, Mikaeloff Y, Pons G.
Pharmaco-epidemiology to evaluate medicines in pediatric
patients. Arch Pediatr 2008;15:814-6.
9. Smith GC, Pell JP. Parachute use to prevent death and major
trauma related to gravitational challenge: systematic review
of randomised controlled trials. BMJ 2003;327:1459-61.
Références bibliographiques
1
/
5
100%