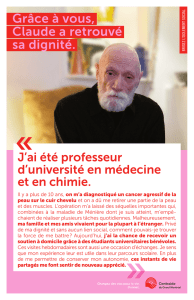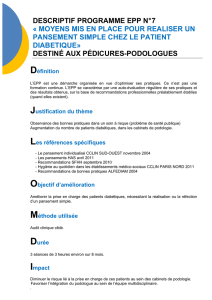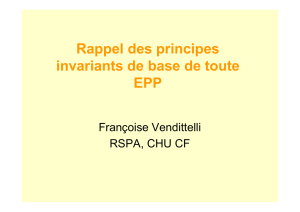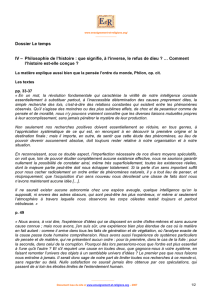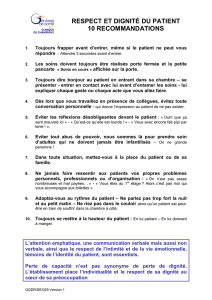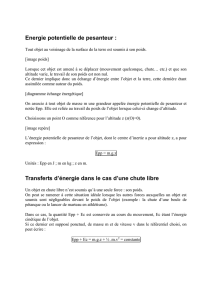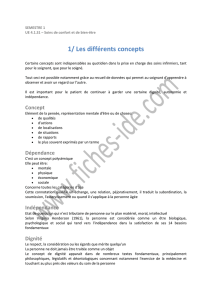Juin – Juillet – Août 2007

La Gazette
de la SOciété Française d’Orthopédie Pédiatrique
N°21
Juin-Juillet-Août 2007 - Commission paritaire en cours - N° ISSN en cours
Bureau de la SOFOP
Président : G. BOLLINI
1er Vice-Président : J.F. MALLET - 2e Vice Président : J.M. CLAVERT
Ancien Président : R. KOHLER
Secrétaire Général : J. COTTALORDA - Secrétaire Adjoint : A. HAMEL
Trésorier : P. LASCOMBES - Trésorier Adjoint : C. ROMANA
Membres du Bureau : S. BOURELLE, M. PEETERS
Editorial SO.F.O.P.
« ...remercions Dieu de nous avoir donné en
cadeau la mort pour que la vie ait un sens ....la
guerre pour que la paix ait un sens »
(Amin Maalouf)1.
Jamais je n’aurais osé mettre cette phrase en
exergue aujourd’hui si elle n’était pas de l’un
des plus grands écrivains Libanais contempo-
rains . Nos amis Libanais comprendront mon
choix ; les Français aussi, je l’espère.
Il m’a été facile de plaisanter dans des édito-
riaux précédents sur l’orthopédie lyonnaise
ou parisienne, sur notre capacité à discourir
sur un livre ou une intervention que nous ne
connaissons que par ouï-dire, de ne pas res-
pecter grand-chose, en apparence tout au
moins.
Aujourd’hui, dans un numéro consacré à nos
amis Libanais, je n’ai pas le cœur à l’ironie.
L’excès des malheurs de ce peuple courageux
oblige plutôt à la tristesse solidaire. La tonalité
de fond de ce court texte sera donc retenue.
Ce premier paragraphe apparaît comme l’en-
foncement d’une porte ouverte. J’y exprime,
bien d’autres l’ont fait déjà et chacun pense
comme moi, mon admiration pour cette ca-
pacité des Libanais, orthopédiatres ou pas,
à ne jamais cesser « d’y croire » même dans
les pires moments, de continuer à chercher,
à travailler, à reconstruire sans relâche. La vie
continue et ils laissent derrière eux la mort
qui les harcèle. Les textes de Jawish sur les
ostéotomies pelviennes, de Mazloum sur son
dynamisme dans la Bekaa, d’Akatcherian sur
les enfants dans la guerre témoignent de ce
réalisme constructif, de ce refus des bras qui
tombent. Bien d’autres qu’eux s’acharneraient
moins.
Dans Léon l’Africain Amin Maalouf, conrme
cette certitude d’espoir invincible, « d’une ré-
surrection après la mort »2, ancrée dans l’âme
Libanaise. Le symbole en est le scarabée
« doté de vertus magiques et dépositaires des
grands mystères de la vie » 3. Le scarabée fait
naître de la bouse un nouveau scarabée, com-
me le peuple Libanais fait resurgir la vie des
ruines sans cesse renouvelées. Pour conrmer
ce dynamisme je pourrais citer tout le texte
de Ghanem sur l’histoire de la Faculté de Mé-
decine Saint-Joseph avec les photos qui l’ap-
puient! J’en retiens une seule phrase car elle
résume tout : « Les reconstructions ne s’arrête-
ront presque pas durant toutes ces années » ;
il s’agit, bien sûr, des quinze ans, 1975-1990,
que dure la guerre.
Dans ce deuxième et dernier paragraphe, je
m’émerveille de la belle coïncidence qui inclut
dans ce N° 21, consacré à notre spécialité dans
un pays où la guerre tue presque en perma-
nence, les réexions de Jean-François Mattei
sur L’évaluation de l’être humain et de Jawish
sur La signication de notre corps. Deux tex-
tes complémentaires à lire avec attention et à
relire. La banalité de la violence généralisée
et le matérialisme de notre civilisation ren-
dent plus nécessaire que jamais ces expres-
sions d’une pensée spiritualiste sur le principe
d’Humanité4.
Que je ne rende pas compte des autres tex-
tes n’implique en rien mon manque d’intérêt
pour ce dont ils traitent, mais c’est un privilège
accordé à l’éditorialiste de se limiter, à l’occa-
sion, à l’évocation d’un seul thème, ici le Liban
exemplaire.
Henri CARLIOZ
Edito .............................................................1
par Henri Carlioz
Ibn Nas
Médecin anatomiste (1215-1288) .....2
par Roger Jawish
Ma technique de quadruple
ostéotomie du bassin ............................5
par Roger Jawish
La faculté de médecine de l’université
Saint-Joseph à Beyrouth contre vents
et marées ....................................................7
par Elie Saliba et Ismat Ghanem
Ma pratique dans la Bekaa ................ 11
par Hamzi Mazloum
Le pédiatre, l’enfant et la guerre ..... 12
par C. Akatcherian
Le corps qu’est ce qu’il est,
pour nous ? ............................................ 14
par Roger Jawish
Jusqu’où peut-on conduire
l’évaluation de l’être humain ? ......... 16
par Jean-François Mattei
Mission d’orthopédie pédiatrique
au Sénégal-Chaine
de l’Espoir-Belgique............................. 18
par Robert Elbaum
Mise en œuvre de l’EPP
en chirurgie orthopédique ............... 20
par Jacques Caton
Le courrier des lecteurs :
à propos du dernier éditorial ........... 22
par Maher Ben Gachem
la Gazette est dorénavant publié en format A4, an d’être directement imprimée
à partir de votre ordinateur via notre adresse www.livres-medicaux.com
Fondateur
J.C. POULIQUEN †
Editorialiste
H. CARLIOZ Paris)
Rédacteur en chef
C. MORIN (Berck)
Membres :
J CATON (Lyon)
P CHRESTIAN (Marseille
G FINIDORI (Paris)
J L JOUVE (Marseille
R KOHLER (Lyon)
P LASCOMBES (Nancy)
G F PENNEÇOT (Paris)
M RONGIERES (Toulouse)
J SALES DE GAUZY (Toulouse)
R VIALLE (Paris)
et le “ GROUPE OMBREDANNE”
Correspondants étrangers
M BEN GHACHEM (Tunis)
R JAWISH (Beyrouth)
I. GHANEM (Beyrouth)
Editeur
SAURAMPS MEDICAL
S.a.r.l. D. TORREILLES
11, boul. Henri IV
CS 79525
34960 MONTPELLIER
Cedex 2
Tél. : 04 67 63 68 80
Fax : 04 67 52 59 05
1 « Léon l’Africain », Amin Maalouf, Lattès éd. 1986, 2 « Le premier siècle après Béatrice », Amin Maalouf, Grasset éd. 1992
3 idem, 4 « Le principe d’Humanité », J Cl Guillebaud, Le Seuil éd. 2001

2
Ibn Nas
Médecin anatomiste (1215-1288)
par Roger Jawish
Aladin Ibn Nas naquit à Damas en 1215, sous le règne du sul-
tan Seifeddine ls de Saladin El Ayoubi. Il étudia la médecine
dans le grand hôpital Louri El Kibir à Damas chez les 2 célèbres
professeurs Mouhazabeddine Addakhwar et Amrane l’Israé-
lite. Vers l’an 1236, Ibn Nas partit en Egypte, où il fut désigné
professeur des maladies des yeux à l’hôpital Nassiri ; il devint
par la suite «Médecin Chef » du pays et médecin privé du Roi
Mamelouk Baybars. Ibn Nas était un bel homme, grand de
taille, mince, imposant et courtois ; il avait gardé d’excellentes
relations avec son entourage, plus particulièrement avec les
Emirs et ses collègues. Il était également pieux et savant dans
les sciences religieuses.
Il mourut au Caire le 17 décembre 1288, non marié. L’oraison
funèbre fut prononcée par son ami Jean (ls de Croix Chré-
tienne), un copte d’Egypte.
Son époque
Après la dynastie des Fatimides qui régnait en Egypte, Saladin
El Ayyubi (Salaheddine) se proclama Sultan d’Egypte et abolit le
khalifat. Il fonda la dynastie des Ayyubides, s’empara de Damas
(1171) et devint maître de toute l’Arabie et de la Mésopotamie.
La puissance des Ayyubides se manifesta de deux façons : au
niveau de l’Islam, par la lutte contre le chiisme, au moyen des
écoles religieuses « madrasa » qui se répandirent en Egypte
et en Syrie ; ensuite sur le plan militaire, par la lutte contre les
croisés (surtout après la mort du Roi Lépreux Baudouin IV en
1185) et leur délocalisation des grandes villes. Saladin, après
la bataille de Hattin (1187), se rendit maître des sites et villes
chrétiens à l’exception de quelques places côtières.
Après la mort de Saladin en 1193, les princes des diérentes
principautés, ainsi que les divers membres de la famille, passè-
rent leur temps à faire des alliances et à guetter les faiblesses
de leurs adversaires, pour des ambitions territoriales égales.
Un des souverains ultérieurs de l’Egypte, Malik Kamil (Roi par-
fait), resta une belle gure. Prince cultivé, il avait entretenu de
bonnes relations avec Frédéric II, et peut-être était-il impru-
demment convenu de lui céder Jérusalem ; ce qui aboutira à
une conjuration en 1237, lorsque Malik Kamil reçut des princes
syriens un ultimatum lui enjoignant de ne pas sortir d’Egypte.
Les mamelouks formaient une milice d’élites au service de
la dynastie Ayyubide. Ils étaient recrutés parmi les esclaves
blancs. Le sultan ayyubide Malik Saleh (Roi sage) les employa
pour assurer sa garde personnelle ; il les installa sur le Nil (les
mamelouks bahrites) et devinrent peu à peu une formation
puissante. Le dernier épisode fut une épouvantable tragédie.
Les francs avaient repris Damiette, mais ils furent arrêtés à
Mansourah. La mort inattendue du Sultan en 1249 obligea son
ls Turanshah de quitter Alep ; il arriva à Mansourah le 25 fé-
vrier 1250, pendant que l’armée cernait les francs à Fareskour
et faisait prisonnier le Roi de France Louis IX (St Louis).
Quelques mois plus tard, Chajaret Eddur (arbre de joyaux),
femme de Malik Saleh, prépara à l’aide des mamelouks l’éli-
mination de Turanchah (30 avril 1250) et réussit à se faire dési-
gnée Sultane des ayyubides. Elle épousa par la suite Izzeddine
Aybak un chef mamelouk qu’elle parvint à assassiner. Chajaret
Eddur fut assassinée à son tour par sa garde, après 90 jours de
règne. Telle était l’histoire sanglante qui allait nir la dynastie
des ayyubides avec la sultane Chajaret Eddur, pour donner
naissance au nouveau régime de l’Egypte celui des sultans
mamelouks.
Le mamelouk Baybars (1223-1277) qui apporta le premier
coup de sabre à Turanshah au cours d’un banquet, était pré-
sent dans toutes les scènes qui allaient contribuer pour nir le
régime des ayyubides. Enn, Baybars tua son compagnon de
guerre Kotoz, au retour de la campagne contre des mongols ;
il s’empara du royaume durant 17 ans, la plus longue période
des règnes des sultans mamelouks .
Ibn Nas dans la tourmente
Iben Nas vécut cette période qui connut des dissensions in-
ternes favorisées par les expéditions des croisés vers l’orient, et
par les guerres des Grecs dans les villes du nord ; mais égale-
ment et surtout par l’envahissement de la Syrie et de la Méso-
potamie par les mongols menés par Hulagu. Ce dernier ayant
ruiné beaucoup de villes, telles que Alep et Damas, et brûlé la
bibliothèque de Bagdad en 1258, il t exécuter le calife Mus-
taasim Billah.
A cette période d’occupation et de destruction suivit une pé-
riode de redéploiement et de erté, favorisée par la victoire
des mamelouks sur les croisés et la reprise de Jérusalem et de
beaucoup de villes syriennes, ainsi que la libération de la côte
égyptienne et la défaite des mongols à Ain Jaloute en 1260.
Cette victoire militaire s’est faite également sentir au niveau
culturel; car même si la dynastie des califes abbassides est ju-
gée une période de faiblesse et de déclin dans l’histoire arabe,
Fig. 1 : Aladin Ibn Nas

3
Ibn Nas
Médecin anatomiste (1215-1288)
par Roger Jawish
nous devons à certains hommes le changement et l’innovation
qui se produisirent au niveau des sciences et de la philosophie,
en refusant les idées pré- établies. En mysticisme, Ibn Arabi et
Ibn Alfared contribuèrent au développement du sousme et
marquèrent leur siècle, longtemps après le philosophe et sou
Al Hallaj (7ème siècle).
Ibn Nas et ses oeuvres
Ibn Nas était un des savants qui participèrent à l’épanouisse-
ment culturel du 13ème siècle, en apportant des connaissances
nouvelles en médecine. Il écrit de nombreux ouvrages pré-
cieux, tels que: « Abrégé en médecine», un livre qui commenta
le livre du Canon d’Avicenne ; des copies de ce livre existent
à Paris, Manchester, Berlin, Damas, Istanbul, le Caire. Dans un
autre livre « Explication du Canon d’Avicenne » en 20 volumes, il
critiqua les enseignements de Galien et d’Avicenne.
Le livre « Explication de la dissection», fut à l’origine de la grande
réputation d’Ibn Nas, car c’est dans ce livre qu’il décrit avec
précision l’anatomie de la circulation sanguine pulmonaire. Ce
livre dont plusieurs copies existent (bibliothèque nationale de
Paris, Oxford, Damas, Istanbul, Berlin, le Caire) comporta une
introduction divisée en 5 parties : La 1ère partie décrit l’anato-
mie des membres chez les animaux, la 2ème les principes de la
dissection, la 3ème la physiologie des membres, la 4ème l’anato-
mie comparée, et la 5ème expliqua le but de l’anatomie et ses
moyens (la physiologie).
Enn l’«Encyclopédie médicale » était un ouvrage complet sur
la médecine de l’époque, prévue être en 300 volumes, seule-
ment 80 volumes furent terminés avant sa mort. Quelques vo-
lumes incomplets furent trouvés à la bibliothèque Boldeian à
Oxford, à la bibliothèque azzahiryat à Damas et à la Maison du
livre (Darel kotob) au Caire.
Ibn Nas écrit plusieurs autres ouvrages en médecine ; je me
contente de mentionner quelques titres : « Le livre du soignant
(médecin) », « Le livre des détails en médecine», « Les lettres dans
les maux de ventre », « Le livre des plantes dans les médicaments
simples », « Explication des parties d’Hippocrate », « Les collyres
prouvés pour les maladies des yeux ».
Le médecin exceptionnel
Médecin de grande réputation, il enseigna à l’hôpital Al Man-
souri construit par Mansour Kalawoun, chef des armées de
Baybars et son successeur sur le trône de l’Egypte, après l’avoir
empoisonné en 1277.
Ibn Nas se distinguait des médecins de l’époque par son sens
critique très poussé. Avant-gardiste, il semble être le 1er ana-
tomiste qui disséqua des cadavres humains. Sa méthode allait
à l’encontre des mœurs de l’époque, car l’Islam interdisait for-
mellement l’expérimentation sur le corps humain. Inuencé
par les idées d’Averroès (1126-1198) à qui on attribua la doc-
trine de la « double vérité », selon laquelle il pouvait y avoir
opposition entre les vérités rationnelles et révélées, Ibn Nas
n’hésita pas à pratiquer la dissection, malgré l’opposition des
« Ouléma » (savants de l’islam). Dans l’introduction de son livre
«Explication de la dissection », il dit : « Nous avons contrarié l’avis
de la Chariaa (la religion) en pratiquant la dissection, mais nous
fûmes éclairés par notre morale et notre piété ». Ainsi Ibn Nas in-
rma entre autres, la présence d’os au niveau du cœur, comme
le croyaient Avicenne et Galien, dans leurs dissections de cœur
d’éléphant et de taureau.
Le génie d’Ibn Nas vient de sa découverte de la petite circula-
tion sanguine, et ceci bien avant Harvey qui la décrivit en 1628.
C’est en 1924 que les travaux d’Ibn Nas sur la petite circulation
furent découverts, dans une thèse présentée par M.D. Natawi
à l’Université de Fribourg en Allemand. Cette réalité fut par la
suite conrmée par S. Haddad et A. Khairallah, dans « Annals of
Surgery » en 1936. La description de la petite circulation gura
dans son livre «Explication de la dissection ». Quarante six ans
avant sa mort, Ibn Nas dessina le croquis qui existe actuelle-
ment dans Stanford University en Californie et dans plusieurs
autres endroits.
Inuencé par le savoir d’Hippocrate, Ibn Nas insista sur les
conditions de réussite d’un acte chirurgical, il distingua trois
temps : le premier est le temps de « consentement », où le ma-
lade ore son corps sans réserve pour le traitement. Le 2ème
temps est « le temps du travail » où le chirurgien doit corriger ce
qui est anormal. Le 3ème temps est celui de la « conservation »,
ou le maintien de la guérison, avec l’aide des inrmiers et des
servants. Ibn Nas expliqua avec précision les trois étapes du
traitement auquel participe le malade, le chirurgien et l’équipe
médicale. Il expliqua également comment nettoyer, utiliser et
conserver les instruments de chirurgie. Tout ceci fut cité dans
son livre « Le précis dans l’industrie médicale ».
En Morale
La personnalité de Saladin laissa, tant en Orient qu’en Occi-
dent, une forte personnalité sunnite. Il essaya de redresser le
monde musulman en lui procurant de nouvelles forces mora-
les et matérielles. Ibn Nas enseigna la « Chariaa » de l’islam, à
l’école Al Masrouria construite par un des conseillers de Saladin
(Masrour Chams Alkhawassi); il fut considéré un des grands sa-
vants « Chaite », disciples de l’une des 4 écoles juridiques de
l’islam. Cette école dénit les 4 sources de droit étant, le Coran,
la tradition ou hadith, l’usage et l’analogie ou alkyas.
Ibn Nas écrivit en philosophie plusieurs ouvrages : l’explica-
tion du livre « Les signes » de Avicenne » et « Les feuillets » un
abrégé du livre « Organon » en logique d’Aristote. En sciences
religieuses, il écrivit « L’abrégé des principes du hadith » et « La
lettre complète de la vie prophétique », cet ouvrage ressemblant
aux lettres d’Avicenne et Ibn Toufayl (philosophe arabe) écrites
un siècle plutôt. Dans sa lettre Ibn Nas cherchait à donner un
éclaircissement de la pensée arabe dans son âge d’or; il cher-
chait également à réconcilier la théologie Musulmane avec
la philosophie, c’est-à-dire entre la « Chariaa » et les sciences
exactes. Dans son récit Ibn Nas relata l’histoire de son héros
nommé Kamel (le parfait), né dans une île déserte, qui par-
vint par sa raison à connaître toutes les vérités de l’univers et
accéder à la certitude morale, plus particulièrement celle de
l’existence de Dieu.

4
Ibn Nas
Médecin anatomiste (1215-1288)
par Roger Jawish
Fig. 2 : Dessin modié de la petite circulation selon Ibn Nas
Fig. 3 : Texte écrit sur la petite circulation
« Quand le sang a été rané dans cette cavité (le ventricule droit du
coeur), il est indispensable qu’il passe dans la cavité gauche où naissent
les esprits vitaux. Mais qu’il n’existait pas de passage direct entre ces
dernières. L’épais septum du coeur n’était nullement perforé et ne com-
portait pas de pores visibles ainsi que le pensaient certains, ni de pores
invisibles tel que l’imaginait Galien. Au contraire les pores du coeur y sont
fermés. Ce sang de la cavité droite du coeur devait circuler, dans la veine
artérieuse (notre artère pulmonaire), vers les poumons. Il se propageait
ensuite dans la substance de cet organe où il se mêlait à l’air. an que sa
partie la plus ne soit puriée et passe dans l’artère veineuse (nos veines
pulmonaires) pour arriver dans la cavité gauche du coeur et y formait
l’esprit vital. »
Réunions à venir
14-15 septembre 2007 - Nice
9ème réunion de la société franco-japonaise
d’orthopédie
jacques.c[email protected]
caton.jacques@wanadoo.fr
10-13 octobre 2007 - Vancouver (Canada)
61ème réunion de l’ AACPDM
www.aacpdm.org
17-19 octobre 2007 - Le Caire (Egypte)
Congrès sur la Fixation Externe
www.externalxation2007.com
5-8 novembre 2007 - Paris-Palais des Congrès
82ème SOFCOT
Conférences d’enseignement le 5/11
Réunion de la SOFOP le 8/11
www.sofcot.fr
GUIDE PRATIQUE
URGENCES ET ORTHOPEDIE PEDIATRIQUE
Monographie de la SoFOP 2007
sous la direction de J.L. JOUVE
978-2-84023-508-8 - 258 pages (Spiralé)
Format :15x21 cm - Prix : 45 €

5
Ma technique de quadruple
ostéotomie du bassin
par Roger Jawish
Les ostéotomies de réorientation ont pour but de normaliser
autant que possible la couverture de la tête fémorale,
pour obtenir une meilleure répartition des charges et une
meilleure congruence tête-cotyle.
L’ostéotomie de la ligne innominée, réalisée par Salter
en 1961, ne permettait pas une bonne bascule du cotyle
chez l’enfant de plus de 5 ans, à cause de la raideur de la
symphyse pubienne. Pol Le Cœur, en 1965, a eectué, en
plus de l’ostéotomie iliaque, une ostéotomie des 2 ponts
du trou obturateur, ce qui a permis de détacher le cotyle du
reste du bassin. A partir de là, le fragment cotyloïdien pouvait
être basculé plus facilement que l’ostéotomie à charnière
pubienne recommandée par Salter ; cette technique
permettait également d’éviter les eets de latéralisation
et d’abaissement de la hanche observés dans les grandes
corrections.
Mais la triple ostéotomie de Pol Le Cœur, ainsi que celle
de Steel en 1973 et de Sutherland et Greeneld en 1977,
ne permettaient pas de réaliser chez le grand enfant des
déplacements cotyloïdiens importants, ceci à cause de la
taille du fragment cotyloïdien et de ses attaches musculo-
ligamentaires.
Tonnis en 1981 et Carlioz en 1982 ont décrit les ostéotomies
juxta-cotyloïdiennes, dans lesquelles les ostéotomies du
trou obturateur ont été réalisées à proximité du cotyle, ce
qui a permis de réduire la taille du fragment cotyloïdien,
et de le libérer de ses attaches musculaires ischiatiques et
obturatrices. Par conséquent, l’orientation du fragment
cotyloïdien est devenue plus aisée et sans contraintes,
dans tous les sens. Pour éviter la limitation du déplacement
cotyloïdien dans les grandes dysplasies, Tonnis a orienté son
ostéotomie de l’ischium vers la petite échancrure sciatique,
en amont de l’épine sciatique, pour exclure l’eet du ligament
sacro-sciatique.
J’ai l’habitude de pratiquer la triple ostéotomie juxta
articulaire de Carlioz (Fig.1), mais je l’eectue depuis plusieurs
années par une seule voie d’abord qui est la voie antérieure,
y compris l’ostéotomie de l’ischium ; je l’avais présentée au
GEOP en 1999 et à l’AOLF 2000. Chez le grand enfant de plus
de 10 ans je réalise également une ostéotomie de l’épine
sciatique sur laquelle s’insère le ligament sacro-sciatique.
La réalisation des quatre sites d’ostéotomie sur le bassin à
travers une seule voie antérieure, permet d’éviter la voie
postérieure par laquelle l’ostéotomie de l’ischium est réalisée
dans les ostéotomies juxta cotyloïdiennes de l’enfant ; elle
permet également de contrôler les diérentes ostéotomies
tout au long de l’intervention.
Technique chirurgicale
L’incision cutanée est celle de Smith Petersen. On traverse
l’espace limité par le tenseur du fascia lata en dehors et le
muscle couturier en dedans ; le tendon du droit antérieur
n’est pas désinséré mais récliné en dehors.
L’abord de l’ischium est un temps crucial de l’opération ;
pour cela on dissèque l’espace entre le tendon du psoas en
dedans et la capsule de la hanche en dehors, jusqu’à arriver
au muscle obturateur externe. On élargit et on maintient ce
passage qui est profond, avec la manche d’une rugine tenue
à l’envers. Cette dernière nous sert également de guide sur
laquelle on fait glisser un ostéotome courbe de 30° large de
15mm, pour éviter les dégâts des parties molles (Fig. 2). On
appuie l’ostéotome sur le bord antérieur de l’ischium, en
respectant deux indices : vérier le niveau de coupe qui doit
être sous le U radiologique, entre le sillon sous cotyloïdien et
la tubérosité ischiatique (Fig. 3 et 4) et vérier la direction de
l’ostéotome qui doit être orientée vers le dedans, pour éviter
le traumatisme du nerf sciatique qui passe à proximité.
L’ostéotomie de l’ischium doit être complète ; elle doit
s’arrêter au moment où la corticale postérieure se rompt,
pour éviter d’aller plus loin en arrière.
Fig. 1 : Le siège de 3 des 4 ostéotomies pelviennes.
Fig. 2 : Ostéotome coudé à 30° en place.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
1
/
24
100%