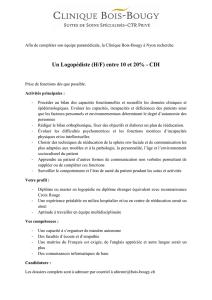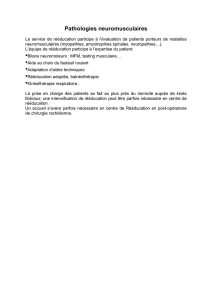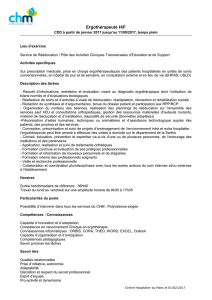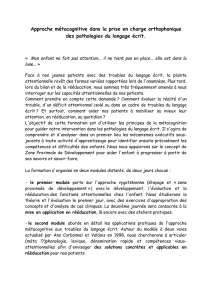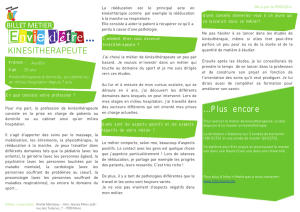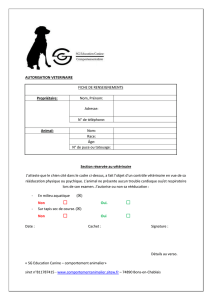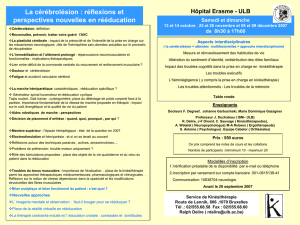Quoi de neuf en rééducation dans la sclérose en plaques ? M R

MISE AU POINT
La Lettre du Neurologue - vol. X - n° 4 - avril 2006
122
L
a rééducation des personnes atteintes de sclérose en
plaques (SEP) est relativement récente. Elle a longtemps
effrayé à la fois les patients et les équipes paramédi-
cales, élevés dans le mythe de l’exercice néfaste car générateur
de fatigue. De plus, la prise en charge de ces patients a souvent
été considérée comme complexe et peu gratifiante pour les
équipes du fait du caractère évolutif de la maladie, rendant a
priori toute progression impossible, et de la nécessité d’un suivi
au long cours reconnu comme peu motivant par les profession-
nels. Enfin, la méconnaissance de cette pathologie, qui touche
pourtant plus de 60 000 personnes en France, tend à la réduire à
l’image négative longtemps médiatisée d’une personne sévère-
ment handicapée, voire grabataire, à l’espérance de vie réduite et
dont la rééducation ne peut être que coûteuse en temps, complexe
et inutile. Et pourtant…
POURQUOI RÉÉDUQUER ?
La commercialisation de thérapeutiques efficaces dans les formes
rémittentes, la meilleure connaissance de la maladie, la prévention
et la prise en charge des complications infectieuses (en particulier
urinaires) des personnes atteintes de SEP ont permis d’améliorer leur
espérance de vie, qui est à l’heure actuelle la même que celle de la
population générale en France, toutes formes de SEP confondues. La
SEP est, de ce fait, à ce jour la deuxième cause de handicap neuro-
logique du sujet jeune. Le développement de services de médecine
physique et de réadaptation (MPR) spécifiquement dédiés à ces
patients au cours des dix dernières années permet de mesurer l’effi-
cacité des prises en charge rééducative et réadaptative proposées.
Ainsi, la rééducation permet une amélioration analytique et fonc-
tionnelle ainsi qu’une amélioration de la qualité de vie des patients.
Amélioration analytique
L’étude de Cantalloube et al. (1) a évalué 21 patients atteints de SEP
avant et après un séjour de 3 à 4 semaines en service de MPR spé-
cialisé. Les patients avaient un score à l’échelle de Kurtzke infé-
rieur ou égal à 6,5. La prise en charge était pluridisciplinaire et
comportait 8 séances de kinésithérapie hebdomadaires (45 minutes
par séance). L’évaluation faite avant et après le séjour comportait
une estimation de la force musculaire des quadriceps et des
ischio-jambiers, en concentrique et en excentrique, sur appareil
d’isocinétisme, une mesure de la vitesse de marche rapide et
spontanée, une mesure de l’équilibre statique sur plate-forme
* Service de médecine physique et de réadaptation, hôpital Léopold-Bellan,
Paris.
Quoi de neuf en rééducation dans la sclérose en plaques ?
What is new in rehabilitation for multiple sclerosis patients?
● L. Mailhan*, A. Fontaine*, C. Terbèche*, I. Monteil*
Rehabilitation in multiple sclerosis (MS) has proved to be
effective, at early stage and in all forms of MS. Contrary to
commonly held opinion, rehabilitation does not cause fatigue
but can stabilize and even improve patients’ abilities. Reha-
bilitation is supported by classical technics, associated with
training and fatigue management. It may occur in speciali-
zed rehabilitation units, with physiotherapists, occupational
therapists, speech therapists and psychologists.
Keywords: Rehabilitation – Multiple sclerosis.
SUMMARY
SUMMARY
RÉSUMÉ
RÉSUMÉ
La rééducation des personnes atteintes de sclérose en plaques
a prouvé son efficacité, y compris à des stades précoces et
quel que soit le mode évolutif de la maladie. Contrairement
aux idées reçues, qui la voulaient néfaste et génératrice de
fatigue, elle permet de stabiliser, voire d’améliorer, les per-
formances des patients. Elle s’appuie sur les bases classiques
de la rééducation neurologique, en y associant un recondi-
tionnement à l’effort adapté à l’état neurologique du patient,
et surtout une gestion de la fatigue, seule spécificité et garan-
tie du maintien des capacités à moyen terme. Elle se fait au
mieux en service spécialisé, au sein d’une équipe pluridisci-
plinaire associant kinésithérapeutes, ergothérapeutes, ortho-
phonistes et psychologues.
Mots-clés : Rééducation – Sclérose en plaques.

La Lettre du Neurologue - vol. X - n° 4 - avril 2006 123
d’équilibre (yeux ouverts [YO] et fermés [YF]). L’analyse des
résultats obtenus mettait en évidence une amélioration de la force
musculaire du quadriceps le plus faible et des ischio-jambiers les
plus forts en concentrique ainsi qu’une amélioration de l’équi-
libre statique YO et YF. L’étude de Robineau et al. (2) confirmait
la possibilité d’un renforcement musculaire des ischio-jambiers
en excentrique sur appareil d’isocinétisme chez 28 patients
atteints de SEP avec des EDSS de 3 à 6 après 12 séances de kinési-
thérapie, mais sans maintien de ce gain en force à 3 mois.
Amélioration fonctionnelle
et amélioration de la qualité de vie
L’étude de Cantalloube et al. (1) montrait, outre l’amélioration des
paramètres analytiques, un gain en vitesse de marche et une cor-
rélation positive entre vitesse de marche et force du quadriceps
et des ischio-jambiers. La mesure d’indépendance fonctionnelle
(MIF) était également déterminée à l’entrée et à la sortie chez les
21 patients, et l’on observait une amélioration significative de
4 points sur la MIF. Cette amélioration correspond à un gain
d’autonomie moyen de 15 minutes par jour, un point en MIF cor-
respondant à 3,7 minutes d’autonomie par jour dans la SEP (3).
Wiles et al. (4) décrivent également un gain significatif sur les
indices de mobilité. Dans cette étude contrôlée randomisée en
cross-over, l’effet de la kinésithérapie sur la mobilité a été éva-
lué chez 40 patients avec un score à l’échelle de Kurtzke inférieur
ou égal à 7,0 (déambulation de plus de 5 mètres avec ou sans aide
technique). Ces patients ont bénéficié de 3 périodes de 8 semaines
de traitement : kinésithérapie au domicile, kinésithérapie en
externe à l’hôpital (2 séances de 45 minutes par semaine), pas de
kinésithérapie, ces périodes étant séparées par un intervalle de
8 semaines. L’ordre des périodes de traitement était déterminé
de façon randomisée. Les évaluations étaient faites la semaine
précédant et la semaine suivant la période de traitement, puis
8 semaines après la dernière période, et portaient sur le critère
principal (index de mobilité Rivermead) et les critères secondaires
(équilibre, marche, fonction du membre supérieur, cognition,
humeur). Le patient et son entourage donnaient également leur
opinion quant aux effets sur la mobilité, la détresse relative aux
conséquences de la mobilité, les chutes. Cette étude mettait en
évidence un effet significativement positif d’une période de
8 semaines de rééducation (2 séances par semaine) sur la mobi-
lité, le bien-être subjectif et l’humeur, par rapport à l’absence de
kinésithérapie, sans différence entre les prises en charge à l’hô-
pital ou en libéral.
Enfin, une communication récente de Lassalle et al. (5) a mis en
évidence l’effet positif d’un séjour de rééducation en centre spé-
cialisé sur les sous-scores physiques de la SEP-59.
QUAND ET OÙ RÉÉDUQUER ?
La rééducation est indiquée dès l’apparition de symptômes
gênants persistants. Romberg et al. (6) ont ainsi mis en évidence
l’efficacité de la prise en charge rééducative pour des patients
avec des scores de 1 à 5,0 sur l’échelle de Kurtzke. Elle est éga-
lement indiquée au décours immédiat d’une poussée (7) ; la seule
limite alors sera la fatigue, qu’il conviendra de respecter en adap-
tant le programme de rééducation. Dans ce dernier cas, la prise
en charge par une équipe pluridisciplinaire a montré sa supério-
rité sur une hospitalisation en milieu neurologique classique (7).
En dehors des poussées, il ne semble pas y avoir de différence
significative entre une prise en charge par un kinésithérapeute
libéral et une prise en charge en externat ou en hospitalisation de
jour (4). Dans notre expérience, cependant, les déplacements hors
du domicile peuvent être source de fatigue ; néanmoins, ils peu-
vent, dans certains cas, être indispensables au maintien d’une vie
sociale a minima, en particulier pour les patients les plus isolés.
En pratique, le nombre réduit d’unités spécialisées et de cabinets
de kinésithérapie se disant aptes à prendre en charge ces patients,
en dehors de tout problème d’accessibilité, rend aléatoire toute
tentative de systématisation de la prise en charge.
COMMENT RÉÉDUQUER ?
Techniques classiques
Les techniques de rééducation utilisées sont les techniques clas-
siques, applicables dans toutes les pathologies neurologiques.
Des étirements des muscles spastiques doivent être réalisés afin
d’éviter des complications musculo-tendineuses et de permettre
aux muscles antagonistes de s’exercer.
Les sollicitations motrices s’aident des séquences de redresse-
ment inspirées de Bobath : à quatre pattes, genoux dressés, en
chevalier servant, debout, etc., chaque étape permettant le travail
des muscles déficitaires et de l’équilibre, sur un mode de plus en
plus complexe, et le travail des perceptions corporelles. Le ren-
forcement musculaire se fait en concentrique (sens de raccour-
cissement du muscle) et en excentrique, mode qui permet d’évi-
ter le renforcement de la spasticité, et uniquement contre
résistance manuelle. Les muscles qui ont besoin d’être renforcés
sont le plus souvent les fléchisseurs des membres inférieurs, et il
convient d’insister sur les ischio-jambiers et le tronc. L’utilisa-
tion de poids comme résistance est à proscrire car elle ne permet
pas une adaptation fine aux signes de fatigue et peut conduire à
un épuisement musculaire.
La rééducation proprioceptive se fait sur des plans instables
(mousses, plateau de Freeman, ballon de Klein), en charge
(debout) ou en décharge (allongé ou assis), et peut s’aider d’un
feed-back visuel (balances, par exemple, pour contrôler la symé-
trie de l’appui).
Ces techniques sont utilisées à des fins fonctionnelles : travail des
transferts, du schéma postural, de la marche.
Techniques plus spécifiques
La cryothérapie à visée antispastique, voire antitremblements
et antifatigue, est souvent proposée aux patients SEP thermo-
sensibles, dont l’état est aggravé par la chaleur (70 % des
patients). Il existe différents modes d’application en services

MISE AU POINT
La Lettre du Neurologue - vol. X - n° 4 - avril 2006
124
spécialisés (application locale sur les membres via un système de
refroidissement à 4°, balnéothérapie froide de 18° à 5°). Son mode
d’action est actuellement non élucidé, sa durée d’action limitée à
2 heures environ. Il n’existe pas encore de système commercialisé
pour l’utilisation individuelle de cette technique par les patients.
L’utilisation de pack glacé appliqué sur les muscles spastiques
gênants (adducteurs, par exemple, avant un sondage) ou une
douche froide peuvent en reproduire partiellement les effets.
Chez ces patients thermosensibles, la balnéothérapie réalisée
dans des eaux chaudes (32° à 34°) est fortement déconseillée.
Le reconditionnement à l’effort correspond au réentraînement de
l’organisme à des efforts d’intensité croissante. Il permet de dimi-
nuer la fatigue des patients (8). Il peut consister en une marche
sur tapis roulant à une vitesse et avec une résistance croissantes,
à faire du vélo sur une durée et avec une résistance croissantes,
ou en une verticalisation sur appareil modulaire de verticalisation
sur une durée progressivement croissante.
La gestion de la fatigue est le seul élément spécifique à la SEP,
et le plus difficile à mettre en place. Il s’agit pour le patient de
reconnaître les signes avant-coureurs de l’épuisement et de
s’arrêter juste avant, afin de récupérer mieux et plus rapide-
ment. Très contraignante au départ, cette gestion permet à moyen
terme de faire les mêmes efforts sans être épuisé, quitte à les faire
en plusieurs étapes, puis d’en faire plus. Les signes “d’alarme”
peuvent être l’apparition d’un steppage, d’un recurvatum du
genou, de paresthésies. Lorsqu’il n’existe pas de signes repé-
rables par le patient, la réalisation d’un “test” (marche sur tapis
roulant, verticalisation) permet de chronométrer la durée
d’apparition de l’épuisement, et d’interrompre systématique-
ment le patient quelques minutes avant ce temps. Il convient
également pour le patient de détecter le mode de récupération
optimal : debout, appuyé ou non (sur un mur, sur des cannes),
assis, allongé. La gestion de la fatigue doit ensuite pouvoir
être intégrée au quotidien et être appliquée lors des séances de
kinésithérapie (alternance de travail actif et passif, pauses fré-
quentes à visée de récupération), mais aussi dans toutes les autres
activités.
PLACE DE L’ERGOTHÉRAPIE
Il s’agit d’une prise en charge neurologique classique sur un ver-
sant rééducatif et réadaptatif, dont la place va en augmentant avec
le score d’EDSS du patient.
Cette prise en charge permet par exemple d’évaluer les aides
techniques pertinentes pour une autonomie maximale du patient
dans sa vie quotidienne, en toute sécurité et avec une dépense
énergétique minimale, ou d’adapter l’environnement aux diffi-
cultés du patient. Les ergothérapeutes utilisent les aides dispo-
nibles sur le marché, les confectionnent et/ou les adaptent au
patient. Les limites sont le non-remboursement de certaines aides
techniques existantes, la rareté et le non-remboursement de l’ergo-
thérapie libérale, qui la réservent de ce fait au secteur hospitalier.
Parmi les techniques et aides techniques régulièrement utilisées,
citons les techniques de désensitivation et les lests.
Les techniques de désensitivation sont utilisées dans les cas de
paresthésies gênantes (palmaires le plus souvent). Des stimula-
tions extéroceptives par des haricots secs, des lentilles sèches ou
des picots réduisent dans certains cas ces paresthésies, pour des
durées variables.
Les lests sont constamment essayés dans les syndromes cérébel-
leux des membres, sous réserve d’une absence de déficit moteur
sous-jacent. Sous forme de bracelet, ils permettent de stabiliser
le membre et de limiter le tremblement ou la dysmétrie. Ils peu-
vent également stabiliser un déambulateur à roues.
PLACE DE L’ORTHOPHONIE
Elle prend en charge soit les troubles de la déglutition, soit les
troubles cognitifs.
Les troubles de la déglutition touchent 24 à 34 % des patients
atteints de SEP, et leur prévalence augmente avec l’EDSS.
L’atteinte de la phase orale, volontaire, est constante et justifie
une prise en charge par un orthophoniste spécialisé. Notons
toutefois que les stratégies compensatoires posturales (position
menton-sternum lors de la déglutition) permettent la résolution
de 94 % des fausses routes.
Les troubles cognitifs concernent 40 à 65 % des patients atteints
de SEP. Ils sont principalement de type frontal, avec une atteinte
de la mémoire, de l’attention et des fonctions exécutives. Ils sont
associés dans 50 % des cas à un syndrome dépressif, ce qui rend
le diagnostic parfois peu aisé. La rééducation de ces troubles est
non spécifique de la pathologie.
LA PRISE EN CHARGE PSYCHOLOGIQUE
Elle est indispensable du fait du caractère évolutif de la pathologie,
qui ne permet pas au patient de se projeter dans l’avenir et qui l’oblige
à s’adapter constamment à un handicap changeant. Elle est cependant
difficile à instaurer en externe et reste actuellement non remboursée.
CONCLUSION
La rééducation est un traitement efficace dans la SEP. Elle permet
d’optimiser la récupération après une poussée, et de stabiliser les
capacités des patients dans les formes progressives. Elle s’appuie
sur des techniques de kinésithérapie neurologique classique mais
s’associe à une gestion de la fatigue, garante du maintien des
acquis à moyen terme. Sous réserve de la bonne compréhension
de celle-ci, et surtout de son intégration dans la vie quotidienne,
la rééducation ne fatigue pas le patient, mais améliore ses per-
formances. Enfin, une rééducation efficace est une rééducation
dont le patient est partie prenante. C’est pourquoi il est essentiel
que les objectifs de la prise en charge soient clairement définis
avec le patient et/ou son entourage. Ces objectifs se doivent d’être
clairs, adaptés et réalistes, et surtout d’être identiques pour le
patient et l’équipe qui le prend en charge.
■

La Lettre du Neurologue - vol. X - n° 4 - avril 2006 125
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
1.
Cantalloube S, Monteil I, Lamotte D et al. Évaluation préliminaire des effets
de la rééducation sur les paramètres de force, d’équilibre et de marche dans la
sclérose en plaques. 2006 (Sous presse).
2.
Robineau S, Nicolas B, Gallien P et al. Renforcement musculaire isocinétique
excentrique des ischio-jambiers chez les patients atteints de sclérose en plaques.
Ann Readapt Med Phys 2005;48:29-33.
3.
Granger CV, Cotter AC, Hamilton BB et al. Functional assessment scales: a
study of persons with multiple sclerosis. Arch Phys Med Rehabil 1990;71:870-5.
4.
Wiles CM, Newcombe RG, Fuller KJ et al. Controlled randomised crossover trial
of the effects of physiotherapy on mobility in chronic multiple sclerosis. J Neurol
Neurosurg Psychiatry 2001;70:174-9.
5.
Lassalle A, Durufle A, Le Tallec H et al. Impact de la prise en charge réédu-
cative en centre de rééducation sur la qualité de vie des patients atteints de SEP :
étude prospective. Ann Readapt Med Phys 2005;48(7): 529.
6.
Romberg A, Virtanen A, Ruutiainen J et al. Effects of a 6-month exercise pro-
gram on patients with multiple sclerosis. Neurology 2004;63:2034-8.
7.
Craig J, Young CA, Ennis M et al. A randomized controlled trial comparing
rehabilitation against standard therapy in multiple sclerosis patients receiving
intravenous steroid treatment. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2003;74:1225-30.
8.
Petajan J, White A. Recommendations fort physical activity in patients with
multiple sclerosis. Sports Med 1999;27:179-91.
I. La rééducation des muscles déficitaires chez les
patients atteints de SEP fait appel à :
a. un renforcement contre résistance manuelle
b. un renforcement contre résistance passive (poids)
c. l’électrostimulation
d. le renforcement est contre-indiqué chez ces patients
II. La prise en charge de la spasticité chez les patients
atteints de SEP utilise :
a. la toxine botulique
b. le baclofène intrathécal
c. les étirements et postures d’inhibition
d. la cryothérapie
AUTO-ÉVALUATION
AUTO-ÉVALUATION
Résultats : 1 : a (l’électrostimulation n’a aucun intérêt) ; II : c et d dans tous les cas ; a si la spasticité focale est
fonctionnellement gênante ; b si la spasticité est diffuse et que le patient est non-marchant (EDSS > 7,0).
Informations : www.eurostroke.org – Inscription : 100 euros
ESC Satellite symposium on TIA
Lundi 15 mai 2006, Maison de la Chimie, Paris.
Chairs of the Symposium :
Pierre Amarenco and Michael G. Hennerici
1
/
4
100%