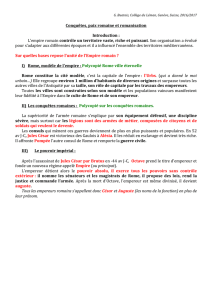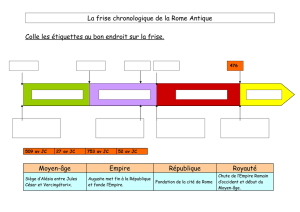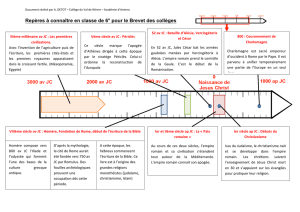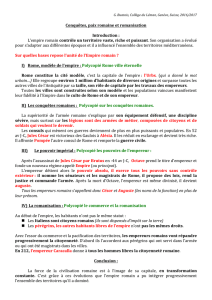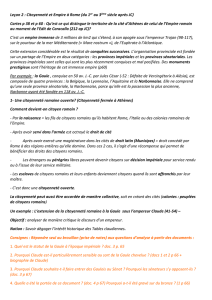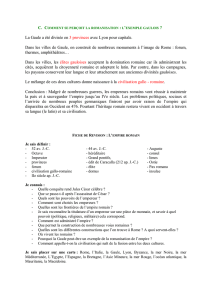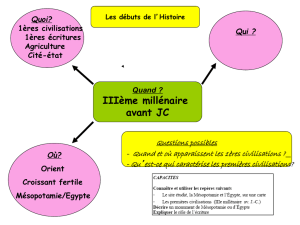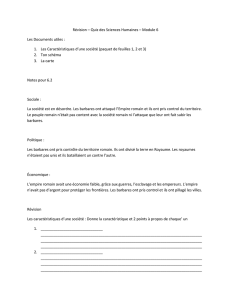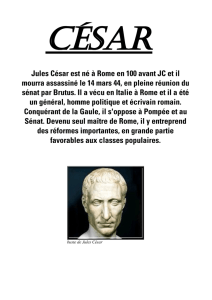Les Barbares - L`Histoire antique des pays et des hommes de la

HISTOIRE UNIVERSELLE
Les Barbares (de 117 à 395 ap. J.-C.)
Par Marius Fontane

CHAPITRE PREMIER
DE 117 à 138. - La monarchie romaine. - Exotisme. - Les Chrétiens ennemis de l'État. -
Christianisme divisé. - Adrien empereur. - Paix avec les Roxolans et les Sarmates. - Révolte et
écrasement des juifs. - Le Livre de Judith. - Les Chrétiens responsables. - Administration d'Adrien.
- Édit perpétuel. - Voyages de l'empereur.- Bretagne abandonnée. - Rhodiens et Hellènes. - Adrien
à Athènes. - Villes monumentales. - Architecture. - La villa de Tibur
CHAPITRE II
Adrien artiste et écrivain. - L'ignorance romaine. - Les idées nouvelles. - Romains, Juifs et
Chrétiens. - Tolérance impériale. - Dilettantisme et moeurs d'Adrien. - Apologies du Christianisme:
Quadratus, Aristide, les Pères. - Polémique. - Littérature romaine : Martial, Stace, Quintilien,
Tacite, Pline le jeune, Juvénal
CHAPITRE III
Infatuation romaine. - Historiens : Quinte-Curce, Suétone, Florus, Velleius Paterculus, etc. -
Marseille et les sophistes. - Langues grecque et latine. - Littérature syrienne. - Littérature
hellénique : Plutarque, Dion Chrysostome, Appien. - Auteurs africains: Carthage. - Le nouveau latin
et la littérature chrétienne. - Architecture. - Statuaire et sculpture. - Colonne Trajane. - Peinture. -
Dernier effort artistique. - Mort d'Adrien
CHAPITRE IV
DE 138 à 161. - Antonin empereur. - Le Droit et les jurisconsultes. - Paix profonde. -
Administration et politique d'Antonin. - Persécution des Chrétiens. - Conflit social. - Christianisme
judéo-hellénique. - Apologie de Justin. - Philosophie. - La langue grecque et la langue latine. -
Contre les Juifs et les Chrétiens. - Victoires des martyrs. - Antonin tolérant. - Chrétiens et
philosophes. - Littérature : Fronton, Aulu-Gelle, Apulée
CHAPITRE V
DE 161 à 180. - Marc-Aurèle empereur. - Guerre aux Parthes. - Lucius Verus associé à l'Empire. -
Barbares. - Persécution des Chrétiens. - Christianisme divisé : gnostiques et montanistes. - Asie
Mineure judaïsée. - Nazaréens et Ebionites. - Catholicisme. - Femmes chrétiennes. - Mort de Verus.
- Les Germains à Aquilée. - Rome ruinée. - Les Barbares. - La légion fulminante. - Révolte de
Cassius. - Poussée des Goths. - Victoires et mort de Marc-Aurèle
CHAPITRE VI
L'éducation chrétienne. - Canon des Écritures. - Pédagogues d'Asie Mineure: Dion de Pruse, Galien.
- Pausanias. - Philosophie : Épictète, Arrien, Fronton, Marc-Aurèle. - Paganisme et Christianisme :
Celse, Lucien, Justin, Tatien. -- Le Christianisme en Espagne, Bretagne, Éthiopie et Gaule. - Pothin
et Irénée. - Persécution à Lyon. - Arles, Marseille et Nîmes. - Philosophes et apologistes. - Minutius
Félix. - Séparation du Judaïsme et du Christianisme. - Papias : la fin du monde et le règne du
Christ. - L'Église catholique et l'Empire

CHAPITRE VII
DE 180 à 222. - Christianisme cosmopolite et révolutionnaire. - Commode, empereur, traite avec
les Barbares. - Pérennis et Cléander. - Pertinax empereur. - L'Empire aux enchères. - Didius
Julianus achète le pouvoir. - Quatre empereurs. - Albinus, Niger et Septime Sévère. - Guerre aux
Parthes. - Persécution des Chrétiens. - Révolte en Bretagne. - Les jurisconsultes et le Droit. -
Apollonius de Tyane. - Caracalla et Geta. - Mort de Papinien. - Paix achetée aux Barbares. -
Caracalla en Égypte et en Orient. - Artaban. - Macrin, empereur, traite avec les Parthes. - Ardachir.
- Héliogabale empereur. - Le dieu d'Émèse à Rome
CHAPITRE VIII
DE 222 à 244. - Alexandre Sévère, empereur. - Christianisme d'Origène. - Chrétiens et
jurisconsultes. - Tertullien. - Littérature chrétienne. - Traduction de la Bible hébraïque. - L'Église
d'Afrique. - Triomphe de Paul. - Les Syriens. - Bardesane. - Ardachir. - Guerre en Asie. - Germains
en Gaule et en Illyrie. - Maximin empereur, vainqueur des Alamans. - Les deux Gordiens
empereurs. - Balbin et Pupien empereurs. - Persécution des Chrétiens. - Gordien III empereur. -
Les Francs. - Les Goths. - L'Arabe Philippe empereur. - L'Empire perse et l'Empire romain
CHAPITRE IX
DE 238 à 260. - Sapor Ier, Roi des rois. - Philippe empereur. - Goths et Carpi. - Jotapien, Pacatien,
Marius et Dèce empereurs. - Le pape Victor et la célébration de la pâque : Rome, Ephèse et Lyon
en désaccord. - Cniva, roi des Goths. - Gallus empereur. - Émilien. - Valérien empereur. - Barbares
et Perses. - Persécution violente des Chrétiens. - Alamans. - Confédération des Francs. - Pirates. -
Scythes. - Goths. - Suèves, Alains, Vandales et Saxons. - Gallien et Postume. - L'Europe contre
Rome. - Valérien, prisonnier des Perses. - Palmyre : Odenath II roi. - Manès (Manichée) et
Marcion. - Le pape Corneille et le prêtre Novatien. - Les Cathares. - École chrétienne d'Alexandrie.
- Christianisme de Paul, juif
CHAPITRE X
DE 260 à 275. - Gallien empereur. - Les Trente Tyrans. - Odénath. - Goths en Asie Mineure. -
Palmyre. - Alamans en Italie. - Victorinus, Victorina, Marius, Tétricus en Gaule. - Salonine et Plotin.
-Claude Il empereur. - Goths refoulés. - Probus et l'Égypte romaine Architecture. - Romains et
Égyptiens. - Les Blémyes. - Aurélien empereur. - L'empire palmyrénéen : Wabalat. - Zénobie et
Longin. - Paul de Samosate et le pape Félix. - Victoires d'Aurélien. - Hormisdas et Varane, Roi des
rois. - Agitations religieuses en Asie. - Martyre de Manès. - Deux christianismes. - Les juifs. -
Manichéens. - Triomphe d'Aurélien à Rome. - La Gaule historique, indépendante
CHAPITRE XI
DE 275 à 303. - Tacite, Florianus et Probus empereurs. - Germains et Germanie. - Burgundes,
Francs, Goths et Saxons. - Gaule et Gaulois. - Celtes. - Proculus et Bonosus usurpateurs. - Narsès,
Roi des rois. - Transportations de peuples. - L'usurpateur Saturninus. - Carus empereur ; Carin et
Numérien césars. - Dioclétien empereur. - Révolte des Bagaudes gaulois. - Carausius empereur en
Bretagne. - Dioclétien s'adjoint Maximien ; Galère et Constance Chlore césars. - Partage de
l'Empire. - Barbares en Gaule. - Julien et Achillée usurpateurs. - Maures soulevés. - L'Afrique
romaine. - L'Égypte. - Traité de Nisibe avec les Perses. - Calédoniens : Picti et Scots. - Politique de
Dioclétien. - Barbares et Empire

CHAPITRE XII
Dioclétien et le Christianisme. - Les augustales. L'Église d'Afrique. - Christianisme d'Occident,
aryen. - Collèges chrétiens pour les funérailles: cimetières, catacombes. - Christianisme d'Asie :
Ebionites et Nazaréens. - Épictète et Papias. - Numénius d'Apamée. - Éclectisme alexandrin. - Juifs
: la Cabbale et le Talmud. - Influences iraniennes et bouddhiques. - Juifs isolés : la Mischna. -
Christianisme militant. - Mithra. - Carthage rivale de Rome. - Traduction de la Bible en latin. - La
religion de Jésus faussée
CHAPITRE XIII
DE 303 à 321 - L'édit de Dioclétien contre les Chrétiens : persécution violente. - Influence des
songes. - Abdication de Dioclétien et de Maximien. - Administration de l'Empire ruiné. - Courtisans.
- Galère et Constance. Chlore, augustes. - Daïa (Maximin) et Sévère, césars. - Constantin et
Maxence, augustes. - Les six satrapes de l'Empire morcelé. - Maxence et Maximien à Rome. -
Licinius, auguste. - L'usurpateur Alexandre. - Constantin au pont de Milvius: apparition de la croix
lumineuse. - Victoires de Constantin sur les Barbares. - Licinius et Constantin seuls empereurs. -
Force du Christianisme. - Barbares dans les légions. - Constantin protecteur des Chrétiens,
empereur unique. - Édits de Milan. - Conversion de Constantin
CHAPITRE XIV
Triomphe du Christianisme. - Les philosophes et le droit. - Histoire, éloquence, science, poésie,
théâtre. - Impôts. - Curiales, colons et industriels. - Crédit foncier. - Plèbe, bourgeoisie, noblesse. -
Sénateurs. - Cités, villes, provinces. - Assemblées provinciales. - Fin de Rome : religion,
superstitions, divinités, famille, moeurs. - Organisation de l'Église. - Évêques représentants du
peuple. - Clercs et laïques. - Corps sacerdotal privilégié par Constantin. - Rome siège de l'autorité
ecclésiastique. - Catholicisme conquérant. - Hérésies : Cécilien, Donat et les traditeurs. - Guerre
religieuse. - Arius et les manichéens. - Le Christianisme et les Barbares
CHAPITRE XV
Germanie et Germains. - Sarmates. - Scythie et Scythes. - Germains et Barbares. - Gaule et
Gaulois. - Celtes. - Gallia romaine. - Celtibères. - Celtes de Germanie et des Gaules. - Beiges. -
Galls et Germains. - Première civilisation gauloise. - Scandinaves et Phéniciens en Gaule. - Ibères,
Eusques, Basques et Cantabres. - Ibères en Ligurie. - Le royaume celtique. - Poème d'Hildebrand. -
Atuatiques, Helvètes et Bohémiens. – Extension des Celtes. - Le Rhin
CHAPITRE XVI
Celtes et Hellènes. - Ancienne Celtique. - Galates. - Celtes, Maures, Arabes scénites (Sarrasins),
Éthiopiens et Perses. - Races teutonique, lithuanienne, gothique ou scandinave, scythe ou slave,
ouralo-altaïque ou finnoise. - Fin de la Germanie conventionnelle. - Alamans et Francs. - Bible et
Évangiles. - Barbares finnois et asiatiques à Rome. - Le pape héritier des Césars
CHAPITRE XVII
Ancienne et nouvelle Germanie. - Alamans et Alamanie. - Histoire des Germains, des Goths, des
Burgundes et des Francs. - Mœurs des Germains. - Aryens et Finnois, ou Scandinaves. - Funérailles
et hospitalité. - Influence romaine, corruptrice. - Moeurs des Burgundes et des Francs. - Rois francs
: hérédité

CHAPITRE XVII (Suite)
Moeurs des Goths. - Vandales. - Histoires et moeurs des Ibériens. - Ligures. - Iones de Marseille. -
La Germanie aux Alamans. - L'œuvre aryenne. - L'invasion. - Aristocratie chrétienne. - Rome et
Constantinople. - Sarmates et Goths en Scythie. - La famille européenne divisée. - Influence de la
Bible hébraïque. - Christianisme gouvernemental. - Pape et Empereur. - Jésus, Jéhovah et Odin. -
Les Barbares, armée de l'Église. - Bois sacrés et cathédrales
CHAPITRE XVIII
DE 321 À 353. - Constantin maître de l'Empire. - Hormisdas chrétien. - L'Église et l'Empire. -
Concile et Symbole de Nicée : Credo. - Byzance. - Inauguration de Constantinople. - La politique
impériale et l'Église. - Mort de Constantin, baptisé. - École d'Athènes. - Athanase et Arius. -
Christianisme égyptien. - Appel au bras séculier et excommunication. - L'héritage de Constantin:
Constantin II, Constant, Dalmace et Annibalien. - Guerre aux Perses. - Magnence, Népotianus et
Vétranion, usurpateurs. - Constance empereur unique
CHAPITRE XIX
DE 353 À 361. - Constance empereur. - Église grecque et Église latine. - Gallus et Sylvain
usurpateurs. - Julien en Gaule. - Défaite de Chnodomar, roi des Alamans. - Guerres de Constance
en Germanie et en Orient. - julien, auguste. - Francs et Alamans. - L'Occident et l'Orient séparés. -
Dédicace de Sainte-Sophie à Constantinople. - Le pape Libère et l'antipape Félix. - Disputes
religieuses. - Victoires de Sapor II. - Perses et Romains. - Julien empereur, apostat. - Édit de
tolérance universelle. - Constance et Julien
CHAPITRE XX
DE 361 à 375. - Philosophes, devins et Chrétiens. -- Luttes d'évêques. - Guerre en Asie. -
Apostasie, paganisme et règne de Julien. - Jovien empereur, - Paix honteuse avec Sapor II. -
Valentinien et Valens empereurs d'Occident et d'Orient, Milan et Constantinople tapi tales. -
Barbares en Europe. - Révolte de Firmus en Afrique. - Procope, usurpateur. - Valentinien en Gaule.
- Burgundes alliés des Romains. - Victoires sur les Alamans. - Théodose, pacificateur de la
Bretagne et de l'Afrique, décapité. - Trajan et Vadomaire en Orient. - Règne et caractère de
Valentinien. - Tolérance ; résistance des Chrétiens
CHAPITRE XXI
DE 367 à 378. - L'Église et l'Empire en conflit. - Valens sectateur d'Arius. - Gratien et Valentinien II
empereurs. - Terreur judiciaire. - Désordres du christianisme romain : Damase et Urbin. - Goths
nationalisés leurs traditions historiques. -. Fondation de l'Europe. - Ermanaric. - Invasion des Huns.
- Withimer et Athanaric. - Lucipin et Maxime affament et exploitent les Goths vaincus. - Révolte
des Goths, Fritigern roi. - Mort de Valens. - Goths chrétiens, de la secte d'Arius. - Histoire des
Huns. - Alains. - Ulphilas et la Bible gothique. - Règne et caractère de Valens
CHAPITRE XXII
DE 378 à 388. - Peuples en Europe : Traditions historiques. - Les Sarrasins (Arabes). - Gratien et
Théodose. - La nation gothique. - Athanaric à Constantinople. - L'Église et Théodose. - Grégoire de
Nazianze. - Arius et Apollinaire condamnés. - Le pape Damase réorganise l'Église. - Prestige de
Rome. - Empire théocratique. - L'usurpateur Maxime. - Grande-Bretagne ravagée : Pictes, Scots,
Frisons, Saxons. - Justine et Valentinien II. - Saint Ambroise. - Catholicisme persécuteur. - Religion
d'État. - Orthodoxes et hérétiques. - Droit ecclésiastique. - Procès, condamnation et exécution de
Priscillien
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114
 115
115
 116
116
 117
117
 118
118
 119
119
 120
120
 121
121
 122
122
 123
123
 124
124
 125
125
 126
126
 127
127
 128
128
 129
129
 130
130
 131
131
 132
132
 133
133
 134
134
 135
135
 136
136
 137
137
 138
138
 139
139
 140
140
 141
141
 142
142
 143
143
 144
144
 145
145
 146
146
 147
147
 148
148
 149
149
 150
150
 151
151
 152
152
 153
153
 154
154
 155
155
 156
156
 157
157
 158
158
 159
159
 160
160
 161
161
 162
162
 163
163
 164
164
 165
165
 166
166
 167
167
 168
168
 169
169
 170
170
 171
171
 172
172
 173
173
 174
174
 175
175
1
/
175
100%