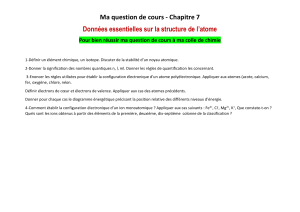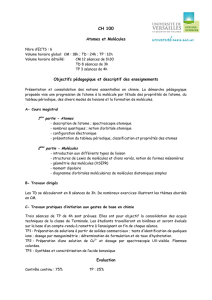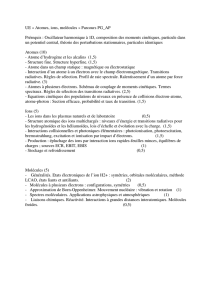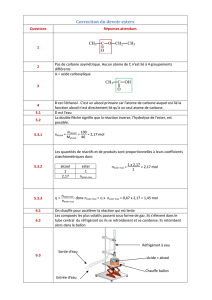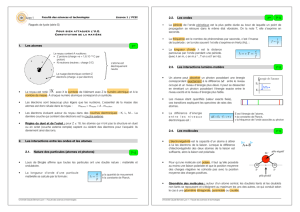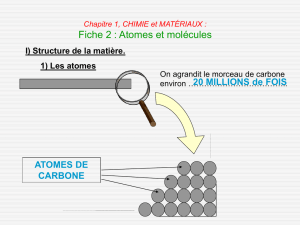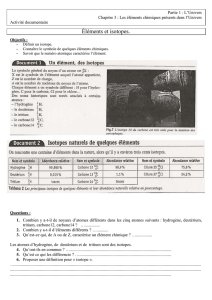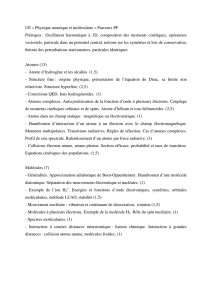2 de Livre du professeur PROGRAMME 2010

Sous la direction de
Mathieu Ruffenach
Inspecteur d’académie, inspecteur pédagogique régional,
académie de Montpellier
Sophie Decroix
Professeur en classes préparatoires, Montpellier
Thierry Cariat
Lycée Dhuoda, Nîmes
Pierre Fabre
Lycée Joliot-Curie, Sète
Bastien Gravière
Lycée Lalande, Bourg-en-Bresse
Adeline Marois
Lycée Victor-Duruy, Paris
Dominique Mercier
Valérie Mora
Polytech, Montpellier
Frédéric Patto
Lycée français La Pérouse, San Francisco
Stéphane Serrano
Lycée Philippe-Lamour, Nîmes
Cédric Vial
Lycée Honoré-d’Urfé, Saint-Étienne
2
Livre du professeur
de
PROGRAMME 2010

SOMMAIRE
1 Analyse de signaux périodiques ................... 3
2 Imagerie médicale ................................ 8
3 Des atomes aux ions .............................. 14
4 Composition d’un médicament ................... 18
5 Les molécules présentes dans les médicaments . . . 23
6 Fabrication de médicaments ...................... 27
7 Observation et analyse de mouvements ........... 31
8 Appréhender la nature des mouvements ......... 36
9 Chronométrage et mesure de durées .............. 43
10 Concentrations et quantité de matière ............ 48
11 Transformations chimiques et activité . . . . . . . . . . . . . 53
12 Pression et plongée ............................... 58
13 Pression et sport en altitude ...................... 64
14 Les matériaux et molécules du sport .............. 70
15 À la découverte de l’Univers ....................... 75
16 Lumière d’étoiles ................................. 80
17 Les éléments chimiques dans l’Univers ............ 85
18 La gravitation universelle ......................... 89
Compléments
Sciences et histoire des arts ........................... 94
Culture scientifique ................................... 96
© BORDAS / SEJER 2010
ISBN : 978-2-04-732674-9

3
cHaPitre
PHYSIQUE
Manuel, p. 12 1
Analyse de signaux
périodiques
SITUATION 3
Cette situation permet d’introduire l’une des différences
entre onde sonore et onde électromagnétique, à tra-
vers une erreur que l’on retrouve fréquemment dans
les jeux vidéo et les films de science-fiction : les ondes
sonores ne se propagent pas sans support matériel, et
ne peuvent donc pas se propager dans le vide, à la dif-
férence des ondes électromagnétiques. Les explosions
dans l’espace sont par conséquent visibles, mais pas
audibles. Cette situation est reprise, en guise d’intro-
duction, dans la seconde partie de l’activité 3.
activités
ACTIVITÉ 1
Les phénomènes périodiques p. 14
1. Fig. 1 : Passage au rouge, passage à l’orange, pas-
sage au vert des feux de signalisation.
Fig. 2 : Les phases de la Lune.
Fig. 3 : Ouverture de la paupière, fermeture de la pau-
pière ou battements des cils.
Fig. 4 : Parution régulière des journaux.
Fig. 5 : Répétition régulière des cours, des salles fré-
quentées…
Fig. 6 : Tour complet du cadran par les 3 aiguilles de
l’horloge.
2. Fig. 1 : Le temps qui s’écoule entre deux passages au
rouge (vert, orange) est de l’ordre de quelques minutes,
il dépend de la situation des feux de signalisation.
Fig. 2 : Deux phases de la Lune identiques sont sépa-
rées d’environ 29,5 jours.
Fig. 3 : Il suffit de mesurer le nombre de battements
de cils en une minute par exemple, puis de diviser une
Les compétences à acquérir du chapitre 1
1. Savoir identifier et caractériser un phénomène
périodique sur une durée donnée.
2. Savoir analyser un signal périodique.
3. Savoir définir et distinguer une onde sonore et
une onde électromagnétique.
Évaluation diagnostique p. 12
SITUATION 1
Les tracés
a
et
b
représentent une tension périodique
sur la durée d’acquisition, car ils présentent la répéti-
tion régulière d’un même motif. Le tracé c ne repré-
sente pas une tension périodique, l’amplitude dimi-
nuant au fur et à mesure.
L’identification d’une tension périodique a été trai-
tée en classe de 3e. Elle est reprise dans l’activité 2 sur
l’électrocardiographie. Cette situation introduit aussi
les phénomènes périodiques, abordés dans l’activité 1.
SITUATION 2
La tension alternative périodique sinusoïdale est enre-
gistrée à l’oscilloscope. Elle est caractérisée par sa
période, sa fréquence, la valeur maximale de la ten-
sion et la valeur minimale de la tension. Une tension
alternative périodique sinusoïdale est aussi caractéri-
sée par sa valeur efficace, déterminée par la relation :
Ueff = Umax/
2
.
Dans l’activité 4, les élèves réalisent l’enregistrement
et l’analyse de tensions périodiques à l’oscilloscope.
Les grandeurs telles que la période, la fréquence et
les tensions minimale et maximale sont introduites et
exploitées dans l’activité 2 sur l’électrocardiographie.
Le programme
Notions et contenus Compétences attendues
–
Signaux périodiques : période, fréquence, tension maximale,
tension minimale.
– Ondes sonores, ondes électromagnétiques.
–
Connaître et utiliser les définitions de la période et de la
fréquence d’un phénomène périodique.
–
Identifier le caractère périodique d’un signal sur une durée
donnée.
–Déterminer les caractéristiques d’un signal périodique.

4
ACTIVITÉ 3
De l’onde au son p. 16
1. Qu’est-ce qu’une onde ?
1. a. Non, il n’y a pas de déplacement de matière : les
barreaux retournent à leur position initiale après le pas-
sage de l’onde, ils ne se déplacent pas avec l’onde.
b. C’est la perturbation qui se déplace.
2. Une onde est la propagation d’une perturbation sans
déplacement de matière.
2. Son et lumière
3. a. On peut voir dans l’espace, puisque l’astronaute
peut filmer dans l’espace.
b. On ne peut pas entendre dans l’espace puisque l’es-
pace est majoritairement constitué de vide (structure
lacunaire, voir chap. 13) et que le son ne se propage
pas dans le vide. En effet, on n’entend plus le son du
réveil lorsqu’on a fait le vide dans la cloche.
4. Une onde sonore a besoin de matière (d’un support
matériel) pour se propager.
Pour conclure
5. C’est l’onde sonore se propageant dans l’air qui met
en vibration le tympan de l’oreille.
ACTIVITÉ 4
Tester son audition p. 17
1. Le haut-parleur convertit la tension délivrée par le
GBF en une onde sonore de même fréquence.
2. Voir sur le cahier de l’élève.
3. Mesure de la fréquence et de la tension maximale
pour laquelle on entend un son, à l’oscilloscope.
Fréquence : on détermine la période du signal en calcu-
lant la moyenne sur le plus grand nombre de périodes
présentes sur l’oscillogramme, à l’aide du réglage de la
sensibilité horizontale. On calcule alors la fréquence à
partir de la relation f = 1/T.
Tension maximale : Il faut préalablement bien régler le
« zéro » de l’oscilloscope, puis lire la valeur maximale
du signal correspondant à une détection par l’oreille,
à l’aide du réglage de la sensibilité verticale.
4. Le signal du GBF converti par le haut-parleur est un
signal périodique. Un son est donc une onde sonore
périodique.
5. Les sons aigus correspondent aux hautes fréquences,
les sons graves, aux basses fréquences.
6. Voir sur le cahier de l’élève.
7. a. L’audition est intacte si la tension maximale limite
pour le son de fréquence 17 000 Hz est non nulle.
b. Pour préserver son audition, il faut par exemple évi-
ter d’écouter la musique trop fort.
minute par le nombre trouvé. Deux battements de cils
sont séparés par quelques secondes (introduction à la
notion de fréquence).
Fig. 4 : La parution des journaux quotidiens se répète
tous les jours, des journaux hebdomadaires, toutes les
semaines, des mensuels, tous les mois…
Fig. 5 : L’emploi du temps d’un lycéen se répète à l’iden-
tique chaque semaine (pour certains cours, toutes les
deux semaines).
Fig. 6 : Le tour complet du cadran par la trotteuse est
effectué en 1 min, par la grande aiguille en 1 h et par
la petite aiguille en 12 h.
3. L’emploi du temps du lycéen se répète à l’identique,
hors vacances scolaires, sur la durée d’une année sco-
laire. Certains phénomènes sont périodiques sur une
durée donnée.
4. On peut citer, par exemple, l’inspiration, l’expiration,
les battements du cœur, les menstruations, etc.
ACTIVITÉ 2
Le principe de l’électrocardiographie p. 15
1. a. – Bradycardie : la fréquence cardiaque diminue ;
les motifs sont plus écartés.
– Tachycardie : la fréquence cardiaque augmente ; les
motifs sont plus rapprochés.
– Arrêt cardiaque : il n’y a plus de motifs, seul un trait
au centre est observable.
b. – Bradycardie : la fréquence diminue, la période aug-
mente, les tensions minimale et maximale restent iden-
tiques.
– Tachycardie : la fréquence augmente, la période dimi-
nue, les tensions maximale et minimale restent iden-
tiques.
– Arrêt cardiaque : fréquence, période et tensions maxi-
male et minimale changent.
2. a. Le motif qui se répète périodiquement est :
b. Deux motifs sont représentés sur 8 graduations (il
faut faire la moyenne sur le maximum de périodes repré-
sentées). Une graduation correspond à 200 ms.
Donc 2 T = 8 ¥ 0,200 = 1,60 s et T = 1,60/2 = 0,800 s.
c. On a un battement de cœur toutes les 0,800 s, donc,
en une seconde, on a 1/0,800 battement, soit 1,25 bat-
tement. La fréquence cardiaque est donc de 1,25 bat-
tement par seconde.
3. f = 1,25 ¥ 60 = 75 battements par minute.
Comme 50 < 75 < 110, l’adolescent est en bonne santé.

5
Chapitre 1 Analyse de signaux périodiques
6 1. 10 Hz = 600 battements par minute.
20 battements par seconde = 1 200 battements par
minute.
2,5 Hz = 150 battements par minute.
On classe les fréquences de la plus petite à la plus
grande, et les animaux du plus grand au plus petit (ce
qui est déjà fait dans l’énoncé). On a donc :
Animal (du plus grand
au plus petit)
Fréquence cardiaque
(bpm)
Baleine 10
Cheval 40
Chat 150
Moineau 600
Oiseau-mouche 1 200
2. Par sa taille, l’Homme se situe entre le cheval et le
chat, on peut donc en conclure que sa fréquence car-
diaque se situe entre 40 et 150 battements par minute.
OBJECTIF 2 : Analyser un signal périodique.
7
1. Les signaux
a
,
b
et
d
sont périodiques. Le
signal c n’est pas périodique. Seuls les signaux a et
d
sont des tensions périodiques, le signal
b
étant une
intensité.
2. Vérifier sur le cahier de l’élève.
3. Signal
a
, période : 3T = 12 s donc T = 4 s ; fréquence :
f = 1/T = 1/4 = 0,25 Hz ; Umax = 2 V et Umin = 0 V.
Signal
d
, période : 3T = 1,8 s donc T = 0,60 s ; fréquence :
f = 1/T = 1/0,60 = 1,7 Hz (f = 100 bpm) ; Umax = 1 V et
Umin = – 0,3 V.
8 1. Période : T = 5 div, or le réglage de la sensibilité
horizontale est 0,2 ms/div, donc T = 0,2 ¥ 5 = 1 ms.
Fréquence : f = 1/T avec T = 1 ms = 1 ¥ 10–3 s, donc
f = 1/(1 ¥ 10–3) = 1 ¥ 103 Hz.
2. L’amplitude est ici de 2,6 div, or le réglage de la sensi-
bilité verticale est : 0,2 V/div. Donc U = 2,6 ¥ 0,2 = 0,52 V,
soit Umax = 0,52 V et Umin = – 0,52 V.
3. a. L’amplitude du tracé diminue, le nombre de motifs
de l’oscillogramme reste le même.
b. L’amplitude du tracé reste identique, il y a plus de
motifs représentés sur l’oscillogramme.
9 1.
10 cm
1,4 cm Jour
1 cm Nuit
0,9 cm Intimidation le jour
2 cm Soumission le jour
exercices
OBJECTIF 1 : Identifier et caractériser un phéno-
mène périodique sur une durée donnée.
1 1. Un phénomène périodique est un phénomène
qui se reproduit à l’identique au bout d’un même inter-
valle de temps.
2. La coupe du monde de football
a
, les cycles de res-
piration au repos b, le passage d’un bus à un arrêt de
bus
d
, les élections
e
sont périodiques. Le temps qu’il
fait c n’est pas périodique.
3. a Période de 4 ans. b Période de 3 à 5 secondes.
d
Cela dépend du bus et du jour de la semaine. Deman-
der aux élèves de travailler sur les horaires du bus proche
de chez eux.
e
Pour les élections présidentielles, période
de 5 ans en France depuis 2002.
Le phénomène
d
est périodique sur la durée du service.
2
1. Les phénomènes périodiques cités sont : les crises
économiques, l’expansion, la crise et la récession et le
cycle en lui-même.
2. Entre 1837 et 1937, c’est-à-dire sur 100 ans, on a
constaté 12 cycles de Juglar. Il y a donc 100/12 = 8,3 ans
qui séparent deux cycles de Juglar successifs, soit une
période de T = 8,3 ans.
3
1. La fréquence est le nombre de reproductions
d’un phénomène périodique en une seconde.
2. La période est la durée qui sépare deux reproduc-
tions à l’identique d’un phénomène périodique.
3. a. Faux : si T est multipliée par 2, f est divisée par 2
(on pourra exhiber un contre-exemple, et calculer la fré-
quence d’un phénomène dont la période est doublée).
b. Faux : f n’est pas égale à l’opposée de la période (– T )
mais à son inverse (1/T ).
c. Vrai : f = 1/T donc f ¥ T = 1, si f est exprimée en Hz
et T en seconde.
d. Faux : la période est de 1 jour, mais pour calculer la
fréquence en hertz, il faut que la période soit en seconde.
T = 86 400 s et f = 1/86 400 = 1,2 ¥ 10–5 Hz.
4 1. et 2.
Fréquence
Période Phénomène périodique
440 Hz 2,27 ms Son pur La3
0,017 Hz 1 min = 60 s Tour du cadran par
la trotteuse d’une montre
107,7 MHz 9,285 ¥ 10–9 s Onde radio d’une station
1 Hz
(60 bpm) 1 s Rythme cardiaque d’un sportif
au repos
24 Hz 0,042 s Défilement des images
au cinéma
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
1
/
96
100%