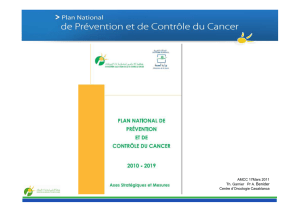EMSP-St-Brieuc ArticleLT-Juillet2015-1

« Vous dormez bien ? Vous n’avez pas de dou-
leurs ? Vous avez vu l’aumônier ? » Lundi
matin, 11 h, service de chirurgie vasculaire du
centre hospitalier Yves-Le Foll. Allongé dans
son lit et pleinement conscient, un homme de
86 ans répond tout doucement aux questions
du Dr Homauon Alipour, le chef de l’unité
mobile de soins palliatifs (UMSP). Autour de
l’ancien urgentiste, deux autres membres du
service sont présents : l’infirmière Dorothée
Tanguy et la psychologue Camille Verdon.
« Ça se passe très bien. Je ne suis pas seul. Et
puis je vais rentrer chez moi », déclare le vieil
homme. Quatre jours plus tôt, le corps médi-
cal est venu annoncer à ce malade aux artères
bouchées et souffrant d’insuffisance rénale
chronique terminale qu’il allait bientôt mou-
rir.
Un moment envisagé par les médecins, l’am-
putation de sa jambe, couplée à la pose d’un
cathéter de dialyse ont été abandonnés. La rai-
son ? Trop de risques de souffrances et de com-
plications pour un gain d’espérance de vie
n’excédant pas quelques mois. « Désormais ce
monsieur va, comme il le désire, rentrer à son
domicile pour y finir sa vie le plus sereine-
ment possible », indique le Dr Alipour.
Ceux pour qui la médecine curative
ne peut plus rien
En fin de semaine dernière, son équipe a été
sollicitée par le service de chirurgie vasculaire
pour avis. Une pratique régulière au sein de
l’hôpital (comme dans plusieurs Ehpad), dès
lors que la guérison n’est plus possible.
« Mais nous ne sommes là que pour le conseil
et le soutien. Le service qui fait appel à nous
reste systématiquement souverain. Le méde-
cin référent décide toujours en dernier lieu.
C’est ce qui s’est passé dans le cas de ce
patient après une réunion collégiale », précise
le Dr Alipour.
Créée au début des années 2000, l’unité
mobile est installée à part au sein de l’hôpital,
dans une petite maison située sous le porche
d’entrée. L’équipe est restreinte : deux infir-
mières, une secrétaire, deux médecins et une
psychologue, tous titulaires d’un diplôme uni-
versitaire spécifique.
Le lundi matin, avant d’aller rendre visite aux
patients, l’équipe étudie lors de son « staff »
hebdomadaire les cas de personnes suivies par
l’unité. Des hommes et des femmes pour qui
la médecine curative ne peut plus rien. Beau-
coup souffrent de cancer, certains sont
déments et souvent très âgés. « Ce sont tous
des cas uniques sur lesquels nous échangeons
collégialement, souligne le Dr Alipour. Le prin-
cipe ici, c’est que chacun enrichit le débat. Car
personne ne détient la vérité en matière de
soins palliatifs. »
« Je ne suis pas le croque-mort
de Lucky Luke »
Soins palliatifs. Deux mots lourds de sens qui
font peur. « Dans la tête de beaucoup de per-
sonnes, le palliatif, c’est le stade terminal.
Mais nous soignons des vivants », insiste Doro-
thée Tanguy qui, comme ses collègues,
n’ignore pas le surnom dont est parfois affu-
blée l’unité : « les anges de la mort ». « Mais,
moi, je ne suis pas le croque-mort de Lucky
Luke. Je ne viens pas prendre les mesures du
cadavre », renchérit le Dr Alipour. « Il y a beau-
coup de choses à faire quand il n’y a plus rien
à faire. Mais différemment », continue la
seconde infirmière du service, Rachel Guenu.
Quels sont les conseils prodigués à leurs col-
lègues par les membres de l’UMSP ? D’abord
éviter l’acharnement thérapeutique. Puis éli-
miner les traitements et les soins futiles. « Il
n’y a aucun sens à faire des prises de sang à
une personne qui va mourir quelques jours
plus tard. C’est également du bon sens d’arrê-
ter un traitement contre le cholestérol »,
détaille le Dr Alipour. « Il est par contre
évident que nous allons soigner une bronchite
pour un patient placé en soins palliatifs. Nous
pouvons prescrire des antibiotiques à visée de
confort. Notre but, c’est vraiment de soulager
le patient de ses douleurs », ajoute sa col-
lègue, le Dr Pascale Chavel.
Du suivi psychologique à l’installation
d’un transistor dans la chambre
Dans ces moments où le temps est compté,
faciliter un retour au domicile (lorsqu’il est
possible et souhaité) fait aussi partie de la
prise en charge globale des patients. Tout
comme l’aide psychologique, l’écoute et le sui-
vi de la famille (lire ci-dessous), mais aussi la
simple installation d’un poste de radio dans la
chambre du malade.
Reste que l’intervention de l’unité se fait sou-
vent à un stade assez avancé de la maladie.
« Nous ne sommes pas suffisamment appelés
par nos collègues et parfois tardivement, alors
que les soins palliatifs peuvent durer des
mois, voir des années », regrette Rachel Gue-
nu. « François Mitterrand a, par exemple, déci-
dé d’être placé en soins palliatifs un an et
demi avant de mourir », cite le Dr Alipour,
avant de poursuivre : « Les médecins sont for-
més à sauver des vies. Ce que nous faisons va
à l’encontre de tout ce qu’ils ont appris. Nous
devons donc apprendre à travailler ensemble
de façon intelligente et réfléchie. »
Julien Vaillant
Ils interviennent lorsque la
médecine curative ne peut plus
rien. Quand le temps est compté.
Les membres de l’unité mobile
de soins palliatifs du centre
hospitalier Yves-Le Foll
accompagnent patients, familles
et personnels médicaux. Pour
soulager le malade de ses
douleurs et ses angoisses, aider
ceux qui resteront et faire entrer
dans les mœurs une médecine
qui ne sauve pas de vie.
Discussion entre trois membres de l’unité mobile
de soins palliatifs du centre hospitalier Yves-Le
Foll : l’infirmière Dorothée Tanguy (au premier
plan), la psychologue Camille Verdon et le
Dr Homauon Alipour. « Notre discipline est
nouvelle. Nous apportons quelque chose de
différent aux patients », explique le chef de
service.
C’est leur texte référence : la loi du 22 avril
2005 relative aux droits des malades et à la
fin de vie, dite loi Leonetti, est le texte sur
lequel s’appuient les membres de l’unité
mobile de soins palliatifs dans leur pratique
quotidienne. « S’il est cohérent, cette loi
permet au patient de demander à stopper
un traitement qu’il estime déraisonnable »,
indique le Dr Alipour.
Pour déterminer l’état de conscience d’un
malade, plusieurs tests existent et une
équipe psychiatrique peut également
intervenir.
Dans le cas où le patient est dément, deux
cas de figures sont possibles. Soit celui-ci a
donné des directives anticipées (par écrit ou
auprès d’une personne de confiance), soit
c’est aux médecins de décider, de façon
collégiale, de lui prescrire, ou non, des soins
palliatifs.
La famille et les proches ont, eux, un avis
consultatif.
Prendre soin des patients, les apaiser, avoir le
temps de réfléchir, de se poser des questions,
se libérer des contraintes administratives, prati-
quer une discipline nouvelle… Autant de raisons
qui ont poussé les membres de l’unité mobile
de soins palliatifs à choisir ce service.
Pour tous, l’un des aspects essentiels de leur tra-
vail, c’est l’accompagnement des familles. Des
familles sur lesquelles ne repose jamais le choix
de passer aux soins palliatifs, puisque leur avis
reste consultatif. « C’est rare qu’ils y soient
opposés. Aujourd’hui, ce sont d’ailleurs nos par-
tenaires, alors qu’hier ils étaient parfois perçus
comme des boulets ou une contrainte, relate
Dorothée Tanguy. Nous avons des informations
à glaner auprès d’eux. Des choses à mettre en
place afin que la fin de vie soit la plus paisible et
confortable pour le patient. »
« Ce sont eux qui vont survivre »
« Nous mettons le paquet sur le malade. Mais
nous devons tout autant soutenir les familles et
les proches. Ce sont eux qui vont survivre »,
estime le Dr Alipour. « Ceux qui restent vivent
avec ce manque. S’ils le désirent, nous pouvons
être une béquille pour eux », continue la psy-
chologue Camille Verdon.
« Il ne faut pas les laisser de côté. La mort est
une rupture affective. Ils vont être abandonnés
par celui qui est allongé. Si nous les abandon-
nons nous aussi dans ce moment-là, la suite
peut être mal vécue. D’où l’importance de les
informer sur ce qui se passe et de les épauler »,
poursuit le Dr Alipour.
« Quand une famille me dit merci, je pense que
j’ai bien fait mon boulot », conclut le Dr Chavel.
Soins palliatifs. Au chevet des vivants
Discipline régie par la loi Leonetti
Les proches, « partenaires essentiels »
SAINT-BRIEUC. REPORTAGE
14 Jeudi 16 juillet 2015 Le Télégramme
1
/
1
100%