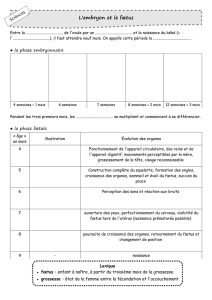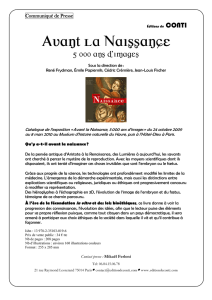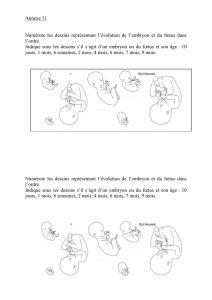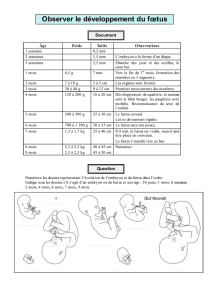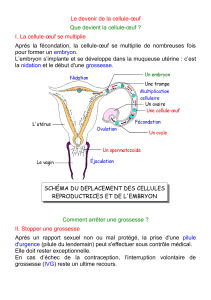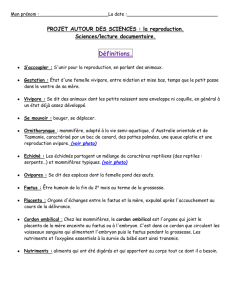G y n é c o e t ... é t

La Lettre du Gynécologue - n° 322 - mai 2007
Gynéco et société
Gynéco et société
6
* Laboratoire d’éthique médicale et de médecine légale, université René-Descartes Paris-5,
45, rue des Saints-Pères, 75006 Paris, et Société française et francophone d’éthique médicale.
SYMBOLIQUE DES EMBRYONS ET DES FŒTUS :
DES CLASSIFICATIONS “ARBITRAIRES” FACE
AUX SENTIMENTS DES FEMMES ET DES COUPLES
Durant longtemps, les tissus embryonnaires et les fœtus expul-
sés lors d’une fausse couche ou d’une interruption de grossesse
étaient considérés comme “déchets hospitaliers” et parfois uti-
lisés pour la recherche sans consentement des femmes. Ces
éléments et produits issus du corps humain étaient laissés aux
équipes médicales et ne faisaient pas l’objet d’intérêt de la part
des femmes et des couples. Mais, depuis une trentaine d’années,
l’évolution de la société et des représentations concernant ces
éléments a changé. Leurs symboliques ont évolué et les femmes
s’attachent à ce qui, sans être encore et vraiment un enfant, n’en
est pas moins une partie d’elles-mêmes. Cette évolution est ren-
forcée par le fait qu’aujourd’hui, très tôt pendant la grossesse, la
femme enceinte voit son enfant à l’échographie qui aboutit à une
“personnification symbolique”, d’autant plus que la technique per-
met aujourd’hui des représentations en trois dimensions in utero
et l’audition des bruits du cœur, source et symbole de vie. Sans
rentrer dans un débat idéologique sur le fait que l’embryon ou le
fœtus soit ou non une personne, et qui fait appel au respect des
convictions de chacun ou aux représentations, il n’en demeure
pas moins que symboliquement, comme le soulignait le Comité
national d’éthique en 1984, on peut parler de personne humaine
potentielle. L’avis de 1984 stipule en ce sens que l’embryon ou
le fœtus doivent être reconnus comme une personne humaine
potentielle qui est ou a été vivante et dont le respect s’impose à
tous (1). De la fécondation à la mort, la vie d’un être humain est
une évolution continue passant par différents stades : embryon-
naire, fœtus, nouveau-né, enfant, etc. Le passage d’un stade à
l’autre se fait sans aucune discontinuité et si, pour la médecine, il
existe des états et des stades, souvent, pour les patients, tel n’est
pas le cas : il s’agit de leur enfant en devenir.
En théorie, le passage de l’embryon au fœtus est habituellement
fixé à deux mois. Un embryon (du grec ancien embruon) est
un organisme en développement depuis la première division de
l’œuf ou zygote jusqu’au stade où les principaux organes sont
formés. Chez l’être humain, ce stade embryonnaire dure huit
semaines, soit dix semaines d’aménorrhée. Au-delà de ce stade
de la grossesse, on parle de fœtus, qui correspond à la matura-
tion des organes.
En droit, ce n’est qu’à la naissance, et à condition de naître
vivant et viable, que la personne acquiert un état civil. L’acte
de naissance est réservé à l’enfant, même décédé au moment
de la déclaration, mais dont il est démontré qu’il a vécu. Dans
le cas contraire, seul un acte d’enfant sans vie pourra être éta-
bli, et encore à condition que la gestation ait duré au moins
22 semaines (ce qui ouvre la possibilité d’être enterré et inscrit
sur les registres d’état civil). En effet, en pratique, le corps de
l’enfant de plus de 22 semaines d’aménorrhée ou de plus de
500 g, né mort, bénéficie d’une procédure à l’état civil (ins-
cription au registre des décès uniquement). Un acte d’enfant
sans vie est produit par l’officier d’état civil sur présentation
d’un certificat médical d’accouchement d’enfant né mort. La
dotation officielle d’un prénom est possible. Si les parents le
demandent, l’inscription sur le livret de famille est possible à
condition qu’ils possèdent déjà un livret de famille. Sinon, dès
l’établissement ultérieur d’un livret de famille (pour mariage
ou naissance), les parents pourront demander l’inscription sur
ce livret de leur enfant né sans vie. Le corps peut être confié
à l’hôpital pour être incinéré ou faire éventuellement l’objet
d’obsèques. Au même terme, un enfant né vivant puis décédé
donne lieu à un acte de naissance et à un acte de décès pro-
duits par l’officier d’état civil sur présentation d’un certificat
médical attestant que l’enfant est né vivant et viable. Dans
ce cas, l’inscription sur le livret de famille est obligatoire. Le
fœtus mort-né de moins de 22 semaines et de moins de 500 g
et son placenta, s’il est théoriquement considéré comme une
“pièce opératoire”, doit cependant être enregistré au sein de
l’institution de soins (inscription sur le registre des pièces ana-
tomiques par les agents de la chambre mortuaire). La gestion
du devenir est alors à la charge de l’établissement, par le circuit
des pièces anatomiques identifiables. Mais la remise du corps
du fœtus à la famille est possible, après restauration tégumen-
taire, pour être, selon ses souhaits, incinéré ou inhumé. On
ressent, bien au-delà de ces descriptifs médicolégaux et admi-
nistratifs définis en 2001 par “simple” circulaire (2), que sou-
vent, à quelques jours près, même à quelques semaines près,
il s’agit en fait d’une situation symboliquement la même pour
la femme et le couple : celle d’une perte, d’une souffrance à
laquelle il faut donner sens, en particulier par des rituels sem-
blables à ceux appliqués pour tous. De plus en plus, la parole
des parents et le respect de leurs choix sont au cœur des déci-
sions et ne peuvent plus être occultés.
Comme le souligne le CCNE dans ses travaux plus récents (3),
si les opinions en France demeurent controversées s’agissant
L’utilisation dans le cadre de la recherche des cellules
et tissus embryonnaires ou fœtaux issus d’une interrup-
tion de grossesse : concepts et réflexions éthiques
IP G. Moutel*

La Lettre du Gynécologue - n° 322 - mai 2007
Gynéco et société
Gynéco et société
7
du statut que l’on devrait ou non accorder au fœtus, en revan-
che, il ne fait aucun doute aux yeux de tous que l’enfant né
vivant, ne fût-ce qu’une seconde, est une personne. Avant sa
naissance, il n’est pas une personne. Cette frontière radicale
sur le plan du droit ne justifie pas évidemment une attitude
binaire de respect absolu dans un cas et de respect relatif dans
un autre, d’autant que cette frontière peut correspondre à des
âges chronologiques différents : une naissance prématurée
suffit à transformer soudain un fœtus en nouveau-né. Le droit
a son formalisme mais le regard porté sur le fœtus, reconnais-
sant son origine humaine, impose le respect. Cela implique
pour les soignants de prendre en compte le corps de ce fœtus
ou de cet enfant mort-né.
Il convient donc de veiller à ce que le regard, forcément ana-
lytique, porté par la médecine et la loi sur les caractéristiques
objectives du fœtus ou du nouveau-né mort (âge chronologi-
que, poids, viabilité, pathologie…) ne heurte pas de front les
représentations affectives que se faisaient les parents de leur
enfant en devenir. En effet, pour eux, ce processus ne peut
être réduit aux caractéristiques précises du stade particulier
auquel son développement s’est soudain interrompu. Dans le
même esprit, les distinctions légales précises (enfant né mort,
vivant, viable ou non viable, enfant décédé avant ou après que
sa naissance ait été déclarée à l’état civil…), même si on peut
concevoir leur éventuelle utilité, ont, au regard des représen-
tations et de la détresse des parents, une dimension arbitraire
qu’on ne peut négliger.
LA RECHERCHE : DES PERSPECTIVES NOUVELLES
POUR LA MÉDECINE
Sur le plan médical, deux domaines bien distincts se déga-
gent, permettant à la médecine de revendiquer un accès aux
embryons et fœtus :
L’utilisation de tissus embryonnaires ou fœtaux dans un
but de recherches fondamentales permettant l’obtention de
lignées cellulaires (à finalité d’amélioration des connaissances,
de travaux de pharmacologie, d’oncologie ou de pharmaco-
génétique…) ou de recherches à finalité thérapeutique (sou-
vent appelées dans les médias recherches sur l’embryon) qui
doivent garder un caractère exceptionnel et être justifiées à la
fois par la rareté des maladies traitées, l’absence de toute autre
thérapeutique également efficace, et l’avantage manifeste que
pourrait apporter une telle approche.
L’utilisation de l’embryon ou du fœtus à des fins diagnosti-
ques (recherche de la cause d’une interruption spontanée de la
grossesse, confirmation des diagnostics in utero), qui est légi-
time, et qui répond à une demande de nombreux couples de
mieux comprendre ce qui s’est passé, démarche fondamentale
pour le travail de deuil, mais aussi pour la préparation et le
suivi de grossesses à venir et pour le progrès des connaissan-
ces en médecine.
Mais il serait erroné de considérer que ce second domaine
est hors du champ de la recherche, car en son sein se mêlent
nécessairement des dimensions de recherche, les cliniciens-
chercheurs essayant en permanence de mettre en évidence
de nouveaux marqueurs pour élucider les causes de malfor-
mations et de décès. Soins et recherche sont donc fortement
intriqués. Des lignées cellulaires, issues d’interruption de
grossesse, sont constituées depuis des dizaines d’années et
leurs études sont essentielles pour la recherche, notamment
pour les maladies génétiques. Pour autant, la recherche des
causes de la mort accompagnée de volets de recherche, tou-
jours essentielle pour comprendre le décès et éventuellement
prévenir une nouvelle pathologie fœtale lors d’une grossesse
ultérieure, ne peut justifier des mesures de conservation sys-
tématique du corps. Les familles peuvent souhaiter procéder
à des rituels d’incinération ou d’inhumation indispensables au
vécu de leur souffrance. C’est la raison pour laquelle, dans tous
les cas, tout prélèvement et toute conservation doivent passer
par une information claire et un consentement explicite.
Depuis 1960, au Wistar Institute de Philadelphie (lignée
WI38) puis au Medical Research de Londres (lignée MRC5)
des lignées fibroblastiques embryonnaires humaines ont été
développées chacune à partir d’un embryon d’IVG. La recher-
che (grâce à l’introduction dans les cellules humaines cultivées
ex vivo d’un gène de virus oncogénique) à partir des tissus pré-
levés a permis la création de lignées de cellules provenant de
certains organes : foie, rein, cartilage... Certaines de ces lignées
sont d’origine embryonnaire et conservent de manière stable
quelques caractères de la différenciation spécifique du tissu
dont elles dérivent. Ces lignées de cellules différenciées sont
d’un grand intérêt pour la recherche et peuvent parfois rem-
placer les modèles animaux. Enfin, certaines de ces cellules en
culture sont et, surtout, pourraient à l’avenir être utilisées à
des fins thérapeutiques.
Les techniques de congélation des cellules permettent des uti-
lisations répétées à partir d’un même stock. Ces lignées ont
été mises à la disposition de l’ensemble de la communauté
scientifique par différentes institutions et sont utilisées pour
la préparation de réactifs, en particulier dans la production
des vaccins.
Outre ces collections de cellules embryonnaires humaines
“normales”, il existe aussi des collections de cellules humai-
nes provenant de sujets atteints de maladies génétiques, ou
d’embryons après interruption de la grossesse à la suite du
diagnostic prénatal de ces maladies. Ces collections de cellu-
les ont permis des recherches importantes sur l’origine et les
mécanismes des désordres héréditaires.
Concernant les cellules souches, il existe plusieurs catégo-
ries :
Les cellules souches spécifiques de tissu. Il s’agit des pré-
curseurs des différentes populations cellulaires constituant
un tissu différencié tel que le système hématopoïétique, le
système nerveux, les muscles, etc. Ces cellules peuvent, en
principe, être utilisées pour tenter de reconstituer un tissu
endommagé par une maladie ou une anomalie du développe-
ment, mais ne participent d’aucune façon à la constitution de
la lignée germinale.

La Lettre du Gynécologue - n° 322 - mai 2007
Gynéco et société
Gynéco et société
8
Les cellules souches embryonnaires, également appelées
cellules ES (embryonic stem cells), sont en principe “totipo-
tentes". Ces lignées de cellules ES peuvent soit se perpétuer
semblables à elles-mêmes, conservant leur totipotence, grâce
à des artifices expérimentaux, soit se différencier en cellules
précurseurs des différents tissus somatiques, puis en cellules
différenciées. Le type de différenciation peut être contrôlé par
les conditions de culture et par différents agents.
VERS DE NOUVELLES RÉGULATIONS
DE LA RECHERCHE ET DES COLLECTIONS
Compte tenu des symboliques en jeu concernant les représen-
tations des fœtus et des embryons, des demandes des femmes
et des couples d’être associés aux prises de décision et d’être
informés, il convient que les règles communes soient connues
de tous, quitte à les remettre en question pour les faire évoluer.
La recherche sur l’embryon est autorisée par l’actuelle loi de
bioéthique. Elle ne vise pas à soigner un embryon malade,
mais à prélever les cellules d’un embryon pour les utiliser
comme matériau d’expérimentation. La loi du 29 juillet 1994
interdisait la recherche sur l’embryon. L’article 2141-8 du code
de la santé publique stipulait : “la conception in vitro d’em-
bryons humains à des fins de recherche est interdite. Toute
expérimentation sur l’embryon est interdite”. La loi relative à
la bioéthique de 2004 (4) l’autorise “à titre exceptionnel”, pour
une durée de 5 ans, et uniquement sur des embryons surnu-
méraires sans projet parental, actuellement congelés dans le
cadre de fécondation in vitro, c’est-à-dire ayant fait l’objet d’un
abandon du projet parental et dépourvus de couples d’ac-
cueil.
La recherche est aussi possible à partir de tissus issus d’inter-
ruption de grossesse.
Des tissus ou cellules embryonnaires ou fœtaux ne peuvent
être prélevés, conservés et utilisés à l’issue d’une interrup-
tion de grossesse qu’à des fins diagnostiques, thérapeutiques
ou scientifiques. La femme ayant subi une interruption de
grossesse donne son consentement écrit après avoir reçu une
information appropriée sur les finalités d’un tel prélèvement.
Cette information doit être postérieure à la décision prise par
la femme d’interrompre sa grossesse. Un tel prélèvement ne
peut avoir lieu si la femme ayant subi l’interruption de gros-
sesse est mineure ou fait l’objet d’une mesure de protection
légale, sauf s’il s’agit de rechercher les causes de l’interruption
de grossesse. Dans ce cas, la femme ayant subi cette interrup-
tion de grossesse doit avoir reçu auparavant une information
sur son droit de s’opposer à un tel prélèvement. Les prélève-
ments à des fins scientifiques autres que ceux ayant pour but
de rechercher les causes de l’interruption de grossesse ne peu-
vent être pratiqués que dans le cadre de protocoles transmis,
préalablement à leur mise en œuvre, à l’agence de la biomédecine.
L’agence communique la liste de ces protocoles, accompagnée
le cas échéant de son avis sur ces derniers, au ministre chargé
de la recherche. Celui-ci peut suspendre ou interdire la réali-
sation de ces protocoles, lorsque leur pertinence scientifique
ou la nécessité du prélèvement ne sont pas établies, ou lorsque
le respect des principes éthiques n’est pas assuré.
COLLECTE ET CONSERVATION
DES ÉCHANTILLONS : VERS DE NOUVELLES
RÉGULATIONS
Par ailleurs, la nécessité de clarifier la conservation des élé-
ments embryonnaires ou fœtaux a été soulignée par l’émotion
et le débat public qui ont suivi, en plein été 2005, la “décou-
verte” (issue en fait d’une pratique pourtant connue de tous
au niveau administratif et médical) d’un nombre important
de fœtus dans la chambre mortuaire d’abord d’un hôpital
parisien, puis d’un second. On sait par ailleurs, au-delà du
débat médiatique et passionnel sur des conditions de garde
litigieuses, que la pratique de conservation d’éléments issus
d’embryons ou de fœtus est une pratique médicale, commune,
historique, qui a lieu depuis longtemps dans de très nom-
breux centres hospitaliers et qui a permis le développement
de travaux de recherche et des découvertes essentielles pour
le monde de la périnatologie, donc pour les futurs parents et
enfants. Depuis le XIXe et au début du XXe siècle, suite à un
intérêt médical croissant pour la fœtopathologie, les “collec-
tions” de fœtus présentant des anomalies morphologiques
étaient pratique courante. Depuis la seconde moitié du XXe
siècle, il en a été de même de la conservation d’organes, puis
de tissus, pour mieux comprendre les anomalies en cause au
niveau macroscopique, puis microscopique, et aujourd’hui
moléculaire. Ce que demande désormais la société, c’est un
principe de transparence et de régulations partagées par tous,
en particulier avec les parents.
En France, la loi relative à la bioéthique du 6 août 2004 a
créé un article L. 1241-5 au sein du code de santé publique
(CSP) en vertu duquel le prélèvement, la conservation et l’uti-
lisation “des tissus ou cellules embryonnaires ou fœtaux” “à
l’issue d’une interruption de grossesse” sont possibles à des
fins scientifiques ou thérapeutiques. L’interruption dont il est
question peut être volontaire, avec ou sans motif médical, ou
spontanée. Ce prélèvement ne peut avoir lieu que dans les
conditions suivantes : information appropriée sur les finalités
d’un tel prélèvement et consentement préalable par écrit de
la femme.
S’agissant de l’utilisation en vue de rechercher les causes de
l’interruption, communément appelée “autopsie” par les fœto-
pathologistes, l’information et le consentement sont requis.
L’autopsie étant étymologiquement l’action de voir de ses
propres yeux, il n’est en effet pas illogique que ce terme soit
employé pour ces embryons et fœtus. Cela est d’autant plus
justifié que les praticiens du diagnostic prénatal, en particulier
ceux qui pratiquent l’imagerie et/ou les tests de dépistage bio-
logiques, viennent fréquemment étudier le fœtus mort, afin de
confronter leur diagnostic à l’examen physique.
L’information devra prendre en compte les questions désor-

La Lettre du Gynécologue - n° 322 - mai 2007
Gynéco et société
Gynéco et société
9
mais sensibles du devenir des “corps” et le fait que des échan-
tillons seront on non conservés. Si tel est le cas, il conviendra
de statuer sur le fait que cette conservation est “transitoire” ou
non, s’inscrivant soit dans le cadre de la démarche de soins et
dans une finalité diagnostique, soit dans une finalité de plus
longue durée souvent liée à la recherche, et dont nous expo-
sons les principes ci-après. Mais il faut d’emblée avoir à l’esprit
qu’en pratique, la frontière est ténue, soins et recherche étant
intimement mêlés et les cliniciens ne sachant pas toujours si
les gestes d’autopsie vont ou non déboucher sur une démarche
de recherche. Il y a donc là pour les cliniciens-chercheurs un
travail d’anticipation des questions à mener avec et pour les
patientes.
Le nouveau cadre législatif, tel qu’issu de la loi du 6 août 2004
relative à la bioéthique, consacre un chapitre à la question de
la conservation et de la préparation d’échantillons biologiques
humains à visée de recherche. La loi y inclut, en la définissant,
la notion de collection sans utiliser le terme de banque, sou-
vent usité en pratique. Le CSP (article L. 1243-3) donne une
définition de la collection qui est constituée par : “la réunion,
à des fins de recherche, de prélèvements biologiques effectués
sur un groupe de personnes identifiées et sélectionnées en
fonction des caractéristiques cliniques ou biologiques d’un ou
plusieurs membres du groupe, ainsi que des dérivés de ces pré-
lèvements”, sans toutefois y attacher de réelle conséquence.
D’un point vue pratique, on doit considérer que l’on parle de
conservation à finalité de recherche dès lors que l’on conserve
les échantillons au-delà du temps nécessaire aux éventuels
contrôles et examens secondaires tel que reconnu dans la
démarche de soin.
Il est alors important que les professionnels définissent clai-
rement la durée de stockage des échantillons dans le cadre du
soin afin d’anticiper la mise en place de procédures pour le
passage du soin à la recherche. Cette anticipation est impor-
tante puisqu’elle permettra de mettre d’emblée les procédures
en place lors de la démarche de soin.
Le nouveau cadre légal s’applique du moment qu’il y a conser-
vation ou préparation d’échantillons biologiques humains à
visée scientifique. L’intervention des comités de protection
des personnes (CPP) est expressément prévue par la loi. Cette
intervention fait l’objet des nouvelles missions des CPP. Le
dossier à constituer sera spécifique et différent des dossiers
de recherche biomédicale de type loi Huriet révisée selon des
modalités prévues par décret.
Lorsque l’on conserve à visée de recherche, il faudra un
programme scientifique et médical dans lequel s’inscriront
les collections. Ce programme devra définir une ou des
thématique(s) générale(s) qui permettront de statuer sur la
légitimité de la garde et sur les procédures de type informa-
tion et consentement qui en découleront. En outre, ce cadre
permettra de définir les conditions techniques et de garde per-
mettant de répondre aux objectifs du programme. De la même
façon, le fait d’avoir défini le programme scientifique devra
permettre de statuer sur les données cliniques et biologiques
qui devront être associées aux échantillons qui seront néces-
saires aux démarches de recherche. Tout cela conditionne les
critères de validation éthiques.
Dans ce cadre, l’interdiction de rémunération, l’anonymat et la
confidentialité des données, la sécurité sanitaire, la vigilance et
les règles relatives à la préparation, à la conservation et à l’utili-
sation des tissus, des cellules et de leurs dérivés s’imposent.
Concernant le respect des “corps”, après l’examen et d’éven-
tuels prélèvements scientifiques, le corps fait l’objet d’une
restauration tégumentaire. Il peut alors être confié à l’hôpital
pour être incinéré ou inscrit sur le registre des enfants sans
vie et faire éventuellement l’objet d’obsèques. Il convient ici
de porter une attention toute particulière au fœtus mort-né
de moins de 22 semaines et de moins de 500 g, et au placenta,
qui bien qu’historiquement qualifiés de “pièce opératoire”, ne
peuvent être affublés de ce terme au regard des parents. Il faut
aménager au plus vite certaines pratiques qui à ce jour consis-
tent encore parfois, après examen du fœtus et de ses organes,
en une mise dans un sac plastique. La question du rituel, quel
qu’il soit, doit être abordée.
CONCLUSION
Aujourd’hui, chaque femme et chaque couple doivent pou-
voir réagir en toute liberté, en fonction de leurs valeurs et de
leur sensibilité. La question du devenir des morts, quels qu’ils
soient, est au cœur de toutes les visions anthropologiques des
civilisations. “Qu’est devenu son corps ?” est donc une ques-
tion essentielle et légitime, et il faut avoir à l’esprit que pour des
parents, cette question concerne aussi les parties du corps, y
compris les tissus et les cellules. La représentation plus “maté-
rialiste” de ces éléments par la médecine ne doit pas occulter
ces forces de la représentation symbolique de certains parents.
Cela doit s’intégrer à la gestion de l’accompagnement psycho-
logique et au travail de deuil qui doit intégrer cette dimension
spirituelle, quelles que soient les croyances des patientes. Il ne
s’agit pas pour autant de réifier l’embryon, le fœtus ou l’enfant
mort, mais d’avoir une attitude d’humanité et de responsabi-
lité face aux évolutions des demandes et de la société.
n
RéféRences bibliogRaphiques:
1. CCNE. Avis sur les prélèvements de tissus d’embryons et de foetus humains
morts, à des fins thérapeutiques, diagnostiques et scientifiques. Rapport n° 1, 22
mai 1984.
2. Circulaire DHOS/DGS/DACS/DGCL n° 2001/576 du 30 novembre 2001 re-
lative à l’enregistrement à l’état civil et à la prise en charge des corps des enfants
décédés avant la déclaration de naissance.
3. CCNE. À propos de la conservation des corps des fœtus et enfants mort-nés.
Réponse à la saisine du Premier ministre. Avis n °89, 22 septembre 2005.
4. Loi n° 2004-800 du 6 août 2004 relative à la bioéthique.
1
/
4
100%