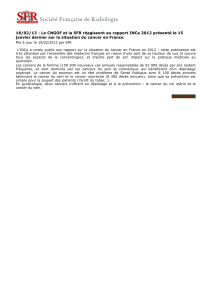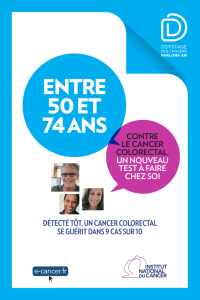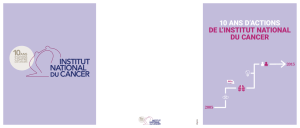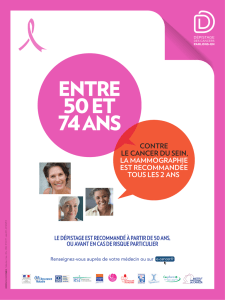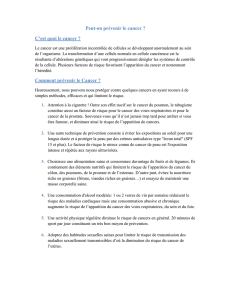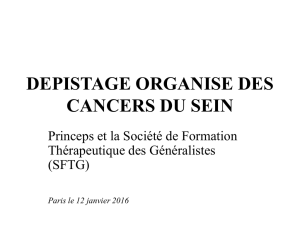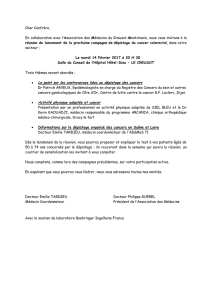Compte rendu des Journées Roche Cancérologie Hématologie R

ÉMERGENCE DE NOUVEAUX PARADIGMES,
BILAN DE L’ANNÉE 2005
Cancers colorectaux : Jean-Yves Douillard
(CRLCC René-Gauducheau, Saint-Herblain)
L’année 2005 fut riche en nouveautés concernant la prise en
charge du cancer colorectal, avec de nouvelles données sur le trai-
tement adjuvant du cancer du côlon, le traitement néoadjuvant
du cancer du rectum et le traitement des formes métastatiques.
La chimiothérapie néoadjuvante du cancer du rectum a fait l’objet
de deux études au cours desquelles l’association radiothérapie +
chimiothérapie préopératoire a permis de réduire de presque 50 %
le risque de rechute locale par rapport à la radiothérapie seule.
Les progrès dans le traitement du côlon métastatique concernent
les associations de chimiothérapies classiques et les thérapeu-
tiques ciblées.
Cancers du sein : Xavier Pivot (CHU Jean-Minjoz, Besançon)
Le cancer du sein a connu une année extraordinaire en 2005 avec
les données de quatre études, HERA, NSABP-B31, NCCTG N9831
et BCIRG 006, qui ont démontré, sur des délais assez courts de
1 et 2 ans, une réduction de 50 % du risque de récidive, et ce pour
tous les sous-groupes de patientes HER2+. Cette association
paraît néanmoins plus efficace quand la chimiothérapie admi-
nistrée contient une anthracycline (BCIRG 006). Les approches
antiangiogéniques ont fait l’objet de plusieurs études dans le trai-
tement du cancer du sein métastatique avec des données préli-
minaires intéressantes.
Anémie : Éric-Charles Antoine
(clinique Hartmann, Neuilly-sur-Seine)
L’anémie est une complication extrêmement fréquente de la mala-
die, retrouvée dans plus de deux cas sur trois, et, avec la fatigue,
elle est la source d’un inconfort majeur, avec un retentissement
important sur la vie quotidienne des patients. Aujourd’hui, les
EPO (érythropoïétine recombinante) permettent de traiter l’ané-
mie plus précocement et de façon plus stable ; elles réduisent les
besoins transfusionnels et corrigent le taux d’hémoglobine.
L’amélioration de la qualité de vie est corrélée au taux d’hémo-
globine, et le gain maximal est obtenu quand le taux d’hémo-
globine est stable et compris entre 12 et 13g/l.
Cancers du rein : Olivier Rixe
(hôpital de la Pitié-Salpêtrière, Paris)
En 1971, Folkmann avait démontré le rôle essentiel de l’angio-
genèse tumorale au cours du développement des tumeurs et,
quelques années plus tard, Ferrara découvrait le VEGF (vascu-
lar endothelial growth factor), facteur clé de l’angiogenèse. Des
travaux menés en recherche fondamentale ont montré que l’angio-
genèse tumorale, avec l’intervention du système HIF (hypoxia-
inducible factor), est un phénomène très important dans le déve-
loppement des cancers du rein ; au vu de premiers résultats très
prometteurs, un développement est actuellement mené avec ces
nouvelles approches antiangiogéniques dans le traitement du can-
cer du rein métastatique. L’évaluation de l’efficacité des traite-
ments antiangiogéniques par les critères RECIST n’est pas opti-
male, et l’évaluation du flux tumoral par scanner de perfusion
pourrait constituer un meilleur moyen d’appréciation de la
réponse objective au traitement. Parallèlement à tous ces efforts
de recherche, l’Institut national du cancer a mis en place un “pro-
gramme national d’excellence spécialisé (PNES) dans le cancer
du rein avec des objectifs spécifiques, dont un certain nombre sont
très orientés sur la réponse aux traitements antiangiogéniques.
Cancers du poumon : Elisabeth Quoix
(hôpital civil Lyautey, Strasbourg)
Les données de l’étude SWOG 9900, qui avait comparé l’asso-
ciation chimiothérapie (3 cycles) + chirurgie versus chirurgie
RÉUNION
Compte rendu des Journées Roche
Cancérologie Hématologie
139
La Lettre du Cancérologue - Volume XV - n° 3 - mai-juin 2006
Comme chaque année, Roche a organisé les Journées Roche Cancérologie Hématologie
les 24 et 25 novembre sous la présidence de Roland Bugat (INCA et Centre Claudius-
Régaud, Toulouse) et Jean-Luc Harrousseau (CHRU, Nantes).

seule et démontré l’intérêt de la chimiothérapie néoadjuvante, ont
été confirmées par les résultats de la méta-analyse publiée en 2005
par Berghmans. Quatre études (IALT, ANITA-1, CALGB 9633
et NCIC) et deux méta-analyses ont rapporté des résultats en
faveur d’une chimiothérapie adjuvante dans les cancers bron-
chiques non à petites cellules (CBNPC). La question de l’intérêt
d’une chimiothérapie adjuvante se pose en particulier pour les
patients atteints d’un CBNPC de stade IIIB ou IV, et les données
de la méta-analyse de Pujol et al. apportent un certain nombre
d’éléments de réponse en sa faveur.
Hémopathies lymphoïdes indolentes : Gilles Salles
(CHU, Lyon-Sud)
Il existe une grande variabilité pronostique parmi les patients
atteints de leucémie lymphoïde chronique (LLC), avec deux tiers
de patients de stade A, dont la durée de survie est comparable à
celle de la population générale, et un tiers de patients de stade B
ou C, dont la survie est beaucoup plus faible. Le pronostic est
aussi influencé par les caractéristiques cytogénétiques, le statut
mutationnel du processus tumoral, et d’autres facteurs pronos-
tiques sont actuellement étudiés (mutations du gène d’Ig, expres-
sion de ZAP70, etc.).
Au-delà des traitements innovants, agir pour favoriser
les diagnostics précoces : résultats du programme ÉDIFICE
sur les comportements des Français et des médecins
généralistes face au dépistage : Jean-François Morère
(hôpital Avicenne, Bobigny)
Au-delà des avancées thérapeutiques, Roche, leader en oncolo-
gie, a souhaité apporter sa contribution au Plan cancer en s’impli-
quant dans l’étude du dépistage des cancers en France avec le pro-
gramme ÉDIFICE : “Étude sur le DépIstage des cancers et ses
Facteurs de complIanCE”, élaboré sous l’égide d’un comité scien-
tifique pluridisplinaire. L’enquête ÉDIFICE, lancée en février
2005, a porté sur les quatre cancers les plus fréquents (sein, côlon,
poumon et prostate), pour lesquels les modalités de dépistage sont
différentes. Deux évaluations ont été menées en parallèle, auprès
du grand public chez plus de 1 500 personnes âgées de 40 ans à
74 ans et auprès de 600 médecins généralistes. Ne seront pré-
sentés ici que certains résultats concernant le dépistage du can-
cer du sein et du cancer colorectal.
Le dépistage organisé du cancer du sein en France
Quatre-vingt-treize pour cent des femmes âgées de 50 à 74 ans
déclarent avoir fait déjà au moins une mammographie de dépis-
tage, mais 15 % d’entre elles n’en ont pas effectué depuis plus
de 2 ans. Environ 70 % des médecins généralistes déclarent
recommander systématiquement, et 28 % souvent, un dépistage
de cancer du sein à leurs patientes âgées de 50 à 74 ans.
Impact de l’organisation du dépistage : exemple du cancer
du côlon
En France, 22 départements pilotes ont été engagés dans l’expé-
rimentation d’un dépistage organisé effectué au moyen d’un test
Hémoccult réalisé tous les 2 ans chez les personnes âgées de 50
à 74 ans. Les résultats de l’enquête ÉDIFICE montrent que le
dépistage du cancer du côlon est plus fréquent dans les 22 dépar-
tements pilotes que dans les autres départements. Un médecin
généraliste sur deux recommande le dépistage du cancer du
côlon, mais ils sont plus nombreux à le recommander systéma-
tiquement au sein des 22 départements pilotes que dans les autres
départements. Ces chiffres démontrent la sensibilisation néces-
saire des médecins généralistes au dépistage lorsque celui-ci est
organisé.
Des données complémentaires de l’enquête ÉDIFICE permet-
tent d’explorer d’autres dimensions, comme le niveau de com-
préhension et d’information des patients, leur attitude générale
à l’égard de leur santé, leurs profils psychologique et d’adap-
tation, leur motivation et la qualité de leur relation avec leur
médecin.
MESURE DE L’IMPACT DES NOUVEAUX MÉDICAMENTS
SUR LES STRATÉGIES THÉRAPEUTIQUES
Exemple de l’observatoire des traitements du cancer
du côlon : Lucien Abenhaïm (hôpital Cochin, Paris)
L’incidence croissante du nombre de cancers en Europe et des
décès liés au cancer amène les autorités à s’impliquer de plus en
plus dans les aspects socio-économiques et l’évaluation des pra-
tiques professionnelles pour la prise en charge des cancers. Pour
répondre à ces nouveaux objectifs, il est indispensable d’inclure
des patients représentatifs de la population générale dans de nou-
velles études, ce qui n’est pas toujours le cas dans les essais ran-
domisés. Un projet de feuille de route, “cancer du côlon”, réalisé
avec Roche et soutenu par l’Institut national du cancer a été mis
en place en 2005. Un premier programme, sous forme d’étude de
cohorte, est sur le point d’être lancé en France. Environ
100 centres français (CHU, CAC, CHG, cliniques, etc.) devraient
participer à cette étude pour un objectif d’inclusion de
2 000 patients. Les données de cette étude française de cohorte
pourront permettre de constituer une base d’informations majeure
sur la prise en charge des patients atteints d’un cancer du côlon
en France.
Exemple des traitements du myélome : Thierry Facon
(CHRU Claude-Huriez, Lille)
Après les progrès observés avec les traitements intensifs et l’auto-
greffe, l’arrivée depuis 5 ans de nouvelles molécules (thalido-
mide, bortézomide, etc.) a permis d’obtenir dans les myélomes
réfractaires un taux de réponse de l’ordre de 30 %, et ce avec un
profil de tolérance acceptable et différent selon les produits admi-
nistrés. Un allongement de la survie sans progression et de la sur-
vie globale a été observé avec l’association de ces nouvelles
molécules aux chimiothérapies traditionnelles. Il est maintenant
envisagé de développer des essais dans le cadre de protocoles
d’autogreffes, soit en phase de réduction tumorale, soit lors de
l’autogreffe, soit en traitement d’entretien. De nouvelles cibles
(plasmocytes, microenvironnement médullaire, récepteurs de sur-
face) et de nouvelles thérapeutiques “ciblées” sont actuellement
en cours d’évaluation. Les différentes caractéristiques cliniques,
cytologiques, génétiques, etc. des myélomes devraient permettre
d’identifier différentes formes de la maladie.
RÉUNION
140
La Lettre du Cancérologue - Volume XV - n° 3 - mai-juin 2006

Maîtrise du risque face à l’innovation : Martine Jager
(Roche, Neuilly-sur-Seine)
L’utilisation de nouvelles molécules sur des durées de plus en plus
longues rend nécessaire la mise en place d’une pharmacovigilance
proactive et de mesures de gestion du risque tout au long du cycle
de vie des produits. L’environnement réglementaire s’est récem-
ment renforcé dans cette optique, avec l’élaboration en 2005 de
recommandations par l’EMEA, adaptées ensuite en France par
l’Afssaps. La feuille de route 2010 mise en place par l’Afssaps
présente un certain nombre de priorités, dont la gestion du risque
fait partie intégrante, et les mesures publiées en juillet 2005
recommandent la création d’un département de surveillance du
risque, le renforcement du système de pharmacovigilance, la
mise en place de plans de gestion du risque, le développement
de la pharmacoépidémiologie et le renforcement des inspections
en pharmacovigilance. La réalisation d’un plan de gestion du
risque est exigée pour toute nouvelle demande d’autorisation de
mise sur le marché (AMM) avec deux parties : un premier volet
dans lequel les risques du médicament et leur prise en charge sont
décrits, et un deuxième volet contenant un plan de minimisation
du risque avec une description des actions mises en place pour
chaque risque.
Mesure de l’impact économique, coût de santé publique :
Pierre Anhoury (IMS Health France, Puteaux)
Les indicateurs de santé publique changent au cours du temps,
avec, en France en 2005, 10 millions de Français âgés de plus de
65 ans, une prévalence très élevée du tabagisme (28 % de la
population adulte), une consommation d’alcool très supérieure à
la moyenne des pays de l’OCDE, un taux d’obésité croissant, de
plus de 10 % dans la population adulte, une augmentation de 35 %
de l’incidence des cancers au cours des 20 dernières années, mais
aussi une réduction de 9 % de la mortalité par cancer. L’envi-
ronnement de la cancérologie en particulier sous l’influence des
nouvelles mesures du Plan cancer et de l’Institut national du can-
cer, évolue aussi (T2A, accréditation V2 et évaluation des pra-
tiques professionnelles, critères d’agrément des établissements de
soins, comités régionaux du médicament, etc.), et les attentes des
patients deviennent de plus en plus importantes. Au niveau des
traitements anticancéreux, les molécules issues de biotechnolo-
gies connaissent un formidable essor, mais au prix de coûts de
traitement de plus en plus élevés. Toutes ces évolutions vont
nécessiter la mise en place de mesures permettant d’évaluer le
coût-efficacité des traitements proposés dans la prise en charge
des cancers.
Mesure de l’impact économique, coût de santé publique :
exemple des traitements de l’anémie :
Jean-Jacques Zambrowski (hôpital Xavier-Bichat, Paris)
Corriger l’anémie des patients atteints de cancer permet d’amé-
liorer leur qualité de vie et l’observance des chimiothérapies anti-
cancéreuses. Et pourtant, cette anémie continue de faire l’objet
d’un déficit de prise en charge. Les nouvelles dispositions sur la
tarification (T2A) et la rétrocession constituent aujourd’hui un
nouvel environnement dans lequel les arguments économiques
doivent être aussi pris en compte.
ÉVALUATION DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES
ET RECHERCHE CLINIQUE
Haute Autorité de santé : Philippe Burnel (Paris)
L’évaluation des pratiques professionnelles (EPP) est une ques-
tion d’actualité, puisque la loi du 13 août 2004 et le décret du
14 avril 2005 imposent une obligation individuelle d’EPP, et que
cette démarche est attendue dans le cadre de la certification des
établissements de santé. Pour être qualifiée d’EPP, une action
devra répondre à quatre critères : constituer un enjeu de la qua-
lité, analyser une pratique, prendre en compte des références vali-
dées et mesurer des résultats, l’objectif étant de réduire l’hétéro-
généité des pratiques. Sur le plan institutionnel, plusieurs
dispositifs sont mis en place pour l’EPP :
– une obligation individuelle d’EPP pour laquelle la commission
médicale de l’établissement joue un rôle important au niveau de
la validation ;
– et une démarche d’accréditation des établissements de santé
dans laquelle l’EPP constitue une exigence nouvelle. L’objectif
recherché est de mieux rendre compte de la qualité des soins ser-
vis aux patients et de mieux impliquer les médecins dans la dyna-
mique d’amélioration de la qualité.
Institut national du cancer : Christine Welty
(Institut national du Cancer, Paris)
Le Plan cancer lancé en mars 2003, plan de lutte global contre le
cancer qui comprenait 70 mesures, a bénéficié d’une impulsion
de haut niveau et a été repris par l’Institut national du cancer
(INCa) depuis mai 2005, celui-ci s’étant fixé quatre objectifs :
combattre la seconde cause de mortalité en France, intégrer dans
un schéma global et cohérent les connaissances sur cette maladie,
assurer l’égalité des soins à tous les patients et leur rendre leur
pleine citoyenneté pendant et après leur maladie. L’INCa, doté
d’une structure légère, privilégie les contacts avec le terrain, les
partenariats avec les différents acteurs concernés (professionnels
de santé en ville et à l’hôpital, tutelle et pouvoirs publics, asso-
ciations de patients, etc.), avec pour mission la mise en place de
la politique de soins, le regroupement et/ou la fédération des tra-
vaux de recherche et la dynamisation de la recherche. L’INCa sou-
haite aussi se positionner au plan international, que ce soit au
niveau de la recherche, de l’aide au développement ou de la coopé-
ration en matière de soins. Ses domaines d’intervention couvrent
un vaste champ d’action allant de l’information à la prévention,
au dépistage, aux soins, à l’image du cancer et à la recherche.
Organisation de la recherche clinique : Marc Buyse
(Institut national du cancer, Paris)
Le département de recherche clinique et de biostatistique a été
mis en place au sein du Plan cancer, et maintenant de l’INCa, afin
de favoriser la recherche clinique. Son objectif est d’inclure 10 %
des patients atteints de cancer dans des essais cliniques. Il est orga-
nisé avec trois grandes structures :
– 28 groupes d’études cliniques destinés à lister tous les essais cli-
niques ouverts à l’inclusion en France, à choisir ceux qui doivent
recevoir le soutien de l’InCA, à proposer un essai pour chaque indi-
cation dans laquelle aucun n’est actuellement proposé et à assurer
l’équilibre des différents types d’essais du portefeuille de l’InCA ;
141
La Lettre du Cancérologue - Volume XV - n° 3 - mai-juin 2006

– 25 équipes mobiles de recherche clinique, dont l’objectif est
l’aide aux cliniciens (inclusion, cahier d’observation, collecte
des documents, envoi de médicaments, etc.), le respect des bonnes
pratiques cliniques et la mise en place d’actions favorisant l’inclu-
sion des patients ;
– 9 centres de traitement de données (1 par cancéropôle ± 2
en Île-de-France), qui doivent assurer l’inclusion et la rando-
misation des patients dans les essais cliniques du portefeuille
de l’INCa, coordonner la collecte et la vérification des don-
nées, assurer la transmission des bases de données sous for-
mat standard à l’INCa, et qui seront choisis parmi les centres
existants.
Référentiels nationaux de bon usage : Laurent Borella
(Institut national du cancer, Paris)
On assiste actuellement en France à une explosion des thérapeutiques
ciblées, dont les bénéfices très importants pour les patients sont asso-
ciés à des coûts en forte progression. L’objectif du Plan cancer est
de rendre accessibles ces traitements innovants à tous les patients en
France dès lors qu’un bénéfice est prouvé. Le nouveau système de
financement des médicaments innovants mis en place assure une éga-
lité d’accès à l’innovation sous réserve du respect d’un contrat de
bon usage. L’INCa réfléchit actuellement à de bonnes pratiques cli-
niques pour les molécules prescrites hors AMM, qui pourraient être
élaborées à partir d’avis d’experts et des données scientifiques dis-
ponibles. Il est envisagé de définir trois situations de prescription :
– les situations réglementaires au cours desquelles le produit est
prescrit dans l’AMM ;
– les situations scientifiquement acceptables temporairement à
partir des données scientifiques disponibles : c’est le PTT, avec
comme premier exemple, Herceptin®, qui vient d’en faire l’objet
dans le traitement adjuvant du cancer du sein ;
– les situations non scientifiquement justifiées où la prescription
du médicament doit être évitée.
Une réflexion est actuellement menée au sein de l’INCa pour
l’élaboration des référentiels de bon usage par des “boards” médi-
caux constitués pour chaque pathologie.
Cancer : maladie sociale ? Régine Goinère
(association “Vivre avec”, Lyon)
L’association Vivre avec a été créée en 1990 par des patients
atteints de cancer et des proches pour “préserver le patrimoine
moral des patients pendant leur hospitalisation”. Elle vient de lan-
cer une opération d’envergure, “Vers une citoyenneté retrouvée”,
dont l’objectif est de permettre l’accès à l’emprunt et à l’assu-
rance aux personnes qui ont été touchées par un cancer. Par son
soutien, Roche permet à Vivre avec de diffuser l’information
concernant ce nouveau service : conférences de presse, cam-
pagne d’affichage et distribution de plaquettes d’information
dans tous les services de cancérologie et d’hématologie. Un centre
d’appel téléphonique a été spécialement mis en place par l’asso-
ciation. Lorsqu’une personne téléphone, après avoir répondu à
quelques questions, elle est orientée vers un courtier qui lui pro-
posera ensuite le meilleur contrat d’assurance. Cette opération,
d’abord initiée sur la Région Rhône-Alpes, et validée par le Plan
cancer, est actuellement étendue à toute la France.
■
RÉUNION
142
La Lettre du Cancérologue - Volume XV - n° 3 - mai-juin 2006
1
/
4
100%