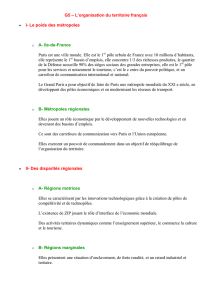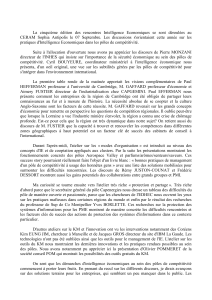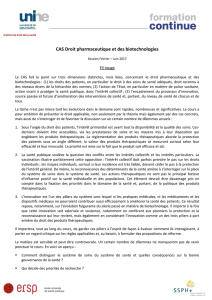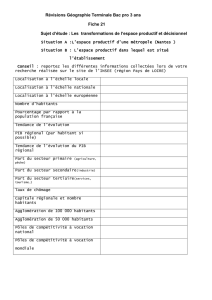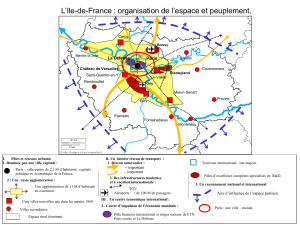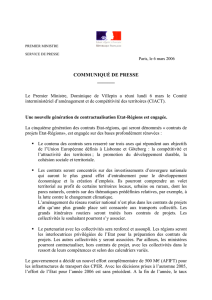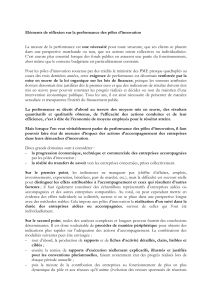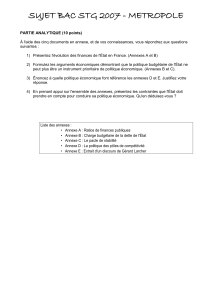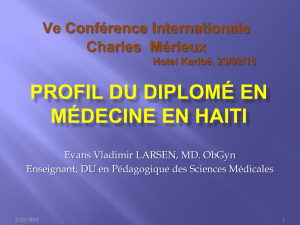Les grands axes de recherche dans le domaine de la... en Europe et en France É

La Lettre du Pharmacologue - Volume 19 - n° 3 - juillet-août-septembre 2005
71
ÉDITORIAL
CONSTAT ET MISE EN PLACE DES APPELS À PROJET
Le séquençage du génome humain et les progrès récents en
postgénomique ont un impact majeur dans la recherche sur la
santé et les pathologies humaines. L’intégration des données
et connaissances nouvelles et la compréhension des processus
biologiques et physiopathologiques sous-jacents nécessitent
de réunir une masse critique et une diversité de compétences
et de technologies qui ne sont plus disponibles à l’échelon
d’une université ou d’un centre de recherche. Les approches
par projet, multidisciplinaires, régionales, nationales, pan-
européennes, impliquant différents acteurs et plates-formes
de recherche, sont devenues nécessaires pour contribuer plus
efficacement au progrès thérapeutique et à la lutte contre les
maladies.
De telles approches se mettent en place en Europe et en
France.
✓
En Europe.
La proposition du Parlement européen et du
Conseil, relative au 7eProgramme cadre de recherche et de
développement technologique (PCRDT) de la Communauté
européenne (7ePCRDT, 2007-2013) qui va être soumis au
Parlement français, place la santé comme thème prioritaire et
vise à renforcer les collaborations (initiatives technologiques
publiques-privées, réseaux d’excellence, actions de coordina-
tion et de soutien), à stimuler la créativité de la recherche fon-
damentale, à encourager les chercheurs européens et à déve-
lopper de nouvelles infrastructures d’intérêt européen.
La proposition du Parlement européen et du Conseil comporte
les grandes lignes de financement envisagées pour le
7ePCRDT. Le futur programme devrait bénéficier d’un bud-
get global de 72,7 milliards d’euros.
La santé se verrait attribuer une enveloppe de 8,3 milliards
d’euros au titre de la partie “Coopération” (projets de
recherche thématiques transnationaux), soit environ 19 % de
l’enveloppe “Coopération”.
Elle devrait bénéficier, par ailleurs, d’autres budgets, soit via
des financements issus des partie “Idées”, “Personnel” ou
“Capacités” du 7ePCRDT, ou encore via le soutien d’autres
programmes thématiques, nanosciences par exemple.
✓En France.
■ L’appel à projet pour des pôles de compétitivité spécialisés
dans le domaine de la santé.
■ La création de l’Agence Nationale de la Recherche (ANR),
qui investira des moyens nouveaux dans des projets de haute
technologie permettant à des équipes universitaires d’excel-
lence de développer les technopôles de demain en partenariat
avec les industries de santé.
L’ANR est d’ores et déjà active avec le lancement d’appels à
projets de recherche dans le domaine de la santé, notamment
en neurosciences, neurologie et psychiatrie ou microbiologie
et immunologie.
Elle finance également le premier appel à projet du “Réseau-
Innovation-Biotechnologies”.
■ Outre la priorité donnée à l’ANR (objectif de dotation
2010 : 1,47 milliard d’euros), la loi annoncée dite “d’orienta-
tion et de programmation de la recherche et de l’innovation”,
qui devrait être discutée avant la fin de l’année 2005, affiche
nettement son soutien à la recherche académique, à la
recherche industrielle et à l’innovation.
Les grands axes de recherche dans le domaine de la santé,
en Europe et en France
The main research priorities in the health field in Europe and in France
●
E. Canet*, A. Puech**, C. Lassale***, P.Y. Arnoux****
* Institut de recherche Servier, Suresnes.
** Sanofi-Aventis, Paris.
*** Les entreprises du médicament (Leem), Paris.
**** Leem Recherche, Paris.

72
La Lettre du Pharmacologue - Volume 19 - n° 3 - juillet-août-septembre 2005
ÉDITORIAL
ENJEUX STRATÉGIQUES
En Europe, comme en France, les enjeux stratégiques sont
en parfaite cohérence et intègrent toute la chaîne de
l’innovation thérapeutique, de la découverte jusqu’aux
systèmes de soins.
Ainsi, le thème santé du 7ePCRDT intègre l’ensemble de
la chaîne de l’innovation en différenciant trois grands
domaines :
✓Biotechnologies, outils génériques et technologiques au
service de la santé humaine :
– Recherche sur les méthodes d’extraction d’information à
haut débit.
– Détection, diagnostic et surveillance, en donnant la priorité
aux approches non invasives ou mini-invasives.
– Prévision de l’adéquation de la sécurité et de l’efficacité des
thérapies, en élaborant et validant des biomarqueurs, des
méthodes et modèles in vivo et in vitro, en intégrant les
aspects de la simulation, de la pharmacogénomique, des
approches thérapeutiques ciblées et des méthodes de substitu-
tion à l’expérimentation animale.
– Approches et interventions thérapeutiques innovantes (par
exemple : thérapies cellulaires).
✓Recherche translationnelle au service de la santé humaine :
– Transposition de la recherche fondamentale à la clinique.
–Intégration de données et processus biologiques pour mieux
comprendre les réseaux régulateurs complexes de milliers de
gènes et produits génétiques qui commandent des processus
biologiques importants.
✓Optimisation des prestations de soins de santé :
– Transposition des résultats cliniques en pratiques cliniques.
– Qualité, efficacité et solidarité des systèmes de soins de
santé.
– Amélioration de la prévention des maladies et de l’utilisa-
tion des médicaments.
– Utilisation appropriée de nouvelles thérapies et technolo-
gies au service de la santé : sécurité à long terme et sur-
veillance de l’utilisation à grande échelle de technologies
médicales.
Ces enjeux stratégiques sont aussi partagés par
l’European Federation of Pharmaceutical Industries and
Associations (EFPIA) qui propose, dans le cadre du
7ePCRDT, une plate-forme technologique, “Innovative
Medicines for Europe”, dont le but est de mobiliser
recherche publique et recherche privée autour d’une
vision et d’un objectif communs : renforcer le potentiel
d’innovation thérapeutique en Europe et, ainsi, redonner
à l’Europe la position de leader. Le programme de
recherche porté par cette plate-forme vise à mobiliser la
masse critique de moyens permettant, à un stade précom-
pétitif, d’identifier et de lever les principaux goulots
d’étranglement qui ralentissent ou font obstacle à l’inno-
vation thérapeutique (modèles prédictifs en pharmacologie
et toxicologie (in silico, toxicogénomique, toxicoprotéo-
mique, métabonomique…), identification et validation de
biomarqueurs, recrutement des patients, gestion du risque…
Quatre domaines thérapeutiques sont privilégiés : diabète,
cancer, maladies inflammatoires et maladies neurodégénéra-
tives ; des actions de formation, de structuration de l’infor-
mation et de développement d’outils informatiques y sont
associées afin d’en renforcer l’exploitation.
La Commission propose que le leadership de ce partenariat
public-privé soit confié à l’industrie.
Enfin, ces mêmes enjeux stratégiques sont identifiés en
France.
✓Après analyse des points forts français en matière de bio-
technologies clés, le gouvernement a décidé de concentrer des
moyens sur cinq filières technologiques : technologies du
The focus is on pre-competitive research
Discovery
research
Preclinical
development
Translational
medicine
Clinical
development
Pharmaco-
vigilance
Predictive
pharmacology
Predictive
toxicology
Identification
of biomarkers
Patient
recruitment
Validation
biomarkers
Risk assessment
with regulatory
authorities
Efficacy Safety
Bottlenecks in R&D supported by...
Predictive
pharmacology
Predictive
toxicology
Identification
of biomarkers
Patient
recruitment
Validation
biomarkers
Risk assessment
with regulatory
authorities
Knowledge management
Education & training

La Lettre du Pharmacologue - Volume 19 - n° 3 - juillet-août-septembre 2005
73
ÉDITORIAL
génome, technologies de recherche et développement in
silico, technologies d’imagerie biomédicale, accès à des
collections d’échantillons biologiques (Centres de Ressources
Biologiques [CRB]), accès à de nouveaux modèles cellulaires
et animaux prédictifs.
✓Dès à présent, le gouvernement a inscrit dans le cadre
du Conseil stratégique des industries de santé, placé
auprès du Premier ministre, deux projets particulièrement
avancés : les technologies d’imagerie biomédicales et les
collections d’échantillons biologiques. Il a également ins-
crit dans ce cadre la création d’un site de bioproduction
destiné à la production de lots cliniques de protéines thé-
rapeutiques et la mise en place de Centres de gestion des
essais des produits de santé (CEGEPS) visant à favoriser
le recrutement de patients dans les études cliniques et épi-
démiologiques.
Le 12 juillet 2005, dans le cadre du Comité interministériel
d’aménagement et de développement du territoire, les
soixante-sept pôles de compétitivité retenus après l’appel à
projets lancé en 2004 ont été annoncés par le Premier
ministre.
Sur ces soixante-sept pôles, 8 portent sur une thématique
liée à la santé, aux médicaments et aux biotechnologies
appliquées à la santé. Ces projets de pôles de compétiti-
vité “santé” intégraient l’ensemble des acteurs de la chaîne
de l’innovation thérapeutique dans leur dossier de candi-
dature.
Dans le domaine de la santé, du médicament et des biotech-
nologies appliquées à la santé, ces projets retenus sont répar-
tis comme suit :
Source : Datar et ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie -
http://www.competitivite.gouv.fr
AXES DE RECHERCHE PRIORITAIRES
Le choix des axes de recherches prioritaires, enfin, est en
parfaite cohésion entre entreprises publiques et privées,
en France comme en Europe (cf. 7ePCRDT, EFPIA, pôles
de compétitivité).
En effet, les maladies chroniques, les maladies rares et les affec-
tions pour lesquelles les besoins thérapeutiques ne sont pas cou-
verts sont prioritaires, et notamment : système nerveux central
[SNC] (AVC, maladies dégénératives et vieillissement…), can-
cer, maladies cardiovasculaires, diabète, obésité, inflammation,
maladies infectieuses (hépatite, sida, épidémies nouvelles,
infections nosocomiales, résistances bactériennes…).
CONCLUSION
Dans un contexte marqué par la complexité de pathologies
pour lesquelles les besoins thérapeutiques restent majeurs et
par le changement des paradigmes scientifiques, une vision
commune est proposée en Europe comme en France. Elle
vise à promouvoir une recherche d’excellence publique et pri-
vée, contributive au progrès thérapeutique en favorisant les
approches multidisciplinaires et paneuropéennes.
Ces nouvelles stratégies qui se mettent en place (7ePCRDT et
plate-forme de recherche consacrée aux médicaments innovants,
en Europe, appels d’offres sur les pôles de compétitivité, création
de l’Agence nationale de la recherche, de l’Agence de l’innova-
tion industrielle et du Conseil stratégique des industries de santé,
en France) réclament une implication et un engagement forts des
entreprises du médicament et de la recherche publique afin de
développer au mieux la compétitivité européenne et plus spécifi-
quement française dans le domaine de la santé. ■
Pôles mondiaux
Domaine Région/Déposant
LyonBiopole Virologie Rhône-Alpes/
Grand Lyon (Lyon)
MédiTech Santé Santé, notamment Ile-de-France/Agence
infectiologie et cancer régionale de développement
(Paris)
Minalogic Nanotechnologies Rhône-Alpes/Agence
de développement
économique de l’Isère
(Grenoble)
Pôles à vocation nationale
Domaine Région/Déposant
Biothérapies Agents et diagnostics Pays de la Loire/
thérapeutiques Atlanpole (Nantes)
Pôle Aliments, Limousin et Midi-Pyrénées/
Cancer-Bio-Santé biotechnologie Association de préfiguration
et biomédical du pôle (Toulouse)
Nutrition-Santé- Alimentation Nord-Pas-de-Calais/
Longévité GIE et maladies Eurasanté (Loos)
cardiovasculaires
“Prod’Innov” : Agro-santé Aquitaine/Agence Aquitaine
produits et procédés de développement
innovants industriel (Bordeaux)
pour la santé
Pôles à vocation mondiale
Domaine Région/Déposant
Innovations Molécules, chirurgie Alsace/BioValley (Illkirch)
thérapeutiques non invasive
1
/
3
100%