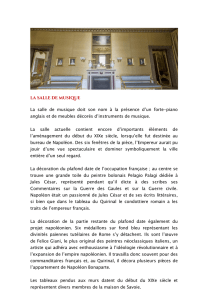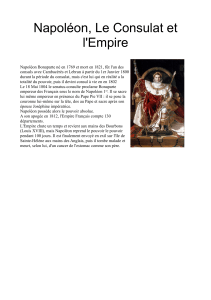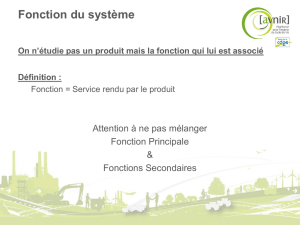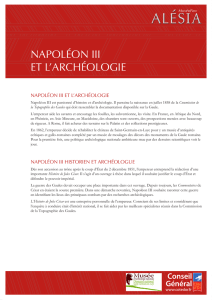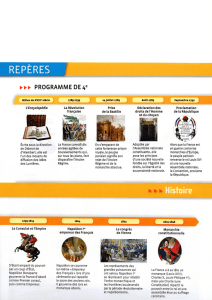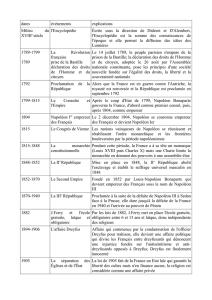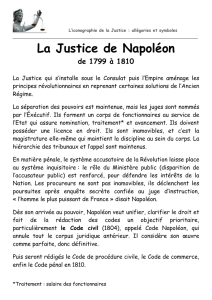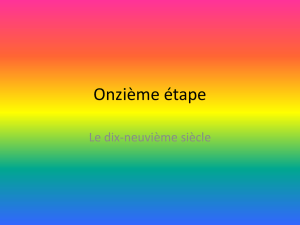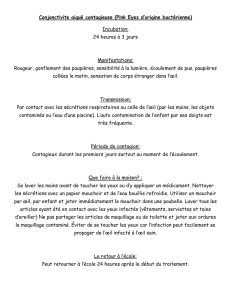DOSSIER A DECOUVRIR Les mouchoirs illustrés de l`atelier Buquet

DOSSIER A DECOUVRIR
Les mouchoirs illustrés de l’atelier Buquet
L’histoire de France en image
Introduction
Le Musée des Traditions et Arts Normands - château de Martainville possède une importante collection de
mouchoirs de cou qu’il doit à la générosité de la famille Buquet, qui en 2001, fit don au musée de l’intégralité
des archives de l’entreprise familiale. Des dessins préparatoires, des calques, coupures de presse,
lithographies et gravures, échantillons textiles, journaux d’atelier et mouchoirs de cou composent cette
exceptionnelle donation qui offre une vue d’ensemble sur la vie d’un atelier artisanal au XIXe siècle.
Le mouchoir de cou est un carré de tissu de coton d’environ 65 cm sur 80 cm, constitué d’une scène centrale
rehaussée d’un entourage rouge. Le mouchoir illustré fait partie du costume populaire des Normands. Il se
porte en fichu pour les femmes et en cravate nouée autour du cou pour les hommes.
Grâce à quelques années d’’expérience acquises chez son oncle Louis-Nicolas Goutan, indienneur à Lyons-la-
Forêt, Alexandre Buquet (1801-1846) fonde à Rouen vers 1840 un atelier de gravure sur cuivre. L’atelier se
spécialise dans la gravure de rouleaux et de planches de cuivre pour l’impression des toiles imprimées et des
mouchoirs de cou. L’atelier travaille pour des imprimeurs aussi appelés indienneurs comme Bataille, Lamy-
Godard et Renault qui passent commande des motifs auprès de l’atelier. Le graveur travaille ensuite à
l’élaboration d’un dessin, qui une fois validé par l’indienneur est gravé sur des plaques de cuivre pour les
mouchoirs et sur des rouleaux pour les toiles imprimées.
L’organisation du travail dans l’atelier est particulièrement bien connue à partir de 1855 grâce à une source
d’informations exceptionnelle : les carnets d’atelier. Ces carnets, tenus quotidiennement par Narcisse-
Alexandre (fils d’Alexandre Buquet) de 1855 à 1885, donne l’emploi du temps de chaque employé, le nom des
mouchoirs commandés, les sommes réglées par les indienneurs pour les gravures.
Les motifs des mouchoirs illustrés sont très variés : militaire, humoristique, moraliste, ou historique. Leur point
commun est de révéler les mentalités de l’époque. Le choix du mouchoir porté autour du cou par les hommes
donne à voir ses opinions politiques ou son attachement à un régime. Le mouchoir a une vocation décorative
mais également éducative. Comme les images d’Epinal, il peut être épinglé au mur et alors dévoiler toutes les
subtilités du dessin et tout le sens des textes qui l’accompagne.
Ce dossier s’arrête plus particulièrement sur une série de ces mouchoirs illustrés, ceux consacrés aux
événements historiques. Evénements d’actualité pour la plupart, puisque les mouchoirs sont publiés quelques
mois après l’événement, ces mouchoirs donnent une vision de l’histoire du XIXe siècle de 1840 à 1890. Flaubert
lui-même dans les brouillons de son manuscrit de Madame Bovary fait mention du port de ces mouchoirs
historiés. Dans un passage parlant de Félicité, la servante de madame Bovary, il écrit : "Elle entra dans la
chambre en poussant des exclamations de joie. Elle portait aux épaules un beau foulard en cotonnade dont
monsieur Lheureux tout à l’heure venait de lui faire cadeau. Cette œuvre d’un génie rouennais et qui était sur
fond rouge, bariolée de foudre noire et avec personnages eut pendant (…) jours un immense succès grâce à sa
portée politique. On y voyait au milieu agréablement représentés Monsieur Guizot en habit noir avec Pritchard
et la reine Pomaré, toute nue, qui autour d’une table buvaient un verre de bière ». Ce passage fait son doute
allusion au mouchoir de cou gravé par l’atelier Buquet et imprimé chez Bataille en 1847 et mettant en scène le
protectorat établi par la France sur Tahiti en 1843.
Photo 1 : Mouchoir illustré « La rencontre de Pritchard et de
la reine Pomaré » imprimé chez Bataille en 1847. Coll. MTAN
2001.1.02.
Ce dossier a été réalisé par Mylène Doré, attachée de
conservation au musée des Traditions et Arts Normands grâce
aux recherches menées par Jean-Luc Lesaffre, chercheur et
collectionneur.

1/ La légende Napoléonienne La « légende dorée » de Napoléon commence dès le début de l’Empire.
Revivifié à sa mort, le mythe célébré par les artistes atteint son apogée sous la
Restauration. Le point culminant de cette glorification de l’Empereur se situe en
1840 avec le retour de ses cendres. C’est le Prince de Joinville, fils du roi Louis-
Philippe qui mène l’expédition sur la « Belle-Poule ». Cet événement donna lieu
à une série de mouchoirs illustrés, imprimés chez Pierre Bataille vers 1840, sur
le thème de Napoléon 1er. Ces mouchoirs inspirés de tableaux ou de gravures
de l’époque glorifient l’Empereur, allant jusqu’à suggérer sa renaissance à
l’image du mouchoir « Napoléon sortant du tombeau ».
Photo 2 : Dessin préparatoire pour le mouchoir illustré « Napoléon
sortant du tombeau » MTAN 2004.7.5.15
- Napoléon et ses neveux
Photo 3 : Epreuve d’atelier, gravée par l’atelier Buquet,
imprimée à la plaque de cuivre en 1840 chez Bataille à
Déville-les-Rouen. MTAN 2001.1.61
Au centre du mouchoir, Napoléon 1er dans un halo de lumière
s’adresse à ses neveux représentés dans quatre médaillons
légendés.
- Napoléon Louis Bonaparte, représentant du peuple, Seine
- Lucien Murat, représentant du peuple, Lot
- Napoléon Bonaparte, représentant du peuple, Corse
- Pierre Napoléon Bonaparte, représentant du peuple, Corse
Sous le médaillon central, une inscription :
« Du haut des cieux, je vous montre la France !
Et vous crois mes neveux ma plus chère espérance à la
République en digne citoyens.
Donnez lui votre vie et soyez ses soutiens.
Que pour les combats vos âmes soient rebelles.
Les palmes de la paix sont des palmes plus belles.
Aimez votre Patrie, mère au sublime cœur
Où les peuples un jour puiseront leur bonheur ».
Napoléon est présenté comme un guide pour ses neveux.
- Napoléon à Saint-Hélène
Photo 4 : Mouchoir illustré, gravé par l’atelier Buquet (« Buquet
sculp. »), imprimé à la plaque de cuivre en 1840, chez Bataille à
Déville-les-Rouen. MTAN 2001.1.174
Napoléon une main dans le dos, l’autre dans le gilet attend sur un
rocher à Saint Hélène, lieu de son exil. Au dessus de lui, un halo de
lumière perce les nuages. En arrière plan, on distingue un navire,
probablement « la Belle-Poule » commandée par le prince de Joinville
pour ramener les cendres de l’Empereur sur le continent. En mai
1840, le roi Louis-Philippe obtient de l’Angleterre la restitution des
cendres et confie à son 4ème fils, le Prince de Joinville, le soin de
conduire cette mission à bord du navire « la Belle Poule ».

- L’Empereur Napoléon (avant, pendant, après)
Ce mouchoir très riche dans sa composition et dans la qualité de sa gravure relate la vie de l’Empereur sur trois
registres. De gauche à droite, les temps forts du règne de Napoléon sont évoqués, l’ensemble de la
composition est surmonté d’un l’aigle. La première colonne représente les débuts de l’Empereur : jeune
officier sur un champ de bataille (en haut), visitant les pestiférés de
Jaffa (inspiré de l’œuvre de Gros), en dessous un texte narre sa
jeunesse et ses premiers exploits militaires.
Au centre, c’est le règne de l’Empereur qui est illustré : debout avec
ses attributs impériaux (en haut), pendant le sacre (inspiré du
tableau de David), en dessous un texte explicatif narre les grandes
réalisations de l’Empereur
A droite, c’est l’exil qui est représenté : Napoléon à Sainte-Hélène
(en haut), Napoléon lors des fêtes du 15 août sur l’île et un texte
narratif en dessous.
Sous cette composition, des objets évoquent les principales
réalisations et conquêtes de l’Empereur : code napoléonien, momie
égyptienne…
De chaque coté du mouchoir deux colonnes sur lesquelles le nom
des grandes victoires militaires de l’Empereur sont inscrites.
Photo 5 : Mouchoir illustré gravé par Houiste, imprimé à la plaque de cuivre vers 1840. MTAN 2001.1.83
- Le tombeau de Napoléon
Photo 6 : Mouchoir illustré, gravé par l’atelier Buquet (« Buquet del. et sc. ») et imprimé chez Lamy-
Godard (« F. de Lamy-Godard à Rouen ») à Darnétal en 1853, MTAN 2001.1.82
Photo 7 : Dessin préparatoire réalisé par l’atelier Buquet. MTAN 2004.7.5.41
Ce mouchoir représente le tombeau de Napoléon Ier aux Invalides. Sous la scène, un texte explicatif : « Les
cendres de ce grand homme rapportées en France sur la frégate "La Belle -Poule" commandée par le Prince de
JOINVILLE, arrivèrent le 15 décembre 1840 après avoir remonté la Seine au milieu des témoignages
d'allégresse de toutes les populations riveraines heureuses de saluer les restes de celui qui fit la France si
grande. On a fait de magnifiques funérailles pour transporter le corps de NAPOLEON 1ier. Dans l'église des
Invalides. Les grands dignitaires de l’Etat, l'Armé le peuple, tout le monde enfin s’empressa d'accompagner les
restes si chers ».
Deux pilastres encadrent la scène. Dessus, figurent des inscriptions rappelant les temps forts du règne de
l’Empereur : Honneur, Conseil d’Etat, code napoléonien, cour des comptes, patrie, travaux publics,
enseignement public.

2/ La Révolution de 1848
Le 23, 24, 25 février 1848, le peuple parisien se soulèvent sous l’impulsion des libéraux et des républicains,
contraignant le roi Louis-Philippe à abdiquer. Les révolutionnaires imposent un gouvernement provisoire
mettant ainsi fin à la Monarchie de Juillet et instaurant un nouveau régime : la Seconde République le 25 février
1848. Les mouchoirs de cou de l’atelier Buquet illustrent les moments forts et les personnages clés de ces trois
jours d’insurrection. Pour réaliser ces mouchoirs d’actualité, puisqu’ils sont publiés pendant l’année de
l’événement, Buquet s’inspire des lithographies de l’époque.
- Le trône brûlé
La scène représente un moment clé des trois journées d’émeute de février 1848. Au centre sur la place de la
Bastille, le trône royal est brulé par les émeutiers. Sous la scène on peut lire : « Le trône de France où tant de
rois se sont assis est brûlé par le peuple au pied de la colonne de juillet ». Au pied du trône des parchemins
sont également incendiés, ils symbolisent les griefs du peuple contre le pouvoir en place « abandon de la
Pologne », « indemnité Pritchard », « corruption électorale » « massacre de la rue Transnonain ».
Le 24 février, après deux journées d’émeute, les révolutionnaires s’emparent de l’hôtel de ville, du palais royal
et des Tuileries où ils prennent le trône royal, symbole du pouvoir en place.
Ce mouchoir s’inspire d’une lithographie retrouvée dans le fonds d’archives de l’atelier Buquet.
Photo 8. Epreuve d’atelier, gravée par l’atelier Buquet (« Buquet del. et sc. » et imprimée chez Lamy-
Godard (« Fque de Pre Bataille à Rouen » en 1848, MTAN 80.10.17
Photo 9 : Lithographie de Lordereau « le trône brulé ». MTAN 2004.7.6.56
-
-
-
-
-
- Lamartine haranguant le peuple
Cet épreuve d’atelier représente Lamartine débout devant une assemblée
proclamant un discours pour défendre le drapeau tricolore. Le drapeau
qu’il tient porte l’inscription « République française ». Sous la scène on
peut lire « Citoyens vous demandez le drapeau rouge, je vais vous dire
pourquoi je le repousse de toute la force de mon patriotisme. C'est que
notre drapeau tricolore a fait le tour du monde à la tête de nos armées
avec nos libertés et nos gloires et que le drapeau rouge n'a fait que le tour
du champ de Mars trainé dans des
flots de sang !... »
Photo 10. Epreuve d’atelier, gravée par l’atelier Buquet (« Buquet,
sc.») et imprimée chez Pierre Bataille (« Fabque de P. Bataille à
Rouen») en 1848, MTAN 2001.1.48
Photo 11 : Dessin préparatoire réalisé par l’atelier Buquet MTAN
2004.7.5.33

- La montagne
Trente députés élus le 23 avril 1848 à l’Assemblée Constituante, siègent dans les tribunes de l’Assemblée.
C’est la partie gauche de l’Assemblée regroupant la gauche socialiste, dénommée les montagnards qui est
représentée ici. Chaque député porte un numéro qui renvoie à son nom et aux départements où il a été élu.
Photo 12. Mouchoir illustré, gravé par l’atelier Buquet
(« Gravé par Buquet ») et imprimé chez Pierre Bataille en
1848, MTAN 2001.1.166
- Le général Cavaignac
Au centre du mouchoir, dans un médaillon de forme octogonale, le général Cavaignac est représenté à cheval
entouré par la Garde Nationale. Le général Cavaignac élu député pour la Seine et le Lot aux élections d’avril
1848, se voit confier à la suite des journées d’insurrection le pouvoir exécutif.
Tout autour du mouchoir de petites scènes légendées relatent les événements marquant des journées
d’émeute de juin 1848 :
- Révolte des Ateliers Nationaux le 22 juin 1848
- Le Garde Nationale
- Leclerc voyant son fils qui combattait à ses cotés, frappé mortellement l’enlève et va chercher son second
fils pour le remplacer.
- Charge de cavalerie contre les insurgés.
- Le Général de Brea et son aide de camp allant porter des paroles de conciliation aux insurgés sont
lâchement assassinés.
- Le Jeune Martin garde mobile s’élance sous une pluie de balles et enlève un drapeau aux insurgés.
- Transport de blessés aux ambulances.
- L’archevêque de Paris blessé mortellement sur la barricade Saint Antoine
-
Photo 13. Mouchoir illustré, gravé par l’atelier Buquet et
imprimé chez Pierre Bataille en 1848, MTAN 2001.1.178
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
1
/
16
100%