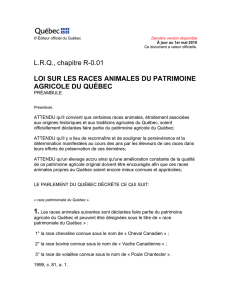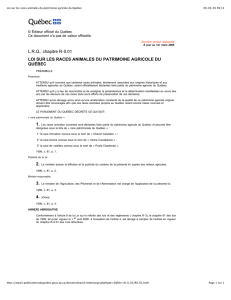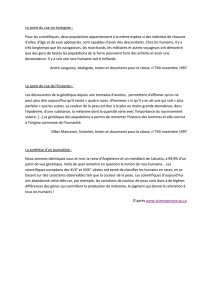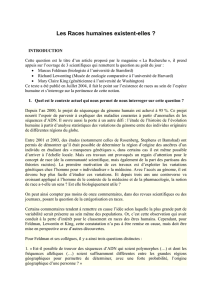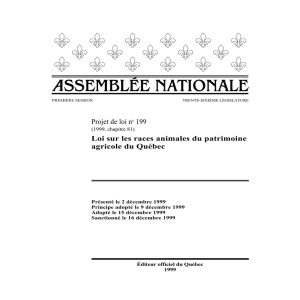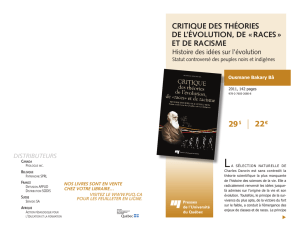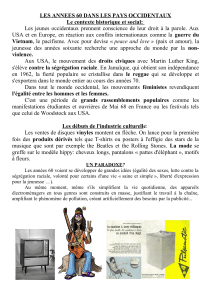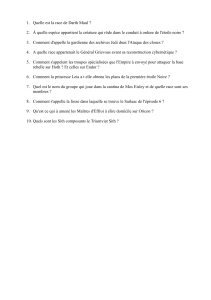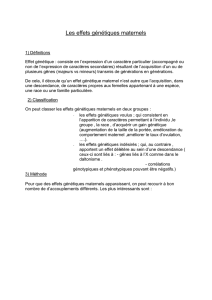La République raciale, 1860-1930.

Carole REYNAUD-PALIGOT, La République raciale, 1860-1930.
Paradigme racial et idéologie républicaine Presses Universitaires de France,
(coll. « Sciences, Histoire et Société »), 2006, 338 p., 28 €.
À la lecture du travail de Carole Reynaud-Paligot, on peine à croire que
les républicains du 19e siècle, héritiers déclarés des Lumières, aient réellement
cru avec Descartes que la raison ou le bon sens fut la chose du monde la mieux
partagée, tant il apparaît que la croyance en l’inégalité biologique et psychique
des races humaines a inspiré bien plus les esprits jusqu’aux années 30.
Oscillant entre les disciplines, histoire des sciences et sociohistoire
principalement, s’appuyant sur des lectures de première main nombreuses et
variées, Carole Reynaud Paligot montre dans La République raciale comment,
au 19e siècle, s’est construite en France, autour d’hommes de sciences affiliés à
la Société d’anthropologie de Paris, une représentation de la différence humaine
en termes raciaux et une vision inégalitaire du genre humain. Au cœur de
l’intrigue qui constitue ce travail, il y a le constat que les artisans de cette vision
« raciologique » du genre humain furent, pour nombre d’entre eux, des savants
républicains convaincus et militants, à l’image de Broca, Hovelacque, Mortillet,
Topinard ou Thulié. Alors même que ces hommes de science proclament leur
ralliement à la Troisième République, ils vont à partir de 1860 consacrer
l’essentiel de leurs activités scientifiques à la formulation et la diffusion d’un
paradigme raciologique fondé sur les principes 1) d’hérédité des caractères
somatiques et psychiques, 2) d’inégalité des capacités et 3) de hiérarchie des
groupes humains. Cette vision raciologique du monde va s’énoncer en parfaite
cohérence avec l’idéologie républicaine, estime l’auteur, alors même que les
présupposés de cette weltanschauung raciale de l’humanité apparaissent
moralement antinomiques avec les valeurs républicaines puisant dans
l’universalisme des Lumières.
À travers une reconstitution des origines et des étapes de la construction

scientifique du paradigme racial autour de la Société d’anthropologie de Paris
(1860-1900), l’étude rappelle les évolutions d’une pensée sur l’homme allant de
la notion de « race » à la formation d’un paradigme racial. Soulignant l’apport
des naturalistes et des philosophes des Lumières ayant par le passé développé
une pensée hiérarchique et inégalitaire, l’auteur estime que l’avènement du
paradigme racial s’inscrit dans une longue tradition dépréciative de l’altérité.
Nouvelle science de l’homme, l’anthropologie raciale se veut science autonome
fondée sur l’usage systématique de l’anatomie comparée des groupes humains
étudiés dans une logique hiérarchique.
Le « portrait-robot du raciologue fin de siècle » est précis. Il est
généralement médecin, libre-penseur, matérialiste, opposant à l’Empire avant de
devenir « républicain modéré ou radical mais non pas modérément républicain ».
Il est avant tout un partisan zélé d’une anthropologie raciale appelée à
révolutionner notre vision de l’humanité et des sociétés. L’année 1885 marque le
point culminant de l’offensive publique des « raciologues ». Cette année-là, la
Société d’anthropologie de Paris compte un maximum de 757 membres oeuvrant
collectivement à la diffusion, dans la sphère publique, d’une authentique culture
raciale vulgarisée via revues, conférences et manuels scolaires. Pour l’auteur, on
observe alors une véritable « osmose entre pensée raciale et idéologie
républicaine (…). Partie intégrante des valeurs républicaines, le paradigme racial
a pu trouver place au sein des publications grand public, des revues de
vulgarisation scientifique jusqu’aux manuels scolaires ».
Militants de la République laïque, les raciologues s’identifient bien au
camp républicain tant par leurs origines sociales que par leur formation et leur
carrière, entretenant des liens étroits avec la libre pensée et la franc-maçonnerie.
Aux heures les plus graves du régime, ils apporteront un soutien sans faille à
cette République. Cette fidélité à la République rehausse le prestige et l’influence
de la communauté des anthropologues raciaux dont l’influence dans le débat
public atteint son apogée à la fin des années 1880.
La naissance des sciences sociales et la défiance à l’égard des doctrines

racistes vont contribuer à la baisse d’audience du paradigme racial à la fin du 19e
siècle, mais non à son éviction du débat public. La croyance diffuse en une
inégalité biologique des races va résister au cœur même des sciences humaines et
sociales qui s’affirment pourtant en rupture avec la logique biodéterministe du
paradigme raciologique. Les sciences humaines et sociales vont ainsi préserver
en partie les cadres d’une représentation raciale de la nature humaine, perpétuant
certains schémas différentialistes et biodéterministes pourtant en contradiction
avec « l’explication du social par le social ». C’est le cas de la sociologie
durkheimienne qui, en théorie, s’oppose radicalement à la raciologie et la
sociobiologie, mais qui, en pratique, perpétue une vague croyance en l’inégalité
des races et en la détermination psychophysiologiques de certains phénomènes
sociaux (Voir Durkheim, De la division du travail social). Ainsi, affirme Carole
Reynaud-Paligot, si la sociologie durkheimienne opère bien une rupture avec la
pensée raciologique, celle-ci doit cependant être relativisée, car si les facteurs de
la race et de l’hérédité cèdent bien le pas devant le social, la causalité
sociologique supplantant la causalité biologique dans l’explication des faits
sociaux, ils ne disparaissent pas totalement de l’appareil épistémologique
durkheimien. Jusqu’aux années 30, les sciences humaines et sociales vont
demeurer dans une position ambiguë par rapport au paradigme raciologique,
oscillant entre permanences et ruptures dans des schémas naturalistes,
héréditaristes, inégalitaires et mixophobes (psychologie des peuples de Taine et
Boutmy, histoire et géographie, Renan, Fouillée).
Dans le débat public, plusieurs querelles idéologiques donnent corps à
cette diffusion du paradigme racial : monogénisme versus polygénisme,
créationnisme versus transformisme, perfectibilité versus décadence. Mais c’est
l’aventure coloniale de la République qui favorise la large diffusion d’une vision
raciale des différences ethnosociologiques. Le monde colonial contribue
largement au maintien d’une vision raciologique et inégalitaire de l’altérité. Les
usages scientifiques et coloniaux du paradigme racial sont nombreux
(1880-1930), montrant que la République ne serait pas incompatible avec une
vision raciale et inégalitaire de l’humanité. Cette intrusion des problématiques

raciologiques dans les colonies a des implications idéologiques vitales sur le
destin des peuples conquis. Anthropométrie et classifications raciales sont en
effet de lourds arguments dans les débats sur les fins de la politique coloniale :
Association ou assimilation ? Quels droits et quelle représentation pour les
indigènes ? Quelle éducation pour des races différentes ? En France
métropolitaine aussi, les théories raciologiques guident la gestion de la main-
d’œuvre exotique importée des colonies pour contribuer en 1914 à l’effort de
guerre. Mais tout bien pesé, estime Carole Reynaud Paligot, ces égarements
raciologiques des Républicains seraient sans graves conséquences idéologiques
dans la mesure où la pensée raciale républicaine se distinguerait par son refus de
l’antisémitisme et du nationalisme.
Ces analyses appellent quelques remarques critiques. Tout d’abord,
Carole Reynaud-Paligot semble souscrire à une vision continuiste de la pensée
raciale. Or, il n’y a pas de continuité épistémologique de la « race » des
théologiens du Moyen Âge, des naturalistes et des philosophes des Lumières à
celle des raciologues du 19e siècle, tenants de l’inégalité biologique des races.
Car le signe distinctif de l’anthropologie raciale de Broca et de ses disciples, c’est
l’affirmation d’une « causalité biologique » comme principe d’explication
universel des identités et des différences. C’est cette causalité biologique qui
trace une frontière nette entre l’ethnocentrisme des Lumières et l’anthropologie
raciale, cette « biologie du genre humain » (Broca) qui sanctionne la conversion
biologique de l’idée de « race » désormais fondée sur des principes d’hérédité et
d’irréversibilité.
Schéma de pensée biodéterministe prétendant expliquer tous les
évènements et toutes les actions par un fait, la « race biologique », le racialisme
inaugure l’âge du fatalisme bioracial. Il fait pénétrer la pensée sur l’homme dans
l’ère du déterminisme biologique où, remarque Michel Foucault, « classer ne
sera donc plus référer le visible à lui-même, en chargeant l’un de ses éléments de
représenter les autres ; ce sera, dans un mouvement qui fait pivoter l’analyse,
rapporter le visible à l’invisible, comme à sa raison profonde, puis remonter de
cette secrète architecture vers les signes manifestes qui en sont donnés à la

surface des corps ».
En outre, la dimension idéologique des théories raciologiques paraît
insuffisamment traitée. Or, en France et aux Etats-Unis, pays où les théories
anthroporaciales et les doctrines racistes connaissent leur développement le plus
puissant entre 1850 et 1900, les thèses raciologiques s’énoncent parallèlement à
la formulation d’une pensée raciste antilibérale. C’est précisément la conversion
biologique de l’idée de race qui marque le saut idéologique de la pensée raciale.
Cette idéologie raciste se construit explicitement comme une doctrine anti-
individualiste, opposant un déterminisme bioracial universel aux revendications
de l’individualisme libéral. En France et aux Etats-Unis, l’idéologie raciste va
s’énoncer dans le débat public sous la forme d’une critique systématique et
cohérente de la doctrine libérale dans ses aspects philosophiques, éthiques,
juridiques, politiques, et même sociologiques. Aux Etats-Unis, l’idéologie raciste
incarne, au cœur de la querelle sur l’institution esclavagiste, une authentique
« réaction » contre les sources libérales de la doctrine abolitionniste. En France,
elle revêt la forme d’une critique radicale de l’héritage des Lumières, de la
Révolution et de la République.
L’avènement de la raciologie marque donc une sorte de reconversion de
la pensée raciste dans le champ scientifique, favorisée par la double dimension de
l’idéologie raciste qui, comme toute idéologie, a une fonction pratico-normative
et une fonction explicative. Ainsi, après avoir été partiellement défaite sur le
terrain politique, elle va former la base d’un paradigme socio-explicatif
hégémonique au 19e siècle. Les notions d’hérédité et de race biologique,
revisitées et adaptées au cadre d’une philosophie évolutionniste, deviennent les
variables incontournables pour toute tentative d’explication de l’Histoire et des
sociétés. En France et aux États-Unis, le développement d’une vision biologique
et racialiste du social s’opère dans la diffusion des modèles évolutionniste et
darwiniste. Une vision raciologique des sociétés humaines va dès lors constituer
la base commune et dominante des premières « sciences humaines » :
philosophie, anthropologie, psychologie, sociologie.
Si cette dimension idéologique de la raciologie est insuffisamment
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
1
/
11
100%