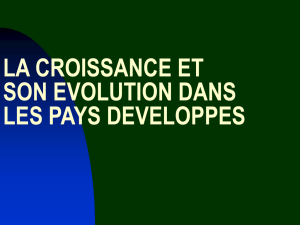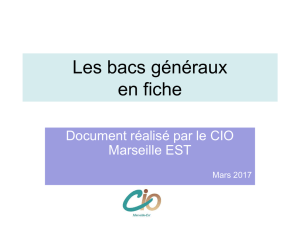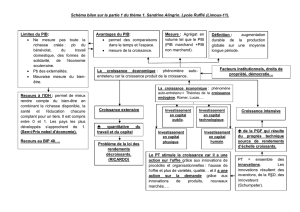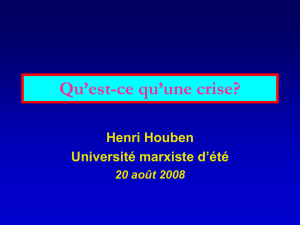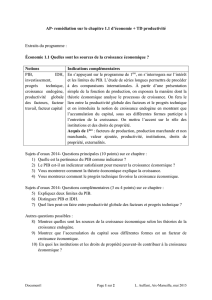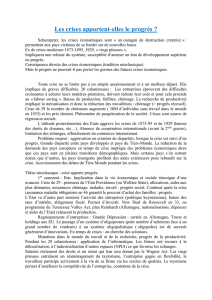Quel rôle respectif peut-on attribuer à la consommation et à l

Quel rôle respectif peut-on attribuer à la consommation et
à l’investissement dans la croissance et les fluctuations aux
XIX et XX° siècle dans les pays occidentaux ?
Source : Catherine Feuillet (Melchior)
Même si il a existé des périodes de croissance c'est-à-dire d’augmentation des richesses avant
le XIX° siècle on peut considérer que c’est à partir de cette période que les économies et
sociétés occidentales se sont vraiment engagées dans des processus de croissance. Mais ces
processus n’ont pas été réguliers. Ils se sont accompagnés de fluctuations qui ont ponctué à
intervalles plus ou moins irréguliers le déroulement de la croissance. La croissance que l’on
peut définir comme l’augmentation durable du PIB a fait l’objet d’analyses de plus en plus
importantes au cours du temps et on a cherché à savoir comment elle était générée, comment
on pouvait augmenter le taux de croissance mais aussi pourquoi à certains moments il pouvait
y avoir un ralentissement de la croissance, ou même une diminution du PIB sur des périodes
plus ou moins longues, ce qu’on a appelé récession ou dépression selon la durée des
mouvements.
Le développement de la comptabilité nationale à partir des années 1950 a permis des
approches statistiques qui sont venues étoffer les approches théoriques : quels enseignements
peut-on tirer des chiffres et des équations comptables ? Comment expliquer la croissance du
PIB ?
Le PIB c'est-à-dire le produit intérieur brut représente les ressources qui sont à la disposition
des consommateurs et des entreprises. L’augmentation du PIB désigne donc une
augmentation des ressources disponibles. Ces ressources sont destinées à être utilisées : c’est
ce qu’illustre le tableau « Entrées –sorties » de la comptabilité nationale. Comment les
ressources sont elles utilisées ? On peut rappeler les grandes lignes de ce tableau :
PIB + Importations=Consommation intermédiaire+ consommation
finale+FBCF+Exportations+Variations de Stock.
Il apparait aussitôt que la consommation (finale) et l’investissement (FBCF) sont des
utilisations des ressources crées, c'est-à-dire du PIB.IL en résulte que on peut se poser la
question suivante : Si l’on regarde ce qui s’est passé depuis le XIX° siècle et les débuts de
l’industrialisation, qu’est ce qui peut bien expliquer la croissance : la consommation ou
l’investissement ou les deux ?Et si l’on veut augmenter le taux de croissance, sur quoi faut-il
compter : la consommation ou l’investissement ?
Si cette question apparait être d’une brulante actualité (politiques d’offre contre politiques de
la demande) il n’en demeure pas moins qu’elle semble avoir été au cœur des préoccupations
des individus qu’ils fussent consommateurs, entrepreneurs, théoriciens, ou même décideurs
politiques depuis longtemps.
Consommation et Investissement sont les deux sources de la croissance, il ne faut donc pas
choisir : les périodes de forte croissance ont été des périodes au cours desquelles il y avait une
augmentation des quantités consommées et de l’investissement tandis que les périodes de
récession et e dépression ont été marquées par la faiblesse de ces deux agrégats. Et
aujourd’hui alors que dans les économies anciennement développées on déplore la faiblesse

du taux de croissance, il semble a priori qu’il faille agir en direction à la fois de la
consommation et de l’investissement.
Et en amont de ces préoccupations la question centrale est donc celle de la politique à mener
pour maintenir ou rétablir un taux de croissance considéré comme optimal au regard des
caractéristiques des pays c’est à dire au regard de l’histoire mais aussi des normes en terme
notamment de qualité de vie et des normes environnementales.
Nous montrerons donc que la consommation et l’investissement entretiennent de manière
complémentaire la croissance. Et que c’est aussi parce que la consommation et
l’investissement nourrissent tous deux la croissance qu’il ne faut pas négliger l’un des deux au
risque de voir l’économie basculer dans la crise. Enfin à la lumière des difficultés
économiques actuelles nous montrerons que la relation entre consommation et investissement
pour assurer la croissance est sans doute de plus en plus complexe ce qui pose la question de
la bonne politique économique à mette en place pour assurer la croissance.
1) La consommation et l’investissement sont au cœur des processus de croissance depuis
la période appelée traditionnellement le décollage. Cette affirmation peut être étayée à
partir de différents angles d’attaque : tout d’abord on peut observer la complémentarité
entre ces deux grandeurs quand on s’intéresse à la croissance dans l’histoire des
économies depuis le XIX siècle, on peut en expliquer les mécanismes et on peut se référer
aux travaux des auteurs.
A - Si chaque période est évidemment marquée par des spécificités qui sont liées à un
contexte politique, institutionnel, démographique et social, il n’en demeure pas moins que
l’on peut lier de manière générale consommation et investissement pour expliquer la
croissance depuis le XIX°siècle et sans doute de manière plus marquée depuis le XX° siècle
On peut l’illustrer par exemple à partir de plusieurs exemples : la croissance industrielle au
XIX° siècle, l’émergence du fordisme dans les années 1920 puis son développement pendant
les 30 Glorieuses.
AU XIXème siècle, l’expansion se réalise autour d’une ou deux industries motrices qui
exercent des effets d’entrainement sur l’ensemble de l’économie. Le développement des
chemins de fer, des industries sidérurgiques et mécaniques met bien en évidence les
interdépendances entre la consommation et l’investissement : par exemple les investissements
dans le chemin de fer ne sont possibles que parce qu’ il y a une demande de transport et cela
depuis la première liaison entre Liverpool et Manchester en 1830(Rosier, les théories des
crises économiques)Cela entraine une conjoncture favorable à la fois aux profits et aux
salaires qui nourrit des anticipations positives qui permettent d’installer le système dans une
croissance durable. Plus tard Le fordisme est mis en place aux Etats Unis et consiste en cette
stratégie qui cherche à associer le consommateur à la croissance en lui permettant d’acheter
donc de consommer les produits que son travail réalisé sur des machines et plus
particulièrement son travail à la chaine dans l’industrie automobile a contribué à créer. Ford a
bien compris que la seule façon d’assurer des débouchés aux firmes est de distribuer aux
salariés un salaire conséquent. Mais en même temps, comme les salaires sont un coût, il faut
augmenter la productivité donc investir, innover et standardiser ce qui est déjà au cœur des
stratégies tayloriennes depuis le début du XX° siècle.

On retrouve cela à une échelle bien plus grande pendant les 30 Glorieuses et c’est l’ensemble
du système qui est alors concerné par cette complémentarité. Tant les éléments sont liés tant il
est difficile de trouver un élément moteur de la croissance. C’est une période où il y a des
gisements de productivité colossaux notamment en France et qui n’attendent qu’une allumette
pour embraser tout le système : Les gains de productivité permettent une augmentation du
gâteau à partager et même si il demeure des inégalités, tout le monde, certes à son rythme, en
profite. Ce sont les dividendes du progrès dont parle P.Massé. Ces gains sont liés en amont à
des investissements qui ont à ce moment une double nature : à la fois de capacité et de
productivité ; ils permettent une production plus importante et plus rapide et le prix relatif des
biens produits diminue par rapport au salaire. Ces investissements n’ont de sens que parce
qu’il y a une augmentation de la demande finale mais celle-ci se manifeste parce que il y a
une augmentation du pouvoir d’achat des « travailleurs-consommateurs », ce qui met en
évidence une sorte de cercle vertueux, « Offre/Demande » et qui est illustrée concrètement par
l’augmentation des taux d’équipement des ménages en machineries domestiques diverses.
B - Mais la croissance prend sa source au sein des entreprises. Comment peut-on mettre en
évidence la complémentarité entre la consommation et l’investissement au sein de la firme ?
Le modèle standard de la microéconomie enseigne que la combinaison entre les facteurs
travail et capital aboutit à un produit qui est écoulé sur le marché de concurrence parfaite. La
croissance de la firme est obtenue par une augmentation des quantités de facteurs utilisés
et/ou par des gains de productivité. L’augmentation des quantités de capital (qui se traduit
concrètement par une augmentation de la quantité d’équipement dans l’entreprise) participe à
l’augmentation de la taille de la firme et est le résultat de l’investissement par définition.
Associée à une quantité de travail croissante elle aussi à un rythme proportionnel ou non à
l’augmentation de la quantité de capital, cette situation permet à la firme d’avancer sur le
sentier d’expansion. On voit bien le rapport entre l’investissement réalisé dans l’entreprise et
l’augmentation de sa taille, donc sa croissance. D’ailleurs l’expression même d’ «
investissement de capacité » désigne cette qualité qu’a l’investissement de permettre la hausse
des « capacités » c'est-à-dire la croissance. Mais le rôle de la consommation est plus complexe
dans ce modèle. L’idée est que l’entreprise qui met des produits sur le marché n’a aucune
contrainte de débouché suivant en cela la loi des débouchés de J.B.Say. Elle peut donc
augmenter les quantités produites sans risque à condition qu’elle suive les règles de la
concurrence parfaite mais ceci est mécanique puisque le fait de déroger aux principes de la
concurrence (contrainte de prix, contrainte de rémunération des facteurs de production…)
l’exclut immédiatement du marché. Donc l’augmentation des quantités produites grâce à
l’investissement trouve des débouchés automatiquement : l’offre (c’est à dire la production
mais aussi l’investissement) crée sa propre demande c'est-à-dire que l’investissement crée la
consommation. Et en agrégeant les données microéconomiques, on retrouve ce qui a été vu
plus haut : la consommation et l’investissement sont bien complémentaires dans l’explication
de la croissance, mais c’est une sorte de complémentarité automatique !
Ces mécanismes sont donc par trop simplificateurs et on peut réfléchir à la façon dont les
firmes ont cherché à assurer leurs débouchés dans un cadre qui est plus proche de la réalité et
qui est celui de la concurrence imparfaite. Dès les années 1930, Chamberlain analyse les
processus de différenciation des produits mis en place par les firmes pour s’assurer un pouvoir
de marché. Ces stratégies de différenciation sont au cœur du fonctionnement des entreprises
pendant les 30 Glorieuses. En même temps que les produits sont standardisés les firmes
s’attachent leurs clients en réfléchissant au petit point de détail qui fera la différence par
rapport au concurrent…et elles investissent en fonction de cela, on assiste bien à un

formidable cheminement qui va de l’investissement à la consommation et qui retourne à
l’investissement et ainsi de suite…
C- L’ analyse économique fournit un certain nombre de paradigmes qui permettent de bien
comprendre la complémentarité de la consommation et de l’investissement dans l’analyse
historique et théorique de la croissance. La complémentarité de la consommation et de
l’investissement c’est d’abord l’illustration de ce que l’économie fonctionne comme un
circuit, premier paradigme. Quesnay est le premier auteur à le mettre en évidence. Chaque
classe de la société participe à l’harmonie de l’ensemble. Toutes les classes sont liées au sein
d’un circuit qui va de la production à la distribution de la valeur. Par extension on peut
considérer que consommation et investissement sont deux pôles de ce circuit.
Mais c’est surtout Keynes qui met en évidence les liens forts entre consommation et
investissement parce que justement il est marqué par ce qu’il observe dans les années1030 :
l’équilibre entre la consommation et l’investissement est rompu, ce que n’ont pas vu les
investisseurs qui ont trop cru en la loi des débouchés : ceux-ci ne sont pas assurés
automatiquement, il faut intervenir dans l’économie pour assurer aux entreprises des
débouchés : comment ? C’est alors qu’il faut faire entrer en scène le mécanisme du
multiplicateur. La décision d’injecter de la monnaie dans l’économie pour déclencher des
opérations d’investissement ce qu’on voit par exemple au moment des grands travaux aux
Etats-Unis dans les années 1930 permet de comprendre cette complémentarité entre la
consommation et l’investissement. Ces grands travaux se traduisent par des commandes
publiques notamment à des fournisseurs qui voient ainsi leur activité se développer, ce qui a
entre autres conséquences positives une augmentation de l’emploi et /ou de la rémunération
du travail ce qui se traduit, pour un taux d’épargne donné par une augmentation de la
consommation. On peut bien se représenter cela de manière statique mais aussi dynamique :
c'est-à-dire à un moment donné on comprend bien la relation mais il faut aussi l’envisager en
pensant au mouvement dans l’économie, c'est-à-dire que c’est bien le supplément
d’investissement qui doit être conforté par un supplément de demande, mais aussi, un
supplément de consommation qui va susciter une hausse de l’investissement ce qui est le cœur
de la thèse d’ Aftalion : l’investissement est expliqué par la croissance de la demande et
l’augmentation de l’ investissement est expliqué par la dérivée seconde de la demande c’est à
dire par son accélération. Ainsi les investissements croissants dans les années 1960 ne l’ont ils
été que parce que les anticipations relatives à l’augmentation ce la demande étaient tout à fait
positives.
Transition :
Il y a donc une relation forte entre consommation et investissement, qui sont deux agrégats
qui permettent de nourrir la croissance. On peut l’observer et on peut l’analyser comme nous
venons de le voir. Si l’on revient sur la question de la différence entre approche statique et
approche dynamique, il apparait alors un nouvel éclairage : C’est sans doute le déséquilibre
entre la consommation et l’investissement qui explique au moins en partie les crises et les
fluctuations qui se sont succédé depuis le XIX° siècle.
2) On peut observer ce qui s’est passé au cours des crises et des récessions et dépressions
qui ont traversé les pays depuis le XIX° siècle et profiter des travaux des auteurs pour
en dégager des analyses sur les rapports de la consommation et de l’investissement en
période de difficultés économiques.

A- Tout d’abord il faut remarquer que un certain nombre de crises au cours du XIX° siècle
demeurent des crises d’ancien régime c'est-à-dire des crises qui sont d’abord expliquées par
des phénomènes climatiques qui viennent désorganiser la production agricole à un moment où
celle-ci représente une grande partie de la production de richesses. Cela se traduit par des
disettes liées à la faiblesse de l’offre agricole : dans ce cas la volonté d’établir un lien entre
consommation et investissement dans l’explication des crises et du marasme économique n’a
qu’un intérêt limité.
Mais le développement des productions industrielles va mettre en évidence cette question du
rapport entre consommation et investissement. Par exemple, B.Rosier montre bien dans « les
théories des crises économiques » comment se produit le déséquilibre qui va faire basculer
l’économie dans la crise puis la dépression. La poursuite des investissements et
l’augmentation des productions créent les conditions de la rupture quand la demande ne suit
plus. Les anticipations de profit deviennent pessimistes, et si l’expansion s’est réalisée autour
de quelques industries motrices qui ont eu des effets d’entrainement sur l’ensemble de
l’économie, de la même façon le déséquilibre parti d’une activité particulière ( chemins de fer,
sidérurgie, mécanique) va se diffuser à l’ensemble de l’économie et puisque le système est un
circuit, on assiste à des réactions en chaine : à la fois dans la sphère économique mais aussi
sociale : chute des prix, chute des profits, chute des salaires, faillites, chômage, misère
ouvrière. Et c’est ainsi qu’entre 1816 et 1914 on ne compte pas moins de 12 crises
économiques ! Et on voit bien l’aspect dynamique de ces situations : c’est la simple variation
d’une grandeur jouant un rôle important dans l’économie qui produit des réactions en chaine.
On ne peut laisser de coté la question de la crise de 1929 qui nous semble être un bon exemple
de l’articulation entre la consommation et l’investissement. La crise de 1929 s’inscrit bien
dans le schéma des crises classiques et des fluctuations se manifestant 8 ans après la crise de
reconversion de 1921.Elle fait suite à une période d’expansion économique depuis 1922 elle-
même liée aux applications de la seconde révolution industrielle, applications industrielles de
l’électricité, du moteur à explosion et de la chimie ; les innovations notamment dans le
domaine de l’organisation du travail permettent d’augmenter la productivité apparente du
travail : « les conditions de la production de masse sont dès lors réunies »(B.Rosier).Mais la
répartition des revenus est inégale et si le salaire est un coût il est aussi un revenu et le support
de la consommation. Et le fait de maintenir les salaires à un niveau faible empêche la
consommation de jouer son rôle : être le débouché de productions croissantes. On voit
immédiatement le déséquilibre qui va résulter de cela et qui montre une fois encore
l’importance des ces deux piliers de l’activité : la consommation et l’investissement.
B- Les travaux théoriques permettent d’affiner les analyses des rapports de la consommation
et de l’investissement dans les mécanismes de fluctuations. Quels sont donc les auteurs qui
nous permettent d’avancer dans la compréhension ? Nous pouvons évoquer les analyses
classiques par exemple en France celle de J.Rueff qui considère que toute crise est
conjoncturelle et que le moyen d’en sortir est de libérer le marché de toute entrave. Il ne s’agit
donc pas d’un problème de déséquilibre entre la consommation et l’investissement mais d’un
« défaut » systémique de l’organisation : on ne respecte pas les règles de la concurrence
parfaite : nous laissons de coté ce type d’analyse qui s’appuie sur une représentation
extrêmement éloignée de la réalité et qui repose aussi sur le rejet de l’intervention de l’Etat.
Par contre la référence à Galbraith nous semble tout à fait importante. Galbraith insiste bien
sur l’écart qui s’est creusé entre l’augmentation de la productivité du travail et la quasi
stagnation des salaires et des prix au moment de la crise de 1929. Ceci se traduit par de
grandes inégalités de revenus : les détenteurs de profits bénéficient de l’augmentation des
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
1
/
9
100%