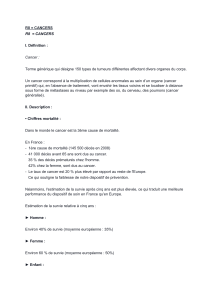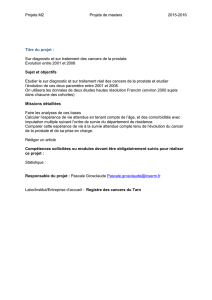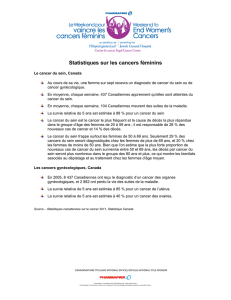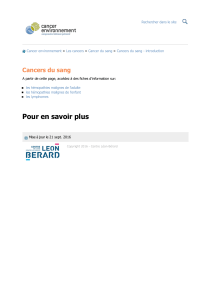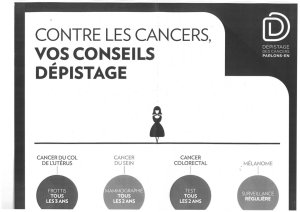Cancers gynécologiques DOSSIER THÉMATIQUE Gynecological cancers

100
80
Survie sans progression (%)
Mois depuis la randomisation
60
40
20
0
0 12
* Borne de la valeur de p = 0,0116Bév. : bévacizumab ; PC : paclitaxel + carboplatine.
24 36
PC
PC + bév. PC + bév. ➙ bév.
Figure 1. Courbes de survie sans progression de l’essai GOG-0218 (d’après Burger RA
et al., abstr. LBA1).
PC
(n = 625) PC + Bév.
(n = 625)
PC + Bév. ➝
Bév.
(n = 623)
Événéments, n (%) 423 (67,7) 418 (66,9) 360 (57,8)
SSP médiane (mois) 10,3 11,2 14,1
HR stratifié
(IC95)0,908
(0,76-1,04) 0,717
(0,63-0,82)
p, test unilatéral 0,080* < 0,0001*
100
75
Survie sans progression (%)
Mois
50
25
00 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30
Contrôle
17,3 19,0
Expérimental
Figure 2. Courbes de survie sans progression de l’essai ICON7 (d’après Perren T et al.,
abstr. LBA4).
Bras
contrôle Bras
expérimental
Événements, n (%) 392 (51) 367 (48)
SSP médiane (mois) 17,3 19,0
p0,0041
HR (IC95)0,81 (0,70-0,94)
20 | La Lettre du Cancérologue • Vol. XX - n° 1 - janvier 2011
DOSSIER THÉMATIQUE
Rétrospective 2010
Cancers gynécologiques
Gynecological cancers
P. Cottu*
* Département d’oncologie médicale, Institut Curie, Paris ; FEDEGYN, Groupe gynécologie de la Fédération
nationale des centres de lutte contre le cancer.
N
ous revoyons ici les principaux essais
concernant les cancers gynécologiques
publiés ou présentés en 2010.
Ovaire
Les nouveautés 2010 relatives aux carcinomes
ovariens peuvent se classer en 3 catégories : l’apport
potentiel du bévacizumab à la phase précoce,
l’expansion du concept de BRCAness et la réflexion
sur les stratégies chirurgicales.
Deux études randomisées multicentriques testant
l’apport du bévacizumab en première ligne dans
les cancers de l’ovaire ont été rapportées : l’étude
GOG-0218 lors du congrès de l’ASCO 2010
(Burger RA et al., abstr. LBA1) et l’étude ICON7 lors
du congrès de l’ESMO 2010 (Perren T et al., abstr.
LBA4). Le principe général de ces 2 études était
similaire : randomiser l’ajout du bévacizumab au
schéma conventionnel paclitaxel-carboplatine,
pour une durée de 12 à 22 cycles, à l’issue de la
chirurgie. L’étude GOG-0218 comportait de plus
un bras sans entretien par bévacizumab et un bras
placebo. Malgré ces différences de schéma et de
populations étudiées, plus gravement atteintes dans
l’étude GOG-0218, le message est très superposable :
l’adjonction du bévacizumab améliore significati-
vement la survie sans progression (SSP), mais de
manière non durable. Dans l’étude GOG-0218, la
SSP passe de 10,3 à 14,1 mois, avec un hazard-ratio
(HR) de 0,71 (IC
95
: 0,63-0,82 ; p < 0,0001) ; dans
l’étude ICON7, la SSP passe de 17,3 à 19,0 mois,
avec un HR de 0,81 (IC95 : 0,70-0,94 ; p = 0,0041)
[figures 1 et 2]. Le bénéfice en survie globale (SG) est
actuellement nul, avec des courbes superposées pour
les 2 études. Rappelons toutefois que la SG n’était
pas un objectif principal et que ce résultat est aussi
biaisé tant par les traitements après la rechute que
par les reculs, encore assez courts. Chaque lecteur
jugera de la pertinence clinique de ces résultats
et les mettra en balance avec les effets indési-
rables occasionnés par le bévacizumab, qui ont été
rapportés lors de la présentation de l’étude ICON7 :
épisodes de saignement (39 %), hypertension (26 %,
dont 18 % de cas de grade ≥ 2), épisodes veineux

100
80
Survie globale (%)
Années
Patients à risque (n)Événements (n)
60
40
20
00 2 4 6 8
336
334
Chirurgie première
Chimiothérapie néo-adjuvante
253
245
Chirurgie première
Chimiothérapie néo-adjuvante
189
195
62
46
14
13
2
2
10
Figure 3. Courbes de survie globale de l’essai EORTC de chimiothérapie néo-adjuvante (6).
La Lettre du Cancérologue • Vol. XX - n° 1 - janvier 2011 | 21
Points forts
»
Le bévacizumab prolonge la survie sans progression en première ligne thérapeutique des cancers
tubo-ovariens.
»Le concept de
BRCAness
commence à trouver une définition clinique et moléculaire.
»La vaccination anti-HPV continue à prouver son efficacité sur toutes les formes de lésions cervicales.
»
La curiethérapie vaginale est le traitement adjuvant de référence des cancers endométriaux à risque
haut ou intermédiaire.
Mots-clés
Bévacizumab
BRCAness
Vaccin contre
le papillomavirus
humain
Curiethérapie
vaginale
Highlights
»
Bevacizumab in first line
treatment of ovarian and
fallopian tube cancers prolongs
progression-free survival.
»
BRCAness is about to be
clinically and molecularly
defined.
»
Anti-HPV vaccines have
proven their efficacy against all
forms of HPV-induced cervical
lesions.
»
Vaginal brachytherapy is the
gold standard adjuvant therapy
for intermediate/high risk endo-
metrial cancer.
Keywords
Bevacizumab
BRCAness
HPV vaccine
Vaginal brachytherapy
thromboemboliques (6,7 versus 4,1 % dans le bras
sans bévacizumab). La discussion sur le position-
nement précoce du bévacizumab dans les carcinomes
ovariens à tous les stades est ouverte !
Les traitements médicaux des cancers de l’ovaire
ont exploré 2 autres voies. Les triplets de chimio-
thérapie sont probablement définitivement enterrés
par l’essai intergroupe comparant paclitaxel-
carboplatine à la même combinaison associée à la
gemcitabine (800 mg/m² à J1 et J8), chez plus de
1 700 patientes (1). Les résultats sont sans appel :
SSP supérieure dans le bras paclitaxel- carboplatine
(HR = 1,18 ; p = 0,0044), sans différence en SG, et
net excès de toxicité générale et hématologique
dans le bras gemcitabine. À l’opposé, le concept de
BRCAness se développe. La définition clinique est
en voie d’unification (tableau I) [2], se traduisant
par une histoire naturelle probablement différente
pour les carcinomes tubo-ovariens BRCA-déficients
avec un excès possible de métastases extrapéri-
tonéales (3). La définition moléculaire correspon-
dante est aussi en cours de définition (tableau I),
probablement sous-tendue par un profil d’expression
spécifique (2). L’application clinique peut se décliner
en 2 niveaux : l’existence d’un déficit constitu-
tionnel de BRCA 1-2 est associée à une haute effi-
cacité des inhibiteurs de PARP (Poly [ADP-Ribose]
Polymerase) [4], et elle est certainement retrouvée
en cas d’inactivation somatique de BRCA 1 et
BRCA 2, ce qui ouvre des perspectives thérapeu-
tiques considérables (5). À l’évidence, la définition
des portraits moléculaires des cancers de l’ovaire
devra conduire à une rationalisation des traitements,
et ce ne sont pas les approches conventionnelles,
ni le ciblage indirect, qui modifieront sensiblement
l’histoire naturelle.
Enfin, le volet chirurgical a également été consi-
dérablement développé au cours de l’année 2010
par 2 publications majeures. L’EORTC (European
Organisation for Research and Treatment of
Cancer) a comparé, au cours d’une étude rando-
misée multicentrique portant sur une population
de 670 patientes atteintes d’un cancer ovarien de
stade IIIc-IV, la chirurgie maximale première à la
chimiothérapie première par carboplatine- paclitaxel
suivie de chirurgie maximale à 3 cycles ou plus,
avec un schéma statistique de non- infériorité (6).
Objectif atteint : il n’a pas été possible dans cette
étude de montrer un bénéfice de la chimiothérapie
première (figure 3) et le facteur pronostique le
plus puissant reste, invariablement, le caractère
optimal de la chirurgie quel que soit le moment où
elle est réalisée. Le HR de décès est de 0,98 (IC
90
:
0,84-1,13 ; p = 0,01 pour la non-infériorité) et le HR
de progression est de 1,01 (IC90 : 0,89-1,15). Il n’y a
pas non plus de différence de morbidité ou de qualité
de vie entre les 2 bras. L’autre aspect important est
celui du curage ganglionnaire dans les formes de
Tableau I. Définition de BRCAness (2).
Définition phénotypique Définition moléculaire
– Sensibilité accrue
aux sels de platine, initiale
et à la rechute
– Intervalles libres longs
– Meilleure survie globale
– Type séreux prédominant
– Défaut de recombinaison
homologue
– Mutation germinale
ou somatique de BRCA 1
ou BRCA 2
– Extinction épigénétique
de BRCA1 ou BRCA 2 (5-31 %)
– Méthylation de FANCF
(environ 20 %), perte de
fonction d’autres gènes de
la recombinaison homologue
– Amplification d’EMSY
– Mutation de p53
– Amplification de c-Myc
– Instabilité génomique

100
A
80
Survie sans progression (%)
Semaines
60
40
20
00 10 20 30 40
Lapatinib
(n = 78) Pazopanib
(n = 74)
Survie sans progression
médiane (semaine)
HR (IC90)
p
17,1
0,013
18,1
0,66 (0,48-0,91)
Lapatinib
(n = 78) Pazopanib
(n = 74)
Survie globale
médiane (semaine)
HR (IC90)
p
39,1
0,045
50,7
0,67 (0,46-0,99)
Lapatinib
Pazopanib
Patients à risque (n)
50 60
78
74
45
46
20
22
8
12
2
6 2 1
70
100
B
80
Survie globale (%)
Semaines
60
40
20
00 10 20 30 40
Lapatinib
Pazopanib
Patients à risque (n)
50 60
78
74
69
69
59
52
37
34
21
23
10
12
5
7
70
1
1
Figure 4. Survie sans progression et survie globale d’une étude de phase II comparant lapatinib et pazopanib chez des femmes atteintes de cancer du
col avancé et prétraitées (10).
22 | La Lettre du Cancérologue • Vol. XX - n° 1 - janvier 2011
Cancers gynécologiques
DOSSIER THÉMATIQUE
Rétrospective 2010
petit stade. B. Trimbos et al. ont rapporté les données
actualisées de l’étude ACTION, qui comparait, chez
448 patientes, chimiothérapie à surveillance (7).
Après un suivi médian de 10 ans, la réalisation d’une
stadification chirurgicale optimale avec curage
ganglionnaire est un élément pronostique fort (HR
de décès = 1,89 ; p = 0,05), y compris en cas de
chimiothérapie complémentaire. Conformément
aux SOR (Standards, Options : Recommandations)
actuels (www.fnclcc.fr), le curage ganglionnaire reste
donc un geste clé de la prise en charge des cancers
ovariens de petit stade.
Col utérin
La saga de la vaccination préventive anti-HPV
(papillomavirus humain) se poursuit allègrement.
Les données des études FUTURE I et II, portant sur
plus de 17 000 femmes âgées de 16 à 26 ans, ont
été rapportées (8). Le principe était d’administrer
un vaccin tétravalent HPV 6, 11, 16, 18 à M0, M1 et
M6, et de suivre l’apparition de lésions bénignes et
malignes. Les résultats sont rapportés après un suivi
médian de 42 mois. Le niveau d’efficacité atteint est
impressionnant, avec plus de 95 % de prévention des
différentes lésions cibles (tableau II) et sans toxicité
notable. La vaccination tétravalente protège ainsi de
manière prolongée contre les lésions bénignes et de
bas grade cervicales et vulvo-vaginales.
En parallèle, plusieurs groupes ont poursuivi le
décryptage des anomalies moléculaires liées à
l’insertion génomique du virus HPV. À partir d’une
série de 34 cancers cervicaux pour lesquels les
sites d’insertion ont été mis en évidence, il a pu
être montré que dans 33 % des cas, cette insertion
s’accompagnait d’anomalies structurelles de l’ADN,
telles qu’une amplification, un gain ou une perte de
Tableau II. Résultats des études FUTURE I et II après un suivi médian de 42 mois (8).
Vaccin Placebo Efficacité ( % ajusté)
Néoplasie intra-épithéliale cervicale
(CIN I)
114/8 562 266/8 598 68,8
Néoplasie intra-épithéliale vulvaire
(VIN I)
8/8 689 26/8 702 69,1
Néoplasie intra-épithéliale vaginale
(VaIN I)
4/8 689 24/8 689 83,3
Condylome 63/8 689 305/8 702 79,4

50
A
0
Maximum reduction
from baseline measurement (%)
Patients (%)
– 50
– 100
0 10 20 30 40
Lapatinib (n = 78)
Progression
Stabilité
Réponse partielle
Réponse complète
Inconnu
50 60 70
50
B
0
Maximum reduction
from baseline measurement (%)
Patients (%)
– 50
– 100
0 10 20 30 40
Pazopanib (n = 74)
Progression
Stabilité
Réponse partielle
Réponse complète
Inconnu
50 60 70
Figure 5. Waterfall plot de la réponse au lapatinib et au pazopanib (10).
100
80
60
40
20
0
0 1 2 3 4 5
A B
Récurrence vaginale (%)
100
Patients à risque (n) Années 0 1 2 3 4 5
Années
80
60
40
20
0
C
Récurrence locorégionale (%)
100
80
60
40
20
0
Récurrence pelvienne (%)
p = 0,74 p = 0,02
10
8
6
4
2
0
0 1 2 3 4 5
10
8
6
4
2
0
0 1 2 3 4 5
0 1 2 34 5
10
8
6
4
2
0
0 1 2 3 4 5
EBRT
VBT EBRT
VBT
EBRT
VBT
EBRT
VBT
EBRT 214 212 197 133 83 35 214 212 199 136 85 35
VBT 213 204 193 136 78 35 213 203 190 135 79 36
EBRT 214 212 197 134 83 35 214 211 198 135 84 34
VBT 213 202 190 134 78 35 213 205 192 135 79 35
Années
100
80
60
40
20
0
D
Survie globale (%)
0 1 2 34 5
Années
p = 0,17 p = 0,57
Patients à risque (n)
EBRT : radiothérapie externe ; VBT : curiethérapie vaginale.
Figure 6. Résultats de l’étude PORTEC2 (11).
La Lettre du Cancérologue • Vol. XX - n° 1 - janvier 2011 | 23
DOSSIER THÉMATIQUE
copies et une perte d’hétérozygotie. De même, une
activation de l’origine de la réplication virale des
séquences intégrées a été mise en évidence dans
des modèles cellulaires, faisant ainsi suspecter
des interactions oncogéniques réciproques entre
séquences virales et génome de l’hôte (9).
Les thérapies ciblées, notamment antiangio-
géniques, commencent à se chercher une place dans
le traitement des cancers du col avancé. Une étude
de phase II a comparé le lapatinib, le pazopanib
et leur combinaison chez plus de 200 patientes
atteintes de cancer du col avancé et prétraitées (10).
Le bras combinaison a été rapidement arrêté après
une analyse intermédiaire de futilité montrant
l’absence de bénéfice par rapport au lapatinib. Le
pazopanib se révèle supérieur au lapatinib, aussi
bien en SSP qu’en SG (figure 4). Ce résultat est
associé à un niveau de réponse supérieur (figure 5)
et témoigne de l’intérêt potentiel des agents antian-
giogéniques, plus que du ciblage non rationnel de
l’EGFR (Epidermal Growth Factor Receptor), dans
les cancers du col.
Endomètre
En 2010, les principaux résultats dans les cancers de
l’endomètre ont porté sur les aspects locorégionaux.
Les résultats finaux de l’étude PORTEC-2 ont été
rapportés (11). Chez 427 patientes présentant un
cancer de l’endomètre de stade I-IIA avec risque
intermédiaire ou haut risque (plus de 60 ans, Ic,
grade 3, infiltration myométriale supérieure à 50 %),
la curiethérapie vaginale et la radiothérapie externe
ont été comparées. Les résultats (figure 6) sont
nettement en faveur de la curiethérapie vaginale,
avec un contrôle locorégional supérieur, et 4 fois
moins de toxicité digestive (12,6 versus 53,8 %). La
SG à 5 ans est identique dans les 2 bras (82 versus
86 % ; p = 0,66).

24 | La Lettre du Cancérologue • Vol. XX - n° 1 - janvier 2011
L’autre question non complètement résolue dans
les cancers de l’endomètre est celle du curage
ganglionnaire locorégional. La position française
est de proposer un curage pelvien et lombo-aortique
systématique pour les formes non endométrioïdes,
de haut grade, avec infiltration myométriale de
plus de 50 %, pour les tumeurs de plus de 2 cm
et pour l’atteinte extra-utérine (12). Deux essais
randomisés ayant inclus 1 945 patientes ont été
revus (13). Aucune différence significative n’a été
mise en évidence, aussi bien en survie sans rechute
qu’en SG. La question reste donc posée et doit l’être
pour chaque patiente.
Conclusion et perspectives
Ce cru gynécologique 2010 se caractérise par
2 grandes tendances. Pour les cancers tubo-ovariens,
l’avenir est à la définition d’un ciblage thérapeutique
rationnel, et la composante chirurgicale de la prise
en charge est arrivée à maturité avec un objectif de
chirurgie maximale, quel que soit le moment de sa
réalisation. Pour les cancers du col et de l’endomètre,
les traitements locorégionaux restent les pierres
angulaires de la prise en charge. On attendra avec
impatience les résultats à long terme des études de
vaccination anti-HPV. ■
1. Du Bois A, Herrstedt J, Hardy-Bessard AC et al. Phase III trial
of carboplatin plus paclitaxel with or without gemcitabine in
first-line treatment of epithelial ovarian cancer. J Clin Oncol
2010;28(27):4162-9.
2. Konstantinopoulos PA, Spentzos D, Karlan BY et al. Gene
expression profile of BRCAness that correlates with responsi-
veness to chemotherapy and with outcome in patients
with epithelial ovarian cancer. J Clin Oncol 2010;28(22):
3555-61.
3. Gourley C, Michie CO, Roxburgh P et al. Increased incidence of
visceral metastases in scottish patients with BRCA1/2-defective
ovarian cancer: an extension of the ovarian BRCAness phenotype.
J Clin Oncol 2010;28(15): 2505-11.
4. Fong PC, Yap TA, Boss DS et al. Poly(ADP)-ribose polymerase
inhibition: frequent durable responses in BRCA carrier ovarian
cancer correlating with platinum-free interval. J Clin Oncol
2010;28:2512-9.
5. Hennessy BT, Timms KM, Carey MS et al. Somatic mutations
in BRCA1 and BRCA2 could expand the number of patients that
benefit from poly (ADP ribose) polymerase inhibitors in ovarian
cancer. J Clin Oncol 2010;28(22):3570-6.
6. Vergote I, Tropé CG, Amant F et al. Neoadjuvant chemotherapy
or primary surgery in stage IIIC or IV ovarian cancer. N Engl J Med
2010;363(10):943-53.
Références bibliographiques
Ce compte-rendu a été réalisé sous la seule responsabilité
du coordonnateur, des auteurs et du directeur de la publication
qui sont garants de l’objectivité de cette publication.
Coordonnateur : David Malka, Paris
Site réservé
aux professionnels
de la santé
On-line San
Francisco
avec le soutien
institutionnel de
Recevez en direct
les temps forts
du congrès
20-22 janvier 2011
Version Web + IPhone
Sous l’égide de
Accédez aux comptes rendus des grands
thèmes abordés présentés sous forme de
billets d’humeur, d’interviews et de brèves
en vous connectant sur :
www.edimark.fr/ejournaux/ascogi/2011/
Retrouvez la suite des références
bibliographiques sur notre site internet
www.edimark.fr
 6
6
1
/
6
100%