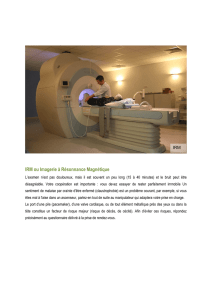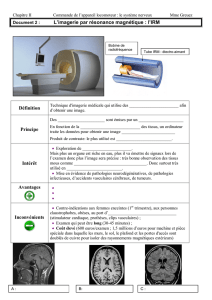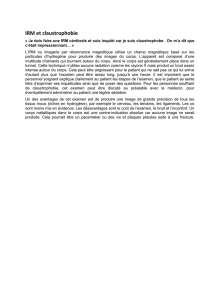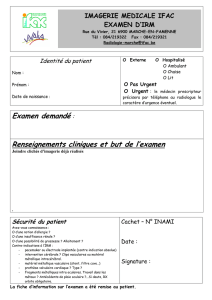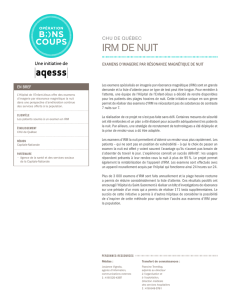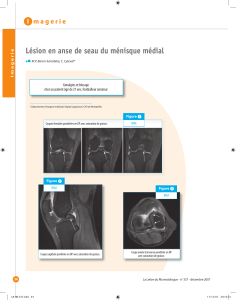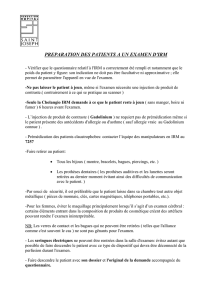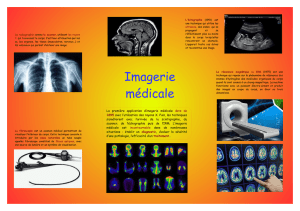L’ Stratégie d’imagerie diagnostique dans les spondylarthrites SYNTHÈSE

Figure 1. Sacro-iliite radiologique (érosions et condensations
sous-chondrales).
Figure 2. Ossifications intervertébrales : syndesmophytes
T11-T12 (bilatéraux) et T12-L1 (à droite). On note des érosions
des articulations sacro-iliaques.
La Lettre du Rhumatologue • Suppl. 2 au n° 363 - juin 2010 | 3
SYNTHÈSE
Stratégie d’imagerie diagnostique
dans les spondylarthrites
P. Claudepierre*, G. Lenczner**
L’
imagerie tient une place prépondérante dans
le diagnostic des spondylarthropathies (SpA)
ou spondylarthrites. Cela vient essentiellement du
fait que, après les données de l’interrogatoire et de
l’examen clinique, il n’existe aucun autre examen
complémentaire pouvant orienter le diagnostic, si
ce n’est la recherche de l’antigène HLA B27 ; or, si
chacun connaît bien l’aide que peut apporter cet
examen dans certaines situations, ses limites en
termes de sensibilité et de spécificité nous sont
également familières.
Notre propos se limitera ici aux formes axiales de
la maladie.
La première étape
Devant un patient ayant des manifestations axiales
compatibles avec une SpA, la première étape dia-
gnostique repose sur des radiographies du rachis,
comprenant au moins la charnière thoraco-lom-
baire, le rachis lombaire de face et de profil et un
bassin de face pour évaluer les sacro-iliaques. Les
premières lésions radiologiques de la maladie sont
souvent localisées au niveau des articulations sacro-
iliaques, et beaucoup plus rarement dans la région
thoracique basse.
Lorsque ces premiers clichés montrent une sacro-
iliite déjà certaine, comprenant au moins des éro-
sions et des condensations sous-chondrales des
2 articulations, le diagnostic de spondylarthrite, et
même de spondylarthrite ankylosante (SA), peut
être posé (figure 1). Aucun autre examen complé-
mentaire à visée diagnostique n’est alors nécessaire.
Il en va de même lorsque, bien plus rarement, des
ossifications intervertébrales typiques sont déjà
visualisées (figure 2).
* Service de rhumatologie ; groupe
hospitalier Chenevier-Mondor, univer-
sité Paris-Est, Créteil.
** Service d’imagerie médicale ;
groupe hospitalier Chenevier-Mondor,
université Paris-Est, Créteil.

Figure 3. IRM des sacro-iliaques. A : Séquences T1 anatomiques, montrant un hyposignal de l’os
sous-chondral prédominant sur les versants iliaques des articulations en rapport avec l’œdème
osseux et aspect irrégulier de l’interligne articulaire. B : séquences T2 Fat Sat, révélant un œdème
osseux sous-chondral des articulations du versant sacré à droite et du versant iliaque à gauche,
notamment le pied de l’articulation.
A B
4 | La Lettre du Rhumatologue • Suppl. 2 au n° 363 - juin 2010
SYNTHÈSE
L’imagerie
de deuxième intention
En l’absence de toute anomalie radiographique axiale
typique de la maladie, la question se pose de savoir
s’il est toujours nécessaire d’aller plus loin dans la
démarche d’imagerie pour affirmer le diagnostic.
Les critères internationaux de spondylarthrite axiale
récemment publiés par le groupe ASAS laissent une
place pour un diagnostic reposant uniquement sur
des données cliniques et/ ou d’anamnèse et/ ou théra-
peutiques et la présence de l’antigène HLA B27. Il
faut cependant noter 3 limites encore à ce stade. La
première est que, avant leur application, ces critères
de diagnostic précoce nécessitent d’être validés sur
de larges populations en soins primaires. La seconde
est que la préoccupation du médecin, à juste titre,
est souvent de ne pas manquer un diagnostic diffé-
rentiel, potentiellement plus urgent ou plus grave
que le diagnostic évoqué. Dans le cas des spondyl-
arthrites, il est évident que certaines rachialgies
inflammatoires peuvent mener à la découverte de
processus tumoraux, voire infectieux torpides, parfois
infraradiologiques, et que, pour cette raison, une
exploration par IRM du rachis s’impose au moindre
doute. La troisième vient des choix thérapeutiques à
faire. Lorsque nous en sommes à un stade tout à fait
initial de la prise en charge du patient, la “sanction
thérapeutique” en cas de confirmation diagnostique
de spondylarthrite sera l’instauration d’AINS. Il est
évident que le rhumatologue qui n’a aucun doute
vis-à-vis d’un diagnostic différentiel n’a pas besoin
d’une imagerie confirmant le diagnostic pour pres-
crire des AINS et maintenir ces traitements s’ils sont
efficaces. Cependant, dans la situation où plusieurs
de ces produits se sont rapidement montrés inef-
ficaces et/ ou très mal tolérés, la question se pose
de l’instauration d’un traitement par anti-TNFα.
Actuellement, ni les AMM de ces médicaments, ni
les recommandations nationales et internationales
n’autorisent leur prescription chez des patients ayant
des radiographies normales en l’absence de toute
preuve de la maladie en imagerie. Ainsi, on peut
considérer que, dans cette situation, en l’état actuel
des choses, il est justifié de demander une IRM afin de
tenter d’objectiver des foyers inflammatoires (voire
des anomalies structurales) typiques de la maladie.
Il peut donc être licite, face à un patient qui se plaint
de douleurs fessières d’horaire inflammatoire, de
rachialgies d’horaire inflammatoire, ou des deux à
la fois, et qui a néanmoins des radiographies axiales
normales, de demander d’emblée une IRM, soit pour
des raisons de diagnostic différentiel, soit pour dis-
cuter un traitement par anti-TNFα. Dans certains cas,
il ne s’agit ni de l’une ni de l’autre raison, mais de la
“pression” involontairement mise par le patient, qui
ne se sentira rassuré, ou confiant dans le diagnostic de
son médecin, que lorsqu’il disposera d’un examen lui
apportant réellement la preuve du diagnostic.
Quelle IRM demander, ou plutôt quelles zones
explorer ? Avec quelles séquences ?
Lorsque les symptômes du patient comprennent des
douleurs fessières inflammatoires, l’IRM à demander
en première intention est celle explorant les sacro-
iliaques avec des séquences dites “anatomiques”,
en T1, et des séquences recherchant l’œdème osseux
ou l’inflammation, c’est-à-dire en T2 Fat Sat ou en T1
avec injection de gadolinium. La plupart des auteurs
privilégient, dans la pratique courante, pour la
recherche de signaux inflammatoires, les séquences
sans injection de gadolinium (STIR ou T2 Fat Sat).
Quelles-sont les anomalies permettant d’établir le
diagnostic de sacro-iliite en IRM chez ce patient ? Le
groupe ASAS a récemment publié des critères IRM
de sacro-iliite ; actuellement, seul l’hypersignal dans
l’os sous-chondral est retenu, aucune importance
n’étant accordée à d’autres hypersignaux qui pour-
raient révéler la présence de liquide intra-articulaire,
d’une synovite, d’une enthésite… Cet hypersignal
osseux, ou œdème osseux, doit être présent sur au
moins 2 sites de l’articulation pour avoir une valeur
diagnostique ou, s’il n’est présent que sur un site,
il doit exister sur au moins 2 coupes consécutives
(figure 3).
Lorsque le patient n’a pas de douleur fessière, mais
uniquement des douleurs rachidiennes inflamma-
toires, certaines données suggèrent que l’IRM des
sacro-iliaques est là encore la plus rentable dans
une perspective diagnostique. Cependant, comme
nous l’avons vu plus haut, le problème du diagnostic

Figure 4. Atteinte rachidienne sur une séquence T2 Fat Sat (nombreux hypersignaux inflamma-
toires des différents listels des corps vertébraux, touchant tout le rachis dorsal).
La Lettre du Rhumatologue • Suppl. 2 au n° 363 - juin 2010 | 5
SYNTHÈSE
différentiel conduit souvent à réaliser en première
intention, ou dans le même temps, une IRM du
rachis thoracique et du rachis lombaire. Là encore,
l’IRM comprend des séquences T1 et des séquences
STIR. Il est cependant très difficile actuellement de
préciser les anomalies qui sont retenues comme
étant spécifiques d’une spondylarthrite, permettant
donc de confirmer le diagnostic (figure 4). Ainsi,
il a récemment été montré que l’inflammation
d’un coin vertébral antérieur, qui pourrait corres-
pondre à une phase préradiologique d’une lésion
de Romanus, n’était en fait pas spécifique de la
spondylarthrite, et pouvait se rencontrer chez des
sujets sains et des patients ayant des pathologies
rachidiennes dégénératives. C’est probablement la
multiplicité des lésions, chez un sujet encore jeune,
qui permettra d’emporter la conviction diagnostique.
Surtout, d’autres éléments inflammatoires, situés
sur d’autres structures (articulaires postérieurs, de
l’arc postérieur, des ligaments intervertébraux, des
plateaux vertébraux, des articulations costotransver-
saires, etc.) peuvent avoir une valeur diagnostique,
celle-ci étant actuellement encore très peu évaluée.
Des études en cours permettront probablement
bientôt de valider des critères diagnostiques IRM
d’inflammation rachidienne de la spondylarthrite.
À côté de cette difficulté à définir une IRM “positive”
de type spondylarthrite existe le problème inverse :
le risque de se tromper en écartant le diagnostic de
spondylarthrite lorsque l’IRM est négative, c’est-à-
dire sans anomalie inflammatoire. Certaines études
IRM réalisées chez des patients atteints de SA vraie,
active en axial, lors d’essais thérapeutiques, ont bien
montré la possibilité de “faux négatifs” de l’IRM. Dans
les formes précoces de la maladie, qui sont celles où
nous avons le plus souvent besoin de l’apport de l’IRM
pour le diagnostic, il est probable que ces faux néga-
tifs sont encore plus fréquents. Cela constitue donc
actuellement une limite de l’IRM comme technique
de référence avant la mise en route d’un traitement
anti-TNFα. Il est cependant nécessaire de disposer
d’un minimum de garde-fous, et celui-ci est le moins
mauvais de ceux dont nous disposons actuellement.
Deux autres techniques d’imagerie peuvent être dis-
cutées : le scanner des sacro-iliaques et l’échographie
doppler. Nous écartons en effet d’emblée la scinti-
graphie osseuse, qui a montré qu’elle était de bien
peu d’intérêt diagnostique en dehors de situations
très particulières, par exemple la douleur fessière
inflammatoire strictement unilatérale (asymétrie de
fixation des sacro-iliaques) ou certaines douleurs de
la paroi thoracique antérieure (point de fixation du
plastron évocateur d’une spondylarthrite).
Concernant le scanner des sacro-iliaques, il reste, à
l’heure de l’IRM, probablement très peu d’indications.
Un doute sur certaines anomalies structurales à la radio-
graphie, mal visualisées en T1 en IRM, et sans anomalie
inflammatoire repérée en IRM, peut conduire de temps à
autre à une exploration osseuse plus fine par le scanner.
L’écho-doppler des enthèses paraît beaucoup plus
prometteuse. Elle est en effet capable de mettre en
évidence des anomalies morphologiques, et surtout
des anomalies inflammatoires, des enthèses. Il pour-
rait être utile alors, même devant des formes axiales,
d’explorer les enthèses périphériques des patients
afin d’y rechercher des anomalies qui auraient une
valeur diagnostique. Cependant, beaucoup de pro-
blèmes restent à résoudre dans ce domaine avant
que nous puissions réellement envisager le recours
à cet outil à visée diagnostique.
Conclusion
La clé de voûte du diagnostic de spondylarthrite
reste, en 2010, l’examen clinique du patient, et avant
tout un interrogatoire approfondi. Devant une forme
axiale, des radiographies visualisant la charnière tho-
raco-lombaire, le rachis lombaire et les sacro-iliaques
sont toujours de mise. Dans nombre de situations
où ces clichés se révèlent normaux, il peut être utile
de recourir à l’IRM des sacro-iliaques et/ ou du rachis
thoracique et lombaire, afin d’éliminer un diagnostic
différentiel plus grave, de rassurer un patient parti-
culièrement inquiet ou de prendre la décision d’ins-
taurer un traitement par anti-TNFα. ■
1
/
3
100%