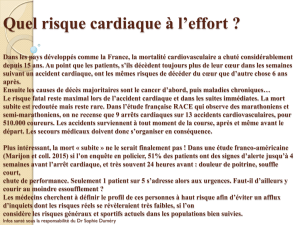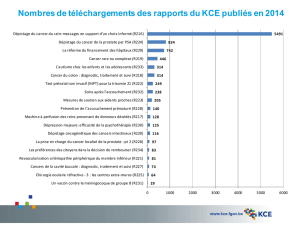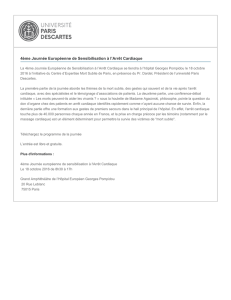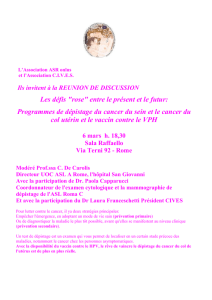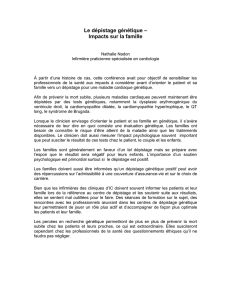L Quand faut-il faire une enquête familiale en cas de trouble

MISE AU POINT
16 | La Lettre du Cardiologue • n° 429 - novembre 2009
Quand faut-il faire une enquête
familiale en cas de trouble
du rythme ?
What’s the good indication for a familial screening in case
of ventricular arrhythmia?
V. Probst*, H. Le Marec*
* Centre de référence pour la prise
en charge des maladies rythmiques
héréditaires, CHU de Nantes.
La dernière décennie a été marquée par l’iden-
tification de nombreux facteurs génétiques
impliqués dans la survenue de troubles du
rythme cardiaque et potentiellement de mort
subite (1). L’identification de ces facteurs génétiques
a démontré qu’un certain nombre des troubles du
rythme cardiaque pouvaient être d’origine hérédi-
taire et familiale. Identifier l’origine familiale d’une
pathologie a deux conséquences : l’une, bénéfique,
donne la possibilité de prévenir la survenue d’ac-
cidents chez les membres de la famille à risque ;
l’autre est potentiellement délétère, étant donné
l’annonce, dans la famille, chez des sujets qui se
portent parfaitement bien, d’un risque de survenue
de mort subite.
La décision de faire une enquête familiale devra donc
en permanence soupeser le risque de la pathologie
dans la famille, et en particulier le risque de mort
subite, tout en le comparant aux conséquences
psychologiques de l’annonce du risque familial.
La situation est évidemment différente en fonc-
tion du type de pathologie concernée et du risque
encouru. En général, moins la pathologie est grave,
plus le consentement à l’enquête familiale sera facile.
Dans ce cas, le sentiment de culpabilité d’avoir
transmis la maladie à ses enfants sera plus faible
mais, à l’inverse, le bénéfice attendu dans la famille
sera moins grand. Généralement, l’enquête sera
d’autant mieux acceptée que l’histoire familiale est
lourde, avec un nombre important de morts subites.
On est pourtant souvent surpris du nombre de morts
subites qui peuvent survenir avant que l’alerte ne
soit donnée.
Dans cet article, nous allons essayer de déterminer
les pathologies rythmiques dans lesquelles une
enquête familiale peut être proposée, et tenter
de déterminer dans quels cas elle est le plus utile.
Actuellement, les enquêtes familiales sont le plus
souvent associées à une analyse moléculaire ; il
semble utile, avant d’aller plus loin, de rappeler les
grandes lignes et les limites de ce processus.
Place de l’analyse génétique
dans l’enquête familiale
Le cardiologue, confronté à une pathologie à risque
et qui veut faire une enquête familiale, se heurte à
une double difficulté. D’une part, il doit prouver qu’il
a mis en place tout ce qui est nécessaire pour faire ce
dépistage, d’autre part, il a une interdiction formelle
de contacter directement les membres de la famille.
Le dépistage devra donc toujours débuter par une
information du patient atteint vu en consultation
(ce que l’on appelle le propositus), qui devra ensuite
informer les membres de sa famille de la nécessité
du dépistage.
Pour la plupart des maladies rythmiques hérédi-
taires, un diagnostic moléculaire est proposé. Avant
de faire ce type d’analyse, quelques règles de base
doivent être rappelées. Tout d’abord, ces analyses
moléculaires ne peuvent être réalisées que lorsque
le patient a été clairement informé sur leur nature et
leurs conséquences. Un consentement écrit signé par
le prescripteur (généticien ou non) et par le patient
devra obligatoirement être obtenu, auquel devront

La Lettre du Cardiologue • n° 429 - novembre 2009 | 17
Résumé
Une mort subite inexpliquée survenue chez un sujet jeune doit conduire à la réalisation d’une
enquête familiale.
Cette enquête devra rechercher la présence d’un aspect de maladie rythmique héréditaire qui
permettra de guider l’analyse moléculaire puis de permettre la mise en place d’une prévention
chez les membres de la famille à risque de mort subite.
Ce dépistage permet d’identifier la cause de la mort subite dans la moitié des cas.
Mots-clés
Mort subite
Génétique
Fibrillation
ventriculaire
Généalogie
Highlights
A sudden unexplained death
occurred in a young person
should lead to a family
screening. This screening will
investigate the presence of an
ECG pattern of a hereditary
arrhythmic disease that will
guide the molecular analysis
and enable the implementa-
tion of prevention in family
members at risk for sudden
death. Familial and molecular
screening can identify the
cause of sudden death in 50%
of cases.
Keywords
Sudden death
Genetic
Ventricular fibrillation
Genealogy
être adjoints un courrier résumant l’histoire clinique
du patient ainsi que l’électrocardiogramme (ECG)
montrant la pathologie concernée. Ces deux derniers
éléments permettent de confirmer le diagnostic
clinique mais également d’orienter le diagnostic
moléculaire, en particulier pour le syndrome du QT
long, car les analyses sont réalisées dans des centres
de référence avec expertise rythmologique.
Avant de proposer au patient des analyses molé-
culaires, il faut l’informer de leurs limites. Tout
d’abord, ces analyses sont longues et il est rare de
pouvoir donner un résultat avant 6 mois. Ensuite,
leur taux de succès est très variable en fonction de
la pathologie : environ 70 % pour le syndrome du
QT long mais seulement 20 % pour le syndrome
de Brugada. Une analyse négative ne remet donc
pas en cause le diagnostic clinique. Enfin et surtout,
l’identification d’un variant génétique ne signifie pas
forcément qu’il est responsable de la pathologie.
Des variants sans conséquence pathologique sont
fréquemment identifiés (polymorphisme géné-
tique). Certains variants peuvent être facilement
considérés sans conséquence, ou au contraire très
probablement responsables de la pathologie, mais
pour beaucoup d’autres, appelés “variants de signi-
fication inconnue”, l’analyse moléculaire seule ne
permet pas de conclure. Dans ces cas, seule l’analyse
de la ségrégation familiale permettra de conclure. Si
le variant est retrouvé chez d’autres membres de la
famille porteurs de l’anomalie clinique, alors il peut
être considéré comme responsable de la maladie et
utilisé ensuite pour le dépistage familial. À l’inverse,
si des membres de la famille sont porteurs du variant
sans être atteints cliniquement ou, surtout, si des
membres de la famille sont atteints cliniquement
sans être porteurs du variant, alors le variant n’est
manifestement pas responsable du syndrome fami-
lial. Enfin, même lorsqu’un variant pathologique
est clairement identifié, il faut se souvenir que la
pénétrance de la maladie est variable. Cela signifie
que, avec la même mutation, certains membres de
la famille vont développer une forme grave de la
maladie, alors que d’autres, bien que porteurs du
gène morbide, ne seront pas ou peu atteints.
Ces exemples montrent bien que l’analyse molé-
culaire ne se substitue pas, bien au contraire, à
l’enquête familiale, et que le clinicien doit rester
au centre de la démarche diagnostique. La labelli-
sation récente de centres de référence et de centres
de compétence devrait faciliter la mise en place de
ces dépistages familiaux, dont voici les principales
indications.
Mort subite inexpliquée
chez un sujet jeune
Quel cardiologue n’a pas été un jour confronté à un
patient venant consulter car un membre proche et
jeune de sa famille venait de faire une mort subite.
Le plus souvent, dans ce cas, on se contente de poser
quelques questions de routine, de faire un ECG, peut-
être une échographie et finalement de rassurer le
patient en lui disant que l’on n’a rien retrouvé chez
lui. Pourtant il s’agit là d’une situation dans laquelle
une enquête familiale large et bien conduite peut
permettre, dans plus de la moitié des cas, d’identi-
fier la cause de la mort subite (essentiellement des
syndromes du QT long et des syndromes de Brugada
en l’absence d’anomalie morphologique) [2]. L’iden-
tification de la pathologie familiale a deux consé-
quences majeures. En premier lieu, elle conduit à
une meilleure acceptation du décès grâce à l’iden-
tification de la pathologie responsable. Cette mort
cesse d’être un événement incompréhensible chez
quelqu’un qui se portait bien pour devenir la consé-
quence d’une pathologie. Ensuite, bien entendu,
l’identification de la pathologie est bénéfique en ce
qu’elle rend possible la mise en place d’une préven-
tion chez les membres de la famille porteurs de la
maladie, que cette prévention soit médicamenteuse
ou qu’elle fasse appel au défibrillateur.
Il est raisonnable de proposer un dépistage familial
chez tous les apparentés du premier degré (père,
mère, frères, sœurs et enfants) de sujets décédés
brutalement, a priori d’un trouble du rythme
cardiaque avant 35 ans en l’absence de cardiopathie
connue. En l’absence d’anomalies morphologiques
cardiaques retrouvées à l’autopsie ou si l’autopsie
n’a pas été réalisée, le dépistage devra comporter
un ECG, une épreuve d’effort, une échographie
cardiaque et un test à l’ajmaline. Dans les familles
où plusieurs morts subites sont survenues et où le
risque qu’il s’agisse d’une maladie génétique est

Quand faut-il faire une enquête familiale
en cas de trouble du rythme ?
MISE AU POINT
18 | La Lettre du Cardiologue • n° 429 - novembre 2009
élevé, il faudra savoir étendre l’analyse familiale,
car il a été montré que les chances d’identifier la
maladie familiale augmentent en même temps que
le nombre de sujets évalués.
Après la survenue d’une mort subite non expliquée
chez un sujet jeune (moins de 35 ans), une analyse
moléculaire pourra être discutée chez celui-ci, à
condition que l’on dispose de son ADN, ce qui est
rarement le cas, sauf si des prélèvements toxicolo-
giques ont été réalisés par la justice (il est générale-
ment possible de récupérer ces prélèvements pour
en extraire l’ADN). Une bonne connaissance des
antécédents du patient (notion de syncope en parti-
culier) et des circonstances du décès (repos, sommeil,
effort, etc.) sera utile pour orienter le diagnostic
moléculaire. Même si l’on dispose de ces éléments,
il faudra tout de même faire une enquête familiale,
car l’analyse moléculaire à l’aveugle (sans connaître
la pathologie familiale) ne pourra être envisagée
que si l’enquête familiale n’a pas permis de dépister
d’anomalie ou si elle n’a pas pu être réalisée.
Pathologies rythmiques
héréditaires à risque
de mort subite
Sous ce terme de “pathologies rythmiques héréditaires
à risque de mort subite”, nous regrouperons des patho-
logies telles que le syndrome du QT long, le syndrome
du QT court, le syndrome de Brugada, les tachycardies
ventriculaires catécholergiques, le syndrome de repo-
larisation précoce et même la dysplasie arythmogène
du ventricule droit (figure, p. 20).
Le type de traitement, la prévention qui sera à mettre
en place et les examens pour établir le diagnostic
seront bien entendu très différents en fonction de
la pathologie considérée, mais la réflexion sur le
dépistage familial sera identique. En revanche, nous
verrons que le dépistage génétique a des chances
de succès très variables en fonction de la pathologie
concernée.
Pour l’ensemble de ces pathologies, il faudra au
minimum faire un ECG de repos chez tous les appa-
rentés du premier degré. La décision de pousser plus
loin les investigations (test à l’ajmaline à la recherche
d’un syndrome de Brugada, épreuve d’effort et Holter
ECG pour le syndrome du QT long ou les tachycar-
dies ventriculaires catécholergiques) dépendra de la
réponse à deux questions : la première concerne le
risque de mort subite du patient à qui l’on propose
le dépistage, la deuxième porte sur la possibilité
d’identifier d’autres membres de la famille poten-
tiellement atteints de la maladie si le sujet dépisté se
révèle être porteur de l’anomalie. À titre d’exemple,
il n’est probablement pas très logique de proposer la
réalisation d’un test ajmaline chez une patiente de
70 ans qui a un ECG normal et qui n’a pas d’enfant.
En effet, dans ce cas, même si on révèle un syndrome
de Brugada chez cette patiente lors du test ajmaline,
cela n’aura pas grande conséquence. À l’inverse,
si cette même patiente a de nombreux enfants, il
devient tout à fait logique de proposer le test, car si
celui-ci se révèle positif, cela permettra d’envisager
un dépistage chez les descendants de la patiente et,
potentiellement, d’éviter des morts subites.
Syndromes du QT long
Les syndromes du QT long sont un groupe hétéro-
gène de syndromes (maintenant au nombre de 10)
qui ont en commun un allongement de la durée de
l’intervalle QT (au-delà de 440 ms pour le QTc chez
les garçons et 460 ms chez les filles) associé à des
anomalies morphologiques de l’onde T.
Les trois premières formes décrites de ce syndrome
représentent la grande majorité des formes
retrouvées. Le syndrome LQT1 (environ 40 % des
syndromes du QT long) est caractérisé par une
onde T large avec une pente ascendante lente et
surtout par la survenue fréquente de syncopes à
l’effort et tout particulièrement lors d’un effort de
natation. Toute syncope en piscine doit évoquer un
syndrome LQT1. L’anomalie électrocardiographique
met en évidence une perte de fonction du canal
potassique lent IKs liée à des mutations dans les
gènes KCNQ1 et KCNE1. Le syndrome LQT1 répond
particulièrement bien au traitement bêtabloquant,
qui permet de faire disparaître la quasi-totalité de
risque de mort subite, et il est rare de devoir recourir
à l’implantation d’un défibrillateur. Le dépistage
familial dans cette forme est facilité par la réalisation
d’une épreuve d’effort, car une des caractéristiques
essentielles de cette forme est l’absence de raccour-
cissement du QT à l’effort.
Le syndrome LQT2 (environ 30 % des syndromes du
QT long) est caractérisé par une onde T en double
bosse (souvent bien visible en V2). Les syncopes
surviennent plus fréquemment lors des stress
émotionnels mais parfois également à l’exercice.
Ce syndrome provient d’une perte de fonction du
canal potassique rapide IKr liée à la présence de
mutations dans les gènes KCNH2 et KCNE2. La
réponse au traitement bêtabloquant n’est que
partielle, et il est parfois nécessaire de recourir

MISE AU POINT
La Lettre du Cardiologue • n° 429 - novembre 2009 | 19
à l’implantation d’un défibrillateur automatique
implantable (DAI). La durée du QT est souvent
variable au cours du temps, le recours au Holter
ECG avec analyse de la durée du QT peut être utile
dans les formes limites du syndrome LQT2 et lors
du dépistage familial.
Le syndrome du QT3 ne représente qu’environ 10 %
des syndromes du QT, mais il faudra rechercher
attentivement cette forme, car c’est celle dont le
diagnostic électrocardiographique pose le plus de
difficultés et, surtout, c’est dans cette forme que le
risque rythmique est le plus élevé, la mort subite
étant fréquemment le mode d’entrée dans la maladie.
Ce syndrome résulte d’un gain de fonction du canal
sodique lié à des mutations dans le gène SCN5A.
Dans ces formes, l’enquête familiale devra être parti-
culièrement attentive pour bien rechercher tous les
apparentés susceptibles d’être atteints. Le traite-
ment bêtabloquant est inefficace, et il est fréquent
de devoir recourir à l’implantation d’un défibrillateur
lorsque le risque rythmique est jugé élevé (3).
Globalement, l’analyse moléculaire permet d’identi-
fier une mutation dans environ 70 % des syndromes
du QT long congénitaux. La rentabilité est beaucoup
plus faible dans les syndromes du QT long acquis
(en particulier après une prise de médicaments
allongeant le QT) ; de même, la réalisation d’un
dépistage familial dans ces formes est beaucoup
moins rentable.
Syndrome de Brugada
Le syndrome de Brugada est caractérisé par un
sus-décalage du segment ST dans les dérivations
précordiales droites, qui est maintenant bien connu
de tous les cardiologues. Le risque rythmique de
cette pathologie apparaît finalement assez faible
chez les sujets asymptomatiques, et la fréquence
des formes cachées de la maladie rend la réalisation
du dépistage complexe.
Une première approche pourrait se contenter de faire
un ECG de base (sans test à l’ajmaline) aux appa-
rentés du premier degré. Cette approche a l’avan-
tage d’être simple à mettre en place mais restera
nécessairement incomplète. En effet, l’enquête
familiale sera stoppée en cas d’ECG négatif, alors
que les descendants de la personne testée peuvent
être porteurs de l’anomalie familiale. L’alternative
peut consister en la réalisation systématique d’un
test à l’ajmaline chez les membres de la famille
potentiellement atteints. Cette approche est plus
systématique mais nécessite une brève hospitali-
sation (en hospitalisation de jour et pour quelques
heures dans notre expérience). Enfin, une troisième
possibilité consiste à réaliser un test uniquement en
cas d’ECG douteux. Il n’est pas possible d’établir des
recommandations claires à ce sujet, les attitudes
dépendant des possibilités locales et des choix des
patients. L’analyse moléculaire ne permet pas actuel-
lement d’aider au dépistage, car des mutations dans
le gène SCN5A (le gène principal de ce syndrome)
ne sont retrouvées que dans environ 20 % des cas,
et les relations entre la présence de ces mutations
et la maladie sont complexes, ce qui complique le
conseil génétique (4).
Tachycardies ventriculaires
catécholergiques
Les tachycardies ventriculaires catécholergiques
(CPVT) sont caractérisées par un risque élevé de
mort subite chez les sujets jeunes (5). Il s’agit d’une
forme rare de maladie rythmique héréditaire, mais
dont les conséquences sont fréquemment dévas-
tatrices dans les familles. La grande caractéristique
de cette pathologie est la survenue à l’effort de
troubles du rythme ventriculaires polymorphes et
bidirectionnels. La plupart des formes sont liées à
la présence de mutations dans le gène RYR2, et le
diagnostic génétique a une bonne rentabilité dans
cette pathologie. Le point essentiel du dépistage
familial est le recours absolument nécessaire à la
réalisation d’épreuves d’effort et d’un Holter ECG,
car l’ECG de base des patients est normale. Lors
du dépistage familial, il faudra savoir se méfier,
en particulier chez les sujets un peu âgés (plus de
40 ans), d’une extrasystolie d’allure assez banale, car
l’aspect bidirectionnel classique n’est pas toujours
retrouvé à cet âge.
Syndrome de repolarisation
précoce
Le syndrome de repolarisation précoce est une entité
récemment décrite, caractérisée par un croche-
tage de la fin du QRS associé à un sus-décalage du
segment ST visible dans les dérivations latérales et
inférieures (6). Cet aspect ECG a été retrouvé chez
30 % des patients ayant présenté une fibrillation
ventriculaire idiopathique, mais également chez
4 % de la population générale.
Des formes familiales existent et les premières
anomalies génétiques ont été identifiées. Il est

Quand faut-il faire une enquête familiale
en cas de trouble du rythme ?
MISE AU POINT
Figure. Représentation des principaux aspects électrocardiographiques rencontrés chez
les patients atteints de maladies rythmiques héréditaires. A. Aspect typique de syndrome
de Brugada de type I permettant de porter le diagnostic. Notez le sus-décalage de plus
de 2 mm et convexe vers le haut. B. Aspect typique de repolarisation précoce visible
sur les dérivations latérales. Notez la grande variabilité battement à battement du
sus-décalage. C. Aspect typique de tachycardies ventriculaires catécholergiques. Notez
le tracé normal sans allongement du QT sur le premier battement puis la tachycardie
ventriculaire avec un changement d’axe de battement à battement sur les 2 battements
suivants. D. Aspect de syndrome de QT long de type I. Notez l’allongement du QT avec
l’aspect caractéristique de l’onde T.
A B C D
20 | La Lettre du Cardiologue • n° 429 - novembre 2009
actuellement très difficile de conseiller le dépis-
tage familial dans cette pathologie. Le risque chez
des apparentés asymptomatiques n’est pas connu,
et le retentissement psychologique de la survenue
d’une mort subite chez un apparenté proche peut
conduire à proposer l’implantation d’un DAI chez
des sujets asymptomatiques qui n’en tireront aucun
bénéfice. Le dépistage familial dans cette pathologie
doit donc impérativement être réalisé après que
chaque membre de la famille aura été clairement
informé, par des équipes à même de gérer tous les
aspects de cette information. De même, les données
concernant ces patients et les résultats du dépistage
familial doivent être centralisés dans des fichiers
afin de pouvoir déterminer le risque réel de cette
nouvelle pathologie.
Situations particulières où un
dépistage familial peut être
proposé
À côté des pathologies précédemment citées, respon-
sables de mort subite, et pour lesquelles le dépistage
familial doit être systématique, d’autres pathologies
peuvent justifier un dépistage dans des cas particuliers.
Des formes familiales et génétiques ont été retrouvées
dans la fibrillation auriculaire ou les troubles de la
conduction dégénératifs, pour évoquer les patholo-
gies les plus fréquentes. La fréquence de ces formes
familiales reste limitée, mais, si l’on en croit l’adage
“on ne trouve que ce que l’on cherche”, elle est proba-
blement sous-estimée. Pensez donc à demander à vos
patients s’il y a dans leur famille un ou plusieurs autres
cas de ces pathologies, et vous serez certainement
surpris du nombre de réponses positives (7). Dans
ces formes potentiellement familiales, un dépistage
clinique simple par la réalisation d’un ECG peut être
proposé chez les apparentés en âge de développer
la maladie.
Conclusion
La liste des pathologies devant amener à la réalisa-
tion d’une enquête familiale que l’on a proposée dans
cet article n’a pas vocation à être exhaustive, et des
pathologies telles que la dysplasie arythmogène du
ventricule droit ou le syndrome de Wolff-Parkinson-
White n’ont pas été citées. Le message principal est
que, dans les pathologies à risque de mort subite, il
faut être le plus exhaustif possible. Le cardiologue
doit au minimum proposer le dépistage aux appa-
rentés du premier degré, qui sont ensuite libres de
l’accepter ou de le refuser. Dans les pathologies non à
risque de mort subite ou à risque faible, un dépistage
peut être proposé lorsque l’interrogatoire retrouve
la notion d’une forme potentiellement familiale ou
d’une forme inhabituelle de la maladie, en particulier
lorsque celle-ci survient anormalement tôt. ■
1. Boussy T, Paparella G, de Asmundis C et al. Genetic basis
of ventricular arrhythmias. Cardiol Clin 2008;26:335-53,v.
2. Meregalli PG, Tan HL, Probst V et al. Type of SCN5A muta-
tion determines clinical severity and degree of conduction
slowing in loss-of-function sodium channelopathies. Heart
Rhythm 2009;6:341-8.
3. Webster G, Berul CI. Congenital long-QT syndromes: a
clinical and genetic update from infancy through adulthood.
Trends Cardiovasc Med 2008;18:216-24.
4. Eckardt L, Probst V, Smits JP et al. Long-term prognosis
of individuals with right precordial ST-segment-elevation
Brugada syndrome. Circulation 2005;111:257-63.
5. Hayashi M, Denjoy I, Extramiana F et al. Incidence and
risk factors of arrhythmic events in catecholaminergic
polymorphic ventricular tachycardia. Circulation 2009;
119:2426-34.
6. Haissaguerre M, Derval N, Sacher F et al. Sudden cardiac
arrest associated with early repolarization. N Engl J Med
2008;358:2016-23.
7. Schott JJ, Alshinawi C, Kyndt F et al. Cardiac conduction
defects associate with mutations in SCN5A. Nat Genet
1999;23:20-1.
Références bibliographiques
1
/
5
100%