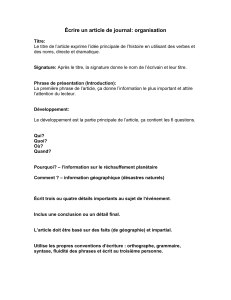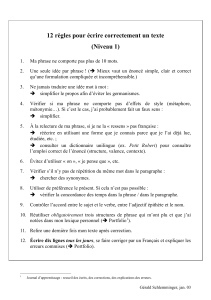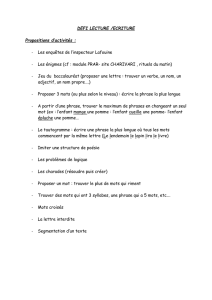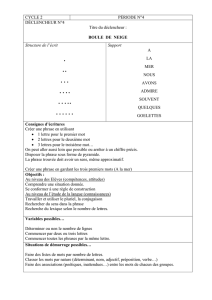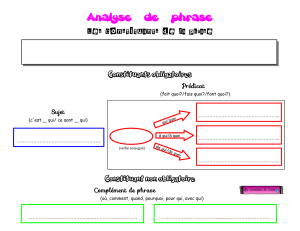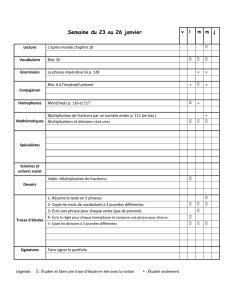Problématique de la phrase clivée dans une approche

Marges linguistiques
http://www.marges-linguistiques.com - M.L.M.S. éditeur - 13250 Saint-Chamas
1
Mai 2002
Problématique de la phrase clivée dans une
approche plurilingue
Par
Nowakowska Aleksandra
Praxiling, UMR CNRS 5475, Discours, Textualité,
Production de sens,
Université Paul Valéry, Montpellier III
France
Introduction
Les constructions de type C’est Pierre qui est venu, C’est Pierre que je vois, ont suscité, en
linguistique, une très forte production d’articles et d’ouvrages qui font apparaître une diversité
d’approches dont résulte une terminologie abondante et hétérogène : présentatif (Chevalier et
alli.), gallicisme (Léard), extraction (Creissels), phrase clivée (Moreau, Fradin, Vikner), phrases
clivées contrastives (Gross) ou encore propositions relatives à antécédent explicite introduites
par des présentatifs (Rothenberg). On pourrait donc se demander pourquoi avoir choisi un su-
jet si étudié qui semble être pratiquement épuisé.
Parce que la construction clivée n’a pas d’équivalent syntaxique en russe ni en polonais, il
m’a paru intéressant d’étudier, à partir des traductions comparées, les moyens mis en œuvre
dans les deux langues afin de traduire c’est …qu-, d’en dresser l’inventaire, de les analyser et
d’en proposer une typologie. J’ai ensuite vérifié que les mêmes correspondants, qui ont été
employés pour traduire c’est …qu- en polonais et en russe, déclenchaient l’emploi de la cons-
truction clivée lors de la traduction d’un texte russe et polonais en français. Contrairement au
russe et au polonais, l’anglais possède l’équivalent syntaxique de la phrase clivée corres-
pondant à la structure It is…whom, which, that. Toutefois, pour peu qu’on ait quelques
connaissances en langue anglaise, il n’est pas difficile de s’apercevoir que la phrase clivée ne
semble pas fonctionner exactement de la même manière en anglais et en français. L’étude
multilingue permet donc de présenter une approche revisitée d’un phénomène linguistique bien
étudié.
De plus, hormis quelques travaux en linguistique du discours (Bres 1999, Rivelin-
Constantin, 1992, Rouget C., & Salze, L, 1985), la plupart des travaux consacrés au clivage a
été effectué à partir d’exemples fabriqués hors contexte pour les besoins de l’analyse. Ainsi, il
est intéressant d’étudier la phrase clivée du point de vue interphrastique. Afin de décrire le
fonctionnement du clivage en discours, j’ai choisi un corpus littéraire pour lequel des traduc-
tions sont disponibles.
L’étude contrastive et interphrastique de la phrase clivée dans un corpus littéraire
s’enrichit également d’un cadre théorique original qui articule, d’une part, la théorie du dialo-
gisme issue des travaux de Bakhtine et, d’autre part, la notion d’actualisation issue de Bally.
En d’autres termes, il s’agit de présenter une approche dialogique et textuelle de la phrase
clivée et de ses équivalents, dans les autres langues étudiées, qui s’appuie sur l’analyse d’un
corpus littéraire et multilingue.
La structure clivée peut être analysée en français à plusieurs niveaux : analyse syntaxi-
que, analyse en thème et rhème et analyse sémantico-discursive. Toutes ces analyses de la
construction clivée ne vont pas sans poser quelques problèmes dans une perspective multilin-
gue, car elles s’avèrent insuffisantes voire inopérantes. La recherche de l’approche et de la
définition de la phrase clivée du point de vue d’une analyse plurilingue servira de cadre à ma
démonstration. Ainsi j’aborderai, dans un premier temps, quelques aspects méthodologiques
liés à l’approche contrastive de la phrase clivée dans un corpus multilingue. J’examinerai
ensuite les différents types d’analyse de la phrase clivée en essayant de montrer, à la fois,

Marges linguistiques
http://www.marges-linguistiques.com - M.L.M.S. éditeur - 13250 Saint-Chamas
2
l’intérêt de chacune comme leurs inconvénients pour une approche plurilingue. Cela me per-
mettra de proposer l’approche dialogique du clivage, afin de montrer qu’elle semble être la
plus satisfaisante pour analyser la phrase clivée et ses équivalents en anglais, polonais et
russe dans un corpus littéraire.
1. Aspects méthodologiques de l’approche du tour clivé dans un corpus multilingue.
1.1. Choix du corpus
Le champ de ma recherche étant différentiel, je m’appuie sur un corpus d’occurrences en
quatre langues : anglais, français, polonais et russe, tirées d’œuvres littéraires dans chacune
de ces langues, que je compare ensuite avec leurs traductions respectives publiées dans les
trois autres langues. En travaillant en linguistique contrastive, et en particulier sur plusieurs
langues, le choix du corpus s’oriente bien souvent vers un corpus d’écrits littéraires auquel on
accède le plus facilement. Le travail sur la langue écrite possède également l’avantage de sim-
plifier la description linguistique, déjà très complexe, du corpus multilingue. Il est évident que
cet avantage constitue également un certain inconvénient, car on perd la composante prosodi-
que des faits linguistiques, celle-ci n’est toutefois pas primordiale dans mes recherches.
Le corpus littéraire présente également l’avantage d’avoir une certaine longueur et
cohérence qui permettent de décrire les phénomènes récurrents, de les situer dans un réseau
contextuel élargi pour en appréhender les variations.
L’inconvénient majeur de travailler sur les écrits littéraires et leurs traductions tient à ce
qu’on est parfois confronté à l’existence de plusieurs traductions d’une même œuvre littéraire
dans les autres langues étudiées (quelquefois plus de cinq, comme pour Tchékhov ou Faulkner,
deux pour Yourcenar) et cela peut constituer, en plus de nombreuses répétitions, un appareil
trop lourd à manier ; parfois, au contraire, il n’existe qu’une seule traduction qui est de plus
incomplète (comme c’est le cas pour la traduction anglaise de Ferdydurke de W. Gombrowicz).
Ainsi j’ai opté pour une seule traduction pour chaque œuvre du corpus, mon choix a été es-
sentiellement motivé par la qualité de la traduction.
On pourra également reprocher au corpus littéraire le fait qu’il comporte des modulations
stylistiques. Cependant tout discours est modulé par des contraintes sociales, professionnelles,
officielles, ou même des tendances personnelles et comporte des traces stylistiques qui ne sont
pas propres au langage littéraire. Par ailleurs il me semble que les problèmes d’ordre histori-
que et poétique (le style de l’auteur) n’appartiennent pas à l’étude linguistique, sauf s’ils sont
susceptibles d’une généralisation en termes linguistiques (par exemple le point de vue privilé-
gié).
Outre les occurrences du corpus littéraire, j’ai également recours à d’autres types
d’exemples : les exemples que j’emprunte à d’autres ouvrages linguistiques sur le même
thème et les exemples forgés, qui sont utilisés afin de faciliter l’explication d’un phénomène
linguistique précis. Les exemples cités d’autres articles sont signalés comme tels par les guil-
lemets, les exemples forgés sont en italique et les occurrences littéraires sont toujours intro-
duites par un chiffre entre parenthèses.
1.2. Présentation du corpus
Si la présentation d’un corpus littéraire unilingue n’implique aucune difficulté particulière,
la présentation du corpus littéraire multilingue pose quelques problèmes méthodologiques.
Premièrement, je me suis heurtée à la question de la transcription : si, pour un corpus
oral, il existe des conventions de transcription, pour transcrire l’écriture des langues impliquant
un changement de caractères, il n’y a pas de conventions et chacun fait un peu à sa façon.
Ainsi, j’ai été confrontée à plusieurs transcriptions concernant les lettres russes dans les tra-
vaux linguistiques portant sur cette langue. Afin de présenter le corpus russe, j’ai adopté la
manière proposée par Sériot (1986) de transcrire la langue russe : cette transcription tient peu
compte de la prononciation et consiste essentiellement à reproduire les caractères russes en
français (contrairement par exemple à la présentation de Bonnot 1998 qui accorde, dans sa
transcription, une plus large place à l’aspect oral).
Un autre aspect relatif à la présentation du corpus concerne la traduction littérale des oc-
currences en d’autres langues que le français. Ainsi je me suis posé la question de savoir s’il
était nécessaire de fournir systématiquement la traduction littérale pour chacune des trois au-
tres langues étudiées, ou bien si on pouvait s’en passer dans le cas de l’anglais : on peut

Marges linguistiques
http://www.marges-linguistiques.com - M.L.M.S. éditeur - 13250 Saint-Chamas
3
penser que la plupart des lecteurs maîtrisent suffisamment bien l’anglais écrit, pour pouvoir le
lire et le comprendre. Je ne propose donc pas de traduction littérale pour cette langue. Par
contre pour le polonais et le russe, la traduction littérale permet au lecteur, qui n’a pas de
connaissances dans ces langues, de suivre le déroulement de la phrase en langue source. Au-
trement dit, l’utilisation de la traduction littérale permet de montrer l’ordre des mots dans la
phrase et cela est particulièrement important lorsqu’on étudie les procédés de thématisa-
tion/rhématisation. Toutefois la traduction des occurrences en polonais et en russe, ne
concerne que la phrase correspondant au clivage français ou anglais.
La traduction littérale peut également être enrichie d’informations morphosyntaxiques.
Cela permet de faire apparaître les changements de catégories d’une langue à l’autre lors de la
traduction. Il est ainsi possible de voir que la particule c’est … qu- en français langue source se
trouve souvent remplacée en polonais et en russe par un adverbe (ou un autre lexème), de-
vant l’élément extrait en français ; ou inversement, un adverbe précédant un élément en polo-
nais langue source déclenche l’emploi de la phrase clivée dans la traduction française.
Bien qu’elle constitue un outil précieux pour montrer la structure phrastique dans une lan-
gue, la traduction littérale se heurte parfois, dans la présentation du corpus, à des difficultés
formelles. Elles tiennent fréquemment, d’une part, du fonctionnement de la catégorie verbale
dans les langues étudiées : absence du subjonctif, fréquence très élevée de la forme réfléchie
du verbe en polonais ; et, d’autre part, à l’existence en polonais et en russe d’une grande
classe de particules très variées, tant du point de vue morphosyntaxique que fonctionnel, qui
ne trouvent d’équivalent en français et en anglais que dans la phrase clivée. En d’autres ter-
mes, il n’est pas possible de rendre compte de la diversité morphosyntaxique des particules
polonaises et russes autrement qu’en créant, dans la traduction littérale, des formes qui
n’existent pas au départ en français (la particule russe etix-to sera traduite en français stan-
dard, dans la traduction littéraire, par le tour c’est … qu-, mais elle apparaîtra dans la traduc-
tion littérale comme une création du type ces-ce). Ainsi, dans la présentation, la traduction
littérale sert essentiellement à marquer la structure morphosyntaxique de la séquence étudiée.
1.3. Interprétation du corpus
Le dernier aspect concernant l’étude de la phrase clivée et de ses équivalents dans un cor-
pus multilingue est en rapport avec l’interprétation de données multilingues. Quel est le type
de connaissances nécessaires pour travailler en linguistique contrastive ? Quel est le niveau de
compétences dans les différentes langues ? Quel est le rapport entre différentes langues ?
Telles sont les questions que l’on peut se poser, entre autres, à propos de l’analyse d’un cor-
pus multilingue.
Premièrement l’étude d’un corpus multilingue implique la question du type de compéten-
ces nécessaires pour prendre en considération les spécificités de chaque langue. De ce point de
vue, il est possible de distinguer, dans un premier temps, deux types des connaissances :
– le premier concerne la connaissance d’une langue, c’est-à-dire des connaissances sur la
langue et/ou en langue nécessaires pour pouvoir décrire cette langue du point de vue de son
fonctionnement linguistique à l’écrit ou à l’oral, il s’agit alors d’un savoir-faire plutôt théorique
qui ne s’accompagne parfois d’aucune pratique ;
– l’autre type des connaissances concerne un savoir-faire pratique, il s’agit alors de maîtri-
ser une langue sans forcément connaître sa description linguistique et le métalangage employé
pour ce faire (cas de chaque locuteur natif et du bilingue précoce).
Il est évident que la situation idéale, pour travailler en linguistique comparée, consiste à
connaître et pratiquer les langues étudiées, ce qui n’est pas toujours le cas, ne serait ce que
dans des travaux comparatistes sur les langues mortes (latin ou grec ancien), qui ne sont pas
pratiquées par les chercheurs les étudiant. Il semblerait ainsi qu’une bonne connaissance
théorique suffise pour analyser le corpus multilingue du point de vue linguistique.
La distinction entre les deux types de connaissances permet de poser la question du ni-
veau des compétences dans les différentes langues. Le niveau de compétences linguistiques
est plus élevé lorsqu’un savoir-faire pratique est doublé d’un savoir-faire théorique dans les
langues étudiées, cela est parfois le cas, en linguistique contrastive, pour ceux qui comparent
deux langues. Cependant le niveau de compétences dans les différentes langues étudiées est
bien souvent inégal, d’une langue à l’autre, en particulier lorsqu’il s’agit d’une étude compara-
tiste sur plus de deux langues, comme dans mon cas, car les types de connaissances ne sont
pas les mêmes et, de plus, ils possèdent des degrés d’approfondissement variables. Je ne

Marges linguistiques
http://www.marges-linguistiques.com - M.L.M.S. éditeur - 13250 Saint-Chamas
4
possède pas des connaissances identiques de quatre langues que j’étudie, c’est pourquoi je
recours, en cas de doute, à un informateur natif, afin de vérifier certaines des mes hypothèses.
A la question du niveau de compétences linguistiques est liée la problématique des
interférences entre les langues étudiées dans un travail comparatiste. Lorsqu’on doit passer
continuellement d’une langue à l’autre, il est parfois possible d’être influencé par l’une ou
l’autre de ces langues, ce qui fausse notre interprétation. Ainsi, face à la disparité des moyens
morphosyntaxiques déployés dans les différentes langues, il faut sans cesse éviter un double
écueil.
Le premier consiste à plaquer sur l’une ou l’autre de ces langues des notions qui ne sont
pas pertinentes dans la description de son fonctionnement. Ainsi parler du clivage en polonais
serait injustifié, car il n’existe pas dans cette langue de structure comparable à celle que l’on
trouve en français, pour des raisons essentiellement typologiques : le polonais est une langue
flexionnelle qui permet de déplacer les constituants de la phrase sans avoir recours à une par-
ticule d’extraction. De même, il serait exagéré de parler de l’aspect pour la catégorie verbale
en français, au même titre que l’on en parle pour la description du système verbal des langues
slaves. Dans cette perspective, la seule attitude linguistique acceptable consisterait à analyser
les données syntaxiques d’une langue pour elles-mêmes, dans une logique systématique qui
leur est propre.
Mais alors, la confrontation des systèmes divergents se heurterait à un autre danger, celui
de déboucher sur un éparpillement de données difficilement comparables. Ainsi, pour qu’une
approche contrastive puisse donner lieu à une réflexion créatrice et aboutir éventuellement à
une généralisation, le choix d’un cadre théorique se révèle capital. Autrement dit, dans le cas
de l’approche plurilingue, il convient de proposer un cadre d’analyse qui permette de définir et
d’aborder la phrase clivée de façon à ce que l’on puisse y intégrer la description de ses équi-
valents dans les autres langues étudiées. Ainsi j’examinerai à présent, du point de vue com-
paratiste, les différentes analyses proposées traditionnellement en linguistique française pour
traiter la phrase clivée, afin de proposer une approche nouvelle qui paraît la mieux adaptée à
la description de la phrase clivée et de ses équivalents en anglais, français, polonais et russe
dans mon corpus littéraire.
2. Analyse syntaxique de la phrase clivée
Le tour clivé a été principalement traité, dans l’approche syntaxique, en particulier par la
grammaire générative transformationnelle, comme une structure phrastique basée sur le dis-
positif de l’extraction. La phrase clivée (C’est Pierre qui est venu) est dérivée de la phrase sans
clivage correspondante (Pierre est venu) par extraction : « On peut donc toujours dériver
transformationnellement une phrase clivée d’une phrase simple par extraction dans C’est… Qu
de l’un des constituants rattachés au verbe » (Gross 1968 : 52). L’extraction est donc une
opération syntaxique consistant à extraire, au moyen de la particule c’est …qu-, un argument
de la relation construite par le verbe placé après qu-. Lorsque l’élément extrait est sujet dans
la valence du verbe, la forme du pronom relatif est qui. Lorsqu’il s’agit d’un complément, le
relatif a, le plus souvent, la forme que. Le verbe être dans le présentatif de la phrase clivée
(c’est) peut toujours apparaître au présent ou bien il peut adopter le temps du verbe de la
phrase tronquée.
En anglais la diversité morphosyntaxique du clivage semble être plus importante. La
phrase clivée est le plus souvent introduite par It :
« It can introduce sentences of the following type (‘cleft sentences’) :
It was Peter who lent us the money. (not Paul)
It’s pilots that we need, not ground staff. » (Thomson A. J. & Martinet A. V., 1986 : 78)
Toutefois il n’est pas rare que, dans le cas d’une locution adverbiale, la forme That’s…
where… corresponde à une forme clivée du type C’est ici/là …qu-.
Le verbe to be s’accorde en temps avec le verbe de la relation prédicative, même s’il ne
semble pas pouvoir s’employer au futur. L’anglais peut également employer plusieurs relatifs
(who, that, whom, which, where, when), là où le français choisit principalement entre que/qui.

Marges linguistiques
http://www.marges-linguistiques.com - M.L.M.S. éditeur - 13250 Saint-Chamas
5
L’expression du relatif n’est pas toujours obligatoire en anglais (That was when her face began
to wear that bright, haggard look. Faulkner :126).
Il est difficile de parler de l’extraction en polonais et en russe, car, du point de vue de la
description syntaxique, l’ordre des mots dans la proposition est relativement libre dans les lan-
gues flexionnelles et c’est la désinence qui fournit les indications sur les fonctions des consti-
tuants. Il n’y a donc pas de forme syntaxique similaire à la phrase clivée en surface, mais
plutôt une pluralité de marques correspondant au clivage. De ce point de vue, la phrase clivée
peut être signifiée, soit par un morphème comme un pronom démonstratif (to en polonais, eto
en russe), plusieurs adverbes en polonais et russe, des particules en polonais (ze, juz) et russe
(ze, ved’, to), soit par des marques de type syntaxique comme les changements dans l’ordre
des mots (accompagnés ou non par l’adjonction de morphèmes), soit encore à des procédés
prosodiques à l’oral.
3. Analyse en thème et rhème
La phrase clivée est associée par un bon nombre de travaux situés en linguistique textuelle
à l’opération de rhématisation (Combettes 1977, Léard 1992, Le Goffic 1993, Bres 1999). La
particule c’est … qu- sert alors à extraire et encadrer le rhème de la phrase : ce que l’on dit,
l’information nouvelle et la plus importante de l’énoncé qui a motivé son énonciation. La parti-
cule c’est .. qu- permet alors de désigner explicitement l’élément extrait comme l’information
essentielle dans l’énoncé et de ce fait souvent nouvelle ou présentée comme telle. Le rhème
est préférentiellement placé en fin de phrase, la phrase clivée opère donc un changement dans
l’ordre habituel des constituants de l’énoncé en plaçant le rhème en tête, ce qui crée une mise
en valeur de l’élément extrait. L’analyse en thème et rhème est utile dans une approche
contrastive, car elle permet d’analyser les changements dans l’ordre de mots de la phrase du
point de vue de leur rôle dans la structure informationnelle de l’énoncé. Cependant l’approche
en termes de rhématisation semble parfois problématique pour expliciter certaines occurrences
de la phrase clivée qui ne se laissent pas facilement décrire de cette façon (cf. point 3., ana-
lyse de l’exemple (4)). Par ailleurs l’analyse en thème et rhème n’est pas à elle seule suffi-
sante pour traiter la phrase clivée et ses correspondants en anglais, polonais et russe et elle
doit être complétée par une approche sémantico-discursive, afin de pouvoir rendre compte de
différents types de rhématisation (cf. 3. (1) et 3. (3)).
4. Analyse sémantico-discursive de la phrase clivée
4.1. Analyse en termes de mise en valeur
La phrase clivée est toujours associée en linguistique traditionnelle (Corbeil 1968) aux
procédés syntaxiques de mise en valeur, autrement dit aux marques de focalisation. La notion
de « mise en valeur » est pourtant très générale et se rapporte également à diverses autres
structures syntaxiques allant de l’insistance pronominale, en passant par le détache-
ment/dislocation jusqu’à un simple déplacement des constituants dans la phrase qui peuvent
mettre en valeur aussi bien le thème que le rhème de l’énoncé. Le caractère vague de la no-
tion de mise en valeur la rend peu opératoire dans une étude multilingue, car elle peut concer-
ner plusieurs structures qui n’opèrent pas la mise en valeur d’un même élément de la phrase
du point de vue textuel du moins. Il est bien évidemment possible de décider, comme le fait
Rivelin-Constantin (1991), que toutes les opérations syntaxiques de mise en valeur servent à
thématiser un argument de l’énoncé, cependant cette affirmation est difficile à soutenir pour la
phrase clivée.
4.2. Analyse en structure identificatrice ou spécificationnelle
Du point de vue sémantico-discursif, la phrase clivée est souvent définie comme une
structure identificatrice ou spécificationnelle : « La phrase C’est Paul qui est arrivé le premier
est un énoncé d’identification entre ce (représentant qui est arrivé le premier), et Paul : ‘qui
est arrivé le premier, cela est Paul’ » (Le Goffic 93 : 221).
Ainsi la particule c’est …qu- permet d’identifier un élément qui est non spécifié dans le dis-
positif verbal.
La définition et l’approche de la phrase clivée en termes d’identification est, d’une manière
générale, intéressante car elle permet d’analyser un très grand nombre d’occurrences du
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
1
/
18
100%