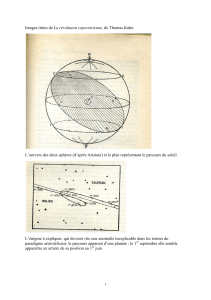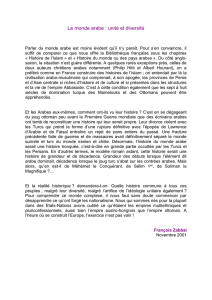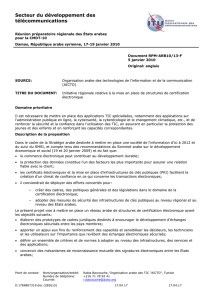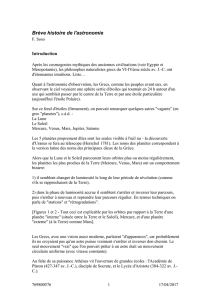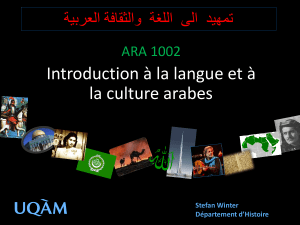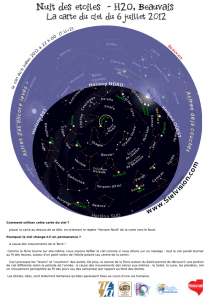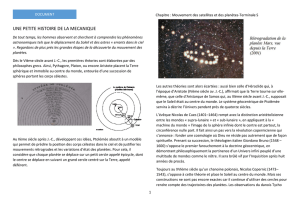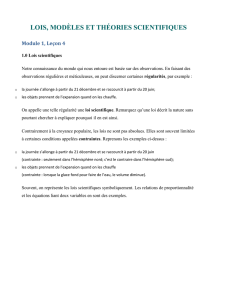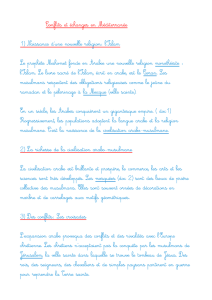La sagesse orientale

19
Un certain regard (2)
La sagesse orientale
Contrairement aux idées reçues, le Moyen-Âge ne fut pas partout un gouffre de
civilisation et un désastre scientifique : si l’Occident se désintéressa peu à peu des sciences
pour se tourner vers l’architecture et la glose, ce ne fut pas le cas de l’Orient, qui hérita du
savoir antique. En effet, dès le VIIe siècle, les Arabes musulmans conquirent petit à petit la
Perse et le bassin méditerranéen, ce qui leur permit de côtoyer l’Empire romain d’Orient et
son héritage grec, ainsi qu’Alexandrie et sa bibliothèque. Bien qu’initialement peu portés vers
les sciences, ils finirent par s’y intéresser tellement que le titre de l’œuvre maîtresse de Claude
Ptolémée (90-168) – La plus grande compilation mathématique – est plus connu sous sa
traduction arabe « al-majisti » ou Almageste. D’autre part, leurs conquêtes les mirent aussi en
contact avec l’Inde, à qui les Grecs d’Alexandre le Grand avaient légué les nombres décimaux
– dits « arabes » ! – et le zéro. Enfin, après les invasions mongoles, les Musulmans eurent
même des contacts avec l’astronomie chinoise.
Ces nombreux échanges attisèrent la soif de savoir de ces hommes religieux, qui
pourtant n’étaient pas très érudits au
départ. En effet, contrairement à
l’attitude chrétienne, étudier l’Univers,
création d’Allah, est un honneur sans
nom pour tout Musulman qui se
respecte. Que la Terre tourne autour
du Soleil ou l’inverse, peu importe,
c’est la place que Dieu lui a donnée :
aucune théorie ne remet en question la
doctrine. De plus, les astres
interviennent sans cesse dans la vie
quotidienne des Musulmans :
• Ils utilisent un calendrier lunaire,
et la Lune marque le début du
Ramadan (jeûne diurne annuel qui
dure un mois), ainsi que le départ
des pèlerinages vers La Mecque,
que tout Musulman doit réaliser au
moins une fois dans sa vie.
L’observation et la prédiction de la course de l’Astre nocturne est d’autant plus nécessaire
que le mois ne débute pas à la Nouvelle Lune – l’instant où le Soleil et la Lune possèdent
la même longitude céleste –, mais plutôt dès que le plus fin croissant devient visible. Ce
Ptolémée supposait que les astres tournaient autour de la
Terre. Comme un simple cercle pour orbite ne suffisait pas
pour expliquer les observations, il inventa les épicycles et
les déférents : les astres se meuvent sur un cercle
secondaire, l’épicycle, dont le centre parcourt un autre
cercle, le déférent. Pour améliorer sa théorie, Ptolémée
oblige le centre des déférents à ne pas correspondre
exactement avec la position de la Terre, et les astres à
avoir un mouvement uniforme autour de l’équant,
symétrique de la Terre par rapport au centre du cercle
déférent.

20
problème occupa d’ailleurs les érudits arabes, et plusieurs scientifiques tentèrent même de
construire des « théories de la visibilité du croissant lunaire ».
• Le Soleil occupe aussi une place non négligeable au panthéon astronomique arabe :
marquant le début et la fin des journées, notre astre diurne indique aussi l’instant des cinq
prières quotidiennes (aube, midi, après-midi, crépuscule, soirée).
• Enfin, le Musulman doit faire ses prières en se courbant vers La Mecque, le Saint des
Saints de l’Islam. Les mosquées, elles aussi, doivent être orientées vers le Lieu saint. Il
faut donc être capable de déterminer latitude et longitude en tout point de l’empire arabe.
Si la latitude se déduit directement de la hauteur de l’étoile polaire au-dessus de l’horizon,
la détermination de la longitude posera bien plus de problèmes (ceux qui ont lu L’île du
jour d’avant d’Umberto Eco en sont bien conscients !), car aucune horloge suffisamment
précise n’existait à l’époque. Les Musulmans utiliseront des événements célestes
simultanés – tels les éclipses de Lune – pour en déduire la différence entre heures locales
des différentes villes et pour ainsi mettre sur pied un système de coordonnées
géographiques.
Les scientifiques du monde arabe se feront donc ainsi connaître pour leurs
observations précises et les solutions mathématiques originales qu’ils apporteront à des
problèmes complexes : si l’outil pour résoudre tel ou tel problème astronomique n’existe pas,
on l’invente ! La trigonométrie, notamment, leur doit beaucoup : ils ont même inventé les
fonctions trigonométriques dont ils avaient besoin, comme le cosinus, la tangente et la
cotangente, la sécante et la cosécante – le sinus provenait des Indes.
Un autre fleuron de la Science orientale, les tables astronomiques, nécessaires à la vie
religieuse : elles reprenaient les jours de Nouvelle Lune, la prédiction des éclipses, et les
heures de lever et de coucher des astres principaux (Soleil, Lune,
planètes,…). La position des astres était donnée avec une précision
d’une à deux minutes d’arc ! Le pionnier dans ce domaine, c’est al-
Khwarizmi (770-840), dont le nom déformé donnera le mot
« algorithme ». Il généralisa le passage aux nombres dits « arabes »,
bien plus faciles à utiliser que les chiffres romains pour réaliser les
quatre opérations ; ce fut aussi le premier à écrire un traité qui porte le
nom d’algèbre1, dans lequel il introduit la notion d’équation et
propose des méthodes de résolution des équations linéaires et
quadratiques. al-Khwarismi justifie son travail : «L’imam et émir des
croyants al-Mamun m’a encouragé à composer un ouvrage concis sur le calcul al-jabr et al-
muqabala, limité à l’art du calcul agréable et de grand intérêt, dont les gens ont constamment
besoin pour leurs héritages, leurs testaments, leurs sentences, leurs transactions, et dans
toutes les affaires qu’ils traitent entre eux, notamment l’arpentage des terres, le creusement
1 L’intitulé exact de ce traité est « Kitab al-jabr wa al-muqabala » : al-jabr – qui a donné le mot algèbre – signifie
« réduction », et al-muqabal « comparaison » ; soient les fondements de sa méthode de résolution d’équation.
al-Khwarizmi.

21
des canaux, la géométrie et autres choses de la sorte». Il ne fut traduit en latin qu’au XIIe
siècle.
Toute cette activité nécessita de nouveaux instruments… et de l’argent ! Et là encore,
les astronomes arabes furent chanceux : le mécénat leur apporta les fonds nécessaires à leurs
recherches. Puisqu’observer le ciel est une activité « divine » et révérée, les émirs et autres
califes se battaient pour retenir auprès d’eux les meilleurs scientifiques (ce n’est – hélas – plus
le cas de nos jours, même sous nos latitudes !). Le plus célèbre d’entre eux fut le calife
abbasside al-Mamun, qui fonda, à Bagdad, une académie baptisée « Maison de la Sagesse » à
laquelle appartenait notamment al-Khwarizmi. C’est dans ce cadre que al-Mamun, avec
l’accord de l’empereur byzantin de l’époque, envoya des étudiants à Constantinople pour
emprunter des ouvrages grecs et les traduire à Bagdad.
Les mécènes commandèrent aussi une révision complète du
catalogue de Ptolémée, qui comprenait la position et la magnitude de
1 022 étoiles : ainsi, l’astronome al-Sufi (Azophi2, 903-986) fut le
premier à décrire la « nébulosité » d’Andromède dans son Atlas des
paradis. Les mécènes financèrent également de nombreuses traductions
de textes grecs et indiens : ces livres, tombés dans l’oubli en Europe,
furent ensuite traduits de nouveau vers le français ou le latin. L’Orient a
donc joué un important rôle de « bibliothèque » en sauvant l’œuvre
scientifique grecque, et en permettant aux Européens de redécouvrir la
science antique après l’éclipse moyenâgeuse.
Enfin, les chefs politiques permirent la construction de plusieurs observatoires de
conception extrêmement
moderne, dirigés par les
astronomes les plus réputés. Les
plus connus sont ceux de
Maragha et de Samarcande.
Celui de Maragha, en Iran, fut
fondé par le petit-fils de Gengis
Khan. Un des co-fondateurs de
cet observatoire, l’astronome al-
Tusi (1201-1274), modifia le
système de Ptolémée, le
simplifia en supprimant l’équant,
et en introduisant un très
ingénieux système combinant les
mouvements circulaires
2 Les érudits sont souvent mieux connus chez nous sous un nom occidentalisé légèrement différent : nous
indiquons ce dernier en italique.
Manuscrit de al-Tusi montrant l’ingénieux mécanisme qui lui
permet de se passer de l’équant de Ptolémée, tout en rendant plus
physique le modèle : c’est en combinant le mouvement de deux
sphères, dont l’une a un diamètre double de l’autre, qu’il
reproduit un mouvement rectiligne uniforme sur le diamètre du
grand cercle.
al-Tusi.

22
uniformes ; ce modèle présente de très grandes similitudes avec le système de Copernic,
même s’il en diffère bien évidemment dans le choix de l’origine. Certains experts vont même
jusqu’à dire que les travaux d’al-Tusi auraient inspiré Copernic.
L’observatoire de Samarcande, en Ouzbékistan, fondé par Ulug Beg, le petit-fils de
Tamerlan, connut la gloire entre 1420 et 1437. Sa réputation internationale en fit le modèle
rêvé pour le fameux « Uranieborg » de Tycho Brahé.
Ulug Beg, quant à lui, légua à la postérité des tables
de sinus et de tangentes précises à la huitième
décimale et calculées tous les degrés !
Dans ces observatoires furent mis au point ou
perfectionnés divers instruments à vocation
astronomique. Citons évidemment l’astrolabe ! Bien
que ce dernier soit d’origine grecque, ce sont les
Musulmans qui lui ont donné ses lettres de noblesse.
Vous pouvez voir ci-dessous un exemple de cet
instrument polymorphe et complet. Il se compose de
diverses plaques métalliques superposées : la
première, le rete ou araignée, indique les étoiles
brillantes (grâce à des « pointeurs » métalliques) et
l’écliptique (nécessaire pour représenter le
mouvement du Soleil dans le ciel au cours des
saisons). Si l’on fait tourner le rete autour de son
axe, on reproduit le mouvement des astres dans le ciel au cours de la journée. Ce rete est
superposé à une des nombreuses plaques graduées, chacune étant adaptée à une latitude
particulière. L’astrolabe permet de trouver l’heure, la position des objets célestes, la direction
de La Mecque et les
heures de lever et de
coucher des astres, et ce
quel que soit le jour,
l’heure ou l’endroit où
l’on se trouve ! Cet
instrument aux multiples
possibilités connut un vif
succès en Orient comme
en Occident et se répandit
rapidement en Europe :
faute de GPS, les marins
utilisaient des astrolabes
simplifiés pour se guider.
Aucun des grands
Observatoire de Samarcande (trace du
« grand quadrant »).

23
découvreurs, de Magellan à Bougainville en passant par Christophe Colomb, n’acceptait de
s’embarquer sans ce précieux auxiliaire !
Cette frénésie astronomique orientale ne
pouvait que conduire à la remise en question du
système de Ptolémée, des siècles avant Bruno,
Galilée ou Copernic ! Bien que plus philosophique
qu’observationnelle (sans la lunette, inventée par
Galilée, les Arabes n’avaient vu ni les phases de
Vénus, ni les satellites de Jupiter), cette remise en
question déclencha un mouvement « de
résistance » qui s’amplifia et atteignit l’Occident,
conduisant aux révolutions scientifiques italienne
ou polonaise.
Dès le IXe siècle, al-Battani (Albategnius,
858-929) engagea les hostilités. Il mit en évidence
la variation du diamètre apparent du Soleil, et
prouva donc la possibilité d’éclipses annulaires,
impossibles à comprendre dans le système de
Ptolémée. Il découvrit la précession des équinoxes
et détermina les conditions de visibilité de la
Nouvelle Lune. Il fut surtout apprécié en Europe à sa juste valeur, et Copernic le mentionne
ainsi pas moins de vingt-trois fois dans son œuvre maîtresse De revolutionibus orbium
caelestium !
Ibn-al-Haytham (Alhazen, XIe siècle), auteur d’un sulfureux Doutes sur Ptolémée,
affirma quant à lui que les modèles planétaires de l’Almageste étaient tout simplement…
erronés ! Même si c’était déjà l’opinion d’Aristote, il assura que la Voie Lactée n’était pas un
phénomène atmosphérique proche, mais était constituée d’astres extrêmement lointains. Il
estima aussi l’épaisseur de l’atmosphère à 52 000 pas (environ 50 000 mètres), ce qui est
assez proche de la valeur actuelle. Il combattit les visions classiques de l’optique, selon
lesquelles ce sont des rayons qui émanent des yeux qui permettent de voir les objets
environnants. Il fut le premier depuis Ptolémée à apporter des contributions substantielles à
l’optique théorique en publiant des théories sur la réflexion, la réfraction, la vision
binoculaire, les lentilles, l’arc-en-ciel, les miroirs sphériques et paraboliques, les aberrations
de sphéricité, ou encore le fait que le Soleil ou la Lune semblent présenter un plus grand
diamètre apparent lorsqu’ils sont bas sur l’horizon.
Plus tard, Ibn Rushd (1128-1198), mieux connu sous le nom d’Averroès, trancha dans
le vif : « l’astronomie actuelle n’offre aucune vérité, et concorde seulement avec les calculs
théoriques, pas avec ce qui existe réellement ». Il supportait un modèle concentrique de
l’Univers, et critiquait vertement le système des épicycles et déférents créé par Ptolémée pour
Les cratères lunaires sont aussi un livre
d’histoire : à gauche, le cratère Albategnius et
ses 136 km de diamètre, et au centre en bas, le
cratère Ptolémée (153 km).
 6
6
1
/
6
100%