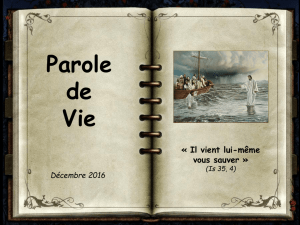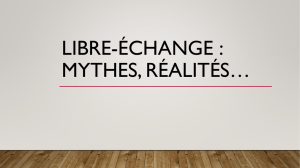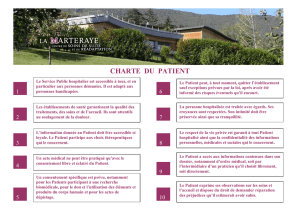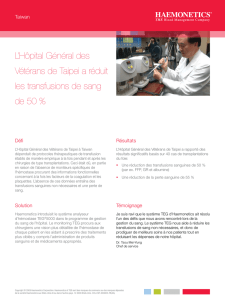A Un jour de vie, c’est la vie ! V I

VIE PROFESSIONNELLE
La Lettre du Neurologue - n° 7 - vol. VI - septembre 2002
272
Un jour de vie, c’est la vie !
●G. Devers*
A
rrêt important rendu par le Conseil d’État le
26 octobre 2001 à propos de la question fort déli-
cate des refus de transfusion opposés par les
Témoins de Jéhovah. En l’espèce, l’équipe médicale était passée
outre. La cour administrative d’appel de Paris, le 15 juin 1998,
lui avait donné raison. Le Conseil d’État confirme, mais avec
une motivation différente. Enfin, la loi du 4 mars 2002 sur le
droit des malades contient une formule qui, inévitablement,
rouvrira le débat.
La question des refus de transfusion opposés par les Témoins
de Jéhovah revient régulièrement dans la pratique des services.
Elle pose une question plus large, celle de la libre acceptation
des soins, et conduit à examiner les limites d’une règle
cruciale : la liberté d’accepter les soins inclut le droit de les
refuser. La décision rendue par le Conseil d’État le 26 octobre
2001 est d’autant plus intéressante que les faits sont particuliè-
rement clairs.
L’AFFIRMATION D’UN REFUS
Un homme âgé de 44 ans est hospitalisé le 2 janvier 1991 dans
un établissement privé de l’Ouest parisien en raison d’une
insuffisance rénale aiguë. Son état s’aggrave, et il est transféré
le 22 janvier 1991 à l’hôpital Tenon. À compter du 28 janvier
apparaît une grave anémie justifiant des transfusions sanguines.
Ces transfusions sont pratiquées durant la période du 28 janvier
au 6 février 1991, date du décès. Les transfusions, légitimes sur
le plan scientifique, ont prorogé la vie du patient de quelques
jours.
De même est tout aussi certaine la volonté du patient, Témoin
de Jéhovah, de refuser toute transfusion sanguine. Conscient de
la gravité de son état, cet homme indique à l’équipe médicale
son refus d’être transfusé et le confirme par une lettre à la
direction de l’établissement le 12 janvier 1991. Cette lettre est
transmise à l’équipe de l’hôpital Tenon. Ce patient déclare à
l’équipe médicale qu’il refuse que lui soient administrés des
produits sanguins, même dans l’hypothèse où ce traitement
constituerait le seul moyen de sauver sa vie. Un nouveau refus
est manifesté le 23 janvier 1991 devant un médecin de l’hôpital,
en présence de l’épouse et d’une infirmière, alors même que le
patient est informé du fait que cette décision compromet ses
chances de survie.
À la suite du décès, l’épouse engage un recours en responsabilité
contre l’AP-HP, estimant que l’attitude de l’équipe est fautive,
et que cette faute ouvre droit à une indemnisation de
100 000 francs à titre de dommages et intérêts, pour le préjudice
moral lié au non-respect de la volonté du patient. La question
financière est annexe. C’est la question de principe qui est
posée.
Le tribunal administratif de Paris rejette ce recours, et ce rejet
est confirmé par la cour administrative d’appel de Paris du 9 juin
1998 : “ L’obligation faite au médecin de toujours respecter la
volonté du malade en état de l’exprimer trouve sa limite dans
l’obligation qu’a également le médecin, conformément à la
finalité de son activité, de protéger la santé, c’est-à-dire en dernier
ressort la vie elle-même de l’individu.”
La cour administrative d’appel de Paris retient une hiérarchie
parmi les valeurs: la volonté de la personne, reposant sur une
croyance religieuse, est estimable et doit être respectée ; mais
ce respect s’efface devant une valeur supérieure qui est le
devoir du médecin de sauver la vie humaine.
La famille forme un pourvoi, et l’affaire vient devant le Conseil
d’État, qui rend son arrêt le 26 octobre 2001. L’issue est la
même : la requête de la veuve est rejetée. Mais l’arrêt rendu par
la cour administrative d’appel est censuré, le Conseil d’État
retenant une autre motivation.
PAS DE SOLUTION GÉNÉRALE
Le Conseil d’État reproche à la cour administrative d’appel de
Paris d’avoir fixé une règle générale : “ En entendant faire pré-
valoir de façon générale l’obligation pour le médecin de sauver
la vie sur celle de respecter la volonté du malade, la cour a
commis une erreur de droit. ”
Ainsi, le Conseil d’État estime que, sur une question aussi
grave, on ne peut raisonner par a priori, mais seulement au cas
par cas, la juridiction devant justifier que la gravité de la situa-
tion permet de dépasser la volonté exprimée du patient :
“Compte tenu de la situation extrême dans laquelle Monsieur X
se trouvait, les médecins qui le soignaient ont choisi, dans le
seul but de tenter de le sauver, d’accomplir un acte indispen-
sable à sa survie et proportionné à son état. Dans ces condi-
tions, et quelle que fût par ailleurs leur obligation de respecter
sa volonté fondée sur ses convictions religieuses, ils n’ont pas
commis de faute de nature à engager la responsabilité de l’Assis-
tance publique-Hôpitaux de Paris. ”
* Avocat au Barreau de Lyon.

La Lettre du Neurologue - n° 7 - vol. VI - septembre 2002 273
Le Conseil d’État poursuit l’examen de cette situation indivi-
duelle sur deux points.
●
●La veuve estimait qu’aurait pu être envisagé un traitement
autre que les transfusions sanguines. Le Conseil d’État puise
alors dans le rapport d’expertise : “ En raison de la gravité de
l’anémie, le recours aux transfusions sanguines s’est imposé
comme le seul traitement susceptible de sauvegarder la vie du
malade. ”
●
●La veuve reprochait que, le jour J, on ne lui ait pas demandé
personnellement son avis. Le Conseil d’État répond que le
patient étant en mesure d’exprimer sa volonté, les médecins
n’ont pas commis de faute en s’abstenant de consulter person-
nellement l’épouse.
Il existe bien une hiérarchie entre le respect de la volonté, cette
volonté reposant sur des convictions religieuses, et la nécessité
de sauver la vie. Mais cette hiérarchie n’est pas systématique,
et il doit chaque fois, au cas par cas, être justifié des conditions
qui permettent d’enfreindre la volonté exprimée. En l’occur-
rence, il s’agissait, dit le Conseil d’État, “ d’accomplir un acte
indispensable à la survie du patient et proportionné à son état ”.
Or, si le Conseil d’État refuse cette hiérarchie générale, la
solution qu’il retient laisse largement prévaloir le devoir du
médecin.
En effet, la situation est exemplaire sur deux points : le patient
avait exprimé son refus d’être transfusé à plusieurs reprises et
en connaissance de cause, alors même qu’il savait que ses jours
étaient comptés ; les transfusions, sans doute adaptées sur le
plan scientifique, ont permis tout au plus de retarder l’échéance
inéluctable de huit jours. C’est dire la prévalence qui est don-
née à la notion de sauver la vie, entendue comme sauver un
jour de vie. Dans nombre de cas, les praticiens sont confrontés
à ces situations de refus de soin, alors qu’il ne s’agit pas de
sauver un ou quelques jours de vie, mais une vie, parce qu’on
se trouve confronté à une situation cruciale imposant une trans-
fusion en urgence. Le refus des transfusions a sans doute été
exprimé, mais lors de cette affirmation, la personne n’était pas
placée devant la perspective d’une mort inéluctable, et l’on
peut penser que cette affirmation aurait peut-être été différente
si la question était, grâce à quelques transfusions, de passer un
cap et de permettre de vivre durablement. Ainsi les médecins
doivent-ils argumenter, mais en tenant compte des signes forts
donnés par le Conseil d’État.
UN DÉBAT ÉVOLUTIF
Un tel arrêt ne peut, quelle que soit la fermeté de la solution
retenue, trancher définitivement la question, question qui com-
porte tant d’implications personnelles, relationnelles, morales.
Mais, même sur le plan juridique, le débat n’est pas clos. Deux
évolutions se dessinent:
– La première est jurisprudentielle et européenne. On peut
en effet penser que cette affaire, ou une autre proche, sera sou-
mise à la Cour européenne des droits de l’homme. La Cour, qui
siège à Strasbourg, a pour mission d’appliquer un texte, la
Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme,
texte qui est marqué par une conception très individualiste des
droits de l’homme. La Cour a montré à plusieurs reprises
qu’elle savait tempérer le contenu de la Convention pour tenir
compte des enjeux sociaux. Mais, à partir du moment où le
débat est posé devant la Cour de Strasbourg, il change un peu
de nature, l’accent étant mis sur l’aspect individuel des droits
et, en l’occurrence, le respect de la liberté de religion. Dans
d’autres domaines, la Cour a déjà eu à rappeler que cette
liberté de religion n’était pas sans limite, et qu’elle devait être
conciliée avec d’autres règles sociales. Il n’est pas interdit de
penser que la Cour, tout en maintenant la solution, apporte à
son tour une adaptation à la motivation. Réponse dans quelques
années, si un recours est formé.
– La seconde est législative et franco-française. Elle résulte
de deux dispositions nouvelles issues de la loi du 4 mars 2002
sur “ les droits des malades et la qualité du système de santé ”.
●
●La personne de confiance
Il s’agit tout d’abord du nouvel article L. 1111-6 du code de la
Santé publique, qui reconnaît l’existence d’une “ personne de
confiance ” :
“Toute personne majeure peut désigner une personne de
confiance qui peut être un parent, un proche ou le médecin trai-
tant, et qui sera consultée au cas où elle-même serait hors
d’état d’exprimer sa volonté et de recevoir l’information néces-
saire à cette fin. Cette désignation est faite par écrit. Elle est
révocable à tout moment. Si le malade le souhaite, la personne
de confiance l’accompagne dans ses démarches et assiste aux
entretiens médicaux afin de l’aider dans ses décisions.”
La loi précise qu’à l’occasion d’une hospitalisation, il doit être
proposé au malade de désigner cette personne de confiance.
Ainsi cette personne doit-elle être associée à la prise de déci-
sion. Il faut rester prudent dans l’application de ce texte qui ne
substitue pas un consentement à un autre. Le seul consente-
ment à prendre en compte est celui exprimé par le patient lui-
même. Si ce consentement ne peut être reçu, le médecin, après
avoir recueilli l’avis de ce tiers de confiance, prendra la déci-
sion lui paraissant adaptée, sur le plan scientifique mais aussi
sur le plan de la dignité.
●
●Le refus de soin
Il s’agit ensuite du nouvel article L. 1111-4 du code de la santé
publique, qui redéfinit le consentement aux soins:
“Toute personne prend, compte tenu des informations et pré-
conisations des professionnels de santé, les décisions concer-
nant sa santé. ”
“Le médecin doit respecter la volonté de la personne après
l’avoir informée des conséquences de ses choix. Si la volonté
de la personne de refuser ou d’interrompre un traitement met
sa vie en danger, le médecin doit tout mettre en œuvre pour la
convaincre d’accepter les soins indispensables. ”
“Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué
sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce
consentement peut être retiré à tout moment. ”
Cet article n’institue pas une rupture. Il confirme une analyse
dominante et développe les dispositions générales inscrites
dans le code civil, à l’article 16-3 : “ Il ne peut être porté

VIE PROFESSIONNELLE
atteinte à l’intégrité du corps humain qu’en cas de nécessité
médicale pour la personne. Le consentement de l’intéressé doit
être recueilli préalablement hors le cas où son état rend néces-
saire une intervention thérapeutique à laquelle il n’est pas à
même de consentir. ”
Il n’en reste pas moins que le troisième alinéa de ce nouvel
article 1111-4 est d’une rédaction telle qu’il n’est pas possible
de le considérer comme un simple rappel de la règle. En outre,
cet article prend place au sein d’une législation qui proclame
les droits des malades, avec une philosophie d’ensemble qui
n’est pas seulement de rééquilibrer la relation médicale, mais
bien de reconnaître des droits aux malades.
La loi définit des exceptions au principe du consentement,
notamment pour permettre les soins sous contrainte en psychia-
trie. Aussi, on entend déjà l’argument : au nom de quel principe
peut-on créer une exception jurisprudentielle, alors que la loi
n’a pas prévu de dérogation légale ? On peut envisager une
réponse : la loi n’a pu remettre en cause le principe selon lequel
un jour de vie, c’est la vie. Et, à supposer qu’il y ait un débat
déontologique, y a-t-il place pour une responsabilité juridique,
dès lors que sauver la vie ne constitue pas un préjudice? Sauver
la vie, comme sauver un jour de vie.
■
©Gastroentérologie (16), n° 5, mai 2002.
LE CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL
ELBEUF / LOUVIERS
près de Rouen
RECHERCHE
UN PRATICIEN HOSPITALIER
EN NEUROLOGIE
À PLEIN TEMPS
Poste à pourvoir à l’automne 2002
Candidatures et renseignements au 02 32 96 34 58
76 ●SEINE-MARITIME
NEUROPSYCHIATRE
50 / 50 + EEG
en prévision cessation d’activité
aimerait transmettre à confrère profil approchant
dossiers cliniques et EEG
(2 Minihuit Alvar)
VILLE UNIVERSITAIRE CENTRE
TÉL. : 06 74 19 97 84 entre 19 et 20 h.
87 ●HAUTE-VIENNE
nnoncez-vous
!
Pour réserver votre emplacement, contactez dès maintenant Franck Glatigny
Tél.: 01 41 45 80 57 – Fax : 01 41 45 80 45
A
2002
MÉDECIN ENVIRONNEMENT
NEUROLOGIE GÉRIATRIE H/F
Laboratoire pharmaceutique international, leader dans
le traitement de la maladie d’Alzheimer, recherche dans le
cadre de son expansion, un Médecin Environnement
Neurologie Gériatrie.
Sous la responsabilité du Directeur Médical, vous prenez en
charge l’ensemble des projets d’environnement du Laboratoire.
En étroite collaboration avec les leaders d’opinion, vous
mettez en place et vous gérez les actions visant à améliorer le
dépistage et la prise en charge des patients atteints de démence.
Médecin de formation (Neurologue ou Gériatre), vous avez
une bonne connaissance de l’environnement de la pathologie
et de ses acteurs.
Vous aimez monter et gérer des projets. Vos capacités
relationnelles et votre créativité vous permettront de réussir
dans ce poste.
Merci d’adresser votre candidature, lettre de motivation ainsi
que vos prétentions, en précisant la référence 07/751EB,
à notre conseil : A.ASTON Ressources Humaines
21, rue du Général Foy - 75008 PARIS
ou par e-mail : [email protected]
1
/
3
100%