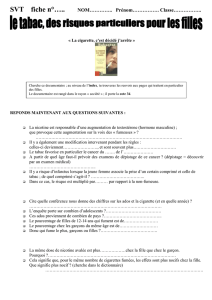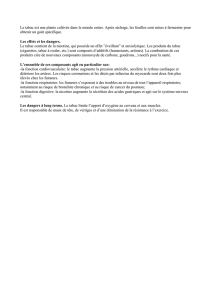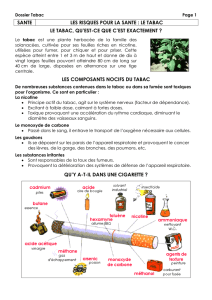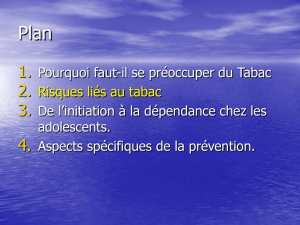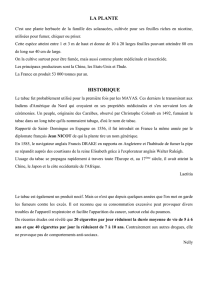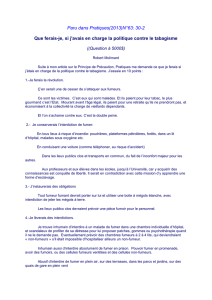i n o

Le Courrier des addictions (14) – n ° 4 – octobre-novembre-décembre 2012 14
M
i
s
e
s
a
u
p
o
i
n
t
a
u
p
o
i
n
t
M
i
s
e
s
Intérêt d’une “réduction des risques”
par diminution de la consommation
de tabac chez des usagers dépendants
des stupéfiants
e stake of “harm reduction” by diminishing the tobacco
consumption in addict patients
J.L. Senninger*
DéFINITION DE LA RéDUCTION
DES RISQUES
Qu’y a-t-il de commun entre les politiques de
réduction des risques en matière de stupé-
fiants et de tabac ? Toutes ces dépendances à
des substances psychoactives imposent, du
fait des difficultés de traitement notamment,
un pragmatisme qui ne permet pas d’éliminer
a priori une technique de soins donnée, fusse-
t-elle de peu d’efficacité, si tant est qu’elle soit
raisonnable.
Pour le tabac et avec ce regard particulier, on
peut dire que le fumeur bénéficie très rarement
d’un traitement symptomatique, que le dogme
de l’abstinence totale est encore prédominant,
les sevrages “secs” favorisés et les traitements
substitutifs à la nicotine prescrits presque
comme un “cadeau” pour que les patients
souffrent un peu moins. Pour résumer un sujet
aussi complexe, on peut se référer aux propos
de Jacques et Figiel (1). “Sur le plan non plus
théorique, mais pratique, de nombreux indices
semblent vouloir maintenir la dépendance ta-
bagique hors du champ de l’addictologie”. Les
liens étranges entre le tabagisme et les autres
dépendances ont été rappelés par Burling et
al. (2) dans l’ouvrage “Tabacologie et sevrage
tabagique”.
Même si nous vivons actuellement dans un
“monde addictologique” plus apaisé, la réduc-
tion des risques n’est pas encore un concept
banal, puisque ces implications sont multiples.
Pourtant, les études récentes découvrent
encore des aspects inattendus, comme par
exemple Okruhlica et al. (3) : “Il semble donc
que fumer de manière importante n’est pas for-
cément un futur inévitable pour les patients en
methadone maintenance treatment (MMT). Le
MMT, s’il est bien conduit et adapté à chaque
individu, peut contribuer à une diminution de
la dépendance à la nicotine.”
La meilleure synthèse sur le sujet reste la re-
commandation de bonne pratique élaborée
par l’Afssaps en mai 2003 (4) : “La réduction
des risques liés au tabac est une stratégie thé-
rapeutique réservée à certaines situations cli-
niques rares et doit être considérée comme une
étape possible vers la maturation à l’arrêt com-
plet du tabac” (accord professionnel). L’argu-
mentaire est bien évidemment irréprochable,
mais on peut espérer que la recommandation
évoluera, en tout cas dans la définition des si-
tuations cliniques pouvant bénéficier de cette
stratégie. L’Afssaps, dans ce même rapport, en
évoque également deux aspects singuliers :
“l’abstinence temporaire” et “l’abstinence par-
tielle”. Pourquoi a priori une telle défiance
envers cette dernière ? Tentons de la réhabi-
liter, notamment par la simple diminution du
nombre de cigarettes fumées...
INTéRêT MéDICAL
ET MéTHODES
Une revue complète de la littérature sur ce
sujet a été faite par Rodu (5) dans le chapitre
11 : “Comment to the US Food and Drug Ad-
ministration summarizing the rationale for
tabacco harm reduction” du rapport “Tabacco
Harm Reduction 2010”. La lecture de quelques
numéros de la revue Harm Reduction Journal
achèvera de convaincre les plus sceptiques.
Mais l’objectivité oblige à rappeler surtout les
critiques au recours à cette approche. Nissen
et al. (6) les énoncent dans le chapitre 7 : “e
implicit ethical claims made in anti-tabacco
harm reduction rhetoric – brief overview” du
rapport “Tabacco Harm Reduction 2010”.
Mais aucun de ces arguments ne tient. Ils rap-
pellent curieusement les arguments anciens
utilisés contre la promotion des traitements
substitutifs aux opiacés… il y a 20ans.
Les questions éthiques de la réduction des
risques doivent être abordées avec humilité.
Le “Report by the Tabacco Advisory Group of
the Royal College of Physicians” (7) de Londres
est intitulé: “Harm reduction in nicotine ad-
diction: helping people who can’t quit”. Il en
consacre le chapitre 11 aux aspects éthiques
et sa conclusion est un modèle de synthèse.
Deux grandes méthodes selon Molimard (8)
ont été tentées pour réduire les risques liés
à la consommation de tabac : diminuer les
composants pathogènes présents dans le
tabac et sa fumée et réduire globalement
l’exposition à la fumée, en particulier l’inha-
lation. La méthode de réduction du nombre
de cigarettes fumées est “un objectif à la fois
inefficace et dangereux. L’expérience montre
que ces réductions ne sont souvent que très
temporaires. Mais elles font partie des ‘pas-
sages à l’acte’ qui le font mûrir et avancer vers
l’arrêt définitif”. Notons que l’on retrouve
encore une fois, et chez un auteur particu-
lièrement critique vis-à-vis de la réduction
des risques, l’hypothèse que cette dernière
peut contribuer à une maturation du fumeur
vers le stade de l’abstinence totale. L’auteur est
Les politiques de réduction des risques en tabacologie, par diminution de la consomma-
tion, sont souvent dénigrées. Or, les personnes qui ont une addiction à des stupéfiants
sont presque toutes dépendantes de la nicotine. Comment traiter cette dépendance ?
Par cette stratégie thérapeutique, justement, qui donne des résultats insuffisants,
certes, mais surprenants, dont un impact positif sur leur confiance en eux-mêmes. Ainsi
la réduction des risques constitue, peut-être, un premier pas vers une abstinence taba-
gique totale et définitive, y compris chez les “toxicomanes”.
The harm reduction politics in tobaccology, especially by consumption diminishing have been often
denigrated. Almost every addict patient have also a nicotine addiction. Applying to such a population
a consumption diminishing management has partial but surprising results, especially a positive effect
on their “self-confidence”. Thus, the harm reducing technique represents a possible first step towards
a definite and complete tobacco abstinence, in addict patients, too.
Mots-clés :
Tabagisme ; Réduction des
risques ; Réduction de consommation ;
Addiction aux stupéfiants.
Keywords :
Nicotine addiction ; Harm
reduction ; Reduction of consumption ;
Addict patient.
* Psychiatre des hôpitaux, chef de pôle, service de soins en
addictologie, CHS Sarreguemines.
Addict déc 2012.indd 14 10/12/12 11:08

Le Courrier des addictions (14) – n ° 4 – octobre-novembre-décembre 2012
15
M
i
s
e
s
a
u
p
o
i
n
t
a
u
p
o
i
n
t
M
i
s
e
s
tout aussi critique vis-à-vis de l’utilisation des
traitements substitutifs à la nicotine dans le
cadre d’une réduction des risques : “proposer
aux fumeurs de réduire leur risque en utilisant
des substituts nicotiniques tout en continuant à
fumer est illusoire et dangereux. Il est de ce fait
condamnable”.
Autre référence : les Entretiens du Carla,
consensus d’experts organisés par le laboratoire
Pierre Fabre, dont un des buts est de rédiger
des recommandations de bonne pratique. Le
rapport sur le tabac est particulièrement bien
documenté (www. entretiens-du-carla.com/pu-
blication.php?pub=tabac). La question2 posée
aux experts et la recommandation préconisée
sont claires : “Peut-on envisager l’usage de subs-
tituts nicotiniques dans le but d’une diminution
de la consommation de tabac ayant pour objec-
tif une préparation à l’arrêt ultérieur?… Dans
le cadre d’une préparation à l’arrêt, chez les fu-
meurs insuffisamment motivés, ne pouvant pas
ou ne voulant pas un arrêt brutal, l’usage des
substituts nicotiniques participe à une augmen-
tation de la confiance du fumeur...” De tout cela,
nous pouvons en conclure qu’il ne s’agit pas de
rejeter, par principe, toute idée de réduction
des risques en matière de tabac, que l’efficacité
d’une diminution de consommation sur la santé
est indéniable et l’utilisation pour cela de trai-
tements substitutifs à la nicotine pas utopique.
L’étude de Benovitz et al. (9), par exemple, le
montre.
En France, la conférence d’experts de l’OFT
sur “Arrêt du tabac chez les patients atteints
d’affections psychiatriques” (2008) conclut,
tout en nuances, sur la faisabilité et l’intérêt
de cette stratégie thérapeutique dans une po-
pulation particulièrement difficile : “Si l’arrêt
forcé en milieu hospitalier est bien accepté, les
conséquences sur l’arrêt à long terme du tabac
sont faibles en absence de prise en charge
adaptée à la sortie des unités de psychiatrie.
En l’absence de prise en charge, la plupart des
patients reprennent leur tabagisme à la sortie
des unités de psychiatrie. L’intérêt d’un arrêt
définitif du tabac doit cependant être systé-
matiquement souligné, et la recherche sur l’ar-
rêt du tabac des patients atteints de maladies
psychiatriques doit être développée.”
Ces nuances atténuent le pessimisme que
pourraient induire les arguments toujours
mis en avant, comme par exemple l’effet bo-
lus-autotitration. Le groupe de travail sur “La
réduction du risque tabagique” en 2002 (10)
rappelle également les limites scientifiques de
cette technique : “Pour qu’une réduction du
nombre de cigarettes fumées par jour se tra-
duise par une ‘diminution de risque’, il faut
que cette réduction soit suffisamment impor-
tante, se fasse sur une durée suffisamment
longue, n’entraîne pas de modification de la
façon de fumer et n’obère pas d’éventuelles ten-
tatives de sevrage”. Pourtant, nous en avons ,
pour ainsi dire, “expérimenté”, l'intérêt.
Étude épidémiologique à
l’hôpital de sarreguemines
Jusqu’à présent, seuls les aspects théoriques
d’une approche moderne et pragmatique de la
dépendance tabagique et d’une tentative (illu-
soire ?) de prise en charge par une réduction
des risques avec usage de traitement subs-
titutif à la nicotine ont été abordés. On peut
pressentir des analogies entre les dépendances
aux opiacés et à la nicotine : fort pouvoir ad-
dictogène de ces produits, faible efficacité des
sevrages... Pourquoi, dès lors, ne pas envisager
un rapprochement entre ces deux substances
par le concept de réduction des risques par
traitement substitutif ? L’intérêt dans la dépen-
dance à l’héroïne est indéniable. Qu’en est-il
dans le tabagisme ? Une situation “expérimen-
tale” singulière nous permettrait peut-être un
début de réponse.
Le service hospitalier de soins en addictolo-
gie, lieu de cette “expérience”, est dévolu à des
personnes dépendantes aux stupéfiants (le
plus souvent héroïne) qui nécessitent un envi-
ronnement hospitalier dédié. En l’occurence,
“L’Étape”, qui compte 6 lits, est située dans un
centre hospitalier spécialisé. Sa vétusté était
telle qu’un déménagement s’imposait dans une
structure particulière du CHS de Sarregue-
mines, temporairement, le temps de faire les
travaux nécessaires. Mais de multiples contin-
gences ont fait durer cette “période transitoire”
du 1er juin 2006 au 1er février 2010. Or, au
cours de ces 4 années, une modification légis-
lative majeure allait nous permettre de nous
focaliser sur l’addiction au tabac : le décret n°
2006-1386 du 15 novembre 2006 fixant les
conditions d’application de l’interdiction de
fumer dans les locaux à usage collectif, rentré
en vigueur le 1er février 2007, en tout cas dans
les hôpitaux. Nous avons décidé de l’appliquer
aussitôt avec toute sa rigueur, précisément le
1er février 2007, notamment dans le service de
soins hospitaliers pour toxicomanes.
Une étude de la littérature montrait à l’époque
qu’il était moins utopique qu’il n’y paraissait de
proposer des soins contre le tabagisme à une
population souffrant d’autres addictions. Hurt
(11) le rappelait déjà en 1993 : “Il y a de plus
en plus d’expériences qui intègrent le diagnostic
et le traitement de la dépendance à la nicotine
dans celui des autres dépendances chimiques.
Little-Hill-Alina Lodge fut le premier, en
1985 (Delaney, 1988). D’autres programmes,
dans des centres comme the Veterans Medical
Center (Minneapolis), le Halterman Center
(Londres, Ohio), l’hôpital Parkwood (Atlanta),
le centre de réhabilitation à Aliquippa (Penn-
sylvanie), la clinique de Cleveland, le collège
médical de Virginie et l’université de médecine
du Texas (Houston) ont tenté cette intégration
avec des degrés variables de succès (Hoffmann
et Slade, 1993)… Il n’y a aucune méthode
infaillible pour réussir.” La prudence nous a
incités, toutefois, à ne pas exiger une absti-
nence totale (et involontaire) et à préférer les
inconvénients de la possibilité de fumer, mais
à l’extérieur du bâtiment. Il s’agissait alors de
faire un choix de traitement, dès lors qu’une
limitation de consommation était imposée.
Nous avons opté pour une mise à disposition
à volonté de traitements substitutifs à la nico-
tine transdermiques et bien sûr un accompa-
gnement “éducatif”.
Ainsi, était posée la situation expérimentale :
– une première période, du 1er juin 2006 au 31
janvier 2007, durant laquelle les patients dé-
pendants continuaient à fumer comme à l’ac-
coutumée, hormis la nécessité de le faire dans
une pièce dédiée, un “fumoir”. Et une deu-
xième période, du 1er février 2007 au 1er février
2010, soit 3 ans, au cours de laquelle l’interdic-
tion de fumer était imposée. Il était proposé à
chaque patient un sevrage tabagique avec mise
à disposition de patchs fournis par la pharma-
cie et des plages de sorties étaient définies afin
de satisfaire le besoin de fumer. Dans les faits,
ces contraintes ont conduit à une consomma-
tion moyenne de 10 cigarettes par jour et par
malade au cours de leur séjour. C’est peu par
rapport aux consommations habituelles de ces
patients mais les “ruptures de contrat” entraî-
nant la sortie du patient, par non-respect de la
loi anti-tabac ont été moindres que redoutées.
En outre, la durée moyenne de séjour n’a pas
diminué malgré les restrictions à l’usage du
tabac.
MéTHODOLOGIE
Nous avons donc deux échantillons de pa-
tients, soignés pour des troubles addictifs par
stupéfiants, qui ont séjourné dans la même
structure, pendant le temps, court des soins
nécessaires (10 jours), mais ont été soumis à
deux règlements différents en ce qui concerne
l’usage du tabac. La population A disposait en
quelque sorte d’un accès libre au tabac, quasi
identique à celui qui existe à l’extérieur. La
population B s’est vue imposer, dans les faits,
une restriction à une consommation moyenne
de 10 cigarettes par jour, quelle que soit sa
consommation à l’extérieur, à des moments
précis de la journée et jamais la nuit. Les
patients ont bénéficié d’un “conseil minimal”
et d’un accès libre à un traitement par subs-
titution nicotinique par dispositifs transder-
miques, après évaluation médicale minimale.
Le but de cette étude comparative était d’éva-
luer les consommations de tabac, avant, pen-
dant et après le séjour, à 1 an, de ces deux
populations. Avec l’hypothèse que la “B”, qui
avait fait, involontairement, l’expérience de
la réduction de ses consommations de ciga-
rettes, était capable de la maintenir au fil du
temps. Si ses détracteurs et les partisans de
l’autotitration pure avaient raison, les consom-
Addict déc 2012.indd 15 10/12/12 11:08

Le Courrier des addictions (14) – n ° 4 – octobre-novembre-décembre 2012 16
M
i
s
e
s
a
u
p
o
i
n
t
a
u
p
o
i
n
t
M
i
s
e
s
mations de chaque patient reviendraient rapi-
dement (avant 1an) au niveau antérieur.
La populationA comprend les patients ad-
mis entre le 1er juin 2006 et le 31 janvier 2007,
soit 115 patients. La population B comprend
les patients admis entre le 1er février 2007
(application du décret du 15 novembre 2006)
et le 1er février 2010 (retour dans le bâtiment
initial qui permet à nouveau une consomma-
tion à volonté de tabac), soit 550 patients. Une
analyse rapide de ces deux populations à partir
des items analysés (âge, sexe, etc.) ne montre
aucune différence significative.
Cette étude n’avait qu’une prétention limitée
à faible valeur épidémiologique scientifique,
étant donné des biais multiples (son caractère
rétrospectif, etc.). Le but était simplement de ne
pas “fermer la porte” à des tentatives de soins
par réduction des risques chez le fumeur. L’outil
utilisé a été un questionnaire écrit comprenant
: “Le bilan tabagique”, “Quelle est votre histoire
avec le tabac ?”, “Pourquoi fumez-vous ?” et
“Quel est votre degré de motivation ?”, tel que
développé dans le dossier “Consultation de ta-
bacologie” distribué par l’Inpes. Le patient était
encouragé à remplir 3fois ce questionnaire, en
tentant de se projeter “en arrière”, avant, pen-
dant et 1 an après l’hospitalisation.
Pour avoir une idée de la faisabilité de l’étude,
nous avons envoyé, dans un premier temps, ce
questionnaire par la poste à 50 sujets, choi-
sis au hasard dans les deux populations. Le
résultat a été décevant puisque nous n’avons
obtenu que 6 retours. Dans ces conditions,
nous avons restreint l’échantillon aux patients
que je soigne encore actuellement pour que je
puisse, dans le cadre d’une relation duelle, leur
expliquer l’étude, répondre à leurs questions,
tout en étant conscient du biais épidémiolo-
gique que cela constitue. De plus, parmi les
personnes de la population A, je ne soignais
plus que 25 patients. Il a donc été décidé de
comparer l’échantillon de ces 25 patients de la
population A avec 25 patients de la population
B, ceux-là tirés au sort parmi les patients que je
suivais encore au Centre ambulatoire d’accueil
et de soins pour toxicomanes.
RéSULTATS
Les résultats seront résumés pour une meil-
leure lisibilité :
Avant l’hospitalisation, 98 % des patients
fumaient du tabac, avec une consomma-
tion moyenne de 25 cigarettes par jour. Seuls
2 patients avaient déjà tenté auparavant un
sevrage de plus de 7 jours. Le test de Fagers-
tröm était en moyenne à 7. L’âge moyen de
début de consommation était de 11 ans et les
consommations quotidiennes avaient débuté à
13 ans. À la question “Pourquoi fumez-vous ?”,
les réponses les plus fréquentes étaient : “pour
combattre le stress”, “pour me soutenir le mo-
ral” (signes de la fragilité psychologique de ces
polytoxicomanes ?) Le degré de motivation à
l’arrêt était, de façon surprenante, assez élevé à
6 sur 10, mais peu de sujets avaient confiance
en eux : 2 sur une échelle de 10.
Pendant l’hospitalisation (avec une durée
moyenne de séjour de 10 jours environ), il n’y
a pas eu de changement notable pour la popu-
lation A, ce qui était prévisible. Je rappelle que
les sujets de la population B ne pouvaient fu-
mer qu’environ 10 cigarettes par jour. La plu-
part des patients (23/25) ont utilisé un substi-
tut nicotinique mais à dose moyenne et sans
excès. Le test de Fagerström était en moyenne
à 7, l’âge de début de consommation à 11 ans et
l’âge de consommation quotidienne à 13 ans.
Le degré de motivation à un arrêt ultérieur
restait à 6, mais cette population expérimen-
tant la réduction des risques par diminution
de leur consommation avait une plus grande
confiance en eux à 4/10 (peut-être par l’effet
de l’absence ou du peu d’effet du manque à la
nicotine, lié à l’utilisation de TSN).
Les réponses aux questions à 1 an étaient
instructives. Huit pour cent des patients de
la population B affirmaient ne plus fumer. La
consommation moyenne avait chuté à 15 ciga-
rettes environ/jour et 5 patients avaient tenté
un sevrage (sans succès). Le test de Fagers-
tröm restait désespérément à 7. L’importance
d’arrêter de fumer était restée à 6/10, mais la
confiance dans la capacité à parvenir à arrê-
ter de fumer avait bondi à 7/10. Quant aux
patients de la population A, 8 % affirmaient
ne plus fumer, mais la moyenne de consom-
mation quotidienne restait élevée (20 ciga-
rettes par jour) et le test de Fagerström était
inchangé (7). L’importance de l’arrêt du tabac
était toujours estimée à 6/10, mais l’indice qui
mesure la confiance en soi était monté à 4/10.
Discussion
On peut résumer les résultats de la façon sui-
vante :
Premièrement, les usagers de drogues “dures”
ont une dépendance très fréquente et très forte
au tabac. Ils ont conscience de la gravité et des
conséquences possibles de cette dépendance.
Leur motivation à changer est assez forte, mais la
confiance dans leurs capacités à réussir est faible.
Deuxièmement, une politique de réduction des
risques par diminution de la consommation de
tabac (sous couvert au minimum d’un traite-
ment substitutif à la nicotine) est possible,
même dans cette population de personnes
dépendantes à des stupéfiants.
Troisièmement, il est possible que cette poli-
tique ait une certaine efficacité, peu percep-
tible, mais réelle, par le biais, semble-t-il, d’un
impact positif sur la confiance en soi.
Il persiste à la fin de cette étude le doute sui-
vant : les patients ayant arrêté ou diminué leur
consommation de tabac, après l’hospitalisation,
ont-ils compensé par une augmentation de leur
consommation de cannabis (très généralement
mélangé à du tabac) ? L’effet obtenu alors serait
vraiment antithérapeutique. Cela ne me semble
cependant pas correspondre à la réalité.
Conclusion
L’arsenal thérapeutique pour lutter contre le
tabagisme se restreint dangereusement et ne
sera peut-être plus représenté dans quelques
temps que par les traitements substitutifs à
la nicotine (à efficacité réduite), par des mé-
thodes “psychologiques” (à efficacité douteuse)
et par les thérapies cognitivo-comportemen-
tales (quasi impossibles à appliquer, faute de
thérapeutes formés). Alors, pourquoi se priver
d’une approche certes peu “glorieuse” et peu
“ambitieuse”, la réduction des risques ? Il reste
à en expérimenter plus à fond les différentes
méthodes, voire à en inventer d’autres. Et,
pour autant, il ne faut pas délaisser les popu-
lations les plus fragiles, psychologiquement
ou en raison de conduites addictives graves,
ou qui cumulent ces deux facteurs de pronos-
tic “péjoratifs”. Il est vraiment temps, sérieu-
sement, comme le disait déjà Touzeau (12)…
en 2009, d’“ouvrir un vrai débat sur tabac et
réduction des risques”.
v
Références bibliographiques
1. Jacques JP, Figiel C. Drogues et substitution. Trai-
tements et prise en charge du sujet. Paris : De Boeck,
2006.
2. Burling TA, Ramsey TG, Seidner AL, Kondo CS.
Issues related to smoking cessation among substance
abusers. J Subst Abuse 1997;9:27-40.
3. Okruhlica L, Devinsky F, Klemplova D, Valentova J.
Reduction in self-reported nicotine dependence after
stabilization in methadone maintenance treatment.
Heroin Add and Rel Clin Prob 2003;5(1):39-46.
4. Stratégies thérapeutiques médicamenteuses et non
médicamenteuses de l’aide à l’arrêt du tabac. Recom-
mandations de bonne pratique. Paris : Afssaps, 2003.
5. Rodu B. Comment to the US Food and Drug. Ad-
ministration summarizing the rationale for tobacco
harm reduction. Tobacco Harm Reduction 2010:149-
68.
6. Nissen CM, Phillips CV, Heffernanc E. e implicit
ethical claims made in anti-tobacco harm reduction
rhetoric: a brief overview. Tobacco Harm Reduction
2010:99-109.
7. Harm reduction in nicotine addiction : helping
people who can’t quit. Royal College of Physicians,
Londres, 2007.
8. Molimard R. La fume. Paris : Sides ed., 2003.
9. Benowitz NL, Zevin S, Jacob P. Suppression of
nicotine intake during ad libitum cigarette smoking
by high-dose transdermal nicotine. J Pharmacol Exp
er 1998;287(3):958-62.
10. La réduction du risque tabagique. Rapport DGS.
La documentation française, Paris, 2002.
11. Hurt RD, Eberman KM, Slade J, Karan L. Trea-
ting nicotine addiction in patients with other addic-
tive disorders. In: Nicotine Addiction. Orleans CT,
Slade J. Oxford University Press, 1993.
12. Touzeau D. À propos du snus : ouvrir un vrai dé-
bat sur tabac et réduction des risques. Le Courrier des
Addictions 2009;3(11).
Addict déc 2012.indd 16 10/12/12 11:08
1
/
3
100%