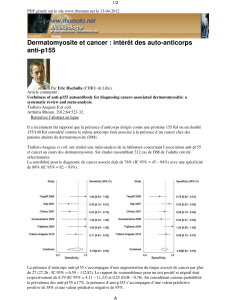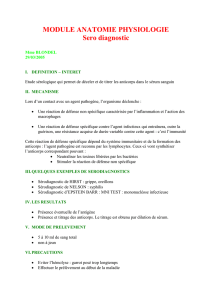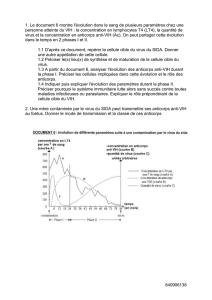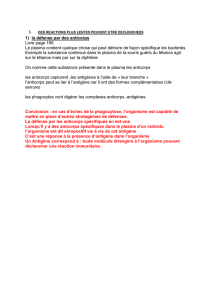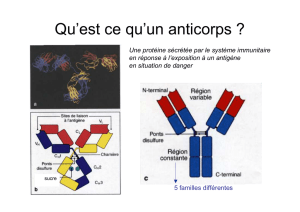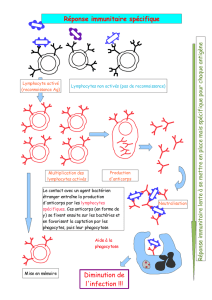r e v u e d e ... Coordinateur : N. Milpied ANTICORPS ANTI-PEG, UN PARADOXE THÉRAPEUTIQUE…

Correspondances en Onco-hématologie - Vol. II - n° 3 - juillet-août-septembre 2007
124
124
revue de presse
Coordinateur : N. Milpied
ANTICORPS ANTI-PEG,
UN PARADOXE THÉRAPEUTIQUE…
Cacher les épitopes sous le PEG pour
augmenter encore la durée de vie des
drogues, quelle bonne idée, mais le système
immunitaire n’est-il pas un peu plus coriace
à duper ?
La pégylation des drogues, c’est-à-dire leur
conjugaison à du polyéthylène glycol, est une
technique développée en vue d’augmenter
la demi-vie de molécules actives mais aussi
de les masquer au système immunitaire, en
diminuant par là même le développement d’an-
ticorps susceptibles de neutraliser leur action
et/ou d’accélérer leur destruction.
Cette méthode, dont J.K. Armstrong et al.
rappellent dans cette étude qu’elle a été
développée dès la fi n des années 1970, est
appliquée à de nombreuses protéines théra-
peutiques, dont l’asparaginase.
La réputation de mauvais antigène du PEG a
pourtant été mise en défaut dès le début des
années 1980, et l’obtention d’anticorps anti-
PEG dans des modèles animaux a permis de
confi rmer que le système immunitaire pouvait
tout à fait le considérer comme immunogène.
Chez l’homme, des IgM anti-PEG ont été histo-
riquement rapportées chez 0,2 % des patients
d’une cohorte de donneurs de sang en bonne
santé ainsi que chez des sujets allergiques.
Plus récemment, la présence de ces anticorps,
d’isotype IgG ou IgM, a été observée avec une
bien plus grande fréquence, de l’ordre de 25 %
chez des donneurs de sang.
Dans ce travail, l’idée était de rechercher si
une perte d’effi cacité de la PEG-asparaginase
administrée à des enfants atteints de leucémie
aiguë lymphoblastique (LAL), corrélée à une
clairance rapide de la molécule, pouvait être
liée à l’apparition d’anticorps anti-PEG. Les
patients sélectionnés étaient 44 enfants inclus
dans les protocoles ALL-BFM 2000 et ALL-BFM-
REZ 2002, pour lesquels des échantillons de
sérums étaient disponibles et analysables
rétrospectivement. Vingt-huit de ces enfants
avaient reçu de la PEG-asparaginase et 16 de
l’asparaginase non modifi ée. L’activité aspa-
raginase a été mesurée dans tous les sérums,
sélectionnés pour représenter environ 50 % de
patients avec une activité mesurable et 50 %
avec une activité non détectable.
Deux méthodes ont été développées pour
rechercher les anticorps anti-PEG : une
techni que d’agglutination d’hématies recou-
vertes de PEG et une technique en cytomé-
trie de flux utilisant des billes de PEG puis
un double marquage permettant d’identifi er
concomitamment les IgG et les IgM fi xées sur
les anticorps ayant potentiellement reconnu le
PEG. En parallèle, la présence d’anticorps anti-
asparaginase était également recherchée.
Les résultats, très bien détaillés, montrent une
nette corrélation entre la présence d’anticorps
anti-PEG et une disparition de l’activité aspara-
ginase dans le groupe des enfants ayant reçu
de la PEG-asparaginase.
Ce traitement avait néanmoins, dans ce groupe,
et en l’absence d’anticorps anti-PEG, conduit à
des activités asparaginase sériques bien supé-
rieures à celles observées dans l’autre groupe.
Cependant, le développement d’anticorps anti-
PEG dans un sous-groupe de ces patients, et
en l’absence de toute manifestation clinique
d’allergie, était indiscutablement associé à une
diminution rapide de l’activité de la drogue.
Les auteurs insistent donc sur l’importance
d’un suivi de l’activité enzymatique pendant
le traitement, et recommandent de plus la
recherche d’anticorps anti-PEG, suivie en cas
de positivité d’un ajustement thérapeutique
ou de l’utilisation d’une autre drogue.
Leur hypothèse physiopathologique est que
les patients “positifs” l’étaient peut-être déjà
avant l’administration de PEG-asparaginase.
Ils relatent à la fi n de l’article l’historique de
leur travail, commencé alors qu’ils cherchaient
à masquer les antigènes érythrocytaires avec
du PEG dans l’idée de fabriquer un “sang
universel”. Ce sont les tests réalisés avec
des sérums de donneurs de sang qui leur
avaient initialement permis de trouver une
forte proportion de sujets présentant spon-
tanément des anticorps anti-PEG. Ils attribuent
cette immunisation à la présence accrue de
PEG dans les cosmétiques, les médicaments
ou certains aliments.
Une attitude générale avant tout traitement par
un composé pégylé serait donc de rechercher
des anticorps préexistants, et, en cas de posi-
tivité, de monitorer soigneusement l’activité
du médicament.
M.C. Béné, Nancy
Armstrong JK, Hempel G, Koling S et al. Antibody
against poly(ethylene glycol) adversely affects PEG-
asparaginase therapy in acute lymphoblastic leukemia
patients. Cancer 2007;110:103-11.
❏
Anticorps anti-PEG,
un paradoxe thérapeutique…
Anti-CD40 et lymphome :
pas tout à fait “juste un autre
monoclonal”
La splénomégalie myéloïde :
du nouveau ?
Trisomie 8 et LAM :
une place pour l’allogreffe ?

125
125
Correspondances en Onco-hématologie - Vol. II - n° 3 - juillet-août-septembre 2007
Revue de presse
ANTI-CD40 ET LYMPHOME : PAS TOUT
À FAIT “JUSTE UN AUTRE MONOCLONAL”
Le ciblage ne se limite plus aux cellules tumo-
rales mais vise maintenant d’autres acteurs
de la défense antitumorale…
L’immunothérapie par anticorps monoclonaux,
humanisés de préférence, et envisagée par
les immunologistes dès les balbutiements de
cette “biotechnologie”, est devenue une telle
réalité au XXIe siècle que l’on pense presque
immédiatement ciblage et destruction des
cellules exprimant l’épitope visé.
C’est cependant une autre histoire que raconte
l’utilisation d’anti-CD40 à visée thérapeutique,
notamment dans les lymphomes. L’article
analysé ici rapporte des résultats expérimen-
taux chez la souris, mais oriente d’emblée le
raisonnement vers d’autres pistes. En effet, des
anticorps anti-CD40 agonistes ont été étudiés
depuis la fi n des années 1990. Leur capacité à
mimer l’effet de CD154, le ligand de ce récep-
teur de la famille du TNF, a permis d’obtenir
la maturation de cellules dendritiques, telle
qu’elle s’exerce in vivo lors de l’engagement
du CD40 qu’elles expriment. Cette maturation,
comme in vivo, a permis d’obtenir des réponses
cytotoxiques, par la génération de CTL CD8+,
capables notamment de détruire des cellules
tumorales. L’utilisation thérapeutique de tels
anti-CD40 dans l’optique d’une stimulation
des réponses cytotoxiques antitumorales par
l’intermédiaire de la maturation des dendri-
tiques présentes localement a ainsi fait son
chemin.
La maturation dendritique induite par l’en-
gagement de CD40 est d’autre part caracté-
risée par l’expression à la surface des cellules
dendritiques de molécules de costimulation
importantes également pour l’expansion et
la survie de CD8+ cytotoxiques.
Dans l’article analysé ici, les auteurs se sont
penchés sur le rôle apparemment clé joué par
le couple CD27/CD70 (respectivement sur les
lymphocytes CD8 et sur les cellules dendriti-
ques) dans ce contexte.
Le modèle murin utilisé est celui d’un
lymphome induit par l’injection de cinquante
millions de cellules BCL1. Les souris inoculées
ont ensuite reçu de l’anti-CD40 puis des anti-
corps dirigés contre les autres molécules de
costimulation, IBBL ou CD70. Les meilleures
réponses ont été observées avec l’anti-CD40
seul, cela confortant l’importance de la mise
en jeu des autres voies de costimulation et,
notamment, de celle impliquant le couple
CD27/CD70. Pour confi rmer cette hypothèse,
d’autres souris inoculées par les cellules tumo-
rales ont ensuite reçu un anti-CD27 agoniste.
L’éradication tumorale observée était similaire
à celle notée avec un anti-CD40.
Ces résultats suggèrent donc que :
l’activité d’anticorps monoclonaux agonistes
de CD40 passe par l’expansion et la maturation
de cellules dendritiques locales ;
cette maturation est essentiellement carac-
térisée par l’expression de CD70, ligand de
CD27 exprimé par les CD8 spécifi ques de la
tumeur ;
l’activation des CD8+CD27+ peut aussi être
obtenue directement, sans maturation des
dendritiques, avec un anti-CD27 agoniste.
Il est intéressant de noter que, bien que les
cellules BCL1 expriment CD27, leur inoculation,
ainsi que celle d’anti-CD27, à des souris SCID
incapables de montrer une réponse immuni-
taire cognitive, ne conduit à aucune réduction
tumorale. On est donc bien, dans ce système
de monoclonaux agonistes, dans le paradigme
d’une stimulation des réponses immunitaires
antitumorales plus que dans celui d’un ciblage
d’épitopes cibles.
Un autre monde… meilleur peut-être ?
MCB
French RR, Taraban VY, Crowther GR et al. Eradication
of lymphoma by CD8 T cells following anti-CD40 mono-
clonal antibody therapy is critically dependent on CD27
costimulation. Blood 2007;109:4810-5.
LA SPLÉNOMÉGALIE MYÉLOÏDE :
DU NOUVEAU ?
Il s’agit d’une étude, menée chez la souris,
émanant du groupe de William Vainchenker,
de l’unité Inserm 790 de Villejuif (1).
Dans cet essai, l’hypothèse de départ était que
le bortézomib inhiberait l’activation de NF-κB,
avec comme conséquence une diminution
de la sécrétion de TGF-β1 et de l’OPG, ce qui
induirait la réduction de la fi brose et de l’os-
téosclérose dans un modèle murin de myélo-
fi brose avec métaplasie myéloïde, le modèle
TPOhigh. Dans ce modèle murin, la fi brose et
l’ostéosclérose extensive sont considérées
comme secondaires à un processus réactif
provoqué par des médiateurs infl ammatoires
✔
✔
✔
❏
comportant le TGF-β et l’ostéoprotégérine,
médiateurs sécrétés par la prolifération
clonale de mégacaryocytes, de monocytes et
de cellules dérivées du stroma (Chagraoui H et
al., Blood 2002;100:3495-503, et Chagraoui H
et al., Blood 2003;101:2983-9).
Il a été montré que l’activation de NF-κB dans
les monocytes de patients porteurs d’une
myélofi brose primitive conduit à une produc-
tion d’IL-1 qui induit elle-même la production
de TGF-β. La voie NF-κB est également activée
dans les mégacaryocytes et dans les cellules
CD34 positives circulantes chez des patients
porteurs d’une myélofi brose primitive.
L’ensemble de ces éléments, couplé au fait
que le bortézomib est un inhibiteur de NF-κB,
a justifi é la recherche dont les résultats sont
proposés ici.
Dans ce modèle, après 4 semaines de trai-
tement, le bortézomib a diminué les taux de
TGF-β1 au niveau médullaire, et réduit signi-
fi cativement le développement de la fi brose
splénique et médullaire. Après 12 semaines
de traitement, on a également observé une
réduction du développement de l’ostéo-
sclérose en relation avec une inhibition de la
synthèse d’ostéoprotégérine. Point tout à fait
intéressant, l’administration de bortézomib a
signifi cativement amélioré la survie des souris
TPOhigh.
La conclusion est que le bortézomib apparaît
comme un traitement prometteur pour les
patients porteurs d’une myélofibrose avec
métaplasie myéloïde de la rate.
Commentaire. Bien qu’il existe quelques limi-
tations du modèle, par exemple le fait que les
souris TPOhigh meurent plus de problèmes de
myéloprolifération que de problèmes d’os-
téosclérose et que le bortézomib peut avoir
joué un rôle sur la myéloprolifération, il n’en
demeure pas moins que l’impact sur les média-
teurs de l’ostéosclérose et de la myélofi brose
est réel.
Cela ouvre des perspectives de prise en charge
thérapeutique de patients porteurs d’une mala-
die pour laquelle, jusqu’à présent, il n’existe
pas de traitement curatif simple, l’attitude thé-
rapeutique se bornant la plupart du temps à
une simple palliation.
Un tel article, émanant d’une équipe française
particulièrement renommée dans l’étude du
processus myéloprolifératif, est tout à fait
important à considérer et doit faire réfl échir

Correspondances en Onco-hématologie - Vol. II - n° 3 - juillet-août-septembre 2007
126
126
revue de presse
quant à la réalisation d’essais prospectifs futurs
incorporant cette drogue dans le cadre du trai-
tement des splénomégalies myéloïdes.
Le seul traitement “curatif” de la splénomégalie
myéloïde serait la réalisation d’une allogreffe
de moelle.
Il n’entre pas dans le propos de cette revue
de presse de discuter le bien-fondé de cette
affi rmation. Acceptons-la.
Un article récent mérite d’être signalé à cet
égard (2).
La mutation V617F du gène JAK2 est retrouvée
chez 50 % environ des patients présentant
une métaplasie myéloïde avec myélofi brose
(Levine RL et al., Cancer Cell 2007;7:387-97).
L’équipe de transplantation de moelle de l’hô-
pital universitaire de Essen, en Allemagne, a
réalisé une étude rétrospective portant sur
l’analyse de la mutation du gène JAK2 et de
son évolution chez des patients subissant une
allogreffe de cellules souches hématopoïéti-
ques pour métaplasie myéloïde de la rate avec
myélofi brose.
Cette étude a porté sur 25 patients ayant reçu
des greffes de moelle pour deux d’entre eux et
de cellules souches du sang périphérique pour
les 23 autres, greffes provenant de frères et
sœurs dans 14 cas et d’un donneur non familial
dans les 11 cas restants.
L’ADN qui servait à l’étude de la mutation JAK2
était obtenu du sang périphérique ou de la
moelle prélevés chez le donneur et chez le
receveur avant et après la greffe.
Une méthode d’amplifi cation par technique
de PCR de JAK2 a été réalisée en utilisant des
primers spécifi ques. C’est la méthode TAQMAN
qui a été utilisée pour faire une quantifi cation
du signal.
Avant la greffe, la mutation était mise en
évidence chez 15 patients (60 %) ; la concen-
tration médiane à ce moment-là était de 19,2 ng
(1,8 à 91,2).
Après la greffe, les patients qui étaient aupa-
ravant positifs ont été surveillés, et les résul-
tats de la recherche de la mutation de JAK2
ont été corrélés au chimérisme. Trois patients
se sont révélés être positifs pour la mutation
de JAK2 après la greffe, et tous trois avaient
simultanément un chimérisme mixte en analyse
PCR. Deux de ces patients sont décédés de
rechute de la maladie ; le troisième patient,
qui a également rechuté, a été traité par une
réduction de l’immunosuppression, un peu de
chimiothérapie et des injections des lympho-
cytes du donneur. Il a alors présenté une réac-
tion aiguë du greffon contre l’hôte, avec, au
cours du suivi, une réduction progressive de
la quantifi cation de la mutation JAK2, jusqu’à
une négativation totale.
Commentaire. Il s’agit d’une étude intéressante
car elle montre qu’il est possible d’envisager
une quantification par PCR du signal JAK2,
et que cette quantifi cation pourrait servir de
marqueur de l’effi cacité d’un traitement – ici
la transplantation de moelle, ailleurs d’autres
traitements.
Certes, dans le cas particulier de la greffe de
moelle, l’analyse du chimérisme s’est trouvée
être assez parallèle à celle de l’existence de la
mutation. Cependant, un patient présentait un
chimérisme mixte, sans mise en évidence de
la mutation de JAK2. Ce patient était porteur
d’une grave réaction chronique du greffon
contre l’hôte, dont il est malheureusement
décédé.
Ainsi, la splénomégalie myéloïde fait l’ob-
jet d’une intense recherche à la fois physio-
pathogénique et thérapeutique. Des espoirs
sont permis quant à une prise en charge thé-
rapeutique plus intéressante qu’elle ne l’est à
l’heure actuelle.
N. Milpied, Bordeaux
1. Wagner-Ballon O, Pisani DF, Gastinn T et al.
Proteasome inhibitor bortezomib impairs both myelofi -
brosis and osteosclerosis induced by high thrombopoietin
levels in mice. Blood 2007;110:345-53.
2. Steckel NK, Koldehoff M, Ditschkowski M et al. Use
of the activating gene mutation of the thyrosine kinase
(VAL617Phe) JAK2 as a minimal residual disease
marker in patients with myelofibrosis and myeloid
metaplasia after allogeneic stem cell transplantation.
Transplantation 2007;83:1518-20.
TRISOMIE 8 ET LAM :
UNE PLACE POUR L’ALLOGREFFE ?
La trisomie 8 est l’anomalie génétique la plus
courante dans les leucémies aiguës myéloïdes
(LAM). Cependant, la valeur pronostique de
celle-ci et la stratégie thérapeutique à proposer
restent des données non résolues à ce jour.
L’intergroupe allemand a donc étudié la valeur
pronostique de cette anomalie, en dehors des
cytogénétiques complexes, à travers une méta-
analyse de leurs différents protocoles menées
entre 1993 et 2002.
Cette méta-analyse a porté sur 131 patients
analysables (âge moyen : 50 ans [18-60]) ayant
une trisomie 8 isolée ou associée à une seule
autre anomalie cytogénétique (exclusion des
complexes ≥ 3 anomalies), en excluant l’as-
sociation aux cytogénétiques dites favora-
bles (t[15,17] ; t[8,21], inv[16], t[16,16]) ou les
anomalies 11q23. Tous les patients ont reçu
une double induction. Soixante pour cent ont
eu une consolidation par fortes doses d’AraC,
14 % ont été autogreffés et 26 % allogreffés.
Soixante-cinq pour cent des patients (85/131)
ont obtenu une RC, 21 % étaient résistants et il
y eu 14 % de décès précoces. La survie médiane
était de 3,6 ans. À 3 ans, la survie (3yOS) est à
29 % et la survie sans rechute à 32 %. Il n’existe
pas de différence entre la trisomie isolée et
celle associée à une autre anomalie. Le schéma
de traitement de consolidation n’infl uence pas
la survie globale, mais la probabilité de rechute
est signifi cativement beaucoup moins impor-
tante dans le groupe “allogreffe” (27 % versus
69 %). Les facteurs pronostiques identifi és (âge
< ou > 45 ans, maladie extramédullaire [MEXM]
et pourcentage de métaphases portant l’ano-
malie clonale [PMAC] < ou > 80 %) permettent
d’identifi er trois groupes de risque :
haut risque (3yOS = 13 %) : âge > 45 ans,
et ± MEXM ± PMAC > 80 % ;
faible risque (3yOS = 55 %) : âge < 45 ans,
pas de MEXM, PMAC < 80 % ;
intermédiaire (3yOS = 36 %) : les autres cas.
Commentaires. Malgré quelques critiques
opposables (faible nombre de patients, peu
de données moléculaires en dehors de FLT3),
cette méta-analyse (composée de protocoles
homogènes) apporte quelques informations
intéressantes sur la valeur pronostique de la tri-
somie 8 dans une LAM et le bénéfi ce potentiel
de l’allogreffe. Par ailleurs, le PMAC apparaît
comme un facteur important et rappelle que
l’obtention optimale de matériel cellulaire
pour analyse génétique est un objectif à ne
jamais oublier.
E. Raffoux, Paris
Schaich M, Schlenk RF, Al-Ali HK et al, Prognosis
of acute myeloid leukemia patients up to 60 years of
age exhibiting trisomy 8 within a non-complex karyo-
type: individual patient data-based meta-analysis
of the German Acute Myeloid Leukemia Intergroup.
Haematologica 2007;92:763-70.
✔
✔
✔
❏
1
/
3
100%