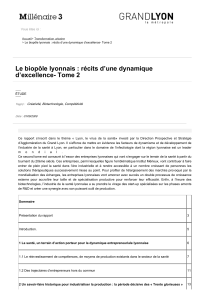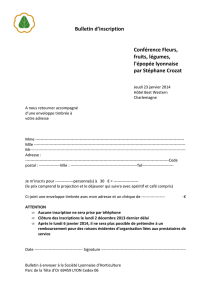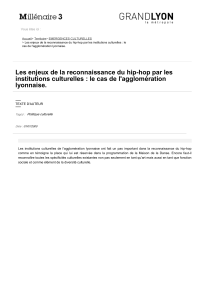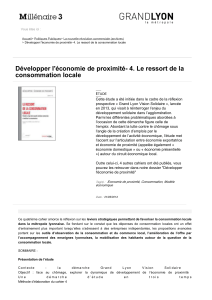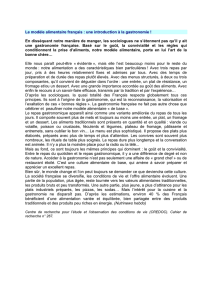La nouvelle gastronomie lyonnaise basée sur des concepts

Vous êtes ici :
Accueil> Territoire> La nouvelle gastronomie lyonnaise basée sur des concepts
La nouvelle gastronomie lyonnaise basée sur des
concepts
INTERVIEW DE ALAIN ALEXANIAN
<< La nouvelle génération de chefs propose du concept lyonnais, et non des recettes lyonnaises >>.
Alain Alexanian, chef étoilé de "l’Alexandrin" et créateur de l’ "A." nous offre ici un aperçu de l’évolution de la gastronomie
en général et de la cuisine lyonnaise en particulier.
Deux grandes tendances s’affrontent en matière de gastronomie : la cuisine traditionnelle de terroir et la cuisine des
chefs à l'écoute de l'évolution de la société ; car la cuisine devient un langage. A Lyon, toute une génération de
nouveaux chefs essaie en fait de concilier les deux : faire perdurer la cuisine lyonnaise tout en la repensant. Ils œuvrent
donc à la fois au renouvellement et à la conservation de cette identité propre à la ville. Mais ils ont aussi besoin des
politiques pour valoriser ces efforts en terme d'image. Un nouveau phénomène caractérise aussi la gastronomie : c’est la
gastronomie basée sur des concepts : le concept du "A." par exemple, basé sur des produits biologiques et sur le
commerce équitable ou le concept "montagne" à l'étude. Les chefs sont aussi, en effet, de véritables chefs d'entreprise
qui doivent sans arrêt se renouveler comme la cuisine qu’ils mettent en scène.
Réalisée par : Ludovic VIEVARD
Tag(s) : Patrimoine, Attractivité, Gastronomie, Thème emblématique
Date : 01/09/2004
Vous faites partie des chefs qui font bouger la cuisine. Comment celle-ci évolue-t-elle ?
La cuisine des restaurants gastronomiques est en avance d’une ou deux générations sur la cuisine des particuliers. Ce
qui a fait la grandeur du bœuf bourguignon ou de la blanquette, ce sont les restaurateurs. Progressivement, ces recettes
sont sorties des restaurants pour entrer chez les particuliers. Il y a trente ans, l’incontournable, c’était le saumon à
l’oseille qu’on ne trouvait que chez Troisgros. Aujourd’hui, on en trouve dans toutes les cuisines. Ce qu’on croit
appartenir à un seul restaurant, demain, les ménagères se l’accapareront. Il y a donc un décalage entre la cuisine des
chefs et la cuisine que l’on fait chez soit, mais il y a des passages de l’une à l’autre. Nous, les cuisiniers, on se doit d’être
à l’écoute de notre temps et non de refaire ces recettes qui remontent à deux générations. La cuisine que nous faisons
parle des aspirations du public et de ce que la société demande.
Aujourd’hui que souhaitent les gens ?
Tout le monde est à la recherche de plus d’authenticité. Les gens veulent de la transparence, que les choses ne soient
plus masquées, etc. C’est là-dessus que se construit notre cuisine : on ne masque plus les produits, on leur donne de la
transparence et on respecte leur goût. Mais il reste pourtant un fils conducteur : le produit. La volaille de Bresse reste la
volaille de Bresse, même si vous changer la façon de la cuisiner. C’est un produit extraordinaire qu’il faut continuer de
travailler. Mais, au lieu de le faire à la truffe et à la crème, on peut innover en le faisant au citron confit. Avant la volaille

était complètement nappée de sauce, aujourd’hui la sauce est dessous et l’accompagnement à part. Ça correspond à ce
que les gens veulent vivre : ils ne savent pas vraiment qu’ils veulent ça en cuisine, mais ils savent qu’ils veulent ça dans
leur vie.
Il y a donc deux grandes tendances opposées : la cuisine traditionnelle enracinée dans un terroir et la cuisine
des chefs qui fait la révolution permanente ?
Non. Il y a une cuisine de tradition qui, par définition, se situe dans le passé et qui correspond aux habitudes des chefs
qui font de la cuisine depuis longtemps et qui ont trouvé un équilibre dans leur cuisine. C’est une cuisine qui correspond
à une population qui aime se réfugier dans une tradition bien particulière et qui ne comprendrait pas qu’on lui serve une
volaille aux agrumes. Nous ne faisons pas la révolution, mais nous reflétons l’évolution de la société. La cuisine est un
langage. Quand les gens se retrouvent autour d’une table, ils choisissent des éléments de ce langage pour pouvoir
partager quelque chose de bien particulier avec les gens qu’ils aiment. La jeune génération se retrouve assez bien dans
notre cuisine. Quant à la génération d’avant, qui pourrait avoir plus de difficulté, elle a cependant des points de repère,
parce qu’elle a connu le même type de bouleversement dans les années 60. Quand Bocuse a proposé une salade de
haricots verts croquants, c’était révolutionnaire ; avant lui on les mangeait archi cuits. Mais ce qui était révolutionnaire
dans les années 60 est devenu classique. Pourtant, ceux qui l’ont accepté facilement sur le moment, ce sont les jeunes
de sa génération à lui, pas ceux qui avaient l’habitude des haricots archi cuits.
Donc ce n’est pas une cuisine d’opposition, mais une cuisine d’évolution qui se fait par petite rupture ?
Oui. La tradition est un fil conducteur. Le produit est toujours là, mais la question est : « Comment je peux exprimer dans
ma cuisine ce que cherche ma génération ? ». En 68, on a voulu changer les choses et bouleverser complètement la
société. Ça c’est retrouvé dans la cuisine, jusqu’à des extrêmes du type turbot au kiwi !
Comment la tradition peut-elle être un fil conducteur ?
Il faut garder ce qu’il y a de meilleur dans la cuisine, c’est-à-dire le produit. C’est la Bresse, l’Ain, la Savoie, etc.
Rhône-Alpes est tellement riche en produits variés et de qualité que l’on n’a presque pas besoin d’aller chercher ailleurs
des produits qui ne correspondraient d’ailleurs pas à la Région. Quand je peux avoir des poissons de lac, omble
chevalier, féra du lac, perche, etc., je me dois de mettre en avant ces poissons, et pas du homard ou du saumon !
On a quand même l’impression que la cuisine se « déterritorialise », notamment à travers l’utilisation des épices.
Qu’est-ce que c’est pour vous qu’une cuisine de terroir ?
C’est une cuisine qui met en avant les produits de la terre régionale. J’ai 49 producteurs de légumes bio qui produisent
presque exclusivement pour moi. Ça c’est de l’ancrage dans le territoire. Le menu entièrement de légumes que je
propose, selon moi, c’est un vrai menu régional. Pour vous un menu régional, ça ne sera peut être pas un menu «
légumes », mais pour moi oui, et en tout cas bien plus qu’un menu « cochonnailles » qui suppose qu’on soit aller
chercher un cochon dans les régions qui en produisent, c’est à dire à 600 ou 1 000 km d’ici !
Mais des légumes, on peut en trouver dans toute la France ! Est-ce qu’il y a encore une spécificité de la cuisine
lyonnaise ?
Bien sûr ! Tout ce qui correspond géographiquement à la Région Rhône-Alpes. On a des fromages fabuleux, des
poissons hors normes, comme l’omble chevalier que l’on ne trouve qu’ici. Il y a aussi la carpe, qui a fait l’identité culinaire
de la région. Derrière ces produits, il y a des pêcheurs, des éleveurs, des agriculteurs, des producteurs de vins, etc. Se
sont eux la richesse de la Région. Nous ne sommes que les derniers maillons de cette chaîne. La cuisine de
Rhône-Alpes c’est ça. Un exemple. La quenelle est née du brochet et c’est ça qui en fait un produit local. Pour moi, la
cuisine lyonnaise, aujourd’hui, c’est le brochet. Bien sûr, je propose aussi des quenelles, même si j’ai enlevé le beurre, la
farine, etc. Il fut un temps, je ne la faisais même plus, très imbu de l’image du cuisinier jongleur de produit, d’herbe, etc.,
mais les gens avaient envie de la retrouver sur la carte. Le produit ne serait pas là, je ne la ferais pas. Mais le produit est
là, alors, allons-y pour la quenelle ! Si j’exerçais à Toulouse, je ferais un cassoulet, mais différemment. Le fil de la
tradition, il est là.
Votre cuisine reste ainsi centrée sur un territoire. En va-t-il de même pour celle de vos confrères ? Quelle
tendance suivent-ils ?
La tendance est de ne pas suivre ce qui se faisait au XXème siècle. Mais dans notre tradition d’innovation, il y a une
grande différence avec la génération des chefs qui nous a précédée. C’était une bande de copain fédérée par un leader.
C’était Bocuse, entouré de Nandron, Bourillot, etc. Lyon avait besoin de ça. Il n’y avait pas de cuisine propre à chacun,
mais une cuisine lyonnaise revisitée : on mangeait partout de la quenelle ou du saucisson brioché. Aujourd’hui, 40 après,
la tendance est inversée. Il n’y a plus de leader, mais une bande de copains qui proposent chacun une cuisine
différenciée et très personnelle. Cette bande de copain, c’est Gauvreau, Nicolas Le Bec, etc., il y en a plein.
Qu’est-ce qui fait l’unité de cette bande de copain ?
Là encore, ce sont les producteurs. Quand on se regroupe, on ne parle pas de recettes. Je n’ai pas envie de faire les

mêmes recettes que Nicolas Le Bec, ça ne me correspondrait pas. En revanche, on échange des adresses de
producteurs. On parle produits parce qu’on sait qu’on peu les transformer chacun à notre façon. Si j’ai une bonne
adresse pour de l’omble chevalier, je peux la lui donner. Il ne le cuisinera pas comme moi. Autrefois, c’était le cas. On
avait besoin de se rassurer sur une cuisine lyonnaise identifiable de partout. Aujourd’hui on veut identifier le produit et
pas la recette. Voilà ce qui a changé : ce n’est plus la recette, mais le produit. D’ailleurs, il n’est pas rare de citer le nom
du producteur sur la carte. En gros, les notes sont les mêmes, mais l’interprétation change. Si on met les produits en
avant, alors dans 40 ans on aura encore des pêcheurs pour faire de l’omble chevalier, du brochet, etc. Mais si on les
oublie pour faire une cuisine mondialiste, alors ils disparaîtront. Je pense que plus l’Europe va s’ouvrir plus les régions
vont imposer leur identité : avant on faisait « une cuisine française » (tomates en chapelure et fagots de haricots verts),
aujourd’hui on retrouve une cuisine de proximité, mais transformée.
Que devraient faire des élus qui souhaiteraient que Lyon reste une ville de gastronomie et ne perde pas cette
image ?
Il faut qu’ils viennent chez nous, ce qu’ils font d’ailleurs de plus en plus. Nous sommes les ambassadeurs de la Ville, ils
sont les ambassadeurs de nos cuisines. Mais ils ne peuvent pas en parler s’il n’y a pas de connexion entre eux et nous.
On a la chance que ce soit le cas. D’ailleurs, à Lyon, aimer bien manger est presque une condition pour être élu. La
cuisine que le public attend de nous, c’est une cuisine transparente, et c’est aussi ce qu’il attend des politiques. Il y a un
lien entre nous parce que nous sommes faits par le public. Il faut être identifiable, lisible, transparent. Avant on cuisinait
des choses épaisses avec des farces, de la crème et des sauces et, pour faire léger, on mettait un bout de cerfeuil. On
ne voyait rien, on savait pas vraiment ce qu’on mangeait, c’était compact. Ça, on n’en veut plus, ni en cuisine, ni en
politique.
Comment valoriser cette nouvelle cuisine lyonnaise ?
A Lyon, on a du mal à parler de soi. Le cinéma est né à Lyon, personne ne le sait. Si le cinéma était né à Chicago, je
peux vous dire que le monde entier le saurait. Il y a tellement de choses qui ont été faites à Lyon et qui y ont grandi sans
être valorisées. Je n’aimerai pas que cela soit aussi le cas de notre cuisine. Il faudrait tout de même qu’on commence à
citer la relève ! Mais, comme personne ne nous interroge, l’image de Lyon ne change pas à l’extérieur. C’est aux
politiques de dire qu’il y a toute cette nouvelle génération de chefs qui s’active à Lyon. S’ils ne le font pas, ils font vieillir
l’image de Lyon.
Les élus, également, ont du mal à percevoir cette transformation ?
Ils ont du mal à la relayer. Si les politiques disaient qu’il y a de la créativité à Lyon et que les jeunes chefs sont ceux
promeuvent le plus la région Rhône-Alpes en France et à l’étranger, on serait encore davantage sollicité pour exporter
notre savoir-faire lyonnais. Je travaille pour des sociétés parisienne et niçoise : c’est aussi ça Lyon, pouvoir s’exporter.
Avant on parlait de la cuisine lyonnaise, parce que les maires allaient dans les bouchons. Aujourd’hui, ils vont aussi dans
les concepts, mais le déclic ne se fait pas encore et on continue à parler recettes et pas concepts. Les journalistes
lyonnais sont en train de fausser l’image de Lyon parce qu’ils parlent toujours des même choses. Le paradoxe est que
les étrangers qui vont à la Rotonde ou chez Mathieu Vianney ont une vision de la ville telle qu’elle respire aujourd’hui,
mais pas de ce que la presse évoque sempiternellement. Du coup, cette image oblige les restaurateurs à faire perdurer
la gastronomie « folklorique », uniquement parce que les gens pensent que c’est la réalité de la cuisine lyonnaise. La
nouvelle génération n’ouvre pas que des bouchons. Pourtant, on ne parle que de cela.
Vous parlez des « concepts ». Est-ce nouveau et qu’est-ce que cela signifie ?
Oui, c’est nouveau. A l’A., je propose du bio et des produits issus du commerce équitable. Vous prenez du plaisir à boire
votre café et, en plus, vous aider les gens qui le produisent à l’autre bout de la planète. Aujourd’hui, ici, les conditions de
vie sont trop bonnes pour que la nouvelle génération descende faire la révolution dans la rue. La seule révolution que
l’on peut faire est économique. C’est en choisissant ses vêtements, ses aliments, etc., qu’on peut se faire entendre : en
mangeant, on peut changer le monde. Je prépare également un concept de « montagne », où l’on pourra manger des
produits de la région, tartiflette, etc., et également une galette lyonnaise avec une petite andouillette aux oignons confits.
Voilà ce que c’est un concept. Quelqu’un qui a compris son terroir, c’est quelqu’un qui utilise les produits de sa région,
mais à sa façon. C’est quelqu’un qui peut faire de la cuisine quasi-japonisante mais qui termine son plat avec une légère
touche de grattons lyonnais revisités. C’est une cuisine qu’on peut identifier, c’est à dire relier à un territoire. La nouvelle
génération de chefs propose du « concept lyonnais », et non des « recettes lyonnaises ».
Les chefs sont aussi, et de plus en plus, des chefs d’entreprise. Pourquoi ?
Il n’y a rien de nouveau là-dedans. Bocuse et Lacombe, par exemple, le font depuis longtemps. Ce n’est pas typique aux
chefs, mais à une cuisine d’élite qui ne permet pas de vivre. Économiquement, la grande cuisine n’est pas viable et les
chefs n’ont pas d’autre choix que celui de se diversifier et d’ouvrir des lieux plus accessibles. Il y a 20 ans, la notoriété
des chefs permettait d’ouvrir ces lieux. On pouvait avoir du Bocuse, même si on ne pouvait s’offrir Collonges. Aujourd’hui

non, cela ne fonctionne plus tout à fait comme cela. Les concepts marchent parce qu’ils répondent à une attente. Les
gens ne viennent pas à A. parce qu’il y a l’Alexandrin, mais parce qu’il y a un concept bio et la réalité du commerce
équitable derrière.
1
/
4
100%