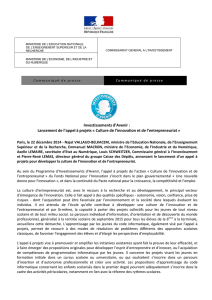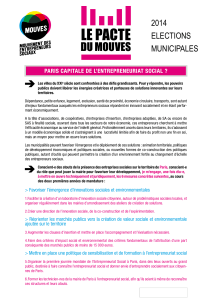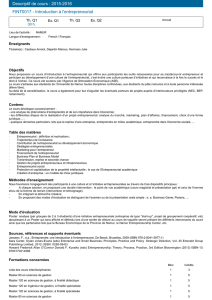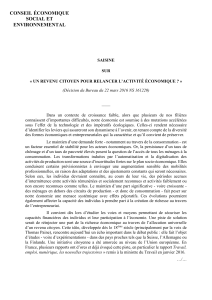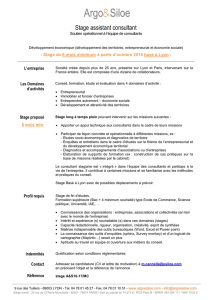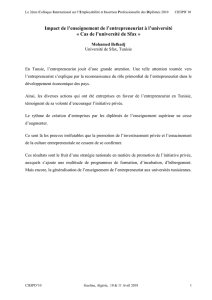Chapitre 19 - L’entrepreneuriat social Introduction

Entreprendre : manuel d’introduction – Chapitre 19 : L’entrepreneuriat social – version 03/03/2016 – page 1
Chapitre 19 - L’entrepreneuriat social
Sybille MERTENS1, Sophie BACQ2 et Julie RIJPENS3
Introduction
Partout dans le monde, des hommes et des femmes créent et développent des entreprises en
cherchant avant tout à offrir une réponse à des besoins sociaux insatisfaits. Ils démontrent par
là qu’il est possible d’entreprendre en poursuivant un objectif social. Leur moteur n’est pas la
recherche d’un rendement maximal pour les investisseurs mais bien la réalisation de la
mission sociale qu’ils se sont donnée.
Depuis quelques années, cette dynamique entrepreneuriale originale intéresse les responsables
politiques et les décideurs économiques. Ce nouveau type d’entreprise, que l’on dénomme
« entreprise sociale » attire l’attention parce qu’il combine de façon convaincante un projet
économique et une finalité sociale. Il démontre qu’il est utile et possible d’entreprendre en
dehors des modèles plus classiques d’entreprises à but lucratif.
Ce chapitre vise à introduire la notion d’entrepreneuriat social, à comprendre ce qui explique
l’existence de ce type d’entrepreneuriat et à en décrire les spécificités. Pour cela, nous
exposons d’abord de façon synthétique le débat terminologique qui entoure la réalité de
l’entrepreneuriat social (section 1). Ensuite, nous mobilisons la théorie économique sur les
échecs du marché et de l’Etat pour identifier ce que l’on appelle des opportunités sociales et
justifier l’existence d’entreprises privées dont la finalité est sociale (section 2). Tout en
reconnaissant d’emblée que l’entrepreneuriat social partage de très nombreuses
caractéristiques avec l’entrepreneuriat à but lucratif, nous tentons alors d’en épingler les
principales spécificités, ce qui fait consensus et ce qui fait débat (section 3). Enfin, nous
passons en revue quatre modèles d’affaires innovants d’entrepreneuriat social. Ils illustrent
l’hétérogénéité des modèles d’entrepreneuriat social et reflètent divers assemblages des
spécificités mentionnées ci-dessus (section 4).
1. Le débat terminologique
Depuis une dizaine d’années, la littérature internationale foisonne de travaux conceptuels
autour des notions d’entrepreneuriat social, d’entrepreneur social ou encore d’entreprise
sociale. Si, pour le lecteur profane, tous ces termes recouvrent peu ou prou les mêmes réalités,
une revue attentive de la littérature permet de comprendre rapidement que les nuances sont
importantes. Très schématiquement, on peut dire que la plupart des travaux se rattachent à
trois grands courants de pensée qui, s’ils se complètent à bien des égards, n’ont pas encore
réussi à dialoguer suffisamment pour construire un socle théorique commun de
l’entrepreneuriat social.
1 Chaire Cera « Entrepreneuriat social et coopératif », Centre d’Economie Sociale, HEC-Liège, Université de
Liège, Belgique.
2 Entrepreneurship & Innovation Group, D’Amore-McKim School of Business, Northeastern University, Boston,
Etats-Unis.
3 McGill University, Montréal, Canada.

Entreprendre : manuel d’introduction – Chapitre 19 : L’entrepreneuriat social – version 03/03/2016 – page 2
Deux de ces courants trouvent leur origine aux Etats-Unis. On y distingue le courant de
l’entreprise sociale, qui s’ancre dans l’évolution actuelle du secteur nonprofit (secteur
associatif) et le courant de l’innovation sociale, centré sur la figure de l’entrepreneur social.
En écho à l’émergence de ces nouveaux concepts, on peut noter, parmi d’autres repères
possibles, la mise sur pied, à la suite de l’initiative prise par la Harvard Business School4, de
nombreux programmes de formation et de soutien à l’entreprise sociale ou à l’entrepreneuriat
social par les grandes universités américaines (Columbia, Berkeley, Duke, Yale, New York,
etc.)5 ainsi que par diverses fondations.
Le troisième courant est d’origine européenne. Porté par le réseau EMES, il défend une
conception de l’entreprise sociale à laquelle il reconnaît une filiation avec le champ plus large
de l’économie sociale.
. L’entreprise sociale, voie pour l’autosuffisance des associations
La conception qui prévaut dans ce courant de pensées né aux Etats-Unis met en avant le
concept d’entreprise sociale et considère celle-ci comme le fruit de l’évolution naturelle des
associations vers un modèle plus entrepreneurial, inspiré de la logique de marché (Boschee,
1998). Il s’agit pour les associations de répondre de façon novatrice à leurs propres problèmes
de financement en développant des activités génératrices de revenus. Ces initiatives
économiques marchandes, qui ne sont pas nécessairement liées à la mission sociale des
organisations, doivent leur permettre de devenir autosuffisantes pour pallier la réduction des
aides publiques et les limites de la philanthropie. Ce courant promeut également la
professionnalisation de la gestion des associations afin d’améliorer leur compétitivité dans un
contexte de plus en plus concurrentiel (Dees et Anderson, 2006).
Certains auteurs vont plus loin dans cette veine et associent à l’entrepreneuriat social un très
large spectre d’initiatives qui témoignent, à des degrés divers, d’un souci de plus-value sociale
(Austin et al., 2006 ; Nicholls 2006). Le contenu du concept devient alors plus large et plus
flou puisqu’il recouvre aussi bien des activités entrepreneuriales menées au sein
d’organisations à finalité sociale que des pratiques inspirées par le mouvement de la
responsabilité sociale des entreprises. Ceux qui adoptent ce point de vue sous-entendent que
les distinctions habituellement établies entre les organisations publiques, les organisations
privées à but de lucre et les organisations privées à finalité sociale tendent à s’estomper.
. L’entrepreneur social, porteur d’innovation sociale
Une deuxième école de pensée associe l’entrepreneuriat social à l’innovation sociale (Dees et
Anderson, 2006). L’entrepreneur social est regardé comme un agent de changement social. Il
mobilise sa créativité, son dynamisme et son leadership pour concrétiser des réponses
nouvelles à des besoins sociaux et, à ce titre, peut être considéré comme un héros des temps
modernes (Bornstein, 2004). Ce courant de pensée doit beaucoup à l’organisation Ashoka,
fondée en 1980 par Bill Drayton pour repérer et soutenir « des individus hors du commun qui
mettent au point des modèles qui favorisent le changement social » (Drayton et Mac Donald,
1993). Aujourd’hui, Ashoka apporte conseils et soutien financier à près de 3000 entrepreneurs
sociaux dans le monde entier. D’autres organisations se sont ensuite créées pour épauler des
individus qui présentent un profil d’entrepreneur social. Citons, parmi d’autres, Echoing
4 En 1993, celle-ci lance la « Social Enterprise Initiative ».
5 Une dizaine d’années plus tard, on assiste à l’émergence de ces thématiques dans les programmes de
formation des universités européennes.

Entreprendre : manuel d’introduction – Chapitre 19 : L’entrepreneuriat social – version 03/03/2016 – page 3
Green (1987), The Schwab Foundation for Social Entrepreneurs (1998), The Skoll Foundation
(1999) ou The Manhattan Institute’s Social Entrepreneurship Initiative (2001).
. L’entreprise sociale, grille de lecture des dynamiques entrepreneuriales d’économie sociale
En Europe, ce sont les travaux du « EMES European Research Network » qui ont fourni les
premières bases théoriques et empiriques pour une conceptualisation de l’entreprise sociale.
Cette approche, construite dans la seconde moitié des années 1990, est le fruit d’un long
travail de dialogue entre plusieurs disciplines (économie, sociologie, science politique et
management), mais aussi entre les diverses traditions et sensibilités nationales au sein de
l’Union Européenne.
L’approche EMES définit l’entreprise sociale de la manière suivante :
Les entreprises sociales sont des organisations privées à but non lucratif, qui produisent des
biens et délivrent des services en relation directe avec leur finalité sociale. Elles prennent
appui sur une dynamique collective impliquant différentes parties prenantes dans leurs
organes de gestion, elles accordent beaucoup d’importance à leur autonomie et elles
supportent un risque économique lié à leurs activités. (Defourny et Nyssens, 2006, p. 5)
Ce courant reconnaît au concept d’entreprise sociale une filiation très nette avec les
différentes approches qui tentent de cerner l’existence d’un troisième secteur, au-delà du
secteur privé capitaliste et du secteur public : économie sociale, nonprofit sector, économie
solidaire, voluntary sector6. L’entreprise sociale n’est toutefois pas le terme qui désigne toute
organisation faisant partie de ces ensembles. L’innovation conceptuelle résulte plutôt d’un
double constat que l’on peut poser sur le troisième secteur : d’une part, de nouvelles
organisations présentant des caractéristiques originales se créent au sein du troisième secteur
et en constituent un nouveau sous-ensemble, d’autre part, on assiste au développement d’un
nouvel esprit entrepreneurial qui remodèle des expériences plus anciennes de ce troisième
secteur. Par conséquent, sans nier l’intérêt des concepts plus anciens, la notion d’entreprise
sociale met en lumière certaines dynamiques particulières au sein des organisations du
troisième secteur.
. La posture adoptée dans ce chapitre
Que retenir de ce préliminaire terminologique ? Les différentes approches apportent des
éclairages intéressants et complémentaires. Il serait dès lors réducteur d’opter pour une
approche plutôt qu’une autre. D’autant plus que sur le terrain, les initiatives qui se
développent peuvent souvent être analysées en combinant les trois approches. Par ailleurs,
même sur plan conceptuel, notons à la suite d’Emerson (2006), qu’il est probable que ces
différentes approches convergent progressivement dans une caractérisation commune de
l’entrepreneuriat social autour de quelques critères centraux qui témoignent à la fois du
caractère entrepreneurial et de la dimension sociale : la poursuite prioritaire d’impacts
sociaux, l’innovation sociale, la mobilisation de recettes (au moins partiellement) marchandes
et l’usage de méthodes managériales empruntées au monde des affaires (Defourny et Nyssens,
2010).
Par conséquent, les différences et les mouvements de rapprochement observés entre les usages
des concepts plaident plutôt pour la reconnaissance de l’entrepreneuriat social en tant que «
concept-cluster », compris comme un conglomérat de différents sous-concepts qui recouvrent
6 Ce troisième secteur est désigné en France et au Québec par l’appellation « économie sociale et
solidaire », tandis qu’il est plus simplement appelé « économie sociale » en Belgique, en Suisse ou encore en
Espagne. Au niveau de l’Union Européenne, on parle volontiers de troisième système.

Entreprendre : manuel d’introduction – Chapitre 19 : L’entrepreneuriat social – version 03/03/2016 – page 4
des réalités proches, partageant suffisamment de caractéristiques tout en n’étant pas
interchangeables (Choi et Majumdar, 2013).
2. Les opportunités sociales
Quelle que soit la nature de l’entrepreneuriat, on peut considérer qu’il est un processus
dynamique par lequel un individu (ou un groupe d’individus) mobilise ses motivations et ses
compétences pour transformer une opportunité en entreprise (Mair et Noboa, 2006).
Si on définit une opportunité comme « une situation différente d’aujourd’hui et la croyance
qu’il est possible d’atteindre cette nouvelle situation » (Austin et al., 2006, p.6), une
entreprise qui naît ou se développe en réponse à une opportunité met tout en œuvre pour se
rapprocher de la situation espérée. Sa finalité réside dans les bénéfices attendus de cette
nouvelle situation. Si on considère l’entrepreneuriat social comme celui qui vise à transformer
une opportunité en entreprise sociale, cela soulève deux questions. Premièrement, on est en
droit de s’interroger sur la nature des opportunités. Sont-elles identiques aux opportunités
décrites dans les démarches d’entrepreneuriat « conventionnel » ? Cette question sera traitée
dans le point 2.1. Deuxièmement, on peut aussi étudier le processus de « détection » des
opportunités. L’opportunité se découvre-t-elle ou se construit-elle et, dans ce cas, la
construction emprunte-t-elle un chemin original lorsqu’il s’agit d’entrepreneuriat social ?
Cette question fera l’objet du point 2.2.
2.1. La nature des opportunités
Une opportunité sociale se différencie d’une opportunité commerciale par le fait qu’elle porte
en elle l’espérance d’une plus-value sociale (Dees et al., 2001 ; Dorado, 2006) alors que
l’opportunité commerciale sous-entend la possibilité d’obtenir un retour de nature
économique qui peut prendre différentes formes mais qui aboutit généralement à
l’accroissement de la richesse des investisseurs (Austin et al., 2006). Pour le dire autrement,
en entrepreneuriat social, la notion d’opportunité n’est pas entendue comme « une source de
profit rendue possible par l’existence d’une demande solvable et de ressources requises
disponibles » (Verstraete et Fayolle, 2005, p. 35) mais s’apparente plutôt à une solution que
l’entrepreneur envisage d’apporter en réponse à une problématique sociétale insuffisamment
rencontrée (Thompson, 2002).
Que l’on se situe dans la perspective de la découverte d’opportunités ou de celle de leur
construction (voir plus loin), il semble nécessaire de regarder de plus près où se situent les
problématiques sociétales insuffisamment rencontrées. Dans les économies mixtes de marché
telles qu’on les connaît aujourd’hui, de nombreux besoins sociaux sont insuffisamment
satisfaits par les institutions existantes : lutte contre l’exclusion sociale, alphabétisation,
sécurité alimentaire, protection de l’environnement, défense de la diversité culturelle, accès
aux soins de santé, à la formation ou au crédit, amélioration des conditions de vie et de travail
de catégories de personnes fragilisées, correction des inégalités Nord-Sud, redynamisation des
quartiers, etc.
L’entrepreneuriat social peut être vu comme la formulation de réponses novatrices à ces
besoins insuffisamment satisfaits par l’Etat ou par les entreprises commerciales classiques

Entreprendre : manuel d’introduction – Chapitre 19 : L’entrepreneuriat social – version 03/03/2016 – page 5
(Alvord et al., 2004 et Thompson, 2002 cités par Fayolle et Matlay, 2010, p. 1 ; Haugh, 2007 ;
Mertens, 2010). Pourquoi ces besoins sont-ils insuffisamment satisfaits ? Parce qu’ils révèlent
des situations qui renvoient à ce que la théorie économique institutionnelle appelle les échecs
du marché et de l’Etat (Austin et al., 2006 ; Drayton, 2002)7.
Pour comprendre intuitivement ce que sont les échecs de marché (Dees, 1996), il faut accepter
l’idée que les mécanismes de marché et l’action des entreprises privées à but lucratif ne
conduisent pas toujours à une situation optimale sur le plan de l’efficacité économique et de la
justice sociale. C’est le cas lorsque les conditions théoriques de la concurrence pure et parfaite
ne sont pas rencontrées : lorsque l’atomicité des agents économiques présents sur le marché
n’est pas vérifiée, lorsque l’information entre agents économiques ne circule pas parfaitement
et lorsque tous les biens et services produits ne sont pas purement privés (la consommation de
certains biens et services génère des effets collectifs).
Dans ces différents cas de figure, on parle d’échecs de marché parce que laisser le marché agir
seul conduit à des résultats « qui ne sont pas souhaitables du point de vue de la société : soit
les entreprises produisent trop peu de biens “bénéfiques” ou trop de biens “nuisibles”, soit
elles limitent trop l’accès de certaines personnes à la consommation de certains biens, soit
enfin elles produisent des biens dont les quantités et les qualités ne sont pas conformes aux
attentes des consommateurs » (Steinberg, 2006, p. 119).
Pour pallier ces échecs du marché, l’Etat peut emprunter la voie de la production publique
(organiser lui-même la production et la distribution de certains biens et services) ou celle de
l’édiction de normes (influencer les résultats de la production des agents économiques en
régulant les prix, les quantités, la qualité des produits ou les conditions d’accès à la
production). Mais ces actions rencontrent également des limites de trois types.
Premièrement, le caractère bureaucratique des organisations étatiques est souvent considéré
comme un frein à la conception de services collectifs nouveaux ou mieux adaptés en termes
de qualité. Deuxièmement, dans nos systèmes démocratiques, les choix de production
publique de services collectifs (quantité de services à produire, qualité de ces services et part
du budget public à y affecter) tendent à suivre les desiderata de l’électeur médian (Weisbrod,
1975). L’Etat produit donc des services qui concernent des collectivités larges et il lui est
difficile de construire des réponses adaptées aux demandes des minorités. Troisièmement, si
l’Etat édicte des normes qui en principe obligent les acteurs à ne pas abuser de leur pouvoir au
détriment des consommateurs ou de la collectivité dans son ensemble, la régulation souffre
elle aussi de certaines limites (manque d’effectivité des normes, difficulté de tout normer).
Face à ces échecs de marché et aux limites rencontrées par l’Etat, il semble bien que
l’entrepreneuriat social soit vu comme un mécanisme qui permet de s’emparer d’opportunités
créées par le comportement inadéquat des entreprises de nature capitaliste et/ou négligées par
l’Etat pour des raisons d’arbitrage dans les priorités d’intérêt général.
Selon la théorie économique néo-institutionnelle, les organisations n’apparaissent pas par
hasard et leurs caractéristiques constituent autant d’atouts qui se révèlent optimaux dans
certaines circonstances. Voyons rapidement en quoi des organisations privées qui combinent
7 Pour une synthèse de la littérature sur le lien entre les rôles des entreprises sociales et les échecs du
marché et de l’Etat, voir Mertens (2010), Steinberg (2006) et Nyssens (2000).
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
1
/
28
100%