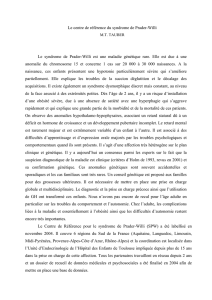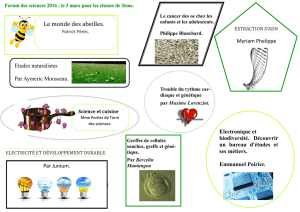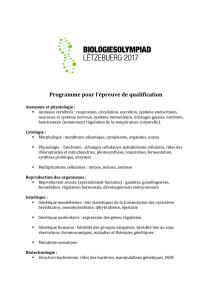Actualité

72
Actualité
Actualité
Harper définit le conseil génétique
comme une procédure par laquelle des
patients ou apparentés, qui pourraient
être porteurs d’une anomalie hérédi-
taire, sont informés des conséquences
de cette anomalie, des risques de déve-
lopper la maladie en cause, de la trans-
mettre, ainsi que de la façon dont elle
pourrait être prévenue, évitée ou atté-
nuée (1).
La consultation de conseil génétique
comprend, dans un premier temps, la
reconstitution de l’arbre généalogique,
le recueil d’une anamnèse précise,
l’examen clinique du patient et la
prescription éventuelle d’une étude
moléculaire, si les différents éléments
préalables orientent le diagnostic vers
une affection dont le gène est connu
(étude directe) ou localisé (étude indi-
recte par haplotypage nécessitant la
collaboration et le prélèvement
d’autres membres de la famille).
La réalisation d’un conseil génétique
fiable sous-entend néanmoins qu’un
diagnostic précis de l’affection neuro-
musculaire ait pu être posé, et la
démarche diagnostique, essentielle,
fait bien entendu appel à une collabo-
ration multidisciplinaire.
Dans un second temps, le conseil
génétique devra apporter au sujet
malade une information précise sur les
conséquences phénotypiques de l’af-
fection héréditaire dont il est porteur
et sur les risques de la transmettre à sa
descendance (2). Si cette affection
peut concerner certains apparentés, le
rôle du généticien sera de solliciter
son patient afin qu’il transmette cette
information à ses apparentés. Il est
ainsi pleinement justifié que des por-
teuses potentielles de dystrophinopa-
thies puissent bénéficier, par le biais
du conseil génétique, d’une étude de
leur statut génotypique, et ce conseil
génétique leur sera proposé précoce-
ment, avant toute grossesse. De
manière analogue, le conseil génétique
permettra de proposer à un couple
apparenté à un sujet atteint d’une
amyotrophie spinale infantile, un test
d’hétérozygotie afin de préciser son
risque de transmettre la maladie. Il
s’avère, en effet, que la réalisation de
ces différents examens, en amont de
toute grossesse, permet de proposer
ultérieurement un choix judicieux
d’examen adapté (diagnostic sérique
de sexe fœtal réalisé précocement chez
une conductrice de dystrophinopa-
thie*,diagnostic prénatal, orientation
éventuelle vers le diagnostic préim-
plantatoire**, etc.) (3, 4).
La place du conseil génétique est tout
aussi justifiée dans le cadre des affec-
tions autosomiques dominantes à
début plus ou moins tardif et à expres-
sion variable, bien qu’elle puisse être
bien plus délicate. Il peut sembler, en
effet, licite d’informer une personne
sur les risques qu’elle a de développer
une affection neuromusculaire, compte
tenu de son étude familiale et, par
conséquent, de lui communiquer la
probabilité de transmettre cette même
affection à ses enfants nés ou à naître.
Il est cependant plus discutable, d’un
point de vue éthique, de proposer la
réalisation secondaire d’un test géné-
A. Moerman
es affections neuromuscu-
laires constituent un
groupe de pathologies
héréditaires très hétérogène,
dont la classification est aujour-
d’hui orientée par les données
cliniques, histologiques, mais
également génétiques qui les
caractérisent. Le conseil géné-
tique ne se limite pas à confirmer
l’origine génétique d’une affec-
tion, ni à évaluer son risque
potentiel de transmission. Il pose
également la question du deve-
nir du sujet chez qui cette carac-
téristique de l’ADN a pu être
mise en évidence et incite à évo-
quer la place d’une éventuelle
recherche de cette caractéris-
tique chez ses apparentés
(ascendants, collatéraux, descen-
dants).
L
Le conseil génétique dans les
affections neuromusculaires :
quand, comment et pourquoi ?
A. Moerman*, S. Manouvrier**
* Alexandre Moerman travaille dans le
service de génétique clinique du
Pr Manouvrier au CHRU de Lille, où il
est responsable des UAM “affections
neuromusculaires” et “infertilité
masculine”. Il est en outre, depuis 1999,
membre du Club de conseil génétique
de langue française et du Groupe
de génétique médicale du 3ejeudi.
** Service de génétique clinique, hôpital
Jeanne-de-Flandres, CHRU de Lille.
*Le diagnostic sérique de sexe fœtal est réalisé par le biais d’un prélèvement sérique
maternel vers les 10e-12esemaines d’aménorrhée, et sur lequel sont recherchées des
séquences spécifiques du chromosome Y, par définition absentes du génome maternel.
** Le diagnostic génétique préimplantatoire (DPI) permet de procéder au transfert
sélectif d’embryons dépourvus d’une anomalie génétique donnée.

73
Actualité
Actualité
tique à visée prédictive chez une
personne à risque de développer une
affection neuromusculaire, alors
qu’aucun signe ne s’est encore mani-
festé. Ce cas de figure ne fait que
renforcer la place du conseil géné-
tique, car il implique non seulement
de donner une information précise à
des personnes jusqu’alors non
inquiètes pour elles-mêmes et pour
leur descendance, mais également de
leur proposer la réalisation d’un test
génétique a priori anodin mais qui
peut conditionner leur vie ultérieure.
Ces tests, appelés “présymptoma-
tiques”, ne sont pas sans poser cer-
taines questions éthiques et justifient
une prise en charge psychologique qui
aura pour but d’évaluer l’impact néga-
tif que peut générer un tel examen.
L’ importance d’évaluer l’intérêt de ces
tests au regard de la prise en charge
qui pourra être proposée, d’informer
la personne sur l’hétérogénéité cli-
nique de cette affection pour une
même mutation, même intrafamiliale,
et de prévoir l’impact psychologique
que peut générer le résultat défavo-
rable d’un test génétique, telles sont
les questions essentielles que tente
d’encadrer le conseil génétique.
Références
1. Harper PS. Practical genetic counsel-
ling (5eed.). Butterworth-Heinemann, 1998.
2. Emery AE. Muscular dystrophy into the
new millennium. Neuromuscul Disord
2002 ; 12 (4) : 343-9.
3. Viville S, Ray P, Wittemer C et al.
Diagnostic génétique préimplantatoire.
Législation et aspects éthiques.
Médecine/Sciences 1996 ; 12 : 1394-7.
4. Costa JM, Benachi A, Gautier E. New
strategy for prenatal diagnosis of X-linked
disorders. N Engl J Med 2002 ; 346 (19) :
1502.
Act. Méd. Int. - Neurologie (4) n° 3, avril 2003
Merci d’écrire nom et adresse en lettres majuscules
❏Collectivité ...............................................................................
à l’attention de ............................................................................
❏Particulier ou étudiant
M., Mme, Mlle ..............................................................................
Prénom ........................................................................................
Pratique : ❏hospitalière ❏libérale ❏autre ........................
Adresse e-mail .............................................................................
Adresse postale ...........................................................................
....................................................................................................
Code postal ........................Ville ……………………………………
Pays..............................................................................................
Tél. ...............................................................................................
Merci de joindre votre dernière étiquette-adresse en cas de réabonnement,
changement d’adresse ou demande de renseignements.
ÉTRANGER (AUTRE QU’EUROPE)
FRANCE/DOM-TOM/EUROPE ❐110
€collectivités
❐92
€particuliers
❐65
ێtudiants*
*joindre la photocopie de la carte
❐90
€collectivités
❐72
€particuliers
❐45
ێtudiants*
*joindre la photocopie de la carte
Actu Neuro - Vol. 4 - No3
OUI, JE M’ABONNE AU MENSUEL Les Actualités en Neurologie
Total à régler .......... €
À remplir par le souscripteur
À remplir par le souscripteur
À découper ou à photocopier
✂
❐
ABONNEMENT : 1 an
+
ETPOUR 10 €DE PLUS !
10
€
, accès illimité aux 26 revues de notre groupe de presse disponibles
sur notre site vivactis-media.com (adresse e-mail gratuite)
+
R
RELIURE
ELIURE
❐10
€
avec un abonnement ou un réabonnement
MODE DE PAIEMENT
❐
carte Visa, Eurocard Mastercard
N°
Signature : Date d’expiration
❐
chèque
(à établir à l’ordre de Les Actualités en Neurologie)
❐
virement bancaire à réception de facture
(réservé aux collectivités)
Aljac - 62-64, rue Jean-Jaurès - 92800 Puteaux
Tél. : 01 41 45 80 00 - Fax : 01 41 45 80 25
E-mail : [email protected]
1
/
2
100%