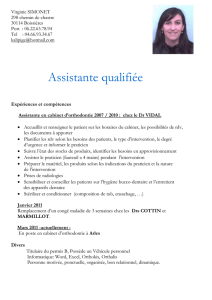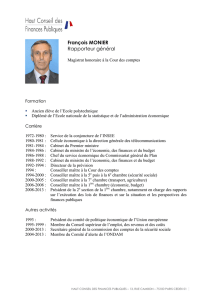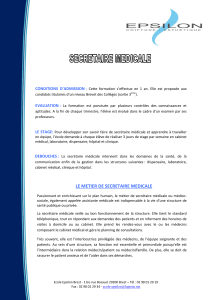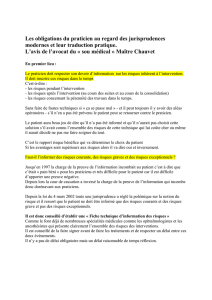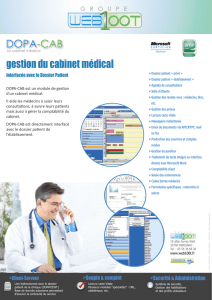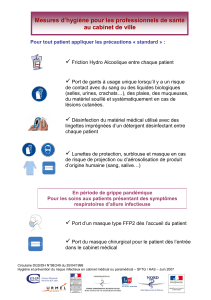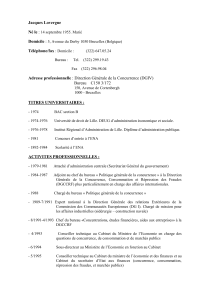R ’

73
Correspondances en médecine - n° 2 - octobre 2000
R
ESPONSABILITÉ SUITE
À UNE HOSPITALISATION D
’
OFFICE
Une personne fait l’objet d’un arrêté d’hospita-
lisation d’office signé par le préfet le 4 sep-
tembre 1989. Le premier renouvellement est
opéré dans des conditions régulières mais le
préfet omet de régulariser la situation le
5octobre 1989 et, en l’absence de décision pré-
fectorale de sortie, le directeur d’établissement
maintient l’hospitalisation.
Saisi ultérieurement, le tribunal administratif
annule l’arrêté préfectoral initial d’hospitalisa-
tion d’office du 4 septembre 1989, pour des
motifs qui ne seront plus ultérieurement
contestés.
En outre, la personne hospitalisée sans consen-
tement a également demandé l’annulation de la
“décision” du directeur d’établissement qui
l’avait maintenue hospitalisée malgré le non-
renouvellement de la mesure préfectorale. Ce
recours est rejeté parce qu’il a été dirigé contre
le directeur de l’établissement.
Conseil d’État – 5 juin 1996 – RDSS 1997, p. 38
Le requérant a vécu un grand moment d’illéga-
lité : l’arrêté préfectoral initial qui avait pro-
noncé l’hospitalisation d’office est annulé pour
des motifs qui n’ont pas été repris par le Conseil
d’État car ils n’étaient plus contestés. On peut
donc penser à une insuffisance nette de
motivation.
Par ailleurs, l’arrêté préfectoral n’a pas été
renouvelé au terme d’un mois, de telle sorte
que l’illégalité était acquise. Or, faute d’avoir
reçu levée explicite de l’hospitalisation par le
préfet, le directeur avait provisoirement refusé
de faire droit à cette personne hospitalisée qui
demandait sa sortie.
Malgré ce cumul d’illégalités, le recours engagé
est rejeté. La réponse du Conseil d’État tient en
quelques mots : l’hospitalisation d’office est
une décision qui relève de la compétence exclu-
sive du préfet, et le directeur d’établissement
est alors un simple exécutant. À l’inverse, l’hos-
pitalisation sur demande entière est une déci-
sion du directeur d’établissement et engage la
responsabilité de l’établissement. Cette per-
sonne, qui a été hospitalisée en toute illégalité
depuis l’origine jusqu’à sa sortie effective,
garde encore une possibilité d’indemnisation,
mais qui doit être dirigée contre l’État, le préfet
étant représentant de l’État. Ces décisions
concernent des faits antérieurs à l’application
de la loi du 27 juin 1990, mais la solution reste
inchangée.
R
EFUS DE SOIN ET AGGRAVATION
DES DOMMAGES
Le conducteur d’un camion est grièvement
blessé à l’occasion d’un accident de la circula-
tion. Il subit un préjudice corporel important et
obtient la condamnation de l’assurance à lui
verser une indemnisation sous forme d’un capi-
tal. La compagnie d’assurance proteste,
demandant que soit allouée une rente et non
un capital afin qu’il puisse être tenu compte
d’une possible évolution favorable qui pourrait
résulter d’une nouvelle intervention chirurgi-
cale. La victime s’oppose à la compagnie d’as-
surance, n’entendant pas subir cette interven-
tion qui consisterait en la pose d’une prothèse.
Pour la Cour de cassation, la compagnie d’as-
surance ne peut tirer d’argument de ce refus de
soin. Elle cite les termes de l’article 16-3 du
Code civil qui rappelle solennellement la néces-
sité du consentement avant tout acte médical.
Cour de cassation – 2echambre civile –
19 mars 1999 – Bull. civ. n° 86 p. 48
Libre d’accepter les soins, le patient est libre
de les refuser dès lors qu’il est conscient et en
mesure d’apprécier les conséquences de son
choix. C’est ce qu’énonce explicitement l’article
Actualités
de jurisprudence
!
!
G. Devers*
Chronique du droit
* Avocat au barreau de Lyon.

16-3 du Code civil. Le droit ne méconnaissait
pas auparavant la règle, mais la déduisait de
l’analyse du principe de libre disposition du
corps humain. On retrouve la règle avec l’ar-
ticle 36 du Code de déontologie médicale :
“Lorsque le malade, en état d’exprimer sa
volonté, refuse les investigations ou le traite-
ment proposés, le médecin doit respecter ce
refus après avoir informé le malade de ses
conséquences”.
Ainsi, le droit reconnaît la validité du refus de
soin. Notamment, il a toujours été jugé que le
médecin doit s’incliner devant un refus de soin,
hors le cas d’urgence ou de nécessité vitale. En
revanche, la décision du patient de refuser les
soins peut être jugée fautive à l’égard des tiers,
et notamment de l’assureur qui doit indemniser
le dommage.
La limite était traditionnellement fixée au
regard du caractère bénin des soins et appré-
ciée par une absence de risque réel ou de souf-
france. En visant l’article 16-3, la Cour de cassa-
tion fixe une règle plus stricte. Toute
intervention chirurgicale peut être refusée
parce qu’elle comporte un aléa lié à l’anesthé-
sie. Dès lors, la compagnie d’assurance ne peut
soutenir que ce refus est fautif à son égard.
E
XISTENCE D
’
UN CABINET SECONDAIRE
Un médecin spécialiste en ophtalmologie ins-
tallé à Toulouse pratique des interventions chi-
rurgicales sur des patients atteints de la cata-
racte dans une polyclinique située à Castres. Le
Conseil départemental de l’ordre estime que,
compte tenu de leur caractère habituel et régu-
lier, les opérations auxquelles se livre le prati-
cien caractérisent l’existence d’un cabinet
secondaire. Le praticien conteste, en relevant
que les patients lui sont adressés par des
confrères qui ont établi eux-mêmes le diagnos-
tic et qu’ils n’assurent pas le contrôle postopé-
ratoire.
Pour l’instance ordinale, confirmée par le
Conseil d’État, le fait qu’il s’agisse d’une inter-
vention ponctuelle ne suffit pas à retirer la qua-
lification de cabinet secondaire. En outre, la
juridiction relève que, compte tenu de la dis-
tance de soixante kilomètres, le praticien
n’était pas en mesure d’organiser un suivi cor-
rect des patients. Enfin, il est souligné que plu-
sieurs médecins spécialistes de la même disci-
pline exercent leur activité dans la ville de
Castres.
Dès lors, bien que les techniques utilisées par
le praticien présentent un caractère novateur,
l’existence du cabinet secondaire qu’il exploite
à Castres n’est pas justifiée par les besoins des
malades.
Conseil d’État – 18 février 1999
Jurisdata 050277
Le Code de déontologie défend l’unicité du
cabinet dans les conditions suivantes : “Un
médecin ne doit avoir en principe qu’un seul
cabinet. La création ou le maintien d’un cabinet
secondaire, sous quelque forme que ce soit,
n’est possible qu’avec l’autorisation du Conseil
départemental. Cette autorisation ne peut être
refusée par le Conseil départemental ou les
Conseils départementaux intéressés si l’éloi-
gnement d’un médecin de même discipline est
préjudiciable aux malades”.
L’instance ordinale retient une interprétation
extensive de cet article. Elle ne se satisfait pas
d’apparences formelles, mais cherche à vérifier
si les données d’exercice pratique correspon-
dent bien à la réalité d’un exercice en cabinet
secondaire.
Ainsi le cabinet secondaire est d’abord une
notion de fait qualifié par la juridiction.
S’appliquent ensuite les critères de validité du
cabinet secondaire, c’est-à-dire la nécessité de
répondre à un besoin de santé, la capacité d’as-
surer un suivi correct et l’absence de praticiens
de même spécialité.
Cet arrêt du Conseil d’État témoigne d’une
grande fermeté. L’acte médical ne peut se
réduire à un geste technique, mais intègre la
continuité des soins, et l’on sait que la respon-
sabilité du chirurgien inclut le postopératoire. Il
n’est pas interdit à ce praticien de pouvoir exer-
cer occasionnellement sa technique à la
demande de confrères, mais l’organisation, qui
semble accorder la prime à l’acte technique sur
le caractère relationnel, conduit l’Ordre à refu-
ser l’autorisation.
En l’état, il s’agit d’une décision administrative
d’interdiction d’ouvrir un cabinet secondaire. Si
le praticien passe outre, en usant de subter-
fuges formels, l’affaire peut alors être appréciée
sur le plan disciplinaire, pour le refus d’appli-
quer une décision administrative.
74
Correspondances en médecine - n° 2 - octobre 2000
Chronique du droit
1
/
2
100%