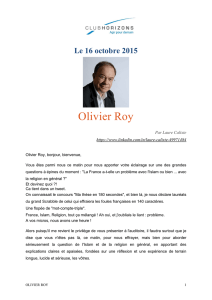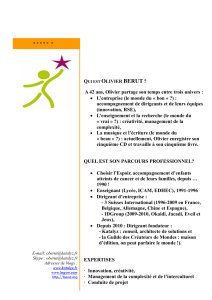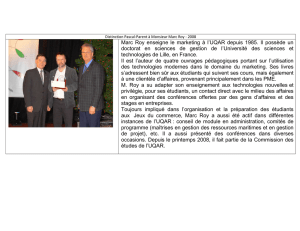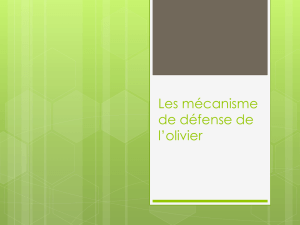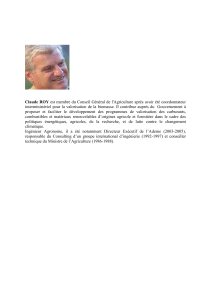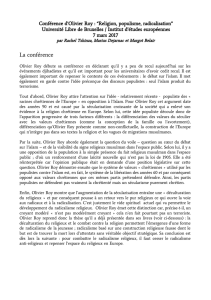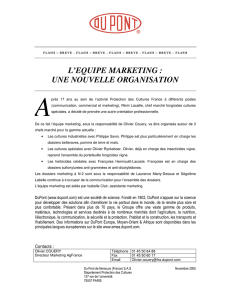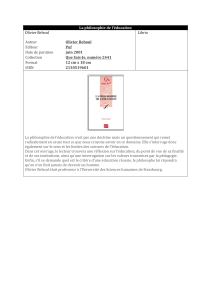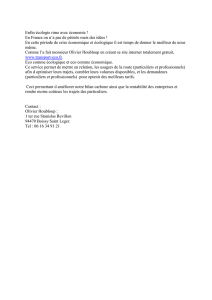PORTRAIT

Article paru dans le quotidien La Croix, mi-janvier 2010
PORTRAIT Ancien abbé de Maredsous, devenu expert en organisation
sociale, Olivier Du Roy, 76 ans, revient en publiant un ouvrage sur la règle d'or
Olivier Du Roy, une quête d'universel
Il vient de publier un ouvrage sur la règle d'or, cette éthique universelle de réciprocité qui prescrit:
«Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas que l'on te fasse.» Est-ce cette morale très
empathique qui donne à Olivier Du Roy, 76 ans, un regard aussi serein sur sa propre vie? Une vie
pleine, qui a propulsé cet ancien abbé bénédictin de Maredsous (Belgique), figure du catholicisme
post-conciliaire, dans le monde de l'industrie, avant qu'il ne renoue avec la philosophie, la retraite
venue.
Il y a deux ans, à 74 ans, Olivier Du Roy avait soutenu une thèse sur la règle d'or, commencée en
1973 alors qu'il venait juste de quitter la vie religieuse. Il en partage aujourd'hui les fruits dans un
livre intitulé La Règle d'or; le retour d'une maxime oubliée.
L'écoulement des années n'a pas entamé sa fascination pour ce principe philosophique. «Je me suis
intéressé à la règle d'or, parce que j'ai toujours été rétif à une conception de la morale centrée sur
le devoir ou sur les grandes vertus», explique-t-il, reprochant à ces deux approches de rester «très
narcissiques». «Pour moi, la vraie morale a toujours été centrée sur autrui et la règle d'or est une
expression extraordinaire d'une morale basée sur l'amour et le respect de l'autre.»
Avant cette retraite active et philosophique, Olivier Du Roy a eu plusieurs vies. La première,
abritée par les hauts murs de l'abbaye de Maredsous où il est entré en 1951, à 18 ans. Il y a fait ses
premières armes philosophiques et théologiques, «formé d'entrée de jeu à Sartre, Merleau-Ponty,
Blondel», avant de soutenir une thèse de doctorat sur saint Augustin à Strasbourg . Mais
l'intellectuel est aussi un homme d'action. En plein bouillonnement post-conciliaire et soixante-
huitard, il est choisi comme prieur en 1968, puis élu abbé en 1969. Il a prévenu ses frères qu'il
conduirait le changement. «Je voulais remettre en cause le mode de vie très ritualisé de la vie
monastique. Il ne me semblait plus correspondre à l'époque», résume-t-i1. Durant trois ans, les
transformations vont aller bon train: l'habit monastique est abandonné, les moines sont autorisés à
reprendre leur nom de baptême, une réflexion sur le travail est engagée... «Je pensais qu'il était
important de s'écarter du modèle d'une abbaye de "moines patrons", embauchant des laïcs pour
salariés, comme des fils de famille.» Il propose aux religieux «d'avoir chacun un gagne-pain» et
de mettre en commun leurs revenus. Dans cette communauté qui rassemble plus d'une centaine de
moines, il met en place de petits groupes pour favoriser la participation de chacun aux prises de
décision. «J'ai introduit une figure moins paternelle de l'abbé. Je me suis fait appeler Olivier et
non plus "révérendissime père".»
Plus périlleux, la réflexion s'engage bientôt vers un nouveau modèle de communauté chrétienne
associant moines et laïcs, célibataires ou mariés... «Je voyais beaucoup d'hommes quitter la
communauté suite à une psychanalyse, après une maturation affective ou personnelle, se souvient
Olivier Du Roy. C'était pourtant ceux avec lesquels je sentais qu'il était possible de créer une
communauté adulte.»
En 1972, alors que l'abbaye fête son centenaire, l'effervescence est à son comble. Son ouvrage
Moines aujourd'hui, où il expose les ambitions de sa réforme, suscite la controverse par l'ampleur
des changements qu'il propose. «J'avais moi-même évolué sur le sens que peuvent avoir
aujourd'hui les vœux monastiques», partage-t-il pudiquement. Depuis Rome, on lui demande
d'abandonner sa charge, puis de quitter la vie monastique et sa communauté. «La réforme que
nous avons menée a pu remettre en question pas mal de choses, qui ont d'ailleurs été conservées
par mon successeur. Mais remettre en question le célibat a été la limite indépassable», relit-il avec
la distance.

La quarantaine venue, le voilà de l'autre côté de la clôture. Il essaie d'abord de valoriser le début de
sa thèse sur la règle d'or, mais, faute de financement pour sa recherche, il doit se réorienter. «Sans
formation professionnelle, sans métier, j'ai dû tout réinventer.» Fin 1973, il se marie, puis trouve
un emploi dans un organisme de formation permanente d'ingénieurs et de cadres. Il se forme au
management, à l'économie et à la gestion. «Je me suis fait une nouvelle culture, une culture
d'entreprise», résume-t-il. Dans ces années, la sociologie des organisations est en train d'exploser.
«C'était l'époque où on remettait en cause le travail à la chaîne. On voulait inventer une nouvelle
organisation, prenant en compte les salariés.» Entreprenant, Olivier Du Roy crée bientôt un
cabinet de conseil en organisation. Il travaille avec d'importants groupes industriels comme BSN-
Gervais Danone, Pechiney ou Arcelor. «C'était une époque où les grands managers comme
Antoine Riboud ou Jean Gandois avaient une véritable vision de l'entreprise, se souvient-il. Avec
l'idée que son projet économique ne pouvait réussir que si celle-ci tenait compte de l'homme et du
développement de son capital humain.» Entre ses deux vies très contrastées, Olivier Du Roy voit
une continuité, son intérêt pour «la conduite du changement». «J'ai commencé à mener des projets
de changement dans un univers, la vie religieuse, où c'est le plus difficile parce qu'il est fait de
convictions, de passions et d'idéologies. J'ai beaucoup appris de ce point de vue à Maredsous.»
Mais oublie-t-on jamais ses premières amours? Après une parenthèse de plus de trois décennies,
Olivier Du Roy a renoué avec la philosophie. Posément, sans excitation, ni amertume, il a exhumé
ses dossiers sur la règle d'or. Il s'est remis à fureter dans les bibliothèques, traquant dans un travail
«un peu policier» ses occurrences dans la littérature mondiale. Aujourd'hui, il voudrait défendre
l'héritage de cette tradition morale, que Kant considéra avec mépris et que Bernard Shaw ridiculisa
dans sa célèbre boutade: «Ne fais pas aux autres ce que tu voudrais qu'ils te fassent. Leurs goûts
peuvent différer des tiens.» «Évidemment, c'est drôle, sourit-il, mais c'est un malentendu
complet...»
S'il a retrouvé le chemin de la philosophie, Olivier Du Roy n'a pas franchement repris celui de
l'Église. Il a bien gardé de «solides convictions» et des liens d'amitié avec d'anciens confrères,
mais confesse ne pas être très pratiquant. Il faut l'interroger pour qu'il émette un jugement sur ces
années de «crise catholique», selon l'expression de l'historien Denis Pelletier. «Ce fut une
hémorragie incroyable», confie-t-il en pensant aux départs de religieux et d'intellectuels
catholiques de sa génération. Actuellement, la situation lui paraît «bloquée»: «L'Église n'arrive
pas à affronter la modernité et un monde séculier; à envisager une nouvelle place pour les femmes
ou la possibilité de prêtres mariés, alors que le clergé est exsangue, analyse-t-il. Elle se maintient
dans un univers sacral qui ne parle plus à nos contemporains, ou qui suscite une aspiration
religieuse à l'égard de laquelle la foi chrétienne devrait être assez exigeante et critique.»
À l'entendre, il n'en faudrait pas beaucoup pour. qu'il reprenne goût au débat ecclésial. «Pendant
tout un long temps, je n'ai plus trop pensé à tout cela, reconnaît-il. Maintenant, j'y reviens un peu,
avec l'idée d'écrire peut-être quelque chose sur cette période, avec d'autres...»
ÉLODIE MAUROT
REPÈRES Une morale «inventive et exigeante»
• La Règle d'or, le retour d'une maxime oubliée est un «ouvrage philosophique», insiste Olivier Du Roy. Tout en
soulignant le rôle majeur de la règle d'or dans la pensée chrétienne, il veut en effet démontrer son universalité. L'auteur
met en évidence deux formulations, l'une centrée sur l'empathie, l'autre sur la justice. La première prescrit: «Ne fais pas
aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse.» La seconde recommande: «Ce que tu réprouves chez autrui, ne le
fais pas toi-même.»
• «Morale sans contenu prescriptif, sans interdit a priori, sans listes closes d'interdits ou de préceptes, elle est une
morale inventive et exigeante, fondée sur l'autonomie du sujet, mais décentrée de soi, car prenant comme seule source
d'obligation l'autre lui-même, comme un sujet aussi important que moi», écrit l'auteur.
• L'ouvrage a été publié l'été dernier au Cerf [174 p., 18 €]
1
/
2
100%