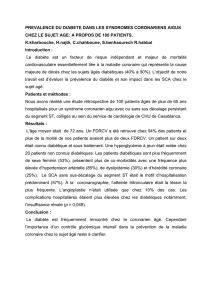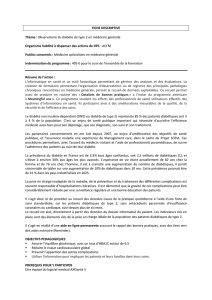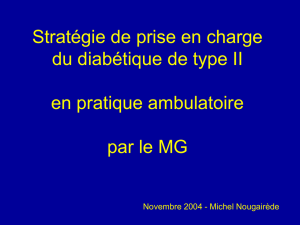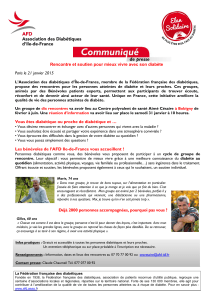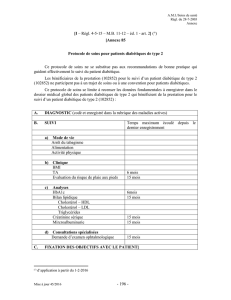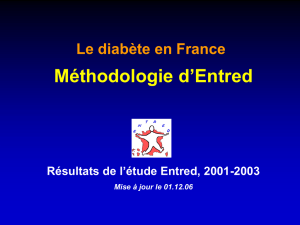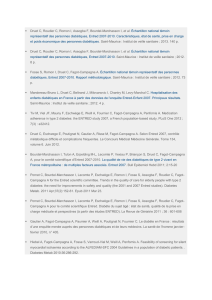Lire l'article complet

Correspondances en Métabolismes Hormones Diabètes et Nutrition - Vol. XIII - n° 3 - mai-juin 2009
99
Échos des congrès
Épidémiologie : les résultats
de l’étude ENTRED 2007-2010
Un symposium était consacré aux premiers résultats de
l’étude ENTRED (Échantillon national témoin représen-
tatif des personnes diabétiques) 2007-2010. Rappelons
que cette enquête épidémiologique, coordonnée
par l’Institut de veille sanitaire (INVS), fait suite à une
première étude réalisée en 2001 sur un même plan
méthodologique : questionnaires soumis à un large
échantillon de sujets diabétiques et à leurs soignants,
suivi de la consommation médicale et des hospitalisa-
tions. Les objectifs étaient non seulement de décrire
les caractéristiques et l’état de santé des personnes
diabétiques de types 1 et 2, mais également d’évaluer
la démarche éducative et le coût des soins dans le cadre
des nouvelles modalités de prise en charge de l’affec-
tion de longue durée “diabète”. Un échantillon aléatoire
d’environ 10 000 sujets a été constitué, incluant des
adultes et enfants diabétiques de type 1 ou 2 identifiés
par trois remboursements d’hypoglycémiants oraux et/
ou insuline au cours de la dernière année.
Trois sous-analyses distinctes ont été menées : ENTRED-
Enfants et Adolescents, ENTRED-DOM pour les sujets
vivant dans les départements d’outre-mer, et ENTRED-
Métropole, dont les résultats ont été présentés à
Strasbourg. La population diabétique est estimée à
2,4 millions de personnes en métropole, et 8 126 adultes
ont participé à cette sous-étude. L’âge médian est de
66 ans et, sans surprise, le diabète de type 2 est la forme
la plus fréquente (92 % des sujets), le diabète de type 1
n’étant prépondérant qu’avant l’âge de 45 ans (54 % des
sujets). Près de 25 % des sujets diabétiques de type 2 ont
plus de 75 ans. Fait notable, 20 % des sujets diabétiques
sont nés à l’étranger. De plus, par comparaison à la popu-
lation française générale, le niveau socio-économique
des diabétiques s’avère nettement plus précaire.
De 2001 à 2007, la prise en charge des facteurs de risque
cardio-vasculaire s’est améliorée chez les diabétiques de
type 2. Ainsi, en dépit d’une plus grande fréquence de
l’obésité, l’équilibre glycémique (HbA1C médiane à 6,9 %),
les chiffres de pression artérielle (médiane à 130/80 mmHg)
et le profil lipidique (LDL cholestérol médian à 1,04 g/l) se
sont améliorés durant cette période. Cette tendance cor-
respond à une intensification des différentes interventions
thérapeutiques, avec en particulier une augmentation
très nette de la prescription de statines. Concernant les
hypoglycémiants oraux, les choix thérapeutiques se sont
modifiés et la metformine devient ainsi le traitement le
plus prescrit en monothérapie (60 % des cas), en accord
avec les recommandations actuelles. Notons cependant
que 41 % des sujets diabétiques de type 2 présentent un
taux d’HbA1C supérieur à l’objectif de 7 %, ce qui devrait
imposer un renforcement thérapeutique.
Concernant la qualité du suivi médical, la réalisation des
actes nécessaires au dépistage et au suivi des compli-
cations du diabète a progressé, mais de façon encore
insuffisante. Ainsi, au cours de la dernière année, seuls
36 % des sujets ont bénéficié d’un dosage de micro-
albuminurie (+ 3 % par rapport à 2001) et 50 % des
sujets d’une consultation d’ophtalmologie (+ 2 %). De
plus, seul un sujet sur deux a bénéficié d’au moins trois
dosages annuels d’HbA1C (+ 11 %). Le suivi de ces dia-
bétiques de type 2 est essentiellement assuré par les
médecins généralistes, sans recours aux spécialistes
diabétologues dans 87 % des cas.
En dépit des nombreux biais méthodologiques inhé-
rents à ce type d’enquête, ENTRED 2007 indique que
© copyright
Alfediam 2009 – Quand l’Alfediam
devient Société francophone du diabète
Pierre Gourdy*
* Service de diabétologie,
maladies métaboliques
et nutrition, pôle cardio-
vasculaire et métabolique,
CHU Rangueil, Toulouse.
Précédant de quelques jours le sommet de l’OTAN, le congrès annuel de l’Alfe-
diam s’est tenu du 17 au 20 mars 2009 à Strasbourg. La convivialité de la capitale
alsacienne, l’organisation parfaitement orchestrée par le Pr Michel Pinget et la
qualité du programme scientifique ont fait de ce rendez-vous un véritable succès.
Des dernières données épidémiologiques aux nouveaux concepts physiopatho-
logiques, nous revenons ici sur certains temps forts de cette manifestation.

Correspondances en Métabolismes Hormones Diabètes et Nutrition - Vol. XIII - n° 3 - mai-juin 2009
100
Échos des congrès
la qualité de la prise en charge des sujets diabétiques
de type 2 évolue de façon favorable en France, mais
que de nombreux efforts restent à mettre en place, en
particulier pour favoriser les interactions entre médecins
généralistes et spécialistes. Pour plus de précisions,
l’ensemble des données communiquées à Strasbourg
est disponible en ligne sur le site de l’institut de veille
sanitaire (www.invs.santé.fr).
Innovations thérapeutiques : le point sur
les greffes d’îlots et les voies alternatives
d’administration de l’insuline
Les représentants du réseau GRAGIL ont rapporté
les données de suivi de 39 patients ayant bénéficié
d’une greffe d’îlots de Langerhans entre juillet 2002 et
décembre 2006 dans un contexte de transplantation
rénale (n = 17) ou de diabète de type 1 instable (greffe
isolée, n = 22). Le protocole d’immunosuppression était
standardisé, associant tacrolimus et sirolimus après
traitement d’induction par daclizumab. En dépit d’une
insulino-indépendance transitoire, la greffe d’îlots a
permis un contrôle métabolique optimal et prolongé,
avec disparition des hypoglycémies : à 2 ans, la reprise
d’une insulinothérapie à faible dose s’est avérée néces-
saire dans la majorité des cas, permettant le maintien
d’une HbA1C inférieure à 7 %. De façon intéressante,
54 % des patients greffés à Genève étaient insulino-
indépendants à 1 an, contre 30 % des sujets greffés
en France. Permettant d’expliquer cette disparité, le
nombre d’îlots greffés dans les centres français était
inférieur à celui de l’équipe suisse, et la durée de trans-
port des îlots était trois fois supérieure pour atteindre
les centres français.
La recherche de voies alternatives pour l’administration
d’insuline se poursuit, et la perspective d’une adminis-
tration par voie orale semble se préciser. Afin de per-
mettre à l’hormone de franchir les barrières chimiques
et physiques gastro-intestinales, un principe de double
encapsulation des molécules d’insuline est en effet en
cours de développement. La première encapsulation,
qui permet de franchir la barrière intestinale, donne
naissance à des nanoparticules qui sont elles-mêmes
encapsulées dans un véhicule d’alginate gastrorésistant
leur permettant d’échapper à la dégradation par les
enzymes gastriques. Des résultats incitant à la poursuite
du développement de ce concept technologique ont
été obtenus chez le rongeur, avec une biodisponibilité
de 20 % et un effet hypoglycémiant encourageant dans
des conditions d’administration chronique (15 jours)
chez le rat diabétique.
Nouveaux concepts : la flore intestinale
au centre des préoccupations !
Parmi les nouvelles pistes physiopathologiques per-
mettant d’expliquer la survenue d’une obésité et d’un
diabète de type 2, F. Baeckhed (Stockholm), P. Cani
(Bruxelles) et R. Burcelin (Toulouse) ont illustré, à la
lumière de leurs derniers travaux, le rôle crucial de la
flore intestinale. Les résultats récemment obtenus dans
les modèles de souris axéniques ont en effet révélé
l’influence majeure du microbiote intestinal sur le méta-
bolisme glucidique. De plus, chez le rongeur, l’adminis-
tration d’une alimentation hyperlipidique entraîne des
modifications importantes de la flore microbienne, avec
pour conséquences une majoration de la perméabilité
intestinale et l’installation de troubles du métabolisme
glucidolipidique. De façon tout à fait originale, des don-
nées cliniques préliminaires semblent indiquer que des
sujets présentant un profil d’insulinosensibilité ou d’in-
sulinorésistance (défini lors d’un clamp hyperinsulinémi-
que) sont caractérisés par des profils très spécifiques en
termes de microflore bactérienne au niveau du cæcum,
suggérant une véritable signature métagénomique
associée au statut d’insulinorésistance. Enfin, chez la
souris, la composition de la flore intestinale influence
directement la production locale de proglucagon, affec-
tant ainsi les taux de GLP1 et GLP2. Or, le GLP2 exerce un
effet trophique sur la muqueuse intestinale, favorisant
ainsi le maintien de sa fonction de barrière intestinale.
Cet effet trophique pourrait expliquer l’effet favorable
de certains prébiotiques sur le plan métabolique. En
effet, l’administration d’un antagoniste spécifique du
récepteur du GLP2 annule les effets bénéfiques de ces
molécules en termes de perméabilité intestinale. À
l’inverse, l’administration d’un agoniste du récepteur
du GLP2 à des souris Ob/Ob permet de réduire de façon
significative la perméabilité intestinale et les taux plas-
matiques de LPS (lipopolysaccharides).
L’Alfediam change de nom
Une fois n’est pas coutume, une des informations
majeures du congrès 2009 n’est pas d’ordre scientifi-
que. En effet, le conseil d’administration a profité de
cet événement pour proposer de modifier le nom de
notre société afin d’optimiser sa visibilité thématique,
en particulier par les instances politiques et adminis-
tratives. L’assemblée générale ayant donné son accord,
l’Alfediam est donc rebaptisée en “Société francophone
du diabète” et nous donne rendez-vous pour son pro-
chain congrès à Lille en 2010.
■
- 092008 - LifeScan SAS, division de Ortho-Clinical Diagnostics France - 1 Rue Camille Desmoulins TSA 40007 92787 Issy-les-Moulineaux Cedex 09 - RCS de Nanterre B330202334.
NOUVEAU,particulièrement adapté aux patients diabétiques de type 2
OneTouch® Vita™, lecteur de glycémie sans
codage, permet de réaliser une Auto-
Surveillance Glycémique en toute simplicité.
OneTouch® Vita™ vous aide également
àexpliquer le lien entre glycémie
et alimentation.
OneTouch® Vita™, pour améliorer simplement
le suivi glycémique.
Un univers de simplicité
Simple,Fiable,Spécifique
24h/24 7j/7
0 800 00 00 00
Hcp/Pharma_210x297 30/07/08 11:30 Page 1
1
/
2
100%