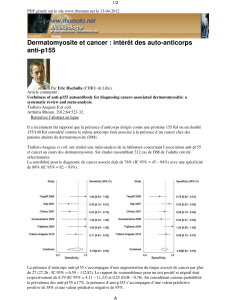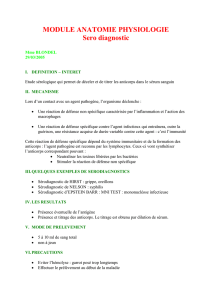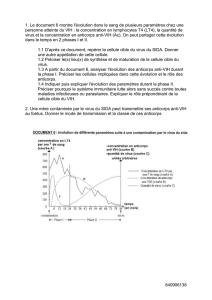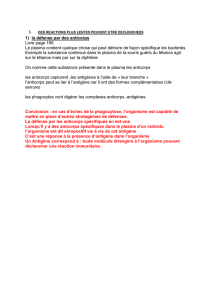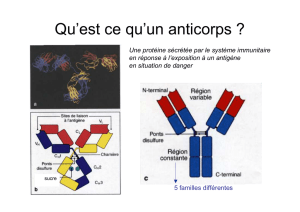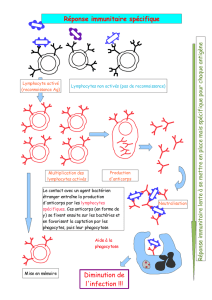L Les syndromes neurologiques paranéoplasiques MISE AU POINT

96 | La Lettre du Neurologue • Vol. XVIII - no 3 - mars 2014
MISE AU POINT
Les syndromes neurologiques
paranéoplasiques
Focus on paraneoplastic neurological syndromes
B. Joubert*, F. Ducray*, J. Honnorat*, **
* Université Claude-Bernard Lyon-1.
** Service de neuro-oncologie,
centre de référence des maladies
rares “syndromes neurologiques
paranéoplasiques”, hospices civils
de Lyon, hôpital neurologique,
Bron ; et Inserm U1028/CNRS UMR
5292, Neuro science Research Cen-
ter, Lyon.
L
es syndromes neurologiques paranéoplasiques
(SNP) sont des syndromes neurologiques rares
associés à un cancer et, par dénition, ne s’expli-
quant pas par une cause métastatique, carentielle,
métabolique, infectieuse ou iatrogène. En général,
ils intéressent uniquement le système nerveux dont
ils peuvent impliquer n’importe quelle région (1).
Physiopathologie
Les SNP sont la conséquence d’une réaction auto-
immune spécique dirigée contre le système nerveux
central (SNC). On estime qu’il s’agit d’une réaction
croisée due à l’expression ectopique, par la tumeur,
de protéines normalement exprimées par le système
nerveux (2). La présence d’auto-anticorps circulants
(sérum et liquide céphalorachidien [LCR]), spéci-
quement associés aux SNP, est une des caractéris-
tiques de ces syndromes (tableau I). Néanmoins,
aucun auto-anticorps n’est retrouvé chez presque
20 % des patients présentant d’authentiques SNP. On
distingue 2 types de SNP selon la cible des anticorps
qui leur sont associés et qui peuvent être dirigés
contre des cibles intracellulaires (onco neuronaux)
ou membranaires.
SNP associés aux anticorps
onconeuronaux
Les anticorps onconeuronaux (AON) sont dirigés
contre des protéines intracellulaires (Hu, Yo, CV2, Ri,
Ma, Tr/DNER, amphiphysine, Sox1). Ils n’ont proba-
blement pas d’effet pathogène direct, car ni leur
transfert passif ni l’immunisation active chez des
souris ne permettent de reproduire les symptômes
ou les lésions histologiques. De plus, les thérapies
visant l’immunité humorale (plasmaphérèses,
immunoglobulines intraveineuses [IgIV]) sont peu
efcaces (2).
L’autopsie de patients a révélé une destruction
neuronale associée à un infiltrat du paren-
chyme cérébral constitué principalement de
lymphocytes T oligoclonaux, et observé aussi au
sein de la tumeur sous-jacente (3). Il a par ailleurs
été mis en évidence des lymphocytes T CD8+ circu-
lants autoréactifs, spécifiques des antigènes Hu
ou Yo (4, 5). Une réaction immunitaire cellulaire
dirigée contre la tumeur, possiblement efficace
(meilleur pronostic carcinologique de ces patients
et caractère souvent limité du processus tumoral),
pourrait ainsi être à l’origine de la production
de lymphocytes T cytotoxiques reconnaissant
l’antigène onconeural exprimé à la fois par les
cellules tumorales et par une population de
neurones. Certains de ces lymphocytes pourraient
donc acquérir la capacité de détruire les neurones
exprimant cet antigène. Les mécanismes à l’origine
de ce glissement d’une réponse adaptée contre
un cancer vers une activité auto-immune ne sont
pas connus, bien qu’une implication du phénotype
HLA ait été suggérée (6).
SNP associés aux anticorps
membranaires
Les anticorps membranaires sont dirigés contre
des protéines exprimées à la surface membra-
naire des neurones. Leur pathogénicité directe est
suggérée par la réversibilité des symptômes après
l’utilisation de traitements agissant sur l’immunité
humorale (plasmaphérèses, IgIV, anti-CD20), et

La Lettre du Neurologue • Vol. XVIII - no 3 - mars 2014 | 97
Points forts
»
Le diagnostic de SNP ne doit être porté qu’après exclusion des diagnostics différentiels que sont les
causes métastatiques, infectieuses, carentielles, métaboliques et iatrogènes.
»
Les SNP les plus fréquemment retrouvés sont la dégénérescence cérébelleuse paranéoplasique, laneuro-
nopathie sensitive subaiguë et l’encéphalite auto-immune.
»
Le traitement précoce de la tumeur conditionne le pronostic. La recherche de la tumeur sous-jacente
est guidée par la nature de l’auto-anticorps retrouvé.
»
Les encéphalites à anticorps anti-NMDAR touchent préférentiellement les femmes jeunes, et correspondent
à un tableau particulier associant signes psychiatriques, dyskinésies, hypoventilation et dysautonomie.
»
Les anticorps anti-VGKC sont en fait dirigés contre des protéines membranaires associées au VGKC (Lgi1,
Caspr2) et peuvent entraîner une encéphalite auto-immune, une neuromyotonie ou un syndrome de Morvan.
Mots-clés
Syndromes
neurologiques
paranéoplasiques
Encéphalite
auto-immune
Dégénérescence
cérébelleuse
paranéoplasique
Anticorps
onconeuronaux
Anticorps
anti-NMDAR
Highlights
»
The diagnosis of paraneo-
plastic neurological syndrome
(PNS) has to be made only after
cautious exclusion of alterna-
tive diagnosis, such as meta-
static, infectious, metabolic or
iatrogenous causes.
»
The most frequently encoun-
tered PNS are paraneoplastic
cerebellar degeneration,
subacute sensory neurono-
pathy, and auto-immune
encephalitis.
»
Early treatment of the under-
lying malignancy is mandatory.
Patients’ antibodies guide the
search for the causative cancer.
»
Auto-immune encepha-
litides can affect both limbic
and extra-limbic structures,
depending on the antibody
involved.
»
Anti-NMDAR encephalitis
affect mostly young women
with an ovarian teratoma, and
constitute a specific phenotype
with pseudopsychiatric symp-
toms, dysautonomia, hypoven-
tilation, and dyskinesias.
»
Anti-VGKC antibodies do not
target the potassium channel
itself, but rather associated
proteins, namely Caspr2 or
Lgi1, and can cause auto-
immune encephalitis, neuro-
myotonia or Morvan’ syndrome.
Keywords
Paraneoplastic neurological
syndromes
Auto-immune encephalitis
Paraneoplastic cerebellar
degeneration
Onconeural antibodies
Anti-NMDAR antibodies
par la corrélation entre les taux d’anticorps dans le
LCR et l’activité de la maladie. L’étude histologique
du tissu cérébral de ces patients montre peu ou
pas de mort neuronale, et l’atteinte inflamma-
toire est dominée par un infiltrat périvasculaire
de lymphocytes B (7). L’incubation des anticorps
des patients (anti-NMDAR, anti-VGKC [8], anti-
mGluR1 [9], etc.) sur des neurones en culture
modifie l’excitabilité de ceux-ci, ce qui suggère que
les auto-anticorps peuvent bloquer, à eux seuls, le
fonctionnement neuronal. Enfin, les symptômes
peuvent parfois être reproduits chez l’animal par
l’injection intrathécale d’anticorps de patients (9).
Le mécanisme précis à l’origine de ce dysfonc-
tionnement varie probablement d’un anticorps à
l’autre. Les anticorps anti-NMDAR ont été les plus
étudiés. La fixation de l’anticorps sur le récepteur
NMDA provoque son internalisation et diminue
sa capacité à se localiser au niveau de la synapse.
Cette situation aboutit à un déséquilibre entre les
récepteurs AMPA et NMDA et, par rétrocontrôle,
à un état hyperglutamatergique diffus à l’origine
des symptômes (10).
Caractéristiques cliniques
Les présentations cliniques sont très variées. L’ins-
tallation est le plus souvent subaiguë. Dans 65 %
des cas, l’atteinte neurologique précède la décou-
verte du cancer de plusieurs mois ou années (1).
Huit SNP sont considérés comme “classiques”
Tableau I. Principaux auto-anticorps impliqués dans les SNP.
Anticorps Syndromes neurologiques
les plus fréquents
Fréquence d’association
à une tumeur (%)
Tumeurs
les plus fréquentes
Hu (ANNA-1) EMN, NSS, ND, EAI, DCP 80-85 CPPC
Ri (ANNA-2) Rhombencéphalite, myélite, OM, DCP 86 CPPC, carcinome mammaire
Anti-Ma1 et Ma2
(PNMA)
EAI, rhombencéphalite, atteinte
diencéphalique, syndrome parkinsonien
90 Tumeur germinale testiculaire
CPPC
Yo (PCA-1) DCP (90 %) 91 Tumeurs utérines, ovariennes,
mammaires
PCA-2 DCP, EL, atteinte du tronc cérébral 89 CPPC
Tr (PCA-Tr) DCP 100 % 90 Lymphome de Hodgkin (100 %)
CV2/CRMP5 DCP, EAI, rétinite/uvéite, SMLE, chorée,
neuropathie mixte sensorimotrice
86,5 CPPC, thymome, sarcome utérin
Sox/anti-AGNA SMLE, DCP 100 CPPC
ZIC DCP 92 CPPC
Amphiphysine SPR, EMN, DCP, SMLE 80 CPPC, sein
GAD65 SPR, DCP, EAI, épilepsie auto-immune 6,5 Thymome, CPPC
Anti-recoverine
Anti-enolase
Rétinopathie
Rétinopathie
100
50
CPPC, cancer du sein,
mélanomes, cancers
gynécologiques, hémopathies
Complexe VGKC
(Lgi1, Caspr2)
EAI, neuromyotonie,
syndrome de Morvan
6-30 Thymome, CPPC
NMDAR EAI 59 Tératome de l’ovaire
AMPAR EAI 65 Thymome, sein, poumon
GABAbR EAI 47 CPPC
VGCC SMLE, DCP 50-60 CPPC
CPPC : cancer pulmonaire à petites cellules ; DCP : dégénérescence cérébelleuse paranéoplasique ; EAI : encéphalite auto-immune ; EL : encéphalite
limbique ; EMN : encéphalomyélonévrite ; ND : neuropathie dysautonomique ; NMT : neuromyotonie ; NSS : neuronopathie sensitive subaiguë ; OM :
opsoclonus myoclonus ; SMLE : syndrome myasthénique de Lambert-Eaton ; SPR : syndrome de la personne raide.

98 | La Lettre du Neurologue • Vol. XVIII - no 3 - mars 2014
Les syndromes neurologiques paranéoplasiques
MISE AU POINT
(tableau II) [11]. Les dégénérescences cérébelleuses,
les neurono pathies sensitives et les encéphalites
auto-immunes sont les plus fréquentes, regroupant
près de 60 % des patients (1). Parmi ces syndromes,
les encéphalites dysimmunes atteignent préféren-
tiellement le système limbique mais entraînent aussi
fréquemment des signes d’atteinte des structures
extralimbiques (dysautonomie, hyponatrémie,
mouvements anormaux [10], signes d’atteinte du
tronc cérébral [12]) selon la nature de l’anticorps
retrouvé. Le terme d’encéphalite auto-immune doit
donc être préféré à l’appellation trop restrictive
d’encéphalite limbique. D’autres syndromes, plus
rares, peuvent être rencontrés (tableau III). Chez
10 % des patients, 2 ou plusieurs syndromes neuro-
logiques sont associés (1).
Tableau II. SNP classiques : caractéristiques cliniques.
Syndrome Description clinique Anticorps associés
lesplus fréquents
Fréquence
du cancer (%)
Cancer le plus
fréquemment associé
Dégénérescence cérébelleuse
subaiguë (PCD)
Syndrome cérébelleux statique
etcinétique aux 4 membres,
le plus souvent subaigu
Yo
Hu
CV2
Tr
Ri
VGCC
Sox-1, ZIC4
90
80
86
89
80
Majorité des patients
100
Ovaire, sein
CPPC
CPPC, thymome
Lymphome de Hodgkin
CPPC, sein
CPPC
CPPC
Neuronopathie sensitive subaiguë
(NSS)
Atteinte sensitive des 4 membres
prédominant sur les grosses fibres,
asymétrique, distale, douloureuse et
ataxiante
Atteinte infraclinique motrice possible
Hu 30 CPPC
Encéphalite auto-immune Atteinte des structures limbiques :
amnésie antérograde, épilepsie temporale
interne, troubles psychiatriques
ou du comportement
Autres symptômes selon l’étiologie
Hu, CV2, amphiphysine
Ma2
NMDA
Lgi1
85
90
47
11-30
CPPC
Testicule, poumon
Tératome de l’ovaire
Thymome
Encéphalomyélonévrite (EM) Atteinte simultanée de plusieurs systèmes
(structures limbiques, cervelet, tronc
cérébral, ganglion rachidien postérieur)
sans prédominance d’une atteinte
sur les autres
Hu, CV2, amphiphysine
Ma2
85
90
CPPC
Testicule, poumon
Syndrome myasthénique
deLambert-Eaton (SMLE)
Déficit moteur proximal débutant
auxmembres inférieurs
Aréflexie avec potentiation à l’effort
Fatigabilité
Dysautonomie : sécheresse buccale,
dysfonction érectile
ENMG : décrément à basse fréquence,
incrément à haute fréquence
VGCC 50-60 CPPC
Opsoclonus myoclonus (OM) Oscillopsie, myoclonies segmentaires
±syndrome cérébelleux
Enfants Hu 50 Neuroblastome
Adultes Ri 20 Poumon, sein
Rétinopathie auto-immune Atteinte subaiguë des cônes
et des bâtonnets entraînant héméralopie,
dyschromatopsie, baisse d’acuité
visuelle
Début unilatéral
α-enolase (30 %)
Transducine α (17 %)
CA II (14 %)
Recoverine (10 %)
CV2
Hsp 60
50
NC
NC
100
NC
NC
CPPC, sein, mélanomes, cancers
gynécologiques, hémopathies
Dermatopolymyosite (DPM) Myopathie proximale douloureuse
subaiguë
Érythro-œdème héliotrope
Papules de Gottron
TIF1-γ5-10 Poumon, ovaire, cancers
digestifs, maladie de Hodgkin
Neuropathie dysautonomique Hypotension, troubles du rythme
cardiaque
Syndrome pseudo-occlusif
Très souvent associé à une autre atteinte,
marqueur de mauvais pronostic
Hu NC CPPC
CPPC : cancer pulmonaire à petites cellules ; ENMG : électroneuromyogramme ; NC : non connu.

La Lettre du Neurologue • Vol. XVIII - no 3 - mars 2014 | 99
MISE AU POINT
SNP associés aux AON (Hu, Yo, CV2, Ri,
Ma, Tr/DNER, amphiphysine, Sox1)
Ils s’associent à un cancer dans 98 % des cas (1).
Du fait de la destruction neuronale causée par la
réaction immune cellulaire, la récupération fonction-
nelle est en général médiocre. Les traitements
immunosuppresseurs sont souvent peu efcaces.
Généralement, seul le traitement de la tumeur, en
supprimant la stimulation antigénique, permet de
stabiliser l’évolution.
SNP associés aux anticorps
membranaires
Ils sont moins fréquemment associés à un cancer.
Le type de tumeur et la fréquence des formes
paranéoplasiques varient selon l’auto-anticorps
incriminé (tableau I). Parmi ces auto-anticorps, les
anticorps anti-NMDAR, dirigés contre le récepteur
iono tropique au glutamate de type NMDA, sont
associés à un phénotype particulier d’encéphalite
auto-immune survenant principalement chez la
femme jeune, souvent en présence d’un tératome
ovarien, ou chez les enfants (10). Les anticorps
anti-VGKC, initialement considérés comme dirigés
contre le canal potassique voltage-dépendant
(Voltage Gate Potassium Channel [VGKC]), ciblent
en réalité des protéines associées à ce canal ionique
(Caspr2 ou Lgi1) [13] et qui étaient co précipités par
la méthode de détection précédemment utilisée
pour mettre en évidence les anti-VGKC. D’autres
anticorps membranaires (anti-VGCC, anti-AMPAR,
anti-GABAbR, anti-GlyR, anti-mGluR1, anti-mGluR5,
anti-DPP10) sont moins fréquemment retrouvés. Du
fait de leur pathogénicité propre et de leur action
réversible, les syndromes associés à ces auto-
anticorps répondent le plus souvent favorablement
aux traitements visant l’immunité humorale (IgIV,
plasmaphérèses, anti-CD20).
Démarche diagnostique
Aucun syndrome neurologique n’est spécifique
de l’étiologie paranéoplasique. Les cancers le plus
souvent retrouvés sont les cancers pulmonaires,
ovariens et mammaires. Les SNP sont rares, mais
doivent être de principe évoqués en cas d’atteinte
Tableau III. Syndromes paranéoplasiques moins fréquents.
Syndrome Description
clinique
Anticorps associés
les plus fréquents
Fréquence
du cancer (%)
Cancer le plus
fréquemment associé
Rhombencéphalite Paralysie oculomotrice,
paralysie faciale,
syndrome cérébelleux,
atteinte respiratoire
IRM : hypersignaux
du tronc cérébral du
cervelet
Hu
Ma2
Ri
77
90
82
CPPC
Testicule, poumon
Sein
Neuropathie
axonomyélinique
sensitivomotrice
Prédominance aux
membres inférieurs
Association avec une
encéphalite limbique
ou une atteinte visuelle
possible
CV2 NC CPPC
Neuromyotonie Crampes diffuses,
raideur, fasciculations
Myokymies
Douleurs neurogènes
Dysautonomie
Caspr2 37,5 Thymome
Syndrome de Morvan Neuromyotonie
associée à des signes
d’encéphalopathie
(agrypnie,
hallucinations) et une
dysautonomie majeure
Caspr2 40 Thymome
Syndrome de la
personne raide
Raideur diffuse,
spasmes musculaires
douloureux, anxiété
GAD65 5 (anticorps anti-
amphiphysine)
CPPC, sein
CPPC : cancer pulmonaire à petites cellules ; NC : non connu.

1. Évoquer systématiquement un SNP devant tout syndrome
neurologique subaigu avec un LCR inflammatoire
2. Recherche des diagnostics différentiels
3. Recherche d’auto-anticorps
dans le sang et le LCR
4. Recherche
du cancer orientée
par le type
d’auto-anticorps
Causes métaboliques, carentielles et infectieuses :
ionogramme, bilan hépatique, dosages vitaminiques, CRP
Causes tumorales (éliminer méningite carcinomateuse) :
– IRM médullaire T1 avec gadolinium
– examen cytopathologique du LCR
Cause iatrogène : protocole de radiothérapie, chimiothérapies
Hu, Yo, CV2, Ma, Ri, Tr, amphiphysine, Sox1
Autres selon le tableau clinique :
recherche de marquage anti-neurophile
anti-NMDAR, -Lgi1, Caspr2 –AMPAR, -GABAb, -GAD65, -VGCC
TDM TAP
PET FDG
Échographie pelvienne, mammographie
IRM pelvienne : anti-NMDAR, anti-Yo
Échographie testiculaire : anti-Ma
BOM : anti-Tr
Marqueurs tumoraux orientés : NSE, ACE, SCC
En cas de bilan oncologique initial négatif
Anticorps onconeural
Bilan à répéter tous les 6 mois pendant 4 ans
Cas particuliers :
– anti-Yo : laparotomie exploratrice ± annexo-hystérectomie
– anti-Ma2 : orchidectomie bilatérale
Anticorps membranaire
Pas de nouvelle exploration nécessaire
Sauf anti-NMDAR : IRM + échographie pelvienne
tous les ans pendant 2 ans
CRP : protéine C réactive ; LCR : liquide céphalorachidien ; TDM TAP : tomodensitométrie thoraco-abdomino-pelvienne ;
PET FDG : tomographie par émission de positrons au fluorodésoxyglucose marqué ; IRM : imagerie par résonance magnétique ;
BOM : biopsie ostéomédullaire ; AON : anticorps onconeural.
Figure 1. Démarche diagnostique devant une suspicion de SNP.
100 | La Lettre du Neurologue • Vol. XVIII - no 3 - mars 2014
Les syndromes neurologiques paranéoplasiques
MISE AU POINT
neurologique subaiguë ou atypique chez un patient
ayant des facteurs de risque de cancer (âge, tabac).
Néanmoins, un SNP ne pourra être affirmé que
sur un faisceau d’arguments, après avoir écarté les
diagnostics différentiels. Quatre situations peuvent
être rencontrées.
Syndrome neurologique associé
à un cancer connu
Le cancer précède la survenue du SNP dans
seulement un tiers des cas. Un SNP ne peut, dans
ce cas, être afrmé que s’il est retrouvé un auto-
anticorps spécique ou s’il s’agit d’un syndrome
classique survenant dans les 5 ans après la décou-
verte du cancer (11). Il s’agit toujours d’un diagnostic
d’élimination, qui nécessite d’avoir écarté les
étiologies métaboliques, carentielles, infectieuses,
métastatiques ou iatrogènes. Il faut savoir évoquer
une méningite carcinomateuse dont la présentation
peut être trompeuse et la mise en évidence des
cellules tumorales toujours difcile.
Syndrome neurologique associé à un AON
La présence d’un AON permet d’afrmer l’origine
paranéoplasique du syndrome neurologique. Un
cancer n’est pourtant pas toujours retrouvé, soit parce
que la lésion est microscopique, soit parce qu’elle a
spontanément régressé sous la pression du système
immunitaire. Ces lésions sont souvent de petite taille,
parfois limitées à une adénopathie. Un bilan exhaustif
doit être réalisé à la recherche du cancer sous-jacent
en fonction de l’anticorps incriminé (tableau I). Les
marqueurs tumoraux peuvent être intéressants en
cas d’image douteuse. La démarche diagnostique
est résumée dans la figure 1. Si aucune tumeur n’est
identiée au terme de ce bilan, il est recommandé de
le répéter tous les 6 mois pendant 4 ans.
Syndrome neurologique associé
à un anticorps membranaire
Les anticorps membranaires sont nettement moins
souvent associés à la présence d’une lésion tumorale.
Le bilan doit s’attacher à rechercher une tumeur en
fonction de l’anticorps retrouvé (tableau III), mais
ne nécessite pas d’être répété plus d’une fois si un
premier bilan bien conduit est négatif.
Syndrome neurologique évocateur
sans anticorps retrouvé
En l’absence d’anticorps identié, une tumeur doit être
néanmoins recherchée si le tableau neuro logique est
évocateur, moins de 20 % des SNP ne s’accompagnant
pas d’auto-anticorps. Le bilan peut être orienté par
le type de syndrome (tableaux II et III).
Prise en charge thérapeutique
(figure 2)
Cas des AON
Le pronostic des SNP liés à un AON est entièrement
corrélé à la rapidité avec laquelle le patient est mis
en rémission tumorale. Les traitements immuno-
suppresseurs ont peu d’intérêt à part pour quelques
anticorps (anti-Ri, anti-Tr, anti-Ma). Néanmoins, il
n’y a pas eu d’essai clinique de qualité réalisé dans
cette situation. L’objectif de l’essai clinique IASON
− actuellement mené par le centre de référence des
SNP −, est d’évaluer dans cette situation l’intérêt
d’un traitement précoce par IgIV chez des patients
ayant une atteinte neurologique encore limitée.
 6
6
1
/
6
100%