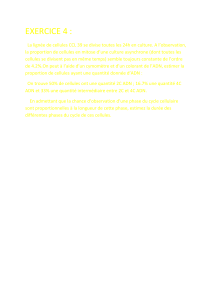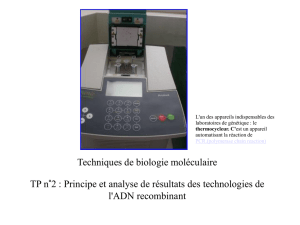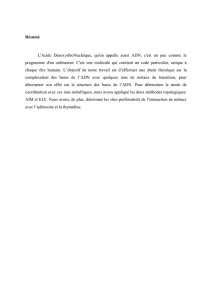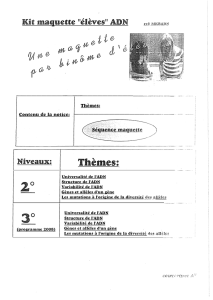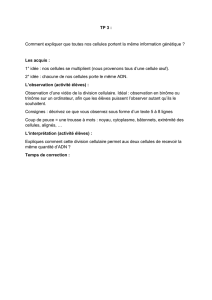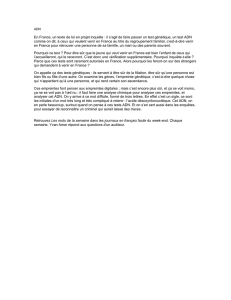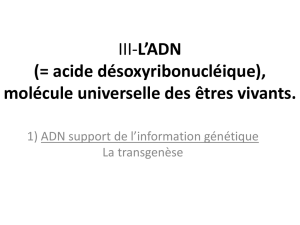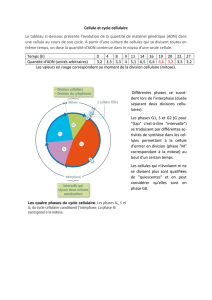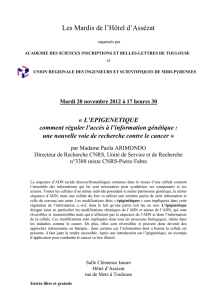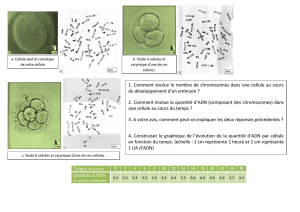» Cellules tumorales et ADN libre circulant

Correspondances en Onco-Théranostic - Vol. II - n° 4 - octobre-novembre-décembre 2013
174
Cellules tumorales
et ADN libre circulant
dossier thématique
RÉSUMÉ
Summary
»
La progression tumorale est associée à une augmentation de la
concentration en ADN circulant dans le cancer bronchique non
à petites cellules comme dans la plupart des cancers. L’utilisation
de ces résultats pour la mise en place d’un dépistage ou d’un test
pronostique reste encore largement discutée. En revanche, ces
dernières années, les altérations moléculaires tumorales ont pu être
détectées dans l’ADN circulant, positionnant ce matériel comme
“biopsie liquide”. L’ADN circulant devient ainsi une source alternative
de matériel tumoral lorsque le prélèvement fait défaut et rend
également envisageable le suivi des changements moléculaires au
cours du traitement. Les aspects technologiques et les applications
à la routine sont discutés ici en prenant comme exemple les
mutations de l’EGFR.
Mots-clés : Cancer du poumon – ADN circulant – EGFR – Suivi.
Changes in the levels of circulating nucleic acids have been
associated with malignant progression in non-small-cell
lung cancer (NSCLC) as in many others cancers. But the
potential use of circulating nucleic acids quantifi cation for
NSCLC screening and prognosis is still debated. During the
past decade, tumor molecular alterations have been detected
in cell-free DNA of patients and therefore their use as a “liquid
biopsy” has been proposed. Cell-free DNA could be used as
a substitute for non-contributive tumor biopsies, and allow
tracking molecular changes during treatment. Technological
issues and routine applications are discussed based on EGFR
alterations as an example.
Keywords: Lung cancer – Circulating DNA – EGFR – Follow-up.
Une biopsie liquide
Soixante-dix pour cent des cancers bronchiques non à
petites cellules (CBNPC) sont diagnostiqués alors qu’ils
sont déjà à un stade avancé et inopérable. Ces stades
avancés sont de mauvais pronostic, et le développe-
ment d’outils de dépistage précoce et de suivi amélio-
rerait considérablement la prise en charge des patients.
Les ADN circulants ont été découverts en 1948 (1), et
les mécanismes cellulaires impliqués sont maintenant
assez bien connus (2). Une partie de ces ADN provient
de la tumeur, et les altérations moléculaires du tissu
d’origine peuvent être détectées en faible proportion
dans l’ADN circulant. Actuellement, dans le cadre de
la thérapie ciblée par inhibiteurs de l’activité tyrosine
kinase (ITK) de l’EGFR, les mutations du récepteur sont
recherchées dans l’ADN extrait de tissus fi xés au formol
et inclus en paraffi ne (fi gure 1). Ces ADN sont souvent
dégradés, les blocs sont parfois épuisés et/ou pauvres
en cellules cancéreuses, et, chez certains patients, il
n’est pas possible d’eff ectuer un prélèvement tissulaire.
À l’inverse, il est facile de réaliser des prélèvements
sanguins. Ces “biopsies liquides” peuvent servir à la fois
pour dénombrer et caractériser les cellules tumorales
circulantes qu’elles peuvent contenir (cf. notamment
articles de E. Pailler et al., p. 162, et de P. Hofman, p. 168)
et pour quantifi er et analyser les ADN présents dans la
phase acellulaire de ces échantillons (fi gure 1). On peut
alors imaginer utiliser ces biopsies pour la recherche
des altérations tumorales avant traitement mais éga-
lement pour le suivi des patients, selon des conditions
techniques qui restent à affi ner.
La quantifi cation freinée par la technique
Concentration augmentée au diagnostic
Depuis quelques années, l’ADN circulant est au cœur
d’études quantitatives évaluant le potentiel diagnos-
tique et pronostique de leur dosage. Dans le plasma
Apports potentiels de l’ADN circulant
pour la prise en charge des cancers
bronchiques non à petites cellules
Cell-free circulating DNA and the management
of non-small-cell lung cancer
Audrey Vallée*, Marc Denis*
* Laboratoire
de biochimie,
CHU de Nantes.

Correspondances en Onco-Théranostic - Vol. II - n° 4 - octobre-novembre-décembre 2013
175
Apports potentiels de l’ADN circulant pour la prise en charge
des cancers bronchiques non à petites cellules
de patients de stade I à IV, les concentrations établies
par PCR en temps réel varient, pour 1 ml de plasma,
de quelques nanogrammes à une centaine de nano-
grammes dans les populations contrôles et d’une
dizaine à plusieurs centaines de nanogrammes chez
les patients atteints d’un cancer du poumon (3, 4).
Si les valeurs diff èrent, les conclusions se rejoignent
sur la diff érence entre les populations : les patients
présentent de 2 à 4 fois plus d’ADN circulant que les
contrôles sains. Si la concentration est parfois corrélée
au sexe (3), aucune association n’a été retrouvée avec
l’âge, le statut tabagique ou le type histologique. Le
stade de la maladie, la taille de la tumeur, sa localisation
ou le nombre de sites métastatiques sont des critères
encore discutés, par manque de cohortes de taille suf-
fi sante pour conclure sur ces diff érents paramètres (5).
Les diff érences de concentration seraient signifi catives
jusqu’à 1 an avant le diagnostic du cancer par scanner
thoracique, comme ont pu l’observer Sozzi et al. sur un
suivi de 1 035 fumeurs pendant 5 ans (6).
Valeur pronostique de la concentration
avant traitement
Avant traitement, les fortes concentrations en ADN
circulants sont presque toujours associées à une survie
globale diminuée chez les patients traités par chimio-
thérapie (4, 7) ou géfi tinib (5). En revanche, peu de
résultats ont été publiés sur la valeur prédictive. Dans
une étude concernant des patients traités par chimio-
thérapie, les auteurs n’observent aucune diff érence
signifi cative de la concentration en ADN circulants
avant traitement entre les patients répondeurs et les
non-répondeurs. Cependant, les dosages en cours de
thérapie montrent une concentration signifi cativement
plus élevée chez les patients en progression que chez
les patients en rémission partielle ou stables (4). De
manière générale, ces résultats sont obtenus dans le
cadre d’études qui n’étaient pas destinées à évaluer la
valeur prédictive des ADN circulants ou sur des petites
cohortes. Un projet dédié répondrait plus clairement
à la question.
Variations signifi catives en cours de traitement
Quelques équipes ont poursuivi les tests après une
chirurgie ou après le début du traitement et observent
que, chez les patients en progression, les concentrations
en ADN circulants resteraient élevées ou augmente-
raient, alors que les patients en rémission ou au moins
stabilisés verraient leurs concentrations plasmiques se
stabiliser, voire diminuer. C’est ce que montre l’étude
de Sozzi et al. (6). Au cours du suivi de 38 patients, ils
observent, chez les 35 patients qui ne rechutent pas,
une concentration moyenne en ADN circulants plasma-
tiques nettement inférieure à la concentration moyenne
mesurée au moment de la chirurgie, et qui devient
comparable aux concentrations du groupe contrôle.
Cette diminution aurait lieu essentiellement dans les
6 mois suivant la chirurgie. À l’inverse, ils observent, chez
3 patients, une augmentation de 2 à 20 fois la concen-
tration en ADN plasmiques initiale sur une période
allant de 7 à 23 mois après la chirurgie. Deux de ces
patients ont développé des métastases hépatiques et
sont décédés 2 mois plus tard, et le troisième a rechuté
localement 2 ans après (6).
Un frein méthodologique
La fi gure 2, p. 176, présente schématiquement les diff é-
rents types de profi ls qui peuvent être obtenus par ces
études quantitatives. Si, actuellement, les concentrations
en ADN circulants ne sont pas utilisées comme outil
diagnostique ou pronostique, c’est par manque d’une
standardisation des méthodes d’extraction et de dosage
qui permettrait d’établir les seuils nécessaires (seuils 1
Figure 1. Les ADN circulants, alternative aux prélèvements tissulaires ?
Les altérations moléculaires de la tumeur sont généralement recherchées dans des prélèvements
tissulaires. Ceux-ci peuvent être “épuisés”, pauvres en cellules cancéreuses, voire diffi ciles à obtenir.
De l’ADN provenant de la destruction des cellules normales circule librement dans le sang chez
toute personne. Chez les patients ayant un cancer, on retrouve, en plus, de l’ADN provenant de
la tumeur. Avec des techniques sensibles, il est possible de mettre en évidence ces altérations
moléculaires présentes dans les ADN circulants.
Prélèvement tissulaire
Biopsie liquide
ADN fragmenté
ADN circulant
Altération moléculaire
Cellules
tumorales circulantes

Correspondances en Onco-Théranostic - Vol. II - n° 4 - octobre-novembre-décembre 2013
176
dossier thématique
Cellules tumorales
et ADN libre circulant
et 2 ; fi gure 2). Récemment, El Messaoudi et al. (8) ont
proposé les premières “bonnes pratiques” préanalytiques
spécifi ques aux ADN circulants. Ils recommandent de
travailler avec du plasma collecté dans des tubes EDTA,
de centrifuger le tube de sang au plus tard 6 h après
le prélèvement, de conserver le plasma entre − 20 et
− 80 °C, de conserver les ADN circulants extraits à − 20 °C
et d’éviter les cycles de décongélation-recongélation
répétés (8). Le respect de ces recommandations devrait
permettre aux prochaines études d’aider à conclure sur
l’intérêt de ces approches quantitatives (8).
Approches qualitatives : recherche
d’altérations moléculaires
Les concentrations en ADN circulants refl ètent des
processus pathologiques mais également physio-
logiques (2). L’identifi cation de marqueurs spécifi ques
au cancer est donc une garantie de suivre exclusivement
l’ADN tumoral. Deux choix sont possibles : rechercher
soit des marqueurs du cancer bronchique, soit des
marqueurs personnalisés, comme le marqueur thé-
ranostique EGFR.
Marqueurs diagnostiques et pronostiques
L’hyperméthylation des promoteurs de gènes suppres-
seurs de tumeurs est un mécanisme classique de la
tumorigenèse. La méthylation de marqueurs comme
RASSF1A et RARB2 a ainsi été analysée par traitement
de l’ADN circulant par du bisulfi te de sodium suivi de
pyroséquençage (9). L’hyperméthylation de ces mar-
queurs est eff ectivement détectable dans le plasma
des patients, et leurs indices de méthylation sont 2 à
3 fois plus élevés chez les patients atteints d’un can-
cer du poumon que dans les populations contrôles.
Les auteurs proposent un test diagnostique sensible
à 87 % et spécifi que à 75 %. De façon intéressante, ils
observent également une diminution de l’indice de
méthylation après une résection chirurgicale ou après
le début d’une chimiothérapie, sauf dans le cas des
patients qui rechutent quelques mois plus tard, chez
lesquels l’indice aurait tendance à augmenter.
Au-delà d’une sensibilité souvent imparfaite, proba-
blement liée aux conditions préanalytiques, l’absence
d’implications cliniques fortes fait que la plupart des
marqueurs testés ne trouvent pas non plus leur place
dans les examens de routine actuels. En revanche, la
détection de marqueurs prédictifs de la réponse aux
traitements (marqueurs théranostiques) aurait un réel
intérêt clinique.
Choix thérapeutique : recherche de marqueurs
théranostiques
Les mutations du gène EGFR sont recherchées en rou-
tine pour la prescription des ITK de l’EGFR sur ADN
extrait de tissus fi xés au formol et inclus en paraffi ne.
Mais, pour environ 10 % des patients (rapport d’activité
des plateformes de génétique moléculaire des cancers,
INCa, 2011), l’analyse n’aboutit pas, soit à cause d’une
qualité insuffi sante de l’ADN extrait, soit parce que le
bloc est épuisé ou que le prélèvement n’est pas suffi -
samment riche en cellules cancéreuses. L’analyse des
ADN circulants pourrait donc se substituer aux tests
sur tissus lorsque ceux-ci ne sont pas fructueux. Pour
compenser les faibles quantités de matériel extrait sur
plasma et la faible représentation des copies mutées
dans les ADN circulants, un travail technique important
a été réalisé pour garantir les meilleures sensibilités de
détection des altérations moléculaires. Une sélection
des techniques les plus sensibles et des résultats les
plus prometteurs est présentée dans le tableau.
Lors d’une analyse comparative récente de sérums et
de plasmas collectés avant traitement chez des patients
dont la tumeur portait une altération d’EGFR, nous avons
observé une meilleure sensibilité avec le plasma (10).
Ceci explique probablement pourquoi, malgré des tech-
Figure 2. Valeurs diagnostique et pronostique des concentrations en ADN circulants.
Représentation schématique des diff érents types de profi ls théoriques qui peuvent être obtenus
par quantifi cation des ADN circulants. La ligne pleine correspond aux concentrations en ADN
circulants chez un patient de mauvais pronostic, et la ligne discontinue aux concentrations chez
un patient de bon pronostic. Le seuil 1 délimite le passage d’une concentration normale à une
concentration pathologique en ADN circulants, et le seuil 2 distingue les patients de bon et de
mauvais pronostic. La zone encadrée par les 2 lignes pointillées verticales identifi e une période
théorique pour la mise en place d’un diagnostic précoce par quantifi cation. La zone en aval
propose un suivi de la réponse au traitement par quantifi cation.
Diagnostic/
traitement
Diagnostic
précoce ?
Progression
Seuil
Seuil
Concentration en ADN circulant
2
1
Rémission/
stabilisation
Temps
Suivi ?

Correspondances en Onco-Théranostic - Vol. II - n° 4 - octobre-novembre-décembre 2013
177
Apports potentiels de l’ADN circulant pour la prise en charge
des cancers bronchiques non à petites cellules
niques sensibles (PCR avec acide nucléique peptidique
[PNA] et kit DxS de Qiagen), les résultats des études
EURTAC et IPASS ne retrouvent que 43 % (22 mutations
sur 51) et 47 % (51 mutations sur 109), respectivement,
des mutations tumorales dans le sérum (11, 12). Sur le
plasma, les meilleures sensibilités ne sont pas obliga-
toirement obtenues par les dernières technologies de
moyen et haut débit. Parmi les techniques que nous
appellerons classiques, parce qu’elles ne nécessitent
pas d’investissement technologique particulier, le kit
Therascreen
®
EGFR RGQ de Qiagen (PCR spécifi que
d’allèle avec sonde scorpion) a prouvé sa sensibilité en
détectant 18 mutations sur les 19 recherchées dans les
plasmas collectés avant traitement (10). Parmi les tech-
nologies les plus récentes, le pyroséquençage donne
également de très bons résultats : sur 52 plasmas testés,
l’équipe d’Akca a détecté 84 % des mutations recher-
chées (13). Enfi n, le séquençage de nouvelle généra-
tion, même s’il est prometteur, n’a été testé que sur une
cohorte de 30 patients ne comportant que 5 patients
porteurs de mutations. Les 5 mutations sont néanmoins
retrouvées dans cette étude préliminaire (14).
Ces résultats ne refl ètent parfois le travail que d’une
seule équipe sur des cohortes généralement de faibles
eff ectifs, et, même si certaines techniques garantissent
désormais une concordance presque parfaite entre
ADN tumoral et ADN circulant, ces résultats méritent
d’être confi rmés dans le cadre d’études prospectives
multicentriques à plus grande échelle. C’est l’objet de
l’étude ASSESS, qui vient de débuter. Il s’agit d’une
étude internationale (Japon et Europe) dont l’objectif
est de comparer les résultats des tests EGFR réalisés
simultanément et de manière prospective sur tissus
et sur ADN circulants chez 1300 patients (détails sur
clinicaltrials.gov ; étude n° NCT01785888).
Suivi des marqueurs : réponse au traitement
et progression
Si la sensibilité au diagnostic est validée, une autre
utilisation de ces biopsies liquides pourrait être envi-
sagée. En eff et, la plupart des patients rechutent dans
l’année qui suit le traitement par ITK. Il existe plusieurs
mécanismes de résistance, dont l’acquisition de la muta-
tion T790M sur l’exon 20 du gène EGFR dans 50 % des
cas. Réaliser une seconde biopsie renseignerait sur les
mécanismes moléculaires en jeu et pourrait aider au
choix de la thérapie de la ligne suivante, mais l’état des
patients rend souvent diffi cile ce second prélèvement.
Tableau. Principales techniques utilisées pour la détection des mutations de l’EGFR dans l’ADN circulant.
Référence Prélèvement Technique Nombre de patients
(mutés et sauvages) Sensibilité
(n détectés/n mutés) Spécifi cité
TECHNIQUES CLASSIQUES ET ADAPTATIONS
Punnoose et al. (15) Plasma Kit DxS pour EGFR et
KRAS ; essais Taqman
pour KRAS, PIK3CA,
BRAF, NRAS
25 9/10 (90 %) ND
Vallée et al. (10) Plasma Kit PCR Therascreen®
EGFR RGQ
85 18/19 (94,7 %) 100 %
Nakamura et al. (20) Plasma WIP-QP* pour
l’exon19, MBP-QP**
pour l’exon 21
39 39/39 (100 %) ND
TECHNIQUES À ÉQUIPEMENT DÉDIÉ
Taniguchi et al. (18) Plasma BEAMing 21 12/21 (62 %) ND
Yung et al. (16) Plasma PCR digitale 35 15/19 (79 %) 100 %
Akca et al. (13) Sérum Pyroséquençage
+confi rmation par
séquençage
52 21/25 (84 %) 100 %
Yam et al. (19) Plasma PCR avec PNA
puis extension
fl uorescente allèle-
spécifi que sur puce
51 36/37 (97,2 %) ND
Narayan et al. (14) Plasma NGS 30 5/5 (100 %) 100 %
ND : non déterminé.
* Détection des délétions de l’exon 19 par PCR avec acide nucléique inhibiteur de la séquence sauvage et sondes fl uorescentes.
** Détection des mutations de l’exon 21 par PCR spécifi que d’allèle et sondes fl uorescentes.

Correspondances en Onco-Théranostic - Vol. II - n° 4 - octobre-novembre-décembre 2013
178
dossier thématique
Cellules tumorales
et ADN libre circulant
En revanche, les prélèvements de sang n’ont pas de
contre-indications et sont répétables pour un suivi pré-
cis des changements moléculaires. Leur signifi cation
en termes de réponse au traitement, de progression
et de rechute reste cependant à établir.
Les études cinétiques de suivi sont en eff et encore
rares, la diffi culté étant de réussir à suivre régulière-
ment un nombre suffi sant de patients porteurs de
mutations et sur un temps assez long pour recueillir
des données statistiquement signifi catives. Dans la
plupart des cas, un seul prélèvement est récolté pen-
dant ou après le traitement pour réaliser des analyses
rétrospectives en fonction de la réponse au traitement.
La persistance de la mutation a ainsi été associée à la
progression alors que, à l’inverse, chez les patients
stabilisés ou en réponse partielle ou complète, on
observe une diminution ou la disparition de la frac-
tion mutée, quantifi able avec les techniques de PCR
spécifi que d’allèle, BEAMing, PCR digitale et séquence
de nouvelle génération (NGS) [14-16]. Dans les études
dédiées aux mécanismes de résistance, la mutation
T790M est retrouvée dans le plasma de 28 à 44 % des
patients (17, 18), des chiff res cohérents avec les don-
nées connues sur tissus.
Yam et al. (19) ont réalisé l’un des rares suivis de cohorte.
Au total, 21 patients ont été suivis jusqu’à 18 mois après
l’instauration du traitement par ITK. Avant le traitement,
18 des 21 mutations étaient détectées dans le plasma
par PCR avec PNA puis extension allèle-spécifi que sur
puce. Chez les 16 patients qui ont répondu aux ITK,
9 mutations sont devenues indétectables. On ne sait
malheureusement pas si une diff érence de survie ou de
progression a été observée entre les 2 groupes. Enfi n, le
plasma de 44 % des patients en progression présente la
mutation de résistance T790M, ce qui rejoint les résultats
sur tissus cités précédemment (19).
Quelques cas cliniques intéressants ont également
été rapportés et fournissent peut-être les résultats les
plus complets avec à la fois la réponse aux traitements,
l’évolution de la maladie, les choix thérapeutiques et
les résultats des analyses de biologie moléculaire sur
tissus et/ou plasmas récoltés à chaque visite. Dans leur
publication de 2012, Nakamura et al. (20) relatent ainsi
le cas d’un patient qui a rechuté après une résection
chirurgicale. La délétion de l’exon 19 étant présente dans
la tumeur primitive, le patient a été traité par géfi tinib.
Avant le traitement, ni la délétion ni la mutation T790M
n’étaient détectables dans le plasma. Suite à une der-
matite sévère, l’ITK d’EGFR a dû être arrêté, et le patient
a été placé sous chimiothérapie. Il a développé une
métastase pulmonaire. À ce stade, la délétion de l’exon
19 était devenue détectable dans le plasma. Le patient a
été placé cette fois-ci sous erlotinib pendant 1 an avant
de développer une résistance au traitement. La muta-
tion T790M était alors détectable avec la délétion de
l’exon 19 dans le plasma. D’autres auteurs ont rapporté
ce même genre de profi l, et une question majeure est
maintenant de savoir si les modifi cations moléculaires
du plasma précèdent les observations par imagerie et
autres outils traditionnels de suivi, auquel cas les ADN
circulants deviendraient un outil puissant du suivi des
patients (fi gure 3). Des études prospectives sont donc
encore nécessaires pour évaluer le pouvoir pronostique
et prédictif des ADN circulants dans le CBNPC.
Conclusion
Les analyses quantitatives de l’ADN circulant ont été les
premières développées ; leurs résultats sont pourtant
encore loin de trouver leur place dans la routine en
cancérologie. Beaucoup d’espoirs ont été placés dans
le diagnostic précoce par quantifi cation, mais l’applica-
tion de cet outil en clinique se heurte à des problèmes
fondamentaux d’homogénéisation des conditions pré-
analytiques. Bien que ce sujet ait été soulevé très tôt
Figure 3. Les mutations de l’EGFR sur plasma comme marqueurs de la réponse au traitement.
Représentation schématique des diff érents types de profi ls théoriques qui peuvent être obtenus
par recherche de mutations dans les ADN circulants. L’exemple choisi est celui d’un patient pré-
sentant une altération activatrice d’EGFR (délétion de l’exon 19). Cette altération est retrouvée
dans le plasma au diagnostic. Le patient est traité par ITK de l’EGFR. 1. Le patient ne répond
pas au traitement, la délétion de l’exon 19 reste détectable dans des proportions équivalentes
à celle de départ sur les prélèvements consécutifs. 2. Le patient répond au traitement. Dans le
deuxième prélèvement, la mutation activatrice n’est plus détectée ; elle reste indétectable après
plusieurs mois de traitement. 3. Le patient commence par répondre, et la délétion de l’exon 19
n’est plus détectable dans le plasma. Après quelques mois de traitement, le patient rechute.
La délétion de l’exon 19 est de nouveau détectable ainsi que la mutation de résistance T790M.
Délétion 19
ITK 1. Pas de réponse
au traitement
2. Bonne réponse
au traitement
3. Rechute avec
acquisition de
résistance
Changement
de traitement ?
Changement
de traitement ?
Maintien
de l’ITK
Diagnostic
Fraction mutée plasmatique
Temps
T790M
Seuil de positivité
 6
6
1
/
6
100%