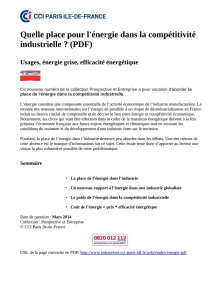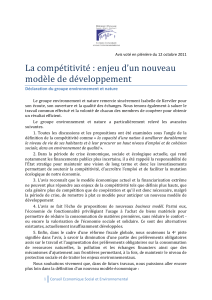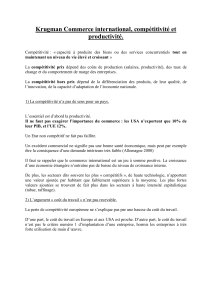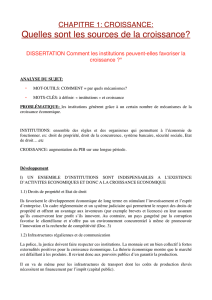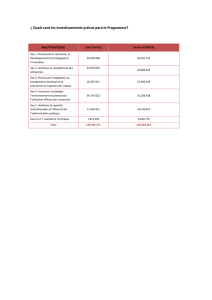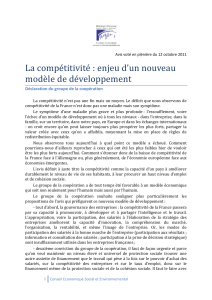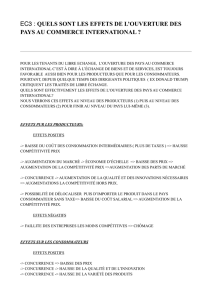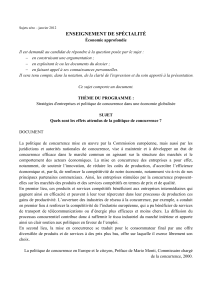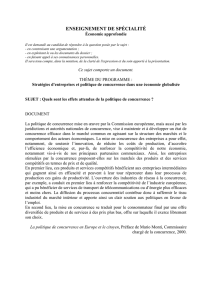Télécharger

dF
LA FRANCE PEUT-ELLE RESTER COMPÉTITIVE ?
&:DANNNA=YUX]U]:
Diffusion
Direction de l'information
légale et administrative
La documentation Française
Téléphone : 01 40 15 70 10
www.ladocumentationfrancaise.fr
Directeur de la publication
Xavier Patier
Cahiers français
N° 380
Mai-juin 2014
Impression : DILA
Dépôt légal : 2e trimestre 2014
DF 2CF03800
ISSN : 0008-0217
10 €
DOSSIER
■ Éditorial par Olivia Montel
■ Le déclin de la compétitivité française: état des lieux Flora Bellone, Raphaël Chiappini
■ Les mauvaises performances françaises à l’exportation :
la compétitivité-prix est-elle coupable ? Antoine Berthou, Charlotte Emlinger
■ Forces et faiblesses de l’industrie française Sarah Guillou
■ Le modèle social français est-il un obstacle à la compétitivité? Amandine Brun-Schammé
■ Trop de réglementations? Frédéric Marty
■ Préparer la compétitivité de demain:
quels dé s pour le système d’enseignement français? Stéphan Vincent-Lancrin
■ Les services peuvent-ils sauver l’emploi en France? Richard Duhautois,
Nadine Levratto, Héloïse Petit
■ Comment rendre le système scal français plus favorable à la compétitivité?
Laurent Simula
■ Le redressement de la compétitivité passe-t-il par des politiques protectionnistes?
Bernard Guillochon
■ Des pôles de compétitivité au CICE: faut-il revoir la politique industrielle?
Vincent Charlet
■ Compétitivité et politiques publiques dans les autres économies avancées
Christophe Blot, Sabine Le Bayon
DÉBAT
■ Fusion impôt sur le revenu / CSG et retenue à la source
1. Fusion IR-CSG et prélèvement à la source: les termes du débat Antoine Bozio
2. Des réformes inutiles et risquées François Écalle
LE POINT SUR…
■ Les pensées féministes contemporaines Alban Jacquemart
POLITIQUES PUBLIQUES
■ Décentralisation: où en sommes-nous? Gérard Marcou
BIBLIOTHÈQUE
■ Philippe Coulangeon et Julien Duval (Dir.),
«Trente ans après
La Distinction
de Pierre Bourdieu»,
La Découverte, 2013.
présenté par Antoine Saint-Denis
N° 380
LA FRANCE PEUTELLE RESTER
COMPÉTITIVE ?
c
ahiers
françai
s
•
Fusion impôt sur le revenu / CSG
et retenue à la source
•
Les pensées féministes contemporaines
•
Décentralisation: où en sommes-nous?
Cahiers français 380
documentation
La
Française
Cahiers français 380
Mai-ajuin 2014
96 pages : 6 mm
LA FRANCE
PEUTELLE RESTER
COMPÉTITIVE ?
CF 380 Compétitivité .indd 1 27/03/14 11:59

ÉDITORIAL
Notion économique controversée, la compétitivité est devenue omniprésente dans le débat
public français. Le creusement du déficit commercial dès le milieu des années 2000, sur fond de
désindustrialisation amplifiée par la crise, a largement contribué à faire de la «dangereuse obsession»
dénoncée par le prix Nobel d’économiePaul Krugman dans les années 1990 un des thèmes centraux
de la campagne électorale de 2012 puis du nouveau gouvernement. C’est notamment par comparaison
avec son principal partenaire commercial, l’Allemagne, que le diagnostic de détérioration de la
compétitivité du site France a été établi. En effet, tandis que l’Hexagone enregistre des déficits
commerciaux croissants – 81,5 milliards d’euros en 2012 –, l’Allemagne affiche des excédents
records – 186,7 milliards d’euros la même année – (Eurostat). La solidité des industries outre-Rhin,
en grande partie assise sur les performances à l’export, contraste également avec le recul du poids
de ce secteur dans le PIB français et la fonte préoccupante des emploisassociés.
Les économistes ont longtemps nuancé ce constat, d’abord parce qu’avant 2008, la diminution
des emplois s’accompagnait d’un maintien de la production industrielle, ensuite parce que la
tertiarisation était porteuse de nouvelles opportunités de croissance,et enfin, au motif que cette
désindustrialisation résultait en partie d’un transfert, induit par l’externalisation, de certaines
activités au secteur tertiaire. Face à l’amplification du phénomène par la crise, les inquiétudes sont
devenues plus vives et plus partagées, une grande part des services et des exportations reposant sur
un cœur industriel qui apparaît aujourd’hui fragilisé.
Si un certain consensus s’est forgé autour du diagnostic, les causes et les réponses à y apporter
demeurent débattues. Bien que largement médiatisés, le coût du travail, les 35 heures, les lourdeurs
administratives et autres éléments associés péjorativement au «modèle social français» ne sont
pas retenus comme facteurs déterminants par les économistes, qui s’accordent plutôt sur le fait que
la sous-performance française, notamment par rapport à l’Allemagne, relève surtout d’un recul de la
compétitivité hors-prix. C’est donc du côté de l’insuffisance en matière d’innovation et de R&D, plus
que de celui des coûts de production, que se trouverait le nœud du problème. Toutefois, compétitivité-
prix et compétitivité hors-prix ne peuvent être complètement isolées l’une de l’autre: l’amélioration
de la seconde passe en effet en partie par un rétablissement des marges des entreprises françaises,
qui ont été comprimées au cours des années 2000 sous l’effet de l’appréciation de l’euro et d’une
évolution des coûts de production peu favorable.
Du côté de l’action publique, c’est évidemment la politique industrielle qui est mise sur le devant de
la scène, après avoir été réduite dans les années 1980 et 1990 à sa portion congrue. Les politiques
de compétitivité croisent toutefois de nombreux instruments : ainsi, le soutien à la recherche et à
l’innovation passe aussi bien par le biais de l’investissement éducatif que d’une fiscalité incitative.
La politique fiscale dans son ensemble mérite une attention particulière, puisqu’elle influence
directement les coûts de production, mais aussi, à plus long terme, la qualité des infrastructures et
de l’environnement institutionnel.
Olivia Montel
LA COMPÉTITIVITÉ AU CŒUR
DU DÉBAT FRANÇAIS

CAHIERS FRANÇAIS N° 380
2
Depuis la n des années 1990, les performances
de la France en matière de commerce extérieur se sont
dégradées. Sa part de marché dans les exportations
mondiales a chuté et son solde commercial – différence
entre les exportations et les importations de biens et
services – a atteint, selon les chiffres de l’INSEE, un
décit de plus de 45 milliards d’euros en 2012 (2,2 %
du PIB), en baisse par rapport au décit record de 2011
s’élevant à plus de 59 milliards d’euros (3 % du PIB).
Ce constat, couplé à celui de la désindustrialisation de
l’économie française, pose la question de la capacité
des entreprises françaises à faire face à la concurrence
internationale et à proter de l’ouverture croissante des
marchés émergents.
Toutefois, le recul des parts de marchés à l’ex-
portation n’est pas une caractéristique exclusivement
française. La plupart des autres économies industriali-
sées ont connu la même érosion, parfois même de façon
encore plus prononcée (États-Unis et Japon). Le débat
en France s’est néanmoins focalisé sur la comparaison
avec le voisin allemand, qui afche des excédents
commer ciaux croissants (6 % du PIB en 2012). C’est
donc principalement au regard des bonnes performances
de l’économie allemande en matière d’exportation que
l’hypothèse d’un déclin de la compétitivité française
a été forgée.
Si cette notion de compétitivité est au cœur du
débat public – en témoignent la remise du rapport de
Louis Gallois au Premier ministre français, Jean-Marc
Ayrault, le 5 novembre 2012, ou encore les négociations
lancées depuis 2014 sur le pacte de responsabilité –, elle
n’en reste pas moins difcile à appréhender et sujette
à controverse du fait du manque de clarté dans sa dé-
nition.
La compétitivité nationale, objet
médiatique ou notion économique ?
Pour les économistes, la seule dénition de la
compétitivité qui soit claire est celle qui s’applique
à l’entreprise, c’est-à-dire sa capacité à faire face à la
concurrence, notamment internationale, et à gagner des
parts de marché. Pour une entreprise, cet objectif peut
être atteint de deux manières, soit en pratiquant des prix
LE DÉCLIN
DE LA COMPÉTITIVITÉ
FRANÇAISE :
ÉTAT DES LIEUX
Flora Bellone et Raphaël Chiappini
Université Nice Sophia Antipolis (UNS), GREDEG-CNRS UMR 7321
Qu’entend-on par « compétitivité d’un pays » et comment l’évalue-t-on ? Qu’est-ce qui fait
dire que la compétitivité française décline ? Est-ce une réalité ou seulement un thème
médiatique ? Dans cet article, Flora Bellone et Raphaël Chiappini reviennent sur des élé-
ments de définition et de mesure de la compétitivité, avant de proposer un diagnostic pour
la France fondé sur trois critères : l’évolution de la productivité intérieure, la dynamique
des exportations et l’attractivité du territoire. Ils montrent que c’est principalement la
détérioration de la capacité de la France à exporter qui nourrit aujourd’hui le diagnostic
du déclin de sa compétitivité. C . F.

DOSSIER - LE DÉCLIN DE LA COMPÉTITIVITÉ FRANÇAISE : ÉTAT DES LIEUX
CAHIERS FRANÇAIS N° 380
3
inférieurs sur des produits similaires – on parle alors de
compétitivité prix –, soit en cherchant des positions
de monopole par la différenciation des produits et/ou
l’innovation – on parle alors de compétitivité hors-prix.
Au niveau des pays, la dénition de la compétitivité
n’est pas aisée et divise la communauté économique.
Le plus célèbre opposant à cette notion est Paul
Krugman (1994) qui, dans un article retentissant du
Foreign Affairs, dénonçait une « dangereuse obses-
sion ». Il rappelle que le bien-être d’un pays ne peut
être confondu ni avec le prot de ses entreprises ni avec
les intérêts de ses industries (1). Selon les opposants
au concept de compétitivité, le seul objectif légitime
pour un pays doit rester celui de fournir un niveau de
vie élevé et croissant à ses citoyens, qui dépend avant
tout de la productivité avec laquelle ses ressources en
termes de travail et de capital sont employées.
De leur côté, les partisans du concept de compétitivité
se divisent en deux catégories. Certains, pragmatiques,
préconisent d’assortir l’objectif central de richesse à des
objectifs de performances sur les marchés extérieurs.
C’est par exemple la position retenue par l’OCDE, qui
dénit la compétitivité comme « la capacité d’un pays,
en situation de concurrence libre et équitable, à produire
des biens et services qui ont du succès sur les marchés
internationaux tout en garantissant une croissance des
revenus réels de ses habitants soutenable dans le long
terme ». Cette dénition apparaît raisonnable car elle
empêche de considérer comme compétitif un pays qui,
au prix de sacrices intérieurs trop importants, par
exemple sous la forme de fortes baisses des salaires, se
forgerait une bonne capacité d’exportation. Inversement,
un pays qui afcherait un bon niveau de vie mais dont
les produits s’exporteraient mal serait également jugé
non compétitif.
D’autres auteurs revendiquent plus ex pli ci tement
l’idée qu’en présence de progrès technologique
endogène et localisé, les pays peuvent se trouver, à
certains moments de leurs trajectoires de croissance, en
concurrence les uns par rapport aux autres (Grossman
(1) Ainsi, lorsqu’une entreprise française perd des parts de
marchés au prot d’une entreprise étrangère plus compétitive, le
consommateur français y gagne même si l’entreprise française y
perd. Dans une étude récente pour le CEPII, Charlotte Emlinger et
Lionel Fontagné montrent que le coût du panier de consommation
moyen en France se renchérirait de 100 à 300 euros par mois si les
biens consommés étaient tous achetés en France. Cf. Emlinger Ch.
et Fontagné L. (2013), « (Not) Made in France », Lettre du CEPII
n° 333, juin.
et Helpman 1991, Lucas, 1993 (2)). Dans ce cas, le
libre-échange peut effectivement créer des gagnants
et des perdants et la mobilité internationale des fac-
teurs de production peut renforcer, plutôt que réduire,
les inégalités de richesses entre les pays. Parmi eux,
l’économiste le plus emblématique est Dani Rodrik
(3)
.
Pour lui, le positionnement à l’international d’un pays
peut directement inuencer sa croissance dans un sens
favorable ou non en fonction des politiques économiques
qu’il met en œuvre. Dans la lignée de ses travaux, la
compétitivité d’un pays peut se dénir comme « sa
capacité à s’insérer de manière avantageuse dans la
mondialisation et à en tirer parti pour améliorer le
niveau de vie de ses citoyens ».
Comment mesure-t-on
la compétitivité d’un pays ?
Faute d’un ancrage théorique pleinement établi,
les diagnostics de compétitivité des pays reposent sur
des indicateurs qui intègrent, sans grande justication,
une variété de critères de performances intérieures et
extérieures. Par ailleurs, ces diagnostics cherchent en
général à aller au-delà de la mesure des performances
elles-mêmes et tentent plutôt d’appréhender des déter-
minants fondamentaux. Les deux indices composites les
plus connus sont ceux proposés par le World Economic
Forum (WEF) et l’Institute for Management Develop-
ment (IMD). Le premier compte 111 critères censés
représenter la compétitivité d’un pays et le second pas
moins de 245.
Les classements de l’IMD et du WEF font tous
deux ressortir le déclin de la compétitivité française par
rapport à son voisin allemand (tableau 1). Toutefois , ce
type de classements est à interpréter avec la plus grande
prudence. En effet, ils sont très vivement critiqués dans
la littérature économique de par leur construction ad
hoc (Debonneuil et Fontagné, 2003).
(2) Voir Grossman G. et Helpman E. (1991), Innovation and
Trade in the Global Economy, Cambridge, MIT Press et Lucas R.
(1993), « Making a Miracle », Econometrica, vol. 61, n° 2.
(3) Dani Rodrik est professeur de sciences sociales à l’Institut
d’études avancées de Princeton. Voir en particulier Rodrik D.
(2008).

DOSSIER - LE DÉCLIN DE LA COMPÉTITIVITÉ FRANÇAISE : ÉTAT DES LIEUX
CAHIERS FRANÇAIS N° 380
4
Un état des lieux de la compétitivité
de la France
C’est précisément pour dépasser le caractère
arbitraire des indices globaux de compétitivité que
Debonneuil et Fontagné ont dressé, au début des
années 2000, un premier bilan global de la compétiti-
vité de l’économie française. S’interrogeant déjà sur
son éventuel déclin, les auteurs concluaient, à l’instar
de Krugman, que la faible progression de la produc-
tivité intérieure restait la préoccupation majeure pour
l’économie française alors que la position relative des
produits français sur les marchés extérieurs était bonne
et que l’attractivité du territoire en matière d’investisse-
ments directs à l’étranger (IDE) demeurait importante.
Dix ans après ce premier bilan sur la compétitivité
française, les gains de productivité sont restés modestes
en France tandis que le positionnement des produits
français sur les marchés extérieurs s’est sensiblement
dégradé et que l’attractivité du site France s’est affaiblie.
La richesse et la productivité relative
de la France restent élevées
Selon le classement du FMI pour 2014, la France
et l’Allemagne se classent respectivement aux 19
e
et 18e rang des pays les plus riches du monde avec
des niveaux de PIB réel par habitant très proches, de
l’ordre de 43 000 et 44 000 dollars respectivement.
Ce premier constat objectif contraste avec les indices
de compétitivité globaux, qui classent la France loin
derrière l’Allemagne.
La France afche également des niveaux de pro-
ductivité horaire du travail parmi les plus élevés des
pays de l’OCDE. Selon les données de la base sur
les comparaisons internationales de productivité du
Groningen Growth and Development Centre (GGCD) (4),
elle apparaît même plus productive que l’Allemagne.
Par ailleurs, ces deux pays apparaissent plus productifs
que la moyenne de la zone euro, les États-Unis et le
Japon (5).
Des gains de productivité
en faible progression
et un taux d’emploi en régression
Si la France détient toujours une position de leader
en termes d’efcacité productive, le constat est plus
nuancé en termes de croissance et de gains de pro-
ductivité sur la période récente. Ainsi, sur la dernière
décennie, le niveau du revenu réel par habitant a crû en
moyenne de 0,5 % par an, contre 1,1 % en Allemagne,
ce qui classe la France légèrement en dessous de la
moyenne de la zone euro et très en deçà de la moyenne
de l’OCDE.
Cette faible croissance des revenus s’explique en
partie par la faiblesse des gains de productivité du travail,
là aussi inférieurs à la moyenne de l’OCDE. Selon un
récent rapport de l’OCDE (2013), la France se classe
20e sur 34 pays en matière de gains de productivité.
(4) La base de données du GGDC sur les comparaisons inter-
nationales de productivité, dont la dernière version a été mise en
ligne en juillet 2013, pour l’année de référence 2005, est la plus
complète en ce qui concerne les comparaisons de productivité par
industrie. Elle couvre 42 pays et 35 industries détaillées. Elle est
disponible à partir du site http://www.rug.nl/research/ggdc/data/
ggdc-productivity-level-database
(5) Le tableau 2 permet également de montrer que l’écart de
productivité horaire du travail entre les pays émergents tels que
la Chine et les pays industrialisés reste élevé. Ce qui permet de
comprendre pourquoi le faible coût de la main-d’œuvre chinoise
n’est pas forcément un élément de concurrence déloyal vis-à-vis
des entreprises françaises.
Tableau 1. Classements selon deux critères de compétitivité en 2008 et 2013
Global Competitiveness Index (WEF) World Competitiveness Yearbook (IMD)
2008 2013 2008 2013
Allemagne 5 4 16 9
Espagne 28 35 33 45
États-Unis 1 5 1 1
France 18 23 25 28
Italie 36 49 46 44
Japon 8 9 22 24
Royaume-Uni 9 10 21 18
Source : WEF (2008, 2013), Global Competitiveness Report et IMD (2008, 2013) World Competitiveness Yearbook.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
1
/
97
100%