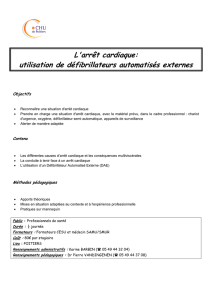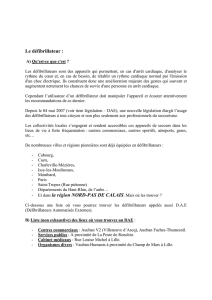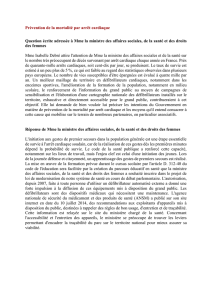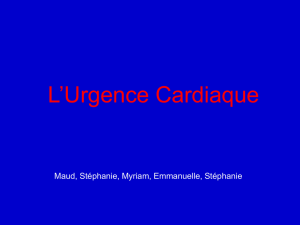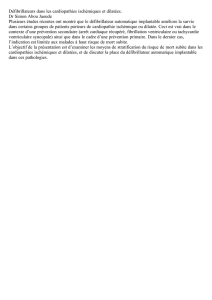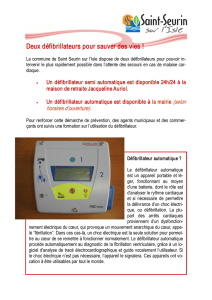L Arrêt cardiaque extra-hospitalier MISE AU POINT Outside hospital cardiac arrest

MISE AU POINT
18 | La Lettre du Cardiologue • n° 430 - décembre 2009
Arrêt cardiaque extra-hospitalier
Outside hospital cardiac arrest
C. Le Feuvre*
* Institut de cardiologie, hôpital de la
Pitié-Salpêtrière, Paris.
L
a mort subite d’origine cardiaque est définie par une
mort naturelle consécutive à une cause cardiaque se
manifestant par une brusque perte de connaissance
dans l’heure qui suit l’apparition des symptômes chez
une personne cliniquement stable. Hippocrate, 400 ans
avant J.C., a été le premier à décrire dans Les Aphorismes la
mort subite : “Ceux qui souffrent de syncopes sévères et
répétitives sans cause démontrée meurent subitement.”
À la même époque, Pheidippides, coureur grec envoyé
à Sparte chercher des renforts après le débarquement
perse à Marathon (200 km de course en 2 jours), puis
envoyé à Athènes pour annoncer la victoire, proclama :
“Réjouissez-vous, nous avons vaincu !”, avant de s’écrouler
d’une mort subite. La première défibrillation interne a été
pratiquée aux États-Unis par C. Beck en 1947. Les travaux
de P. Zoll et B. Lown ont contribué à la mise au point
du défibrillateur externe portable entre 1955 et 1960.
Les chiffres en France
Chaque année, en France, 50 000 personnes sont victimes
d’une mort subite, soit 130 par jour (10 fois plus que les
victimes d’accident de la route). La mort subite survient plus
souvent au domicile (75 à 80 %) que sur la voie publique
(10 %), sur le lieu de travail (1 à 2 %) ou sur un terrain
de sport (1 à 2 %). En France, l’arrêt cardiaque concerne-
rait 400 sportifs par an, parmi lesquels des sujets jeunes,
parfois professionnels (mort du footballeur camerounais
Marc-Vivien Foë à l’âge de 28 ans le 26 juin 2003, mort
du footballeur espagnol Antonio Puerta à l’âge de 22 ans
le 2 septembre 2007). Les autres lieux sont les maisons
de retraite, les cabinets médicaux et centres de soins, les
grands magasins, les gares, les aéroports, les avions, etc.
L’âge moyen de survenue de l’arrêt cardiaque est de 67 ans,
avec une prédominance masculine (deux tiers des cas) [1].
Dans 75 % des cas, l’arrêt cardiaque survient devant un
témoin. Le témoin met 4 à 6 minutes pour reconnaître
l’arrêt cardiaque et appeler les premiers secours. Moins
de 20 % des témoins entreprennent des manœuvres de
réanimation. Le délai d’intervention des secours est de
10 à 30 minutes. Le taux de décès après arrêt cardiaque
augmente de 10 % avec chaque minute qui passe, ce
qui explique qu’en France, le taux de survie ne soit que
de 2 à 3 % (1).
Les séries autopsiques et coronarographiques identifient
une cause cardiaque dans 80 % des cas. Dans 20 %
des cas, la mort subite est non cardiaque (accident
vasculaire cérébral, embolie pulmonaire, hémorragie,
asthme, intoxication), avec un taux de survie plus bas.
La cause la plus fréquente de mort subite d’origine
cardiaque est la maladie coronaire (80 %), suivie des
cardiopathies dilatées ou hypertrophiques (14 %), puis
des cardiopathies restrictives (5 %). Les autres causes
(syndromes de Brugada ou de Wolf-Parkinson-White,
etc.) représentent moins de 1 % (2). Bayes de Luna a
analysé les tracés ECG Holter de 157 patients décédés
subitement pendant l’enregistrement (3). Ces tracés
retrouvent le plus souvent une extrasystole ventriculaire
(ESV) qui déclenche une tachycardie ventriculaire (TV),
évoluant vers une fibrillation ventriculaire (FV) dégéné-
rant en asystolie. La FV est primaire dans 11 % des cas,
et précédée d’une TV chez la moitié des patients. Une
brady-asystolie est retrouvée dans 21 % des cas, et une
torsade de pointe dans 18 % des cas. Après plusieurs
minutes de collapsus, la proportion d’asystolies est plus
élevée, atteignant 60 à 80 % dans les enregistrements
du service mobile d’urgence et de réanimation (SMUR).
Exemples à l’étranger
Aux États-Unis, les défibrillateurs automatiques sont
en vente libre depuis 2004. Dans certaines villes pilotes
comme Seattle, le déploiement de défibrillateurs et la
formation d’une grande partie de la population permet
d’atteindre 30 % de survie après un arrêt cardiaque
extrahospitalier.
Dans les casinos de Las Vegas, équipés de défibrilla-
teurs et de surveillance vidéo, le temps moyen entre le
collapsus et le début des manœuvres de réanimation est
de 2,9 minutes, et le taux de survie est de 38 % (74 %
chez les patients en FV défibrillés avant la troisième
minute de collapsus).

Figure 1. Affiche de la campagne de la Fédération
française de cardiologie.
Figure 2. Brochure de la campagne de la Fédération
française de cardiologie.
La Lettre du Cardiologue • n° 430 - décembre 2009 | 19
Points forts
»En France, chaque année, 50000 personnes sont victimes d’une mort subite.
»
Depuis mai 2007, tout individu a la possibilité d’utiliser un défibrillateur automatisé externe.
»
Le taux de survie de ces arrêts cardiaques passe de 2 % en cas d’intervention tardive à
30 % en cas d’intervention précoce avec utilisation d’un défibrillateur.
»
L’amélioration du pronostic nécessite une formation de la population aux 3 gestes qui
sauvent: appel des services de secours, massage cardiaque, défibrillation. C’est l’objectif de
la campagne grand public de la Fédération française de cardiologie, menée en France sur ce
thème depuis janvier 2008.
Mots-clés
Arrêt cardiaque
Défibrillateur
automatisé
Massage cardiaque
externe
Pronostic
Highlights
»
In France, sudden cardiac
death occurred in 50,000 per-
sons.
»
Everybody can use an auto-
mated external defibrillator
(DAE) since May 2007.
»
The survival rate after
cardiac arrest increases from
2% in case of late interven-
tion to 30% in case of rapid
intervention and use of a DAE.
»
Prognosis improvement
requires population training
at the 3 saving motions: call
emergency medical services,
perform cardiac resuscitation,
and use a DAE. It is the objec-
tive of the campaign of the
Fédération française de cardio-
logie, ongoing in France since
January 2008.
Keywords
Cardiac arrest
Automated external
defibrillator
Cardiac resuscitation
Prognosis
Les terminaux des aéroports américains et les avions de
la compagnie American Airlines sont équipés de défi-
brillateurs et le personnel est formé à leur utilisation. Le
taux de survie chez les patients en TV/FV est de 40 %.
En Grande-Bretagne, 681 défibrillateurs automatiques
ont été installés dans des lieux à haut risque (gares,
aéroports, supermarchés) et le personnel est formé
aux gestes qui sauvent. Le taux de survie dans cette
étude était de 22 %, alors que le taux moyen de survie
n’est que de 2 % dans ce pays (2).
Campagne de la FFC :
1 vie = 3 gestes
S’appuyant sur les recommandations de l’Académie
nationale de médecine de janvier 2007 (1), le décret du
4 mai 2007 autorise le grand public à utiliser un défi-
brillateur (4). Dans le cadre de son combat pour réduire
la mortalité cardiovasculaire, la Fédération française de
cardiologie (FFC), association de cardiologues béné-
voles, a choisi de faire campagne sur le thème de l’arrêt
cardiaque. Sa mission dans le cadre de cette campagne
dont elle est l’initiatrice comporte deux volets :
– éduquer le public sur les 3 messages “appeler - masser
- défibriller” et l’encourager à se former aux gestes
qui sauvent ;
– fédérer les partenaires du monde cardiologique (Société
française de cardiologie [SFC], Collège national des
cardiologues [CNCF], Collège national des cardiologues
des hôpitaux généraux [CNCHG]), les urgentistes (Samu
de France, Conseil français de réanimation cardio-pulmo-
naire [CFRC]) et les secouristes (Croix-Rouge française).
La campagne média a débuté lors des Journées euro-
péennes de la SFC en janvier 2008. L’objectif de cette
campagne est de sauver 5 000 vies à l’horizon 2010,
en passant de 3 % à 10 % de personnes sauvées
chaque année. Cet objectif passe par l’augmentation
de l’équipement de notre territoire en défibrillateurs
et l’accroissement du nombre de Français connaissant
les gestes qui sauvent. Depuis 18 mois, la FFC a produit
et diffusé plusieurs centaines de milliers de brochures
d’information (figures 1 et 2). Un site Internet a été créé
(www.1vie3gestes.com), ainsi qu’un film pédagogique.
Des conférences grand public et des démarches person-
nalisées auprès des décideurs contribuent à encourager
collectivités locales et entreprises à former leur personnel

Arrêt cardiaque extra-hospitalier
MISE AU POINT
20 | La Lettre du Cardiologue • n° 430 - décembre 2009
et à équiper leurs locaux. Le soutien des pouvoirs publics
a été sollicité (ministère de la Santé, conseiller tech-
nique santé à l’Élysée, Parlement) afin de développer
la formation aux gestes qui sauvent chez un plus grand
nombre de personnes.
La formation aux gestes
qui sauvent
Il existe 2 types de formation : l’initiation aux premiers
secours (IPS), qui correspond à une sensibilisation
de courte durée (2 heures environ), le plus souvent
proposée gratuitement par les opérateurs de formation,
et la prévention et secours civiques (PSC1), un module
plus complet (une douzaine d’heures), habituellement
payant, et qui donne lieu à la délivrance d’une attes-
tation (tableau I). La réunion interministérielle du
29 janvier 2009, présidée par le directeur de cabinet
du ministère de la Santé, suivant les recommandations
des représentants des associations d’urgentistes, des
secouristes et de la FFC, s’est prononcée en faveur d’une
formation courte limitée au massage cardiaque (sans
bouche-à-bouche), avec intégration de cette formation
aux Journées civiques et diffusion, avec l’aide de l’Ins-
titut national de prévention et d’éducation pour la santé
(INPES), de spots télévisés incitant à cette formation.
Implantation de défibrillateurs
en ville
Le rôle des collectivités locales est de rendre accessibles
les défibrillateurs automatisés externes dans les lieux
de vie à forte fréquentation : lieux de travail, centres
commerciaux, centres sportifs, aéroports et gares,
transports en commun, etc. De nombreuses villes et
régions pionnières (Cabourg, Caen, Issy-les-Moulineaux,
Montbard, Paris, Communauté urbaine du Grand Nancy,
départements du Nord, du Haut-Rhin et de l’Aube,
etc.) sont déjà équipées en défibrillateurs et ont initié
des campagnes de formation aux gestes de premiers
secours. Plusieurs milliers de défibrillateurs automatisés
externes sont aujourd’hui à la disposition du public. Il
existe 2 types de défibrillateurs : le défibrillateur semi-
automatisé externe (DSA) et le défibrillateur entièrement
automatisé externe (DAE) [tableau II].
Les DAE sont principalement installés sur la voie publique
ou dans des lieux très fréquentés par le public comme les
gares, les places de marché, les centres commerciaux,
etc. Les DSA sont plutôt implantés dans des lieux très
fréquentés, mais non accessibles en permanence tels
que les stades, les piscines, les postes de secours, les
mairies, etc. Ce type de matériel est plutôt utilisé par
des personnels formés.
Chaque commune est libre dans la démarche à mettre
en œuvre pour s’équiper en défibrillateurs. Les 6 étapes
conseillées par la FFC, que l’on retrouve sur le site
www.1vie3gestes.com, sont :
– créer un groupe de travail avec des professionnels des
premiers secours ;
– déterminer les lieux d’implantation (selon le taux de
fréquentation, la proximité de lieux à risque, la distance
entre deux centres de secours ou deux défibrillateurs, le
temps d’accès au défibrillateur ou au centre de secours
le plus proche, etc.) ;
– choisir le matériel (en tenant compte de la mainte-
nance et de la surveillance) ;
– financer le projet (municipalité ou soutiens financiers
extérieurs) ;
– informer et former le personnel municipal, puis le
grand public ;
– communiquer pour asseoir le projet (médias, presse
locale et régionale).
Exemple de la Communauté
urbaine du Grand Nancy
Lancé début 2006 et en cours de réalisation, ce projet de
grande envergure concerne une vingtaine de communes,
soit une population de 266 000 habitants. Les 400 défi-
brillateurs automatisés externes seront installés progres-
sivement sur le territoire du Grand Nancy. Des sessions
de formation de secouristes volontaires sont également
programmées, pour être au plus près de la population.
Partant du constat qu’il y avait au moins 10 minutes
incompressibles pour que les secours arrivent sur le
lieu d’une urgence (où qu’il se situe sur le territoire),
Tableau II. Principaux fabricants de défibrillateurs.
Cardiac Science France www.cardiacscience.com DEA et DSA
Defibtech www.defibtech.fr DEA
Laerdal Medical www.laerdal.fr DEA et DSA
Medtronic Physio Control www.medtronic.com DEA et DSA
Schiller Medical www.schiller-medical.com DEA et DSA
Welch Allyn France www.welchallyn.com DSA
Zoll Medical France www.zoll.fr DEA et DSA
DSA: défibrillateur semi-automatisé externe; DAE: défibrillateur entièrement automatisé externe.
Tableau I. Organismes proposant une formation aux gestes qui sauvent.
Association nationale des premiers secours www.anps.fr
Croix-rouge française www.croix-rouge.fr
Fédération des secouristes français www.croixblanche.org
Ordre de Malte France www.ordredemaltefrance.org
Protection civile www.protection-civile.org

MISE AU POINT
La Lettre du Cardiologue • n° 430 - décembre 2009 | 21
le Pr Aliot, du service de cardiologie du CHU de Nancy
et président de l’Association régionale de la FFC, ainsi
que les médecins du Samu et du pôle des urgences du
CHU, ont pris contact avec la déléguée à la Santé de la
Communauté urbaine du Grand Nancy. La Commu-
nauté urbaine était favorable à cette demande, mais ne
pouvait mettre en place seule un projet d’implantation
de DAE et de formation du public. Elle a donc profité de
l’opportunité d’une réunion d’élus sociaux pour présenter
ce projet et diffuser différents rapports pour les alerter.
Les élus ayant accueilli favorablement le projet, un
groupe de travail a été constitué pour traiter de l’ins-
tallation et de l’assurance du matériel, et pour inciter
la population à se former. Le Samu a développé une
campagne de recrutement et de formation de citoyens
bénévoles (“sauveteurs volontaires de proximité”), à
l’aide de l’association Grand Nancy defib’, créée pour l’oc-
casion par les intervenants concernés (Pr Aliot, Commu-
nauté de communes, organismes locaux de formation).
Ce réseau de citoyens bénévoles doit constituer un
maillon supplémentaire dans la chaîne de survie entre
les secours et les victimes d’arrêt cardiaque. Afin de
simplifier les démarches, il a été décidé que le CHU
centraliserait les achats et superviserait l’installation
des 400 DAE pour la Communauté urbaine du Grand
Nancy. Chaque commune reste responsable du nombre
d’appareils qu’elle souhaite acheter et de leur implanta-
tion. Elle finance l’achat des DAE et les commande via le
CHU ; elle assure le relais de la maintenance et la mise
en place des assurances une fois les matériels livrés. Les
lieux municipaux fréquentés par le public (mairies, parcs,
gymnases) sont les sites d’implantation généralement
privilégiés.
Tous les personnels administratifs des communes ont
été sensibilisés ou suivront un module de formation sur
l’utilisation des DAE et sur les gestes qui sauvent par
l’intermédiaire du CNFPT (Centre national de la fonc-
tion publique territoriale). Des formations aux premiers
secours seront également proposées aux habitants.
Parallèlement à ces actions, l’association Grand Nancy
défib’ a commencé, en février 2008, son action de recru-
tement et de formation des sauveteurs volontaires de
proximité. Le grand public a été sensibilisé par plusieurs
campagnes par voie d’affichage, diffusion de brochures
et parution dans les médias régionaux.
DAE à domicile :
pas de bénéfice
en termes de survie
La plupart des arrêts cardiaques extra-hospitaliers
survenant à domicile, l’étude HAT (Home Auto-
mated External) a analysé l’intérêt du défibrillateur
automatique à domicile. Cette étude a randomisé
7 001 patients avec infarctus antérieur sans indi-
cation de défibrillateur implantable en un groupe
contrôle (appel aux urgences, massage cardiaque) et
un groupe défibrillateur (appel aux urgences, massage
cardiaque et utilisation du défibrillateur) [5]. Le défi-
brillateur a été utilisé à domicile par un témoin chez
32 patients ; 14 patients ont reçu un choc approprié
et seuls 4 d’entre eux ont survécu. Au final, aucune
différence de survie n’est observée entre les 2 groupes
après 37 mois de suivi moyen (tableau III). Chez les
patients avec antécédent d’infarctus antérieur sans
indication de défibrillateur implantable, la présence
d’un défibrillateur automatique à domicile n’améliore
donc pas le pronostic par rapport à une prise en charge
conventionnelle.
Conclusion
Le thème de la mort subite nécessite une approche
pluridisciplinaire réunissant surveillance épidémiolo-
gique, prévention primaire et secondaire des mala-
dies à l’origine des arrêts cardiaques – notamment la
cardiopathie ischémique –, amélioration constante
des services de secours et création de nouvelles stra-
tégies favorisant la participation des non-médicaux
à la réanimation et à l’utilisation des DAE.
La campagne grand public de la FFC (1 vie = 3 gestes),
débutée en janvier 2008 et réalisée en partenariat
avec les principaux acteurs de santé, contribue à
inciter les Français à se former aux gestes qui sauvent,
et les élus à équiper les lieux publics de DAE. Un bilan
est prévu au terme de cette campagne, qui permettra
de chiffrer l’amélioration du pronostic de l’arrêt
cardiaque extra-hospitalier, dont le taux de survie
en France n’est actuellement que de 2 à 3%. Il reste
beaucoup à faire pour atteindre les 30 % de survie
obtenus à Seattle. ■
Tableau III. Résultats de l’étude HAT : absence de bénéfice d’un défibrillateur automatique
à domicile (5).
Suivi moyen 37 mois Groupe contrôle
(n = 3 506)
Groupe défibrillateur
(n = 3 495)
Décès toutes causes confondues 228 (6,5 %) 222 (6,4 %)
Mort subite, n (%)
Décès au domicile, n
Décès à l’hôpital, n
78 (2,2 %)
60
8
82 (2,3 %)
57
10
Arrêt cardiaque réanimé
et vivant à 48 heures, n
19
24 % des TV-FV
19
24 % des TV-FV
Références
bibliographiques
1. Vacheron A, Bounhoure JP.
Groupe de travail de la Commis-
sion IV (maladies cardiovas-
culaires).Recommandations
de l’Académie nationale de
médecine. Bull Acad Natl Med
2007;191:1763-77.
2. Katz E, Metzger C, Sierro C et al.
La mort subite : de l’épidémio-
logie à la prévention. Rev Med
Suisse 2007;96:1-9.
3. Bayes de Luna A, Coumel P,
Leclercq JF. Ambulatory sudden
cardiac death: mechanisms of
production of fatal arrythmia on
the basis of data from 157 cases.
Am Heart J 1989;117:151-9.
4. Décret n° 2007-705 du
4 mai 2007 relatif à l’utilisation
des défibrillateurs automatisés
externes par des personnes
non-médecins et modifiant le
Code de santé publique. JO du
5 mai 2007.
5. Bardy GH, Lee KL, Mark DB
et al. Home use of automated
external defibrillators for sudden
cardiac arrest. N Engl J Med
2008;358:1793-804.
1
/
4
100%