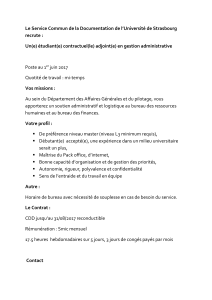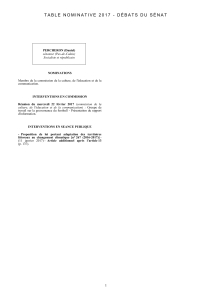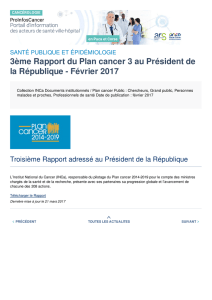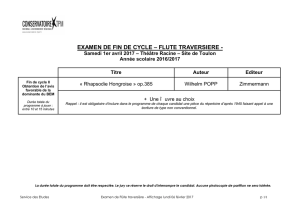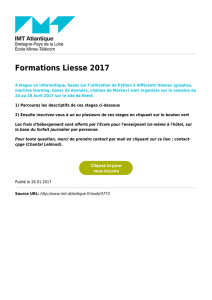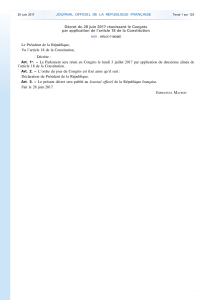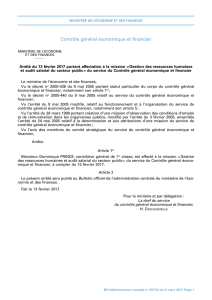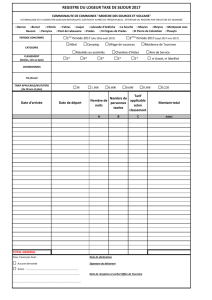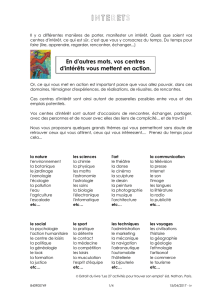Revue de presse Comité Consultatif National d’Ethique du 1

Comité Consultatif National d’Ethique
pour les sciences de la vie et de la santé
Revue de presse
du 1er au 19 avril 2017
N° 330
35, rue Saint-Dominique – 75700 Paris
01.42.75.66.44
DIFFUSION RESTREINTE

SOMMAIRE n° 330
du 1er au 19 avril 2017
I- ÉTHIQUE
Don d’organes après euthanasie : nouvelles directives en place aux Pays-Bas 1
Institut Européen de Bioéthique, 30/03/17
Belgique : autour de l’avortement, c’est la liberté d’expression
qui est menacée 1/2
Institut Européen de Bioéthique, 30/03/17
Les soins palliatifs en périnatalité restent en tension éthique
dans la recherche d’un modèle 2/4
Hospimedia, 31/03/17
Un rapport néerlandais favorable à la création d’embryons humains
pour la recherche 4
Bioedge, 01/04/17
L’Italie épinglée sur les IVG par le Comité des droits de l’homme de l’ONU 4/5
Le Quotidien du Médecin, 05/04/17
Dispositifs médicaux : le Parlement en faveur de critères plus stricts 5/6
Le Parlement Européen, 05/04/17
Petit pas vers la mise en vente de cellules-souches ? 6/7
Le Devoir, 10/04/17
Les médicaments anti-Alzheimer vont continuer à être remboursés 7/8
La Croix, 13/04/17
Suède : la croisade anti-IVG d’une sage-femme 8/9
Libération, 14/04/17
GPA : « Le désir d’enfant ne légitime pas un prétendu droit à l’enfant » 9/10
Causeur, 23/03/17
II- SOCIÉTÉ
Une association alerte face à « l’épidémie » de têtes plates
chez les nourrissons 11
Le Monde, 21/03/17
Trisomie 21 non dépistée : un couple s’attaque au CHU de Limoges 12
Le Populaire du Centre, 01/04/17
Grippe aviaire, une sortie de crise se dessine 12/13
La Croix, 04/04/17
Alcoolisme : un risque d’intoxication sous baclofène 13/15
Le Monde Science et Techno, 05/04/17
Du glyphosate retrouvé dans les urines de 30 personnalités,
d’Emily Loizeau à Charline Vanhoenacker 15/16
Huffington Post avec AFP, 06/04/17

Hôpitaux : face aux dérives de la T2A, le Dr Véran mise sur le financement
à l’épisode de soins et au parcours 16/17
Le Quotidien du Médecin, 05/04/17
Indépendance : trois syndicats de biologistes assignent le groupe Cerba,
qui réplique avec fermeté 17/18
Le Quotidien du Médecin, 05/04/17
Paris : les riverains de la salle de shoot veulent aller en justice 18/19
Le Parisien, 05/04/17
« La douleur chronique déchire la vie » 19/22
Le Temps, 03/04/17
Bioéthique : qu’est-ce que la fondation Lejeune qui agace les chercheurs ? 22/24
L’Express, 30/03/17
Dispositifs médicaux : Statice toujours en pole position 24
Les Echos, 15/03/17
Cette femme a accouché pendant son coma et s’est réveillée trois mois
plus tard 25/26
Huffington Post, 10/04/17
Quel candidat fera le moins pour la santé publique ? 26
Allo Docteurs avec AFP, 11/04/17
Deux ministres se rendent à Grande-Synthe, où un camp de migrants
a été réduit en cendres 27
Libération avec AFP, 11/04/17
La fondation Lejeune lance une Master-class en éthique biomédicale 28
Famille Chrétienne, 07/04/17
Son médicament contre le cancer déremboursé, elle lance un appel aux dons 28
Le Télégramme, 12/04/17
Belgique : le débat sur l’avortement refait surface 29/31
Famille Chrétienne, 07/04/17
Royaume-Uni : des médecins autorisés à laisser un bébé mourir
« dans la dignité » 31
L’Express avec AFP, 11/04/17
Un protocole autour de trois grands principes 31/32
Le Quotidien du Médecin, 13/04/17
Etats-Unis : Trump restreint le financement de l’avortement 32/33
Le Parisien avec AFP, 14/04/17
Un test génomique sur Internet contesté 33/34
Le Monde Science et Techno, 19/04/17
Les enjeux de la présidentielle, de meilleures conditions de fin de vie 34/36
La Croix, 19/04/17
III – RECHERCHE
Cancer : l’intérêt de dresser le portrait génétique de la tumeur démontré 37
Sciences et Avenir avec AFP, 03/04/17

Des avancées en vue dans la maladie de Parkinson 37/39
Le Quotidien du Médecin, 10/04/17
Ebola : deux vaccins vont être testés en Guinée et au Liberia 39/40
La Croix, 11/04/17
La timide révolution des thérapies ciblées anti-cancers 40/42
Le Monde Science et Techno, 12/04/17
Des nouveaux venus chez les virus géants 42/43
Le Monde Science et Techno, 12/04/17
Des greffes cellulaires pour traiter les infarctus 43/44
Le Figaro Santé, 12/04/17
Un colorant au feu orange E171 44/46
Libération, 14/04/17
Le rôle complexe des cellules-souches cancéreuses 46/47
Le Figaro, 15/04/17
Un implant cérébral contre les tics 47/48
Sciences et Avenir, 13/04/17
Imbroglio sur la validation d’un nouvel essai clinique 48/49
Le Figaro, 19/04/17
IV - PERSONNALITÉS, FILMS ET OUVRAGES
André Grimaldi : « La maladie chronique conduit à réaménager sa vie » 50/52
Libération, 04/04/17
Le dilemme de Magdalena Zernicka-Goetz, mère et cultivatrice d’embryons 52/54
Le Monde Science et Techno, 05/04/17
Prix des médicaments innovants contre le cancer : le système doit évoluer,
ou périr 54/57
The Conservation, 04/04/17
L’homme augmenté, fantasme d’un monde qui rêve d’abolir la mort…
de quelques privilégiés 57/59
Le Figaro, 05/04/17
Dépakine : au moins 14 000 victimes, selon une estimation non-officielle 59
Allo Docteurs avec AFP, 06/04/17
Scandale de la Dépakine : les années de combat d’une épileptique 60
Le Figaro, 10/04/17
Anne Bert : celle qui veut mourir vous salue 60/62
Libération, 12/04/17
« Marisol Touraine prend une grosse responsabilité en ne déremboursant
pas les médicaments anti-Alzheimer » 62/63
La Croix, 12/04/17
L’hôpital, l’intelligence artificielle et le patient 64/65
Le Monde Economie, 14/04/17
Augmentation des IST : le cri d’alerte des gynécologues 65/66

Elle, 12/04/17
On naît femme, on ne le devient pas 66/69
Causeur, 04/04/17
GPA : lettre ouverte à Emmanuel Macron 69/70
Le Figaro, 19/04/17
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
1
/
75
100%