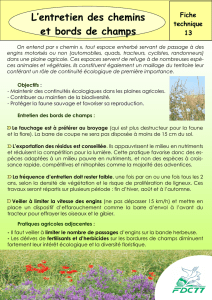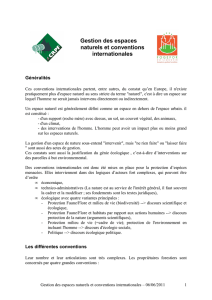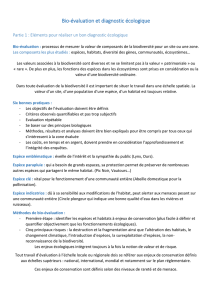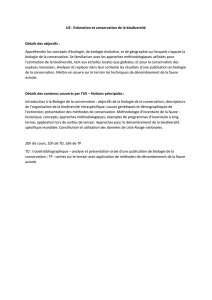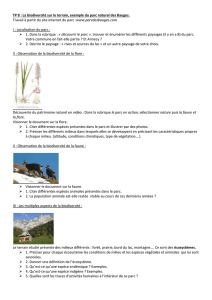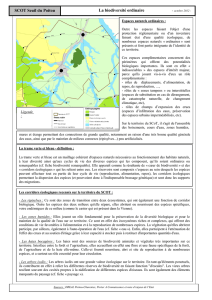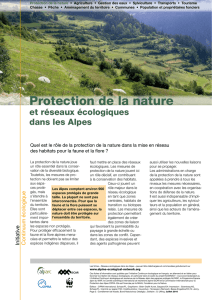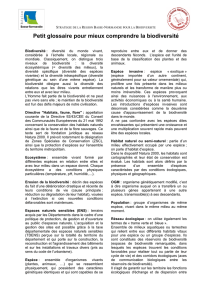Glossaire et acronymes

Axe potentiel de déplacement de la faune
Lieu, passage, ligne directrice de déplacement de
faune déterminés par un expert local, qui concernent
plus particulièrement la grande faune. Ces axes sont
potentiels car ils représentent une liaison supposée
entre un lieu et un autre, passant par les milieux
intermédiaires les plus favorables. Ils viennent
renforcer la trame des réseaux écologiques Ces
données non exhaustives reflètent majoritairement la
connaissance des lieux de déplacements d’animaux
par un ou plusieurs experts locaux et ce, à une
échelle fine.
Biodiversité
La biodiversité désigne la richesse du monde vivant
(faune, flore). Une zone présentant une forte
biodiversité présente un nombre d’espèce
notablement plus important que les zones voisines.
Biotope et Biocénose
Le biotope représente la composante non vivante de
l’écosystème (soit les éléments physiques,
chimiques, climatiques). C’est un milieu homogène
qui contient les ressources suffisantes pour assurer
le développement et le maintien de la vie. Un biotope
donné héberge une faune et une flore spécifique. La
biocénose désigne l’ensemble des êtres vivants
coexistant dans un espace défini (le biotope). Les
limites spatiales et temporelles d’une biocénose sont
celles des populations homogènes qu’elles décrivent.
Un biotope et sa biocénose associée sont en
interactions constantes ; ils constituent un éco-
système.
Biotope + Biocénose + Interactions = Écosystème
Coeur de nature
Secteur à l’échelle de Rhône-Alpes où la circulation
des espèces est globalement bonne même s’il peut
exister des problèmes ponctuels. Ce sont des zones
peu fragmentées, à dominante naturelle (nature
« ordinaire » comme remarquable) où la circulation
des espèces est peu contrainte. Les coeurs de nature
ne sont pas synonymes de réservoirs de biodiversité.
La préservation de la fonctionnalité de ces zones doit
être l’objet d’une attention particulière.
Connectivité
La connectivité permet de décrire comment
l’arrangement spatial et la qualité des éléments du
paysage affectent le mouvement des organismes
entre des fragments d’habitats. Elle a deux
composantes. La première est structurelle et est
déterminée par l’arrangement spatial des différents
types d’habitats dans le paysage. La deuxième est
fonctionnelle, liée à la réponse comportementale des
individus et des espèces à la structure physique du
paysage.
Continuum écologique
Ou continuum écopaysager. C’est un ensemble de
milieux contigus et favorables qui représente l’aire
potentielle de déplacement d’un groupe d’espèces. Il
est composé de plusieurs éléments continus (sans
interruption physique) incluant une ou plusieurs
zones nodales et des zones d’extension. Il comprend
également à sa marge des espaces temporairement
ou partiellement utilisés par la faune selon ses
capacités à s’éloigner des zones de lisières ou des
zones refuges. Cette marge de continuum est très
polyvalente et peut servir de corridor pour des
espèces lors de leur phase de dispersion.
• Continuum aquatique
Structure écopaysagère composée d’habitats de type
aquatique (rivières, ruisseaux, fleuves, plans d’eau…)
ou de zones humides (marais, tourbières, mares…)
et utilisée majoritairement par la faune inféodée au
milieu aquatique.
• Continuum terrestre
Structure écopaysagère composée d’habitats
terrestres (prairies, forêts, haies, bosquets…) et
utilisée majoritairement par la faune inféodée au
milieu terrestre. En fonction des groupes d’espèces
et des milieux qu’ils fréquentent, on peut distinguer
les continuums boisé, agricole extensif, thermophile,
rocheux, etc.
Corridor biologique
Un corridor désigne toute liaison fonctionnelle entre
deux écosystèmes ou deux habitats favorables à une
espèce permettant sa dispersion et sa migration
(pour la reproduction, le nourrissage, le repos, la
migration, etc.). C’est un espace de forme linéaire qui
facilite le déplacement, le franchissement d’obstacle
et met en communication une série de lieux. Il peut
être continu ou discontinu, naturel ou artificiel.
Le corridor peut également jouer le rôle d’habitat : il
est alors une composante fonctionnelle du paysage.
Ces espaces assurent ou restaurent les flux
d’individus et donc la circulation de gènes (animaux,
végétaux) d’une (sous-) population à l’autre; ils sont
donc vitaux pour la survie des espèces et leur
évolution adaptative.
La terminologie des corridors, fortement variable et
parfois contradictoire, est employée dans divers
contextes. Synonymes : couloir ou passage de faune,
corridor d’habitats, corridor de dispersion, corridor de
déplacement, corridor de faune, corridor écologique
ou couloir biologique, bio-corridor, liaison paysagère,
etc. Le terme corridors peut parfois être employé
dans le sens plus large de réseau écologique.
Écologie du paysage
Cette discipline scientifique étudie les interactions
entre l’organisation de l’espace et les processus
écologiques. Elle s’intéresse donc aux impacts des
activités humaines sur l’évolution du paysage et
cherche à identifier les facteurs humains et
écologiques qui influencent l’organisation et
l’hétérogénéité de l’espace à diverses échelles.
Combinant approche spatiale de la géographie et
approche fonctionnelle de l’écologie, elle repose sur
plusieurs théories qui permettent, entre autre, de
décrire les notions de connectivité et de prévoir la
biodiversité des espèces en fonction de la mosaïque
paysagère, dans un souci d’aider à la conservation
voire à la restauration des espaces et des espèces.
Écosystème
Unité écologique fonctionnelle constituée par un
ensemble d’organismes vivants (biocénose)
exploitant un milieu naturel déterminé (biotope). Les
éléments constituant un écosystème développent un
réseau d’interdépendances permettant le maintien et
le développement de la vie. Cette notion intègre les
interactions des espèces entre elles et avec leur
milieu de vie, que ce soit dans la nature « ordinaire »
ou « extraordinaire ».
Écotone
Un écotone est un espace marquant la transition
entre deux écosystèmes dont il se différencie par ses
caractéristiques écologiques propres. Il est
caractérisé par une diversité et une richesse
spécifique souvent plus importantes que celles de
chacune des communautés qu’il sépare car on y
rencontre des constituants des biocénoses situées de
part et d’autre de ce dernier ainsi que des espèces
qui lui sont strictement inféodées (exemples : une
haie, un fossé, une lisière forestière…).
Espace naturel remarquable (ENR)
Ensemble de milieux à forte biodiversité connu ou
reconnu par des inventaires naturalistes (dans la
Cartographie des réseaux écologiques de Rhône-
Alpes, les ENR correspondent aux Znieff de type 1 et
aux zones « Natura 2000 » selon la Directive
Habitats). Ils abritent des espèces et/ou des milieux
naturels (habitats) remarquables et/ou protégés à
l’échelle régionale, nationale voire internationale. Ces
sites peuvent avoir ou pas un statut de protection.
À ne pas confondre avec les ENS, espaces naturels
sensibles, qui sont un outil de protection des espaces
naturels géré par les Conseils généraux.
Espèce
Ensemble des individus appartenant à des
populations interfécondes, c’est-à-dire pouvant se
reproduire entre elles de manière naturelle et
échanger librement leur stock de gènes.
Glossaire et acronymes
C
A
R
T
O
G
R
A
P
H
I
E
D
E
S
R
É
S
E
A
U
X
É
C
O
L
O
G
I
Q
U
E
S
D
E
R
H
Ô
N
E
- A
L
P
E
S
• G
L
O
S
S
A
I
R
E
/ 1

Exemple : schéma illustrant le déplacement d’une espèce
stoppée par la construction d’une route (Jean Carsignol,
Journées Corridors en Rhône-Alpes, 2008).
C
A
R
T
O
G
R
A
P
H
I
E
D
E
S
R
É
S
E
A
U
X
É
C
O
L
O
G
I
Q
U
E
S
D
E
R
H
Ô
N
E
- A
L
P
E
S
• G
L
O
S
S
A
I
R
E
/ 2
Espèce invasive ou espèce envahissante
Espèce faunistique ou floristique exotique qui devient
un agent de perturbation nuisible à la biodiversité
autochtone des écosystèmes naturels parmi lesquels
elle s’est établie par introduction volontaire ou non.
Les phénomènes d’invasion biologique sont
considérés comme une des grandes causes de
régression de la biodiversité, avec la pollution, la
fragmentation écologique des écosystèmes et la
chasse/pêche/surexploitation de certaines espèces.
Exemples : Tortue de Floride, Écrevisse de Louisiane
en Europe, Caulerpa taxifolia en Méditerranée,
Perche du Nil dans le lac Victoria, Renouée du
Japon, Ambroisie…
Fragmentation écopaysagère
Ou morcellement d’habitat. Processus dynamique
formé par deux phénomènes : la disparition d’habitats
et la séparation en plusieurs fragments résiduels
(Bennett, 2003). Il contrarie le déplacement naturel
des espèces, des individus et des gènes au sein de
leur aire normale de répartition, au point de
provoquer leur régression ou disparition. Exemples :
de nombreuses infrastructures routières ou
ferroviaires constituent des barrières pour certaines
espèces. Leur construction peut signifier la
fragmentation des habitats naturels. L’urbanisation
constitue également un mécanisme de fragmentation.
Les conséquences de la fragmentation des habitats
sont, entre autre :
– obstacles au déplacement, isolement des
fragments ;
– réduction des superficies « continues »
d’habitat ;
– effet Bordure (augmentation des zones
écotonales) ;
– érosion de la biodiversité ;
– modification des processus écologiques au sein
des fragments.
Gène, génome, diversité génétique
Le génome est constitué de l’ensemble du matériel
génétique (les gènes) d’une espèce. La diversité
génétique est une caractéristique décrivant le niveau
de variabilité des gènes au sein d’une même espèce
(diversité intraspécifique). C’est un des aspects
essentiels de la biodiversité sur notre planète.
Habitat naturel
L’habitat correspond au lieu où vit une espèce
donnée. Il contient tous les éléments physiques et
biologiques du paysage utilisés par une espèce à l’un
des stades de son cycle de développement, ou pour
tout son cycle (Burel & Baudry, 1999).
Hétérogénéité
L’hétérogénéité intègre la diversité des éléments du
paysage (dans leur forme, leur taille ou leur nature) et
leur arrangement spatial (mosaïque d’habitat et
écotones) (Burel & Baudry, 1999).
Hot spot
Voir spot de biodiversité.
Infrastructure/Aménagement du territoire
Une infrastructure est une construction le plus
souvent linéaire (les plus courantes sont les voies de
communication routière ou ferroviaire) qui constitue
une barrière plus ou moins franchissable selon les
espèces (selon si elle est grillagée ou non, selon
l’importance du trafic, la largeur de l’emprise, etc.).
Leur construction participe à la fragmentation de
l’habitat et diminue voire condamne la connectivité de
la mosaïque paysagère.
Infrastructure verte et bleue
Trame verte et bleue
Ensemble d’espaces (« vert » pour les milieux
naturels terrestres ; « bleu » pour les milieux naturels
aquatiques) reliés et hiérarchisés comprenant à la
fois :
– les grands axes de déplacement des animaux
ou « continuums écologiques », garants de la
survie des populations et reliant les foyers de
nature et de biodiversité de grands ensembles
naturels ;
– les déplacements doux des hommes, espaces
d’aménités reliant les lieux de vie et de loisirs
du territoire.
Insularisation
La notion d’insularisation en écologie du paysage
décrit l’isolement d’une population ou d’un groupe de
populations sur un territoire. Plus une « île
écologique » est petite et isolée, moins les espèces
qui y vivent ont des chances de survie à long terme.
Quand il est naturel, ce phénomène est souvent très
lent (sur des siècles, des millénaires) et il peut alors
contribuer à la spéciation (apparition de nouvelles
espèces). Quand il est lié à l’homme, il est souvent
brutal (populations vivant sur des territoires entourés
d’éléments paysagers devenus hostiles :
déboisement, urbanisation, changement d’occupation
du sol, etc.). C’est un facteur de dérive génétique,
d’affaiblissement et de disparition de population voire
d’espèce.
Matrice paysagère
Élément dominant, le plus étendu et le mieux
connecté, d’un paysage homogène. La matrice est
réputée défavorable aux flux debiodiversité au sein
du paysage (elle est alors exprimée comme
« rugueuse » voire « hostile »). Elle peut toutefois
être le support d’une biodiversité qui lui est
particulière.
Métapopulation
Une métapopulation est un ensemble de populations
d’une même espèce, séparées spatialement et
pouvant se connecter de façon transitoire entre elles
pour permettre la migration. Elle se caractérise
également par des phénomènes d’extinction et de
(re)colonisation grâce à la migration des individus
(d’après Levins, 1969) entre les habitats favorables.
Migration, dispersion, mouvement,
colonisation
Ces termes désignent le déplacement d’un
organisme. Les processus biologiques associés
dépendent de la manière dont l’organisme occupe
l’espace ou du processus de déplacement au cours
de son cycle de vie. Les termes de migration/
dispersion sont souvent associés à des mouvements
saisonniers de faune (pour l’hivernation, la
reproduction, la ponte…) à caractère périodique qui
implique un retour régulier dans la région de départ.
Les mouvements sans retour, qui conduisent à une
extension de l’habitat de l’espèce, correspondent
plutôt à un phénomène de colonisation.
Les déplacements ou mouvements d’individus
peuvent également être journaliers (recherche de
nourriture).
Ces termes, migration, dispersion, colonisation,
s’appliquent également aux espèces végétales, mais
sur des échelles temporelles et spatiales très
différentes.

C
A
R
T
O
G
R
A
P
H
I
E
D
E
S
R
É
S
E
A
U
X
É
C
O
L
O
G
I
Q
U
E
S
D
E
R
H
Ô
N
E
- A
L
P
E
S
• G
L
O
S
S
A
I
R
E
/ 3
Morcellement des habitats.
Voir fragmentation écopaysagère
Mosaïque d’habitat
Assemblage d’éléments de nature différente. La taille
moyenne de ces éléments définit le « grain » de la
mosaïque (Burel et Baudry, 1999).
Nature ordinaire
Elle représente les territoires de nature abritant des
habitats et des espèces indigènes ni rares ni
menacés, l’occupation naturelle banale d’un territoire.
Indispensable au bon fonctionnement des réseaux
écologiques, elle possède un rôle important de
corridor biologique : les milieux naturels qui la
composent facilitent les déplacements de la faune et
de la flore sur un territoire.
Nature remarquable
Elle représente des territoires de nature abritant
des habitats et des espèces rares et/ou menacés
par les activités humaines. Ce sont de véritables
réservoirs de biodiversité. L’ensemble de la nature
remarquable n’est pas systématiquement référencé
par des inventaires naturalistes et n’est donc pas
toujours reconnu en tant qu’Espaces Naturels
Remarquables.
Obstacle
Ou barrière. Site ou phénomène local bien délimité
contraignant totalement ou partiellement le passage
des organismes vivants. Il peut être naturel (fleuve,
falaise…), ou lié aux activités humaines
(infrastructures routières et ferroviaires, barrages et
seuils…). Selon l’échelle d’analyse et les espèces
concernées, de nombreux autres éléments peuvent
former une barrière: pollution, lumière, bruit… Dans
ce document, seuls les obstacles anthropiques sont
représentés en tant que tels dans l’Atlas commenté
de la Cartographie des réseaux écologiques de
Rhône-Alpes. En échange, des obstacles naturels,
comme des pentes supérieures à 45°, ont été
intégrés aux continuums (cf. document Méthode).
Passage à faune
Ou écoduc. C’est un passage construit par l’homme
pour permettre aux espèces animales et végétales de
traverser des infrastructures (routes, autoroutes,
voies ferrées) ou tout élément qui fragmente le
paysage. Ces ouvrages sont des substituts, artificiels
et ponctuels mais en théorie fonctionnels, aux
corridors biologiques : ils rétablissent la connectivité
écologique (mesure de réduction de l’impact). Les
passages « petite faune » sont réalisés pour les
espèces de petite taille comme les amphibiens, les
petits mammifères…Les passages à grande faune
s’entendent pour les grands mammifères, ongulés en
particulier.
Point de conflit
Point d’intersection entre un élément du réseau
écologique et un obstacle, se traduisant, entre autre,
si la connectivité n’est pas complètement rompue,
par des écrasements de faune.
Population
Ensemble des individus d’une même espèce qui
interagissent et se reproduisent sur un territoire
donné. Lorsqu’une population présente un nombre
insuffisant d’individus, elle risque de disparaître, soit
par sous-effectif soit par consanguinité. Une
population peut se réduire pour plusieurs raisons, par
exemple, par disparition de son habitat
(fragmentation, destruction d’habitat naturel) ou par
prédation excessive.
Réseau écologique
Ou trame (verte et/ou bleue). Concept théorique de
l’écologie du paysage, il comprend l’ensemble des
éléments naturels ou seminaturels présents dans un
paysage pouvant être le support de flux de
biodiversité (haies, bosquets, mares, prairies, bandes
enherbées, etc.). Il est composé de zones nodales,
zones d’extension, de zones relais, de corridors
zones d’extension, de zones relais, de corridors
biologiques… Dans la Cartographie des réseaux
écologiques de Rhône-Alpes, la trame écologique
globale résulte d’un cumul de 7 continuums
écopaysagers. Le réseau écologique est donc dans
ce cas un ensemble fonctionnel de continuums et de
corridors offrant une capacité d’accueil pour une
majorité d’espèces.
Réservoir de biodiversité
Ou zone réservoir, zone nodale, zone à biodiversité
élevée. Ce sont des espaces naturels où la
biodiversité est particulièrement riche, et où les
conditions vitales au maintien et au fonctionnement
d’une ou plusieurs espèces sont réunies (une espèce
Schéma d’un réseau écologique
peut y exercer un maximum de son cycle de vie :
alimentation, reproduction, repos…). Ces zones
assurent le rôle de « réserve » pour la conservation
des populations et pour la dispersion vers d’autres
espaces vitaux potentiels. Les Espaces Naturels
Remarquables sont des réservoirs de biodiversité.
Spot de biodiversité
Dans le cadre de la Cartographie des réseaux
écologiques de Rhône-Alpes, ce terme revêt une
définition très spécifique : il s’agit de sites,
mentionnés par des experts ou des acteurs locaux,
qui accueillent des espèces ou des habitats à
préserver pour le maintien de la biodiversité.
Trame
Voir réseau écologique.
Zone d’extension
Ou zone de développement, zone tampon… Espace
de déplacement des espèces en dehors des zones
nodales. Il est composé de milieux plus ou moins
dégradés et plus ou moins facilement franchissables,
mais qui peuvent accueillir différentes espèces.
Espace qui préserve aussi les coeurs de biodiversité
et les corridors des influences extérieures.
Zone relais (ou milieu relais)
Elle correspond à une zone d’extension non contiguë
à une zone nodale. De taille restreinte, elle présente
des potentialités de repos ou de refuge lors de
déplacement hors d’un continuum.
Zone nodale
Ou noyau, zone réservoir. Habitat ou ensemble
d’habitats dont la superficie et les ressources
permettent l’accomplissement du cycle biologique
d’un individu (alimentation, reproduction, survie).
Dans ce document, c’est le point de départ des
déplacements des individus au sein d’un continuum.
1
/
3
100%