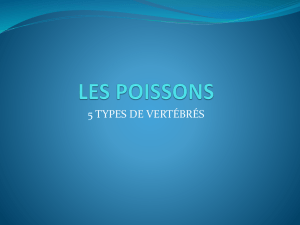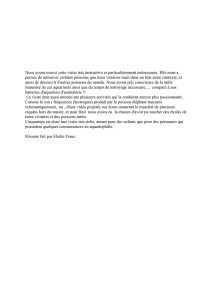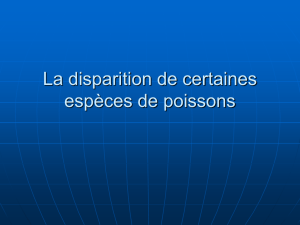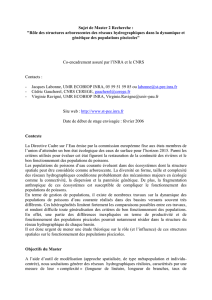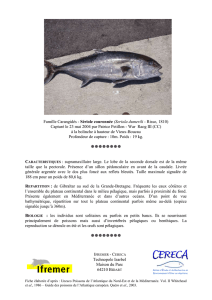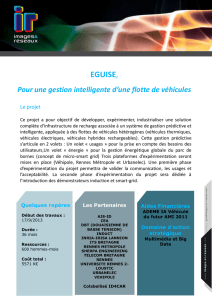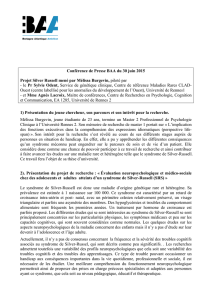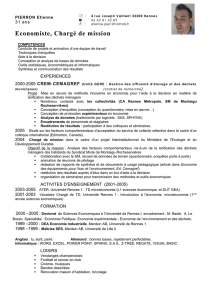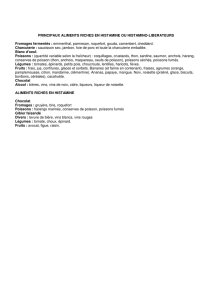fiche détaillée - Université de Rennes 1

ORIGINALITÉ DES POISSONS COMME MODÈLES
POUR LA RECHERCHE FONDAMENTALE ET BIOMÉDICALE
(J.-J. Lareyre, SCRIBE-INRA Rennes)
Les poissons, en tant qu’animaux de laboratoire, se sont imposés com-
me une alternative ecace et moins coûteuse à l’utilisation des modèles
mammifères dans le cadre d’études toxicologiques. Leur positionnement
phylogénétique original chez les vertébrés fait qu’ils sont aujourd’hui lar-
gement utilisés dans les recherches fondamentales et biomédicales. La
diversité des espèces de poisson ore la possibilité d’expérimenter sur
des animaux aux caractéristiques physiologiques ou génétiques extrêmes
(durée de vie, compaction des génomes…). L’intérêt de la diversité des
espèces et des souches mutantes, naturelles ou obtenues par les techni-
ques de génie génétique (transgénèse, mutagénèse aléatoire ou ciblée
(tilling)…), sera illustré au travers d’exemples portant sur l’étude de cer-
tains cancers (mélanomes), du vieillissement, ou des maladies génétiques
humaines (anémies et porphyries congénitales…).
http://etudes.univ-rennes1.fr/master-bapsa/
w
Master BIOLOGIE, AGRO, SANTÉ
Spécialité BAPSA
GRANDES FONCTIONS PHYSIOLOGIQUES DES POISSONS :
APPLICATIONS À LA PISCICULTURE ET À LA RECHERCHE
FONDAMENTALE
Responsables : Lareyre J.-J., Le Bail P.-Y.
UE BIOPOISSONS
Spécialité BAPSA
Biologie appliquée aux productions et à la santé animales
Master
BIOLOGIE, AGRO, SANTÉ

w
Fonction de reproduction
Déterminismes et différenciation du sexe chez les
poissons (Yann Guiguen, SCRIBE-INRA Rennes)
Les poissons présentent une extraordinaire diversité des
modes d’expression de leur sexualité avec des espèces
hermaphrodites synchrones ou successives et des espèces
gonochoriques strictes. Les déterminismes du sexe sont
multiples: soit génétiques mono ou poly factoriels avec
ou sans chromosomes sexuels diérenciés soit environne-
mentaux (température, pH, densité, interactions sociales),
voire des combinaisons de ces deux types de déterminis-
mes. La diérenciation sexuelle de la gonade est forte-
ment dépendante du contexte stéroïdien et en particulier
des capacités de synthèse des oestrogènes qui jouent un
rôle prépondérant
au moins dans la
différenciation
ovarienne. Ce rôle
clef des hormones
stéroïdiennes a de
fait de nombreu-
ses applications
pour le contrôle
du sexe phénotypique des poissons qui est une biotech-
nologie importante pour la pisciculture moderne.
Neuroendocrinologie (Olivier Kah, UMR 6026 CNRS-Ren-
nes I)
Le cerveau intervient dans toutes les étapes du processus
reproducteur principalement en contrôlant la libération
des hormones gonadotropes hypophysaires, LH et FSH.
Ceci s’eectue grâce à la sécrétion de neurohormones
parmi les quelles la GnRH (gonadotrophin-releasing hor-
mone) est la plus importante. L’activation des neurones
à GnRH à la puberté constitue une étape cruciale placée
sous la dépendance de multiples facteurs endogènes, qui
renseignent le système nerveux central sur la croissance
et l’état nutritionnel de l’organisme, et exogènes, qui per-
mettent de synchroniser les partenaires d’une part entre
eux et d’autres part avec leur environnement. Le cours
s’attachera à dégager les aspects essentiels de ces méca-
nismes en montrant comment le dialogue permanent en-
tre le système nerveux et le système endocrinien conduit
au succès de la reproduction et permet ainsi la survie des
espèces.
Ovogenèse (Julien Bobe, SCRIBE-INRA Rennes)
Ce cours s’appuie sur les problèmes récurrents de maîtrise
de la qualité des œufs de poissons rencontrés en élevage
et sur le verrou constitué par ce facteur pour le dévelop-
pement de l’élevage de nouvelles espèces. La qualité de
l’œuf, ou, compétence ovocytaire au développement en
termes biologiques repose sur une construction progres-
sive tout au long de l’ovogenèse. Après avoir brossé un ta-
bleau rapide de l’ovogenèse chez les poissons notamment
via de nombreux exemples, il sera fait état des diérentes
façons d’évaluer la qualité des œufs ainsi que des connais-
sances actuelles sur les facteurs environnementaux ou
zootechniques qui inuencent la qualité des œufs de
poisson. Enn, un bref aperçu des résultats récents sur les
mécanismes cellulaires ou moléculaires participant à l’ac-
quisition d’une bonne qualité ovocytaire s era proposé.
Spermatogenèse (Florence Le Gac, SCRIBE-INRA Ren-
nes)
Après un rappel sur les évènements cellulaires et déve-
loppementaux communs aux testicules des diérents
vertébrés, nous insistons sur les organisations spatiales
et temporelles de
la spermatogenèse
diverses et origina-
les des poissons.
Les régulations hor-
monales de la sper-
matogenèse sont
abordées par des
données d’endo-
crinologie classique (hormones gonadotropes, stéroides
sexuels) et des approches moléculaires des mécanismes
d’action des hormones dans le testicule. Les interactions
entre fonctions de croissance et de reproduction, souvent
marquées au moment de la puberté, sont présentées en
relation avec le rôle des hormones du métabolisme sur
l’axe hypophyso-gonadique. La morphologie et les mé-
canismes de la motilité des spermatozoïdes sont décrits,
ainsi que la régulation de leur maturation nale et de leur
excrétion. Les applications piscicoles de ces connaissan-
ces sont discutées.
w
Fonction de croissance
Différenciation, développement et croissance musculaires
(Pierre-Yves Rescan,
SCRIBE-INRA Rennes)
Ce cours rassemble
les connaissances ac-
quises ces dernières
années sur les mé-
canismes cellulaires
et moléculaires dont
dépendent la forma-

tion embryonnaire et la croissance post-larvaire du muscle
myotomal du poisson. L’accent est mis sur la compartimen-
talisation précoce du somite embryonnaire conduisant à
la spécication et à l’émergence de populations de cellu-
les musculaires distinctes qui interviendront séquentielle-
ment dans le développement et l’expansion du myotome.
Les données présentées dans ce cours seront assorties
d’un aperçu des innovations méthodologiques qui les ont
rendus possibles.
Contrôle endocrinien de la croissance (Jean-Charles
Gabil-lard, SCRIBE-INRA Rennes)
La croissance des poissons, comme des mammifères, est
contrôlée par un système complexe d’hormones : le systè-
me GH/IGF (axe somatotrope). Ce système est principale-
ment constitué de l’hormone de croissance (GH) produite
par l’hypophyse et par les Insulin-like Growth factors (IGF1
et IGF2) produits principalement par le foie. Au cours des
saisons, la croissance de la plupart des poissons varie pa-
rallèlement à l’activité du système GH/IGF. Enn, parmi les
facteurs environnementaux, la prise alimentaire et la tem-
pérature inuencent fortement l’activité du système GH/
IGF et donc par conséquent la vitesse de croissance des
poissons.
w
autres Fonctions physiologiques
Osmorégulation et adaptation au milieu (Patrick Prunet,
SCRIBE-INRA Rennes)
Nous contacter
Nutrition et nouveaux aliments ou Bases physiologi-
ques de la nutrition (Françoise Médale, NUAGE-INRA
St-Pée-sur-Nivelle)
La première partie du cours est consacrée aux besoins nu-
tritionnels des principales espèces de poissons d’élevage
et à leurs capaci-
tés digestives et
métaboliques an
de faire connaitre
les bases physio-
logiques de la for-
mulation des ali-
ments piscicoles.
Ces connaissances
permettent de comprendre l’intérêt et les limites de ma-
tières premières alternatives pour réduire l’emploi de la
farine et l’huile de poisson, issues de la pêche. A l’aide
d’exemples issus des travaux de recherche, le cours détaille
les conséquences du changement de composition des ali-
ments sur le développement précoce et la croissance des
poissons, la qualité des produits et les rejets dans l’envi-
ronnement.
w
génétique et Biotechnologies
Amélioration génétique (Marc Vandeputte, GDR INRA-
IFREMER “Amélioration génétique des poissons”, Pala-
vas-les-Flots)
L’objectif de ce cours est de présenter les diérentes métho-
des d’amélioration génétique utilisées chez les poissons,
et particulièrement la sélection, les manipulations chro-
mosomiques et la transgenèse. Les méthodes de sélection
«classique» utilisent le cadre de théorique de la génétique
quantitative, dont l’adaptation au poisson sera étudiée en
détails. En particulier, l’utilisation de généalogies obtenues
par génotypage de marqueurs sera étudiée en détails.
Les manipulations chromosomiques (triploïdie, gynoge-
nèse) et leur application pour le contrôle de la maturation
sexuelle seront passées en revue. Enn, les applications
«agronomiques» de la transgenèse chez les poissons se-
ront vues sur le plan des techniques utilisées, des résultats
obtenus, et des risques réels ou perçus de leur utilisation
en production.
Biotechnologies de la cryoconservation et de la régé-
nération des génomes (Catherine Labbé, SCRIBE-INRA
Rennes)
Ce cours s’appuie sur les diérents besoins de conserva-
tion des ressources génétiques aquacoles pour des popu-
lations domestiques et sauvages et développe l’une des
stratégies de conservation qui est la cryoconservation des
cellules. Les don-
nées fondamen-
tales de cryobio-
logie permettant
de comprendre
l’origine des
dommages après
cryoconservation
sont expliquées.
Les forces et fai-
blesses des spermatozoïdes, ovocytes, embryons, cellules
et tissus somatiques comme support de l’information gé-
nétique sont développées en relation avec leurs capacités
de cryoconservation. La dernière partie est consacrée aux
méthodes actuelles de régénération des individus à partir
des diérents supports cryoconservés, incluant l’androge-
nèse, la gree de cellules germinales et le transfert nucléai-
re (ou clonage).

Responsables de l’UE BioPoissons
Pierre-Yves Le Bail
INRA SCRIBE
Campus de Beaulieu • 35042 Rennes Cedex
Tél. : 02 23 48 50 19
Courriel : pierre-yves[email protected]
Jean-Jacques Lareyre
INRA SCRIBE
Campus de Beaulieu • 35042 Rennes Cedex
Tél. : 02 23 48 57 23
Courriel : jean-jacques.lareyre@rennes.inra.fr
Responsables de la spécialité BAPSA
Christian Saligaut
Université de Rennes 1 - UFR SVE
Campus beaulieu - Bâtiment 13 - Bureau 037 • 35042 Rennes Cedex
Tél. : 02 23 23 68 23
Courriel : [email protected]
Pierre-Guy Marnet
Département sciences animales et UMR INRA - AGROCAMPUS OUEST Production du lait
Directeur scientique d’AGROCAMPUS OUEST
65 rue de St-Brieuc • 35042 Rennes Cedex
Tél. : 02 23 48 53 71 (dépt sciences animales) ; 02 23 48 56 81 (direction scientique)
Courriel : pierre-guy[email protected]
© 2009
Conception et réalisation :
Cellule de diffusion scientique INRA / AGROCAMPUS
OUEST
Photos © INRA : photothèque et © Fotolia.com : Karl
Bolf, Rémy MASSEGLIA, Ildar Abul`khanow
CONTACTS
1
/
4
100%