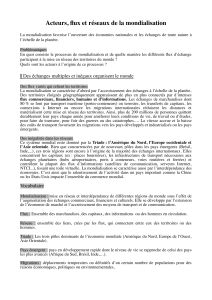Colloque_mondialisation et l'Afrique.doc

2
2
Introduction : La mondialisation phénomène controversé mais
incontournable : quelle signification ?
1) La mondialisation est probablement un des concepts les plus vivement
controversés à cause de son caractère polymorphe. Il est parfois défini comme
un processus d’intégration mondiale des économies et des société, parfois
comme le développement d’une économie globale de plus en plus intégrée,
caractérisée par le libre-échange, la libre circulation des Technologies de
l’information et de la communication, des capitaux et des investissements sur
les marchés du travail étranger et parfois comprise comme la convergence des
systèmes économiques, politiques et culturels.
Le monde est trop vaste, trop divers, trop peuplé et trop traversé par
des mutations incontrôlables pour que la mondialisation n'ait qu'un
seul maître d'œuvre.
La mondialisation que nous subissons présentement n'est pas la
première de notre histoire, mais elle est différente à cause de son
ampleur.
La mondialisation est un phénomène irréversible ; elle est une
révolution à ses débuts et sera ce que nous déciderons qu'elle soit.
La première phase, de 1995 à 2000, fut sauvage et n'a bénéficié qu'à
quelques majors ; elle a diminué le pouvoir des États-nations et
appauvri les citoyens parce qu'elle n'avait pas de projet de société.
Maintenant qu'une deuxième phase commence, les négociations
entre les partenaires socioéconomiques seront beaucoup plus
ardues, comme l'indiquent les échauffourées de Seattle, de Davos, de
Gênes, de Prague ou de Québec. Afin de développer « un demain
plus généreux», tous les acteurs doivent connaître cette force qui
propulse le développement de notre société.
La mondialisation ne crée pas un village planétaire comme on le
pense, mais un système-monde beaucoup plus sophistiqué qui
s'impose actuellement sans mode d'emploi.
2) En l’absence de consensus sur la définition, les pratiques et les
tendances qui configurent l’économie mondiale, dans sa double sphère réelle
et monétaire, laissent apparaître 4 interdépendances caractéristiques :
L’internationalisation de la production par les firmes multinationales qui
réalisent une décomposition internationale des processus productifs en
s’appuyant sur un réseau de filiales ou de sous- traitants et en organisant le
nomadisme de segments entiers des appareils de production selon la
logique des avantages comparatifs ;
L’explosion des échanges commerciaux des produits, des biens et des
services rendus possible par la disparition des frontières géographiques,
l’abaissement des barrières tarifaires et non tarifaires qui accélère alors les

3
3
échanges commerciaux et par les énormes progrès de tous les modes de
transport.
La formation d’un méga marché des capitaux qui procède de
l’interconnexion des places financières mondiales grâce à la conjugaison de
trois éléments que sont la désintermédiation financière, le
décloisonnement des marchés et la déréglementation.
L’implosion des Technologies de l’Information et de la Communication qui
permet le développement d’une économie virtuelle et l’intensification de la
mobilité et de la flexibilité des capitaux, des biens, des services et des
personnes
Si l’on s’intéresse à la compétition entre nations à l’échelle mondiale, les pays
capitalistes développés conservent un rôle moteur dans la mondialisation. Ils
réalisent, au milieu de la décennie 2000-2010, 75 % des exportations mondiales, et
80 % des échanges de services. Ils effectuent plus de 80 % des IDE mondiaux, et
reçoivent également 60 % de ces mêmes investissements. En d’autres termes,
aujourd’hui comme par le passé, les IDE sont essentiellement des investissements
croisés entre pays à hauts revenus.
S’il y a une chose qui a été vraiment marquante durant les 5 dernières
décennies, c’est bien la réussite insolente des Pays Emergents d’Asie et d’Amérique
Latine qui ont pu construire des systèmes économiques pertinents et performants. Ils
sont sortis du sous-développement en l’intervalle d’une génération. Ils ont réussi à
opérer un basculement des lieux de croissance et de commerce et à déplacer le centre
de gravité du commerce mondial en s’appuyant sur plusieurs facteurs : les salaires
bas eu égard à la productivité, la faible protection sociale, les taux de change
modulables, la politique sélective de soutien aux exportations et la mise en place
d’institutions solides d’encadrement au premier rang desquelles « l’Etat pro » :
programmeur, producteur, prospecteur.
L’Afrique, quant à elle, n’a point bénéficié des opportunités offertes par la
mondialisation.
1) Un concept polymorphe : une réalité, plusieurs dimensions
De toute évidence, il n’existe pas de définition de la mondialisation qui soit
admise pour tous. Toutes les définitions existantes sont souvent incomplètes ou
discutables. Cela atteste de la réalité complexe qui se cache derrière ce mot. Retenons
que la configuration observable de la mondialisation, c’est d’abord l’effacement des
frontières (décloisonnement) qui permet une libre circulation des biens et des
capitaux, des technologies et des personnes ; celle-ci n’obéit qu’à une logique unique
de rendement optimal: une transaction peut se produire entre deux entités, dans
deux endroits différents, pour le compte d’un client situé dans un troisième avant
d’être conclu dans un quatrième endroit. C’est ensuite une tentative de gommage des
frontières institutionnelles avec l’exclusion des Etats au profit du tout marché : les
grandes institutions économiques et financières exercent désormais plusieurs métiers
sur des espaces unifiés. Enfin, les progrès technologiques introduisent les innovations
et les transformations majeures dans tous les secteurs et assurent une parfaite
interconnexion du territoire mondial.
2) Elle peut s’appréhender à partir de 4 interdépendances
caractéristiques

4
4
En l’absence de consensus sur la définition, les pratiques et les tendances de
l’économie mondiale, dans sa double sphère réelle et monétaire, fixent les contours
du phénomène à travers ses 4 grandes manifestation laissent apparaître un certains
nombre d’interdépendances dont la claire perception permet d’évaluer les coûts et
les opportunités et des mesurer les conséquences à la fois sur les économies et sur les
différents acteurs.
La première interdépendance est relative à la production : un système
productif dominé par des firmes multinationales.
La seconde interdépendance est relative au surdéveloppement des échanges. Alors se
pose à savoir la question suivante : comment accéder aux marchés ?
La troisième interdépendance concerne les marchés financiers. Comment capter les
ressources pour financer les opportunités d’investissements ?
La quatrième interdépendance est relative au facteur déterminant des Technologies
de l’Information et de la Communication. Quelles chances offrent-t-elles dans le
domaine de l’innovation ?
3) Elle a des incidences multiformes
Dans sa configuration, la mondialisation laisse apparaître de
fortes inégalités : celles qui existent d’abord entre les pays et celles
observées au sein même des pays, qu’ils soient du Nord ou du sud.
La mondialisation impose la diffusion des mécanismes de
marché à l’ensemble de la planète et la libéralisation de toutes
les économies. Plus le monde sera ouvert et libéral, plus la croissance
sera élevée, plus le bien-être se généralisera.
Au plan politique, la mondialisation se traduit par l’imposition à
toutes les sociétés du modèle de démocratie occidentale et de
défense des droits de l’homme comme le socle minimal de la nouvelle
civilisation universelle. Il repose sur l’idée implicite de l’existence de
valeurs universelles dans lesquelles devaient se reconnaître l’ensemble des
« citoyens du monde ».
Considérée donc, à juste titre, comme un phénomène polymorphe, elle pose
des questions déterminantes pour l’ordre national :
Offre-t-elle les mêmes chances et les mêmes avantages à tous les
partenaires ou participants? Est-elle inéluctable ou contournable ?
Quelles sont objectivement ses conséquences directes et indirectes sur les
différents partenaires singulièrement les plus faibles d’entre eux?
1
Pourra-t-elle contribuer positivement à la croissance économique des pays
d’Afrique sub-saharienne comme la Côte d’Ivoire, au développement de
l’emploi, à l’éradication de la pauvreté et à la réduction des inégalités ?
Quel sort réserve-t-elle aux acteurs nationaux les plus fragiles et les plus
déficients ? Va-t-elle harmoniser les structures institutionnelles et les
normes et valeurs propres aux sociétés ?
Si la mondialisation constitue une aubaine pour les pays capitalistes
développés et les pays émergents d’Asie et d’Amérique Latine, l’Afrique ne bénéficie
point des opportunités offertes. Des évolutions majeures sont, certes, intervenues,
1
Moustapha KASSE (2003) : De l’UEMOA au NEPAD : le nouveau régionalisme africain, Edition Nouvelles
du Sud, 256 p

5
5
mais cela ne permet pas de conclure que "le continent est véritablement sur le point
de prendre en marche le train de la mondialisation". En dépit de l'accélération de la
croissance, de la progression du PIB par tête, de la hausse de la part des échanges de
marchandises dans le PIB, de l'accroissement des flux d'investissements directs
étrangers (IDE) sur le continent ou encore de la diversification des partenaires
étrangers, la part de l'Afrique dans le commerce mondial ou dans les IDE est encore
très faible. L’Afrique souffre d’un quadruple handicap : sa spécialisation quasi
exclusive dans les matières premières, son poids économique réduit, la trop petite
taille des nations et sa faible capacité de négociation dans les instances
internationales.
I/ Les gagnants et les perdants de la mondialisation
1) Au niveau des Pays Développés
Pour les pays riches, la mondialisation économique comporte deux bénéfices
essentiels. Le premier profite au consommateur, qui a accès à un éventail plus large
de biens (diversité) à un prix plus faible que s'ils étaient fabriqués dans le pays même.
Le second bénéfice profite aux détenteurs du capital, qui obtiennent un meilleur
rendement de leurs capitaux. Les pays riches souffrent en revanche de la
délocalisation de leurs industries intensives en main-d'œuvre peu qualifiée, ainsi que
de la concurrence accrue entre pays riches eux-mêmes. Quantitativement peu
importants, ces effets posent cependant des problèmes du fait qu'ils sont localisés,
touchant particulièrement certains individus ou certaines régions, alors que les gains
sont répartis sur l'ensemble de la population.
2) Les pays émergents d’Asie en ont tiré les meilleurs profits pour
sortir du sous-développement en l’intervalle d’une génération et
devenir de redoutables puissances industrielles, financières et
technologiques.
Le modèle des pays d’Asie est riche d’enseignements pour la Côte d’Ivoire et
l’ensemble des pays africains. La success story de ces pays est la preuve que l’espoir
est permis. En effet, dans les années soixante, ces pays et l’Afrique (Corée du Sud
versus Côte d’Ivoire) n’étaient guère différents en termes de niveau de
développement. Aujourd’hui, ces pays ont pu construire des systèmes économiques
pertinents et performants qui leur ont permis en l’intervalle d’une génération de
sortir du sous-développement. S’il y a une chose qui a été vraiment marquante durant
les 5 dernières décennies de mondialisation, c’est bien la réussite insolente des pays
d’Asie du Sud-est et certains pays d’Amérique latine. On parle même souvent de
miracle tellement ces derniers ont su profiter de la mondialisation.
3) Comment ont-ils fait ?
Si les variables quantitatives et mêmes qualitatives sont bien connues, ce qui
l’est moins, c’est la compréhension de leurs enchaînements, de leur mise en œuvre,
dans les politiques économiques appropriées. Dans le cas de l’Asie, le modèle de
développement asiatique et ses performances se fondent sur quatre préalables :
philosophiques et culturels, économiques, institutionnels et sociaux.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
1
/
11
100%