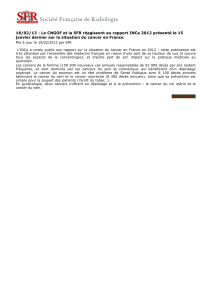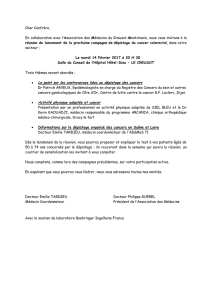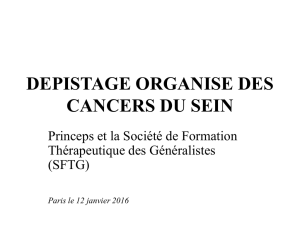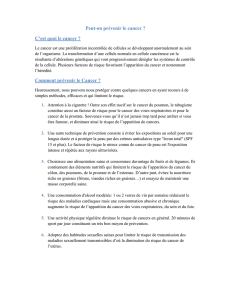L Dépistage organisé du cancer du sein : le point en 2014

P. Cottu
M. Espié
208 | La Lettre du Cancérologue • Vol. XXIII - n° 6 - juin 2014
Actualités sur
laPRÉVENTION
Dépistage organisé du cancer
du sein : le point en 2014
The 2014 status of mammography screening programs
P. Cottu*, M. Espié**
* Département d’oncologie médicale,
Institut Curie, Paris.
** Centre des maladies du sein, hôpital
Saint-Louis, université Paris-Diderot,
Paris.
L
e cancer du sein est un problème majeur de
santé publique, touchant chaque année près
de 53 000 nouvelles femmes en France et
entraînant le décès de plus de 10 000 d’entre elles.
Le pronostic du cancer du sein reste actuellement
étroitement lié au stade de la maladie lors du diag-
nostic, représenté essentiellement par la taille tumo-
rale et l’envahissement ganglionnaire axillaire. Les
autres paramètres pronostiques utilisés en routine
sont l’âge, le grade histopronostique, la prolifération
et le statut des récepteurs (hormones sexuelles et
HER2). Les causes du cancer du sein restent incon-
nues à ce jour, tous les facteurs de risque connus
n’augmentant que modérément le risque en dehors
des histoires familiales. Les traitements préventifs
restent donc réservés aux études cliniques pros-
pectives. Le cancer du sein se prête en revanche
parfaitement à un dépistage organisé, c’est-à-dire
à la détection dans une population asymptomatique
d’une maladie sans signe clinique, selon les critères
de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).
Le cancer du sein représente un enjeu de santé
publique, son histoire naturelle est suffi samment
identifi ée, il existe un test acceptable et reproduc-
tible, cliniquement et économiquement (la mammo-
graphie), avec des possibilités thérapeutiques peu
invasives s’adressant aux formes précoces ainsi
diagnostiquées. Malgré les résultats concordants
de plusieurs études randomisées, il persiste une
vive polémique sur le bénéfi ce réel apporté par le
dépistage du cancer du sein. Nous nous proposons
donc de faire le point.
L'expérience française
Les données françaises ont été revues en détail par
2 rapports récents de l’Institut national de veille
sanitaire (InVS) [1] et de l’Institut national du cancer
(INCa) [2]. Le rapport de l’InVS rappelle que le
programme français de dépistage organisé a été
mis en place en 1994 sur les recommandations de
l’Union européenne, avec des mises à jour régulières
du cahier des charges, dont l’introduction dès 2008
de la mammographie numérisée. Ce programme
repose sur la convocation systématique tous les
2 ans des femmes âgées de 50 à 74 ans, avec
double lecture aveugle des clichés. Il coexiste avec
le dépistage individuel, non organisé et non pris en
charge, et qui ne comporte pas de double lecture.
Le dépistage individuel n’est pas évalué, au contraire
du dépistage organisé, dont l’évaluation repose sur
2 types de données transmises par les structures
de coordination départementales : les chiffres de
participation et les données individuelles anony-
misées des femmes ayant participé au dépistage.
Tableau I. Nombre et taux de cancers diagnostiqués à la suite d’un dépistage dans le programme depuis 2006. Standardisation sur l’âge (d’après le rapport
InVS 2010).
2006 2007 2008 2009 2010
Nombre de cancers 14 418 14 879 15 525 15 959 16 116
Taux de cancers (‰) 7,0 6,9 6,9 6,8 6,8
Premier dépistage sans antécédent de dépistage individuel 12,0 12,1 12,1 11,7 13,3
Premier dépistage avec antécédent de dépistage individuel 6,2 6,6 7,0 7,1 7,2
Dépistages suivants 6,2 6,3 6,3 6,4 6,4
Nombre de cancers détectés par une deuxième lecture 1 320 1 345 1 261 1 071 1 004
Pourcentage de cancers détectés par une deuxième lecture 9,2 9,0 8,0 6,7 6,2

La Lettre du Cancérologue • Vol. XXIII - n° 6 - juin 2014 | 209
Points forts
»La couverture du territoire français est réalisée par la combinaison du dépistage organisé et du dépis-
tage individuel du cancer du sein.
»La mammographie numérisée plein champ est la nouvelle technique de référence.
»Le bénéfice en survie spécifique est évalué à 20%.
»Les limites du dépistage organisé sont le surdiagnostic et ses conséquences, et les cancers induits.
Mots-clés
Dépistage organisé
Mammographie
Survie
Surdiagnostic
Morbidité
Highlights
»
Combined organized and
individual breast cancer
screening should ensure a good
coverage.
»
DR digitalized mammogram
is the new gold standard tech-
nique.
»
The benefit in specific
survival is about 20%.
»
Overdiagnosis and secondary
breast cancers may limit adhe-
sion and effi cacy of organized
screening.
Keywords
Organized screening
Mammogram
Survival
Overdiagnosis
Morbidity
La participation moyenne des femmes françaises est
de 52 %, avec de fortes disparités selon les régions et
les tranches d’âge. L’impact en termes de diagnostic
individuel est résumé dans le tableau I, qui montre
que des taux de cancers plus élevés sont observés
parmi les dépistages initiaux (qui détectent des cas
“prévalents”) comparés aux dépistages sub séquents
(qui ne détectent a priori que des cancers apparus
depuis le dépistage précédent). Au-delà de cette
démonstration de l’importance d’une participa-
tion de masse, l’impact réel de la “prévention”
du cancer du sein est estimé par l’évaluation du
stade diagnostique des cancers dépistés. En 2010,
on enregistre 15 % de cancers canalaires in situ,
et, parmi les cancers invasifs, 36 % sont classés
T1ab (taille ≤ 10 mm) et 74,3 % ne présentent pas
d’envahissement ganglionnaire axillaire (quand le
statut ganglionnaire est connu). Ces résultats sont
conformes aux références européennes. De plus,
l’évaluation de 2 010 femmes a souligné la dimi-
nution notable du nombre de cancers avec des
caractéristiques inconnues (4,8 contre 7,5 % l’année
précédente, à recul équivalent), témoignant d’une
meilleure exhaustivité du recueil de cette infor-
mation par les structures de gestion. Une grande
hétérogénéité est cependant observée, et l’exclu-
sion d’un nombre important de départements reste
nécessaire pour certaines analyses. L’apport de la
mammographie numérisée (plein champ [DR] ou
plaque fl uorescente [CR]) a également été analysé
lors du rapport 2010 de l’InVS (tableau II). La tech-
nique numérisée plein champ semble la plus promet-
teuse, en permettant globalement un diagnostic plus
précoce que les 2 autres : pourcentage de cancers
in situ plus élevé, pourcentages de cancers invasifs
sans envahissement ganglionnaire, de cancers de
moins de 10 mm et de cancers de moins de 10 mm
sans envahissement ganglionnaire également plus
élevés. Il convient néanmoins de tenir compte des
expériences individuelles des radiologues, qui n’ont
pas pu être évaluées dans ce rapport. Les conclu-
sions du rapport de l’InVS restent globalement
favorables, en tenant compte du dépistage indi-
viduel pour évaluer la couverture de la population
cible. Le rapport INCa 2013 (2) vient très utilement
compléter ces données en se focalisant sur les points
les plus controversés des programmes de dépistage
organisé : quel est le bénéfi ce en survie ? Quelle est
l’ampleur du surdiagnostic ? Quel est le risque de
cancer radio-induit ?
Tableau II. Apport de la mammographie numérisée (plein champ [DR] ou plaque fl uorescente [CR]) [d’après le rapport
InVS 2010].
Toutes
techniques
Analogique Numérique
DR
Numérique
CR
Cancers (nombre et pourcentage)
Taux de cancers (pour 1 000 femmes dépistées) 6,4 6,4 6,9 6,3
Pourcentage de cancers détectés parunedeuxième lecture
(pour 100cancers diagnostiqués à la suite dudépistage)
6,6 7,5 4,0 6,9
Cancers invasifs, n (%) 9 686 (80,2) 2 415 (81) 1 714 (77,3) 5 466 (81,0)
Canalaires in situ, n (%) 1 790 (15,2) 420 (14,6) 403 (18,3) 947 (14,4)
Caractéristiques non renseignées, n (%) 549 (4,5) 132 (4,5) 102 (4,5) 305 (4,6)
Total, n 12 025 2 967 2 219 6 718
Taille et envahissement ganglionnaire des cancers invasifs
Cancers invasifs N0, n (%) 6 273 (76,0) 1 585 (75,0) 1 065 (77,9) 3 563 (75,8)
Cancers ≤ 10 mm, n (%) 3 325 (38,2) 816 (36,7) 620 (41,6) 1 850 (37,6)
Cancers ≤ 10 mm et N0, n (%) 2 716 (33,6) 669 (32,2) 489 (36,6) 1 527 (33,2)
Cancers > 20 mm, n (%) 1 644 (19,3) 430 (20,1) 269 (18,2) 933 (19,5)

Figure 1. Estimation ajustée du surdiagnostic (d’après
le rapport INCa 2013).
20 %
10 %
0 %
Estimation ajustée
Cancer invasif seul
Cancer in situ et invasif
210 | La Lettre du Cancérologue • Vol. XXIII - n° 6 - juin 2014
Dépistage organisé du cancer du sein : le point en 2014
Actualités sur
la PRÉVENTION
Bénéfi ce en survie
La revue de la littérature montre de manière homo-
gène et stable une réduction du risque de décès par
cancer du sein d’environ 20 %, soit un gain de 150
à 300 décès pour 100 000 femmes participant à un
programme de dépistage pendant environ 10 ans
(tableau III). Ce gain théorique s’accompagne d’une
réduction de la morbidité secondaire aux traite-
ments, moins lourds pour les stades plus précoces.
Il est également rappelé que les cancers de l’inter-
valle, classiquement considérés comme plus graves,
ne représentent que 17 % des cancers diagnostiqués
dans le cadre du dépistage organisé.
Surdiagnostic
Le surdiagnostic est défi ni par le diagnostic d’une
pathologie infraclinique qui n’aurait pas donné de
symptôme du vivant de la personne dépistée. Il ne
s’agit pas d’un faux-positif du dépistage, mais d’une
lésion cancéreuse réelle à potentiel évolutif nul ou
très lent. Les potentielles conséquences morbides
et/ou psychologiques du surdiagnostic imposent d’en
prendre conscience et de tenter de le quantifi er. Cette
quantifi cation est diffi cile, car elle nécessite un ajus-
tement sur le type de cancer considéré (par exemple,
in situ versus infi ltrant), l’incidence attendue et le
retard au diagnostic ; par ailleurs, elle a donné lieu
à des estimations parfois farfelues et inquiétantes.
Les études récentes et correctement ajustées font
état d’un surdiagnostic de 0 à 10 % (fi gure 1), ce
qui correspond à environ 1 cas de surdiagnostic pour
4 décès évités pour les cancers infi ltrants.
Cancer radio-induit
Ce risque existe, et des effets biologiques des radia-
tions ont été démontrés, y compris pour les faibles
doses utilisées en imagerie diagnostique. Le rapport
de l’INCa fait le point sur les modélisations qui ont
été menées chez les femmes de plus de 50 ans, et
évalue à 1 à 20 cas le nombre de potentiels cancers
induits. Ce chiffre, qui peut paraître élevé, est à mettre
en relation avec le nombre de décès évités, comme
indiqué précédemment. Au-delà du devoir de connais-
sance et d’information, la quantifi cation de cet effet
indésirable a contribué à la mise en place d’un contrôle
qualité des mammographes et des mammographies,
ainsi qu’à l'instauration d'une formation continue
des radiologues, qui font aussi partie des bénéfi ces
à attendre d’un programme de dépistage organisé.
Tableau III. Estimation du bénéfi ce absolu (d’après le rapport INCa 2013).
Situation concernée Nombre de femmes àdépister pour
éviter 1décès parcancer dusein
Nombre dedécès parcancer dusein
évités pour 100 000participantes
Duffy (2010) Femmes de 50 à 69ans
Dépistage tous les 2 à 3 ans
(pendant 7ans, extrapolation à 20ans)
323 (7 ans)
113 (20 ans)
310 (7 ans)
885 (20 ans)
Tabár (2011) Participation régulière au dépistage
(pendant 10 ans)
400 250
Béral (2011)
NHS Cancer Screening Programmes
(2006)
Femmes âgées de 50 à 70 ans
Participation régulière au dépistage
(pendant 10ans)
400 250
Canadian Task Force (2001) Femmes âgées de 50 à 69 ans
Dépistage tous les 2 à 3 ans
(pendant 11ans)
721 139
Marmot-ISBR (Groupe indépendant
d’experts) [2012]
Femmes âgées de 55 à 79 ans
Dépistage tous les 3 ans
(pendant 20 ans)
180 556

Figure 2. Relation entre l’incidence du cancer du sein et le dépistage.
80
10
20
30
40
50
60
70
040-44 60-6450-5470-7445-49 65-6955-59 75-89
Âge
Taux pour 1 000 examens
Taux de cancers Taux de cancers détectés
La Lettre du Cancérologue • Vol. XXIII - n° 6 - juin 2014 | 211
Actualités sur
la PRÉVENTION
Les technologies récentes (mammographie numé-
risée, tomosynthèse) devront être soumises au même
niveau de contrôle et d’évaluation. Pour mémoire et
par comparaison, le dépistage individuel n’offre pas les
mêmes garanties et n’est pas évalué. Au total, l’INCa
continue à recommander la pratique du dépistage
organisé du cancer du sein pour les femmes âgées
de 50 à 74 ans. Il souligne néanmoins la nécessité de
communiquer, d’informer et de former la population
aussi bien que les acteurs de la santé concernés.
Points de vue européens
Malgré l’ensemble de ces éléments en défi nitive
rassurants, la polémique relancée en 2000 par
P.C. Gøtzsche et O. Olsen (3) continue à alimenter
la chronique. Les données récentes mettent en
lumière l’association entre détection (c’est-à-dire
par le dépistage) et augmentation de l’incidence des
cancers du sein (fi gure 2). Deux rapports européens
récents et contradictoires viennent nourrir la polé-
mique. Un rapport britannique, mené sous la double
responsabilité du Département de la santé et du
Cancer Research UK, vient d’être publié (4). Comme
dans les conclusions de l’INCa, il y est souligné que
la réduction de la mortalité par cancer du sein attri-
buable au dépistage organisé a été mise en évidence
par 11 essais randomisés. La méta-analyse de ces
essais confi rme une réduction de 20 % du risque.
Ce rapport souligne néanmoins les causes d’incer-
titude autour de ce chiffre et en isole au moins 3 :
➤
l’intervalle de confi ance de cette réduction rela-
tive est large, entre 11 et 27 % ;
➤
les biais possibles sont nombreux, notamment
du fait de l'ancienneté de ces essais : méthodologie
statistique, randomisation, qualité de la mammo-
graphie et de la lecture, fi abilité de l’information sur
la cause des décès qui n’était pas l’objectif initial de
ces études ;
➤
enfi n, compte tenu de ces éléments, pouvons-
nous projeter ces résultats sur les programmes en
cours actuellement ?
Malgré ces limites, le groupe d’étude britannique
admet que le dépistage organisé doit permettre
d’éviter 1 décès pour 250 femmes invitées. Dans ce
rapport, la question du surdiagnostic est également
abordée sous 2 angles : celui de la population géné-
rale, et celui de la population de femmes invitées.
Les chiffres ont été appréciés à partir de 3 essais
randomisés qui ont proposé un simple suivi (sans
proposition de dépistage) à la population témoin à
l’issue de l’étude. Dans ce contexte, le surdiagnostic
est évalué à 11 % pour la population générale et
à 19 % pour une population invitée au dépistage.
Il est ainsi estimé que, sur 20 ans, environ 1 %
des femmes d’une tranche d’âge de 2 ans auront
un surdiagnostic. Au total, le rapport britannique
reste très favorable au dépistage organisé. Le Swiss
Medical Board est un organisme suisse indépendant
qui “analyse et évalue les processus diagnostiques et
les interventions thérapeutiques du point de vue de
la médecine, de l’économie, de l’éthique et du droit”
( www. medical- board. ch). Sous l’auspice de la Confé-
rence des ministres de la Santé des cantons suisses,
de l’Association médicale suisse et de l’Académie
suisse des sciences médicales, ce board a mené sa
propre analyse des essais de dépistage du cancer
du sein (5). Tout en reconnaissant le bénéfi ce de
20 % en mortalité souligné par l’INCa et le rapport
britannique, les auteurs insistent sur les failles impor-
tantes de ces études, déjà évoquées et générées
par leur ancienneté, ainsi que sur les conséquences
considérées comme néfastes du dépistage : infl ation
diagnostique, biopsies invasives, surdiagnostic, etc.
Le board recommande ainsi de ne lancer aucun

212 | La Lettre du Cancérologue • Vol. XXIII - n° 6 - juin 2014
Dépistage organisé du cancer du sein : le point en 2014
Actualités sur
la PRÉVENTION
nouveau programme, de limiter dans le temps les
programmes en cours, et d’améliorer la transparence
et la qualité de l’information délivrée aux femmes.
Conclusion
En l’absence de nouveaux essais qui pourraient théo-
riquement répondre aux légitimes questions posées
par les contempteurs du dépistage, la polémique va
continuer de tourner sur elle-même comme elle le
fait depuis plus de 10 ans (6). Le rapport du Swiss
Medical Board souligne avec justesse qu’il existe des
différences régionales et culturelles majeures dans
l’appréciation de ces programmes et l’adhésion à
ceux-ci. Il est probable que le dépistage va comporter
une part croissante de dépistage individuel, fondé sur
une évaluation individuelle et collective du risque,
du bénéfi ce attendu, des possibilités offertes par la
société. Le National Cancer Institute (NCI) a lancé
dans ce contexte un programme intitulé PROSPR
(Population-based Research Optimizing Screening
through Personalized Regimens), dont l’objectif est
de fournir les éléments permettant de construire un
modèle global de dépistage mais établi sur les risques
individuels (7). Néanmoins, comme dit le poète, “en
attendant ce jour”
a
, reconnaissons et appliquons les
bénéfi ces majeurs apportés par plus de 40 années
d’expérience du dépistage organisé. ■
1. Lastier D, Salines E et Rogel A. Programme de dépistage du
cancer du sein en France : résultats 2010, évolutions depuis
2006. Saint-Maurice : Institut de veille sanitaire 2013. 26 pages.
Rapport accessible en ligne : http://www.invs.sante.fr/
2. Bénéfi ces et limites du programme de dépistage orga-
nisé du cancer du sein. Quels éléments en 2013 ? Rapport
INCa 2013. Accessible en ligne : http://www.e-cancer.fr/
component/docman/doc_download/10793
3. Gøtzsche PC, Olsen O. Is screening for breast cancer with
mammography justifi able? Lancet 2000;355(9198):129-34.
4. Marmot MG, Altman DG, Cameron DA, Dewar JA et al.
The benefits and harms of breast cancer screening: an
independent review. Br J Cancer 2013;108(11):2205-40.
5. Biller-Andorno N, Jüni PN. Abolishing mammography
screening programs? A view from the Swiss Medical Board.
N Engl J Med 2014;370(21):1965-7.
6. Cottu PH, Cuvier C, Perret F, Gorins A, Espié M. Dépistage
de masse du cancer du sein. Presse Med 2003;32(3):120-4.
7. Onega T, Beaber EF, Sprague BL, Barlow WE, Haas JS
et al. Breast cancer screening in an era of personalized
regimens: A conceptual model and National Cancer
Institute initiative for risk-based and preference-
based approaches at a population level. Cancer 2014.
[Epub ahead of print].
Références bibliographiques
a. Extrait de la chanson de Jacques
Brel “Zangra”.
Les auteurs déclarent
ne pas avoir de liens d’intérêts.
REGARDS CROISÉS
CLINICIENS/BIO-PATHOLOGISTES
SUR LA LITTÉRATURE EN ONCOLOGIE THORACIQUE
www.edimark.fr/revues-presse/onco-thoracique
Sous l’égide de
Avec le soutien institutionnel
Directeur de la publication :
Claudie Damour-Terrasson
Rédacteur en chef :
Jean-François Morère (Bobigny et Villejuif)
Coordinateur
Denis Moro-Sibilot (Grenoble)
Experts
Nicolas Girard (Lyon)
et Marie Brevet (Lyon)
Alexis Cortot (Lille)
et Fabienne Escande (Lille)
Charles Ferté (Villejuif)
et Julien Adam (Villejuif)
Les articles majeurs
de la littérature en oncologie
thoracique analysés et décryptés
pour vous par des duos d’experts.
1
/
5
100%