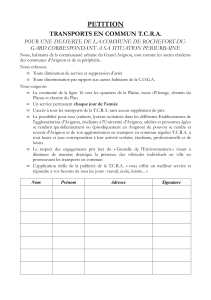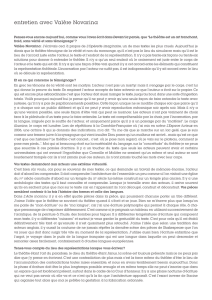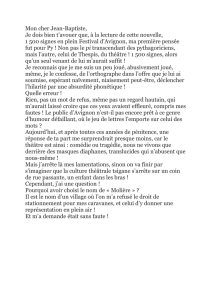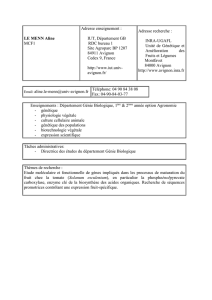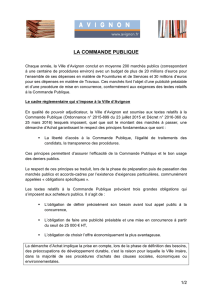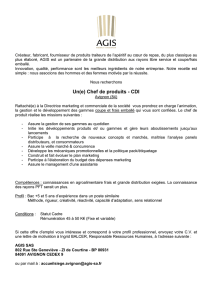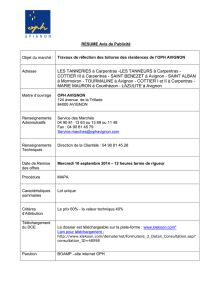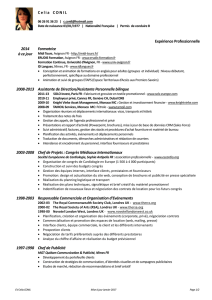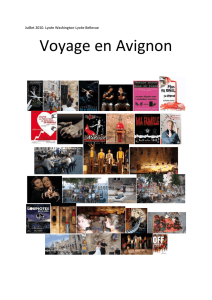Avignon - Le Monde

0 123
Festival
AVIGNON 2006
CAHIER DU « MONDE » DATÉ JEUDI 6 JUILLET 2006, NO19111. NE PEUT ÊTRE VENDU SÉPARÉMENT
Souvenirs. Trois générations de critiques du Monde p. 5 à 10
Découvertes. Stefan Kaegi et Oriza Hirata p. 4 et 11
Entretien. Peter Brook, le théâtre et la vie p. 12 et 13
Le chorégraphe Josef Nadj, artiste associé, donne
le ton d’une programmation qui renoue avec le théâtre
et les auteurs. Il fait l’ouverture dans la Cour d’honneur,
avec Asobu (photo), création d’après l’œuvre
d’Henri Michaux. En clôture de cette 60eédition,
qui se tient du 6 au 27 juillet, Olivier Py dirigera,
toujours dans la Cour d’honneur, une lecture
de textes de Jean Vilar, en hommage au fondateur
du Festival. Le Monde se souvient de cette histoire
unique et exemplaire.

J’ai fait à mon époque le théâ-
tre de mon temps », disait
Jean Vilar. C’est ainsi
qu’en 1947 il fondait le
Festival d’Avignon. Dans
cet après-guerre où la Fran-
ce était à reconstruire, il
bâtissait à l’ombre du Palais des
papes une utopie : du théâtre en
province, des grands textes en
plein air, au service
du plus grand nom-
bre.
En cette année
2006, le Festival fête
sa 60eédition, qui a
lieu du 6 au 27 juillet.
Soixante éditions, ce
sont trois généra-
tions de spectateurs,
des ruptures et des
empoignades, des
moments de grâce et
des souvenirs pour demain. Le
Monde avait 2 ans quand le Festi-
val est né. L’histoire du Festival,
chaque année recommencée, c’est
aussi la sienne, chaque jour réécri-
te. Trois générations de critiques
en témoignent, à commencer par
Michel Cournot, qui était à Avi-
gnon en 1947.
Pendant le Festival, cette
60eédition – en attendant les
60 ans, pour 2007 – sera fêtée par
plusieurs événements, dont une
lecture de textes de Jean Vilar,
sous la direction d’Olivier Py,
dans la Cour d’honneur. Ce sera
le 27 juillet, pour la clôture d’un
Festival très attendu, après l’onde
de choc de 2005.
En effet, de toutes
les crises qu’a
connues Avignon, et
elles sont nombreu-
ses, celle de la 59eédi-
tion fut une des plus
virulentes. Elle est
née de l’invitation
lancée à Jan Fabre,
artiste associé,
autour duquel a été
bâtie une program-
mation radicale qui a
mis les nerfs à vif, tant du côté cri-
tique que public.
La discussion a porté sur la
modernité et ses formes, la place
du théâtre et son enjeu, le pacte
artistique et social. Vastes ques-
tions, que déjà Jean Vilar affron-
ta. Avignon est ainsi fait qu’il se
renouvelle dans le débat.
« Comment redéfinir l’enjeu
théâtral ? », se demande Josef
Nadj. C’est lui l’artiste associé de
cette 60eédition, qui s’annonce
beaucoup plus calme que la pré-
cédente. Le chorégraphe d’origi-
ne hongroise présente dans la
Cour d’honneur Asobu, une créa-
tion inspirée par Henri Michaux.
Eric Lacascade prend sa suite et
fait entrer dans la Cour Les Barba-
res, une pièce très peu connue de
Gorki. Ainsi, le théâtre revient
dans le saint des saints, d’où il
était absent en 2005. De quoi
apaiser plus d’un esprit.
Autour de Josef Nadj, il y aura
des arts plastiques, avec Barcelo,
et beaucoup de musique, en parti-
culier du jazz (dont un concert
d’Archie Shepp, T. McClung et le
Dresh Quartet, dans la Cour).
Avec Bartabas, il y aura deux
orchestres, un de cordes, l’autre
de vents, pour entraîner le grand
galop de Battuta, présenté pen-
dant toute la durée du Festival.
Peter Brook lui aussi reste
trois semaines à Avignon, avec
Sizwe Banzi est mort, une pièce
qui nous emmène à Soweto dans
les années de l’Apartheid. On va
ainsi beaucoup voyager dans le
temps et dans l’espace. Du
Japon, où Ozira Hirata cherche le
chemin d’un « théâtre calme », à
la Suisse, d’où nous vient Stefan
Kaegi, un jeune metteur en scène
en quête d’un théâtre politique et
documentaire.
Hirata et Kaegi font partie des
nouveaux venus au Festival, avec
le Belge Guy Cassiers et les Fran-
çais Joël Pommerat et Christo-
phe Huysman. Beaucoup
d’auteurs les accompagnent, de
Copi à Koltès, de Marguerite
Duras à Edward Bond.
La danse, elle, se fait plutôt dis-
crète, même si sont présents
François Verret, Jan Lauwers,
Alain Platel, Thierry Baë et Le
Sujet à vif, bien sûr. Mais il y aura
beaucoup de lectures, de débats
et de rencontres, en particulier
trois jours pour parler d’« Une
histoire en mouvement », celle
d’Avignon, et vingt-quatre consa-
crées à la décentralisation.
Et puis il y aura ces moments
comme seul le Festival sait en
offrir : une causerie de Pippo Del-
bono, ou un Lever de soleil avec
Bartabas et son cheval, à 5 h 30,
à la Carrière Boulbon. a
Brigitte Salino
Le théâtre
revient dans
la Cour d’honneur,
d’où il était absent
en 2005. De quoi
apaiser plus
d’un esprit
Après Thomas
Ostermeier, en 2004,
et Jan Fabre, en 2005,
Josef Nadj
est l’artiste associé
de la 3eédition
dirigée par Hortense
Archambault
et Vincent Baudriller
Les présages
d’un horizon
apaisé
Coordination : Brigitte Salino
Edition : Christine Clessi
Réalisation : Patricia Gauthier
et Nadège Royer
Direction artistique : Marc Touitou
Iconographie : Laurence Lagrange
b
En couverture : « Asobu »,
mise en scène et chorégraphie
Josef Nadj.
TRISTAN JEANNE-VALES/CIT’en scène
« Les Barbares », de Maxime Gorki, adaptation et mise en scène Eric Lacascade. PASCAL GÉLY/AGENCE BERNAND
0 123 - Jeudi 6 juillet 2006 - page 2 AVIGNON 2006

J
osef Nadj file entre les
doigts. Appuyé à une table
de café ou replié dans un
bureau au Centre chorégra-
phique d’Orléans qu’il diri-
ge depuis 1995, le chorégra-
phe aux grands cernes som-
bres, créateur d’une vingtaine de
pièces en près de vingt ans, ne se
pose que pour mieux s’échapper.
La tête légèrement enfoncée
dans les épaules, les mains occu-
pées à rouler des cigarettes, il sem-
ble toujours jaillir d’un rêve, en sus-
pend le cours, l’espace d’un ins-
tant, pour mieux y replonger.
Entre-temps, il aura fait défiler
d’une voix sourde ses obsessions et
fantasmes avec l’élégance noncha-
lante de celui qui est là sans y être
tout à fait. Dans sa bulle, oiseau
noctambule, Josef Nadj veille, tis-
sant inlassablement la toile de sa
géographie intime.
Le cœur battant de cette spirale
est une petite ville, Kanizsa, située
en Voïvodine, enclave hongroise
autrefois située en Yougoslavie,
aujourd’hui en Serbie. Grâce au
chorégraphe (né en 1957) pour
lequel vie et œuvre sont inextrica-
blement mêlées, cette bourgade de
12 000 habitants, en passe de
devenir un mythe, appartient
désormais à l’imaginaire de tous
les spectateurs de Josef Nadj.
Kanizsa, coupée en deux par le
fleuve Tisza, affluent du Danube,
que les hirondelles frô-
lent pendant qu’on
s’y baigne. Kanizsa
ouvrant sur une plai-
ne si longue et si
immense que le
regard s’y perd. Sans
même y être allé, Kani-
zsa « la ville que tout le
monde rêve de quitter
sans y réussir »,làoù
Josef Nadj possède
une grande partie de
sa bibliothèque, se dresse, pétrie
d’histoires toutes plus fascinantes
les unes que les autres.
Dès 1987, la première pièce de
Josef Nadj, présentée au Théâtre
de la Bastille, ouvre l’album de sou-
venirs. Sur un ton surréaliste,
Canard pékinois recomposait les
souvenirs-éclairs d’un gamin nom-
mé Nadj qui s’entraînait aux arts
martiaux dans un théâtre où une
troupe d’acteurs, rêvant de partir
pour la Chine, finit par se suicider.
Un an plus tard, Sept peaux de
rhinocéros évoquait la mort du
grand-père du chorégraphe. Et ain-
si de suite. Les Echelles d’Orphée,en
1992, dépliait celles des pompiers
de Kanjiza qui gagnèrent le cham-
pionnat du monde des pompiers à
Turin en 1911 et se livraient par
ailleurs à des activités théâtrales en
amateurs.
Fiction ou réalité ? Impossible
de vérifier et au fond peu importe.
On croit dur comme fer à ces scéna-
rios magiques d’une ville où tout
peut arriver et que Nadj sait incar-
ner sur scène. En conteur, en cha-
man, avec cette puissance à vif
d’un être qui n’a pas le choix,le cho-
régraphe qui « danse sa mémoire
sur scène », puise dans les couches
les plus souterraines de son incons-
cient pour en rapporter une langue
spectaculaire unique.
Chaque pièce, en particulier les
premières, socles de l’œuvre à
venir, réactive le passé avec la puis-
sance d’un exutoire. Chapitre
après chapitre, Nadj déploie le
roman de la vie d’un Européen
nomade, fils d’un charpentier, petit-
fils d’un paysan, qui tous deux dési-
raient ardemment que Josef suive
leurs traces. Avec détermination, le
chorégraphe a choisi de partir pour
bâtir un monde à la démesure de
son décalage, de son désir de liber-
té, sans jamais rompre pourtant
avec sa famille et ses racines.
Celui qui à 11 ans exposait déjà
ses premières peintures, commen-
ce des études aux Beaux-Arts de
Novi Sad, puis à Budapest. Le
service militaire l’éloigne momen-
tanément des arts plastiques avec
lesquels il renouera en 1996 lors
d’une exposition de sculptures au
Carré Saint-Vincent à Orléans.
De retour à Budapest, il décou-
vre le théâtre du mouvement et raf-
fine sa quête d’un art global, à la
fois physique, visuel, musical. Arri-
vant à Paris en 1980, il s’initie au
mime auprès de Decroux et Mar-
ceau, collabore à différents projets
en tant que danseur avec les choré-
graphes Catherine Diverrès, Mark
Tompkins et François Verret.
Cet amalgame de formations,
de techniques, consolidé par un
esprit viscéralement constructif et
furieusement bosseur, a abouti à
un style spectaculaire reconnaissa-
ble au premier coup d’œil. Sur fond
d’engrenage théâtral ou de scéno-
graphies en trompe-l’œil, le monde
selon Nadj est peuplé d’hommes-
pantins habillés tout en noir qui
s’acharnent à extraire un sens
momentané de l’obscure saga du
destin.
La gestuelle, hachée, butée aus-
si, parfois heureusement saisie par
un tourbillon, dessine
une partition sophisti-
quée, féroce, que les
danseurs subliment
telle une superbe
épreuve de force. L’es-
prit des arts martiaux,
et plus spécialement
de la lutte gréco-
romaine, noyaute sa
danse.
Josef Nadj n’est-il
jamais aussi près de
chez lui que sur un plateau ? Parmi
les repères scénographiques, la
table, par exemple, renvoie à celle
de son grand-père qui y dissimu-
lait des livres sous un tissu. De ces
premières lectures (de Kafka entre
autres), Nadj a conservé une pas-
sion vorace pour la littérature. Les
écrivains sont ses compagnons de
traversée, ses appuis mentaux. Kaf-
ka donc, mais aussi Büchner dont
il a adapté Woyzeck en 1994, Bruno
Schulz, Jorge Luis Borges, récem-
ment Raymond Roussel pour
Poussières de soleil, servent depuis
quelques années de ferment à ses
spectacles.
De ces confrontations littérai-
res, Josef Nadj extrait le jus néces-
saire pour relancer sa sarabande
somnambulique, dégager d’autres
voies à son labyrinthe personnel.
En cheminant au coude-à-coude
avec ces auteurs, il projette ses
motifs intimes sur l’écran de leurs
œuvres, déployant les différences
mais surtout les points communs
dans un réseau aux multiples
résonances.
Avec Henri Michaux, point de
départ de la pièce Asobu, pour
lequel il développe un intérêt puis-
sant depuis de longues années,
tant pour ses écrits que pour ses
dessins, le voisinage se révèle une
mine de correspondances. Tous
deux dessinent, tous deux sont des
voyageurs. Le Japon, ultime desti-
nation de Michaux avant la secon-
de guerre mondiale, se révèle l’un
des pays de prédilection de Nadj.
L’Ailleurs de l’un comme celui de
l’autre n’est jamais qu’un détour
pour rentrer chez soi. Partir pour
mieux revenir.
a
Rosita Boisseau
Voir programme Josef Nadj, page 14.
- Crédit photos : Getty images / J. Brooks - Tristan Jeanne-Valès
Thierry Baë, interprê-
te et complice de Nadj
(Canard pékinois et Les
Philosophes) présente
Journal d’inquiétude, un
solo sur le destin d’un
danseur vieillissant.
Miquel Barcelo, pein-
tre vivant entre Marjor-
que, Paris et le Mali, par-
tage ses outils de jeu
(boue, sable,...) avec
Nadj pour Paso Doble,
une performance en
duo.
Akosh S., saxophonis-
te, né en Hongrie en
1966, mêle musiques
ethniques et free-jazz. Il
a accompagné le groupe
de rock Noir Désir. Il don-
ne deux concerts.
La galaxie
Nadj
L’homme de Kanizsa, en Voïvodine,
recherche un art global physique et musical
Chaque pièce,
en particulier
les premières,
réactive
le passé avec
la puissance
d’un exutoire
Josef
Nadj L’homme qui danse
sa mémoire
Josef Nadj, directeur du Centre chorégraphique national d’Orléans.
RAMON SENERA/CIT’en scene
De haut en bas :
Thierry Baë,
ERIC BOUDET.
Akosh S., DR.
Miquel Barcelo,
JÉROME CHATIN/L’EXPRESS/
EDITIONGSERVER.COM
2006 AVIGNON page 3 - Jeudi 6 juillet 2006 - 0 123

Ils viennent pour
la première fois
Stefan Kaegi
spécialiste suisse
Ce metteur en scène
de 33 ans
renouvelle
le théâtre
documentaire
et politique
De haut en bas :
Guy Cassiers, PATRICK DE
SPIEGELAERE. Christophe
Huysman, VINCENT PONTET.
Joël Pommerat, YANNICK
BUTEL
Guy Cassiers. Né en
1960 à Anvers (Belgique),
où il vient de prendre la
direction du Toneelhuis, il
fait découvrir Rouge décan-
té, le récit autobiographi-
que d’un auteur flamand,
Jeroen Brouwers, qui,
enfant, a passé deux ans
dans un camp d’interne-
ment japonais.
Christophe Huysman.
Acteur, auteur et metteur
en scène, c’est une tête
chercheuse qui explore les
domaines du cirque et du
multimédia. Il présente à la
Chartreuse Human, La
Course au désastre et Les
Eclaireurs, une pièce pour
un haut-parleur.
Joël Pommerat. Les
deux pièces, Au monde et
Les Marchands, qu’il a écri-
tes et mises en scène,
appartiennent à une trilo-
gie qui donne une parole à
ceux qui n’en ont pas, les
exclus du monde du travail.
illustration Marc Daniau
La maman bohême
et
Médée
Dario Fo et Franca
Rame / Didier Bezace
La Mère
Bertolt Brecht / Jean-Louis Benoit
Chair de ma chair
Ilka Schönbein
Antigone, Hors
la loi
Anne Théron
Dissident, il va sans dire
Michel
Vinaver / Laurent Hatat
May
Hanif Kureishi / Didier Bezace
Spectacles Jeune public
Le Petit Chaperon rouge /
un froid de kronos / Petit Navire / La Forme d'une ville...
et d'autres spectacles, des lectures, des Dîners, le Festival Ici et là...
Théâtre de la Commune - Direction Didier Bezace - 2 rue Edouard Poisson - 93300 Aubervilliers
Abonnements / Adhésions
01 48 33 16 16
theatredelacommune.com
Avignon le découvre :
Stefan Kaegi, un
Suisse de 33 ans
dont la réputation
n’est plus à faire
outre-Rhin, surtout
dans la génération des jeunes
spectateurs. C’est un garçon à la
drôle de voix, un peu cassée, qui
aime s’asseoir dans des endroits
qu’il ne connaît pas pour écouter
les gens. Il ne conduit pas, mais il
a sillonné l’Europe en camion ou
à vélo. Il n’a plus d’adresse depuis
cinq ans, mais il va de ville en ville
avec un sac de vingt-cinq kilos. A
l’intérieur, il y a un ordinateur et
des cartes, ses attributs de géogra-
phe de la modernité.
Avec cela, il porte le nom d’un
chocolat suisse connu. Mais il n’a
rien à voir avec. Son père est un
ingénieur, qui, au moment où les
montres Swatch sont sorties, tra-
vaillait dans une entreprise qui a
voulu lancer des téléphones en
plastique « super bon marché
mais pop », sur le modèle des
montres. « Ça n’a pas marché du
tout. Et c’était lui qui était chargé
du projet », dit Stefan Kaegi.
Cette histoire l’amuse beaucoup,
comme tout ce qui déraille un
peu.
Lui-même a étudié en zig-zag.
« J’ai commencé par la philoso-
phie, mais je ne me suis pas accom-
modé de la rectitude univer-
sitaire. » Alors il fait l’école d’art
de Zurich, dont il s’échappe avant
le diplôme. Il part pour Giessen,
en Allemagne, et s’inscrit dans
une école de théâtre qui lie la pra-
tique et la théorie. A ce moment-
là, Stefan Kaegi veut être écrivain.
Il rédige de nombreux textes, des
nouvelles surtout, qui sont refu-
sés par les éditeurs.
« Comme personne ne voulait
les imprimer, je les ai lus devant des
gens. Mais je trouvais ça un peu
ennuyeux. J’ai commencé à utiliser
toutes sortes de machines pour
déformer le son de ma voix et intro-
duire d’autres sons. Ça a très bien
marché. Le premier texte racontait
l’histoire d’un homme qui reste
chez lui, avec une immense carte. Il
veut comprendre comment marche
le monde sans sortir de sa
maison. »
Stefan Kaegi ne termine pas
ses études de théâtre, parce qu’il
n’aime « pas trop » lire des piè-
ces. Il préfère déjà « lire les jour-
naux ou écouter des gens qui ont
une raison de parler ». C’est en par-
tant de là qu’il signe son premier
spectacle, à l’université de Gies-
sen : « Giessen est une ville très
connue pour son école vétérinaire.
Il y a là, au milieu de l’Allemagne,
toutes sortes de chameaux et d’ani-
maux très étranges.J’ai connu un
spécialiste de l’élevage des poulets
qui donnait des conférences pour
les jeunes cultivateurs. Je l’ai invité
à venir en faire une, sur la scène de
l’université. On a dessiné une affi-
che sur laquelle était écrit Peter
Heller va venir parler de l’élevage
des poulets, avec une date.Les
gens ont cru qu’on allait faire du
Handke, à cause de la longueur du
titre. Ils ont été très surpris. »
« Je ne dirai pas que ce Peter
Heller… était une œuvre, reconnaît
Stéphane Kaegi. Mais c’était une
expérience qui montrait qu’on peut
recontextualiser la réalité avec les
moyens du théâtre. » Après, les piè-
ces du jeune Suisse sont devenues
« beaucoup plus sophistiquées ».
D’abord, il y a eu celles qu’il a fai-
tes avec Hygiene Heute, sa pre-
mière compagnie.
PROTOCOLE
DIPLOMATIQUE
Stéphane Kaegi a organisé un
Congrès des cochons d’Inde, à
Vienne, ou un Etat des fourmis,
dans une galerie. Dans les deux
cas, il s’agissait de voir comment
le comportement animal est un
miroir du comportement social.
Puis il est passé à l’observation
directe quand, avec deux amis, il
a fondé une nouvelle compagnie,
Rimini Protokoll, en 2000. (Ne
cherchez pas le sens de Rimini, ils
voulaient trois « i » pour répon-
dre aux « o » de protocole.)
Un de leurs premiers specta-
cles concernait le protocole diplo-
matique, raconté par des spécia-
listes, dont un ambassadeur
d’Autriche, invités sur la presti-
gieuse scène du Burgtheater de
Vienne. Un autre les a menés à
Hanovre, où ils ont ausculté le
désir d’ordre du pouvoir, à tra-
vers des caméras de surveillance
installées sur la place principale
de la ville.
Stéphane Kaegi n’aime pas
raconter ses spectacles, parce que
cela les rend anecdotiques, quand
il revendique une démarche nette-
ment politique. « En Allemagne,
le fait d’être politique a encore une
connotation années 1970. La réfé-
rence reste celle d’auteurs comme
Peter Weiss, Rolf Hochhut ou Hei-
ner Müller. Je n’ai rien à voir avec
ça. Etre politique aujourd’hui,
pour moi, c’est être documentaire.
Dans ce domaine, le théâtre a pris
beaucoup de retard sur les arts
visuels. Il s’occupe encore de l’idéolo-
gie, alors que, depuis une dizaine
d’années, les arts visuels s’intéres-
sent à l’économie. »
C’est ce théâtre-là, politique et
sensible, qu’Avignon va décou-
vrir, avec deux spectacles : le pre-
mier Mnemopark, montre ce que
cache la beauté de la Suisse, vue
par des modélistes qui construi-
sent des trains. Il se donne dans
une salle. Le second, Cargo Sofia-
Avignon, emmène les spectateurs
dans un bus, à la découverte de ce
que cache le décor d’Avignon,
hors des remparts, sur le réseau
des camions qui sillonnent l’Euro-
pe d’aujourd’hui. a
Brigitte Salino
Mnemopark, les 12, 13, 14 juillet, salle
Benoît-VII. Cargo Sofia-Avignon,du20
au 25 (relâche le 23).
« Cargo Sofia-Avignon », de Stefan Kaegi. DAVID BALTZER/ZENIT
0 123 - Jeudi 6 juillet 2006 - page 4 AVIGNON 2006

Par Michel Cournot
Agauche du Palais,
des marches à mon-
ter. Notre-Dame-des-
Doms. Puis un jar-
din, il ne bouge pas,
il est là depuis la pre-
mière année du Festival, et bien
avant. Le 17 décembre 1914, Paul
Claudel, qui venait d’embrasser sa
sœur Camille à l’asile de Montde-
vergues, passe par Avignon et s’ar-
rête dans ce jardin : « Le délicieux
parc. Vue admirable sur le Ventoux,
la plus longue, la plus belle, la plus
harmonieuse ligne de montagnes
que j’aie vue de ma vie. » Il avait
pourtant beaucoup voyagé, déjà.
Dans ce parc, de nos jours, en
juillet, autant dire personne. Et
rues et places d’Avignon bondées.
En 1946, l’éditeur d’art parisien
Christian Zervos décide de créer,
dans l’enceinte du Palais, une
« Semaine d’Art » : peinture,
musique, théâtre. Il propose à Jean
Vilar de venir jouer dans la grande
cour Meurtre dans la cathédrale de
T.S. Eliot, une réussite très
brillante de Vilar, qui répond :
« C’est un lieu informe, je ne parle
pas des murs, mais du sol ; techni-
quement, c’est un lieu théâtral
impossible, et c’est aussi un mauvais
lieu théâtral parce que l’Histoire y
est trop présente. »
Cependant, Vilar est tenté de
jouer quelque chose, dans ce
palais si beau ; quinze jours de
réflexion, et, tranquille, il déclare :
« Ce palais est peut-être de tous les
lieux du monde le plus apte à nous
soutenir dans notre engagement. »
Il reste que le sol de la cour, toute
en pentes, excavations, talus, est
« injouable ».
Intervient l’homme providen-
tiel, communiste, grand Résistant,
le maire d’Avignon, Georges
Pons : il soutient Zervos et Vilar, et
il demande aux soldats du régi-
ment du 7eGénie de venir aplanir
le redoutable sol. Les militaires
sont enthousiastes. Vilar va
annexer aussi, de l’autre côté du
Palais, le jardin d’Urbain V, une
forêt enchantée, une jungle de
fleurs et d’insectes. La grande cha-
pelle abritera l’exposition d’art,
Picasso, Braque, Matisse, Gia-
cometti, Léger, Klee…
La « Semaine d’Art » va deve-
nir le « Festival d’Avignon ». Ce
qui n’est alors pas prévu, c’est
qu’aux quelques œuvres de théâ-
tre du Festival officiel viendront se
greffer, dans des lieux de fortune,
des pièces de fortune, aujourd’hui
en 2006 elles sont plus de six
cents, et ce sont elles que choisis-
sent, venus de la France et de l’Eu-
rope entière, les spectateurs en
grande majorité (souvent ils
louent d’avance, en supplément,
une place pour l’une des choses
jouées dans la grande Cour).
Oublieuse mémoire ! Des cen-
taines de chefs-d’œuvre donnés
par le Festival officiel depuis
60 ans dans la grande Cour et
ailleurs, duquel surtout se souve-
nir ? Quand Paul Claudel décou-
vrit du haut d’Avignon « la plus bel-
le ligne de montagnes », il s’écria :
« O adorable lumière ! soleil, je
n’aime que toi ! »
DE LA PEUR
À L’APAISEMENT
Choisissons l’inverse, les ténè-
bres, la nuit, le noir. C’était en
1993. Dix-huit aveugles d’Avi-
gnon et de la région faisaient
entrer, par groupe de dix, les spec-
tateurs, dans une caverne noire,
noire absolument. La visite durait
trois quarts d’heure. Les specta-
teurs avaient une canne, mais
avançaient surtout en portant les
mains en avant ou en tâtant le sol
avec leurs pieds.
Dans le noir la substance des
parois, lisses, rugueuses, spon-
gieuses, et celle des sols, durs ou
mousseux, gravier ou tapis, ou
macadam, calment un peu notre
angoisse, notre vertige. Ce granité
d’un mur à main gauche, ce sable
sous la plante des pieds, nous
disent quelque chose : en un sens,
un tout petit sens, nous les
« voyons ». Nous allons reconnaî-
tre l’écorce d’un arbre, ses
aiguilles, les planches et la balus-
trade d’un petit pont en dos d’âne,
il y a aussi le son puisque nous
allons entendre, avant de la tou-
cher, l’eau d’une fontaine.
Le sentier tourne, la main palpe
des rondeurs, des arêtes, des
creux : le visage d’une statue. Des
marches à franchir, le métal d’un
capot de voiture, le bord d’un trot-
toir : la ville. Aboiements de chien,
motocyclettes, passage d’un avion
assez bas, tables et chaises sur une
terrasse. Puis la proche campa-
gne, les faubourgs, un dancing,
l’ovale d’une bouteille de Coca ou
de Perrier, le bord strié d’une piè-
ce de monnaie. Un talus abrupt
pas facile à descendre, une lueur
là devant : c’est la fin !
Le jour. Nous nous regardons,
un peu autrement. Ce n’était rien,
juste un jeu. Nous sommes passés
d’une peur à un apaisement.
D’une maladresse entière à un
accommodement. Nous avons
« vu », avec les doigts, avec l’ouïe,
un tout petit peu de choses. Mais
ce qui l’emporte, de beaucoup,
c’est notre regard sur la guide,
vraie aveugle, elle qui a conduit
notre file de dix voyants à l’aveu-
glette. Son visage est serein, sou-
riant. Nous fixons ses yeux qui ne
voient pas.
Cette jeune femme, claire, bel-
le, est dans sa nuit. Plus cruelle
que nos jours. Je pense à ces mots
de René Char, que je ne com-
prends pas mais qui me suivent :
« Cette part de l’obscur comme une
grande rame plongeant dans les
eaux. » a
Notre histoire,
c’est celle d’un festival,
né en 1947
et d’un journal,
né en 1945.
Trois générations
de critiques du Monde
se sont succédé
à Avignon.
Elles témoignent ici
De haut en bas :
Jean Vilar (1947-1971),
AGNÈS VARDA AGENCE ENGUERAND.
Paul Puaux (1971-1979),
MARC ENGUERAND.
Alain Crombecque
(1985-1992),
MARC ENGUERAND.
Bernard Faivre d’Arcier
(1980-1984 et 1993-2003),
TRISTAN JEANNE-VALES
AGENCE ENGUERAND.
Hortense Archambault
et Vincent Baudriller
(depuis 2003),
MARC ENGUERAND.
Les cinq
directions
maccreteil.com / 01 45 13 19 19
une saison avec nous
,
L’honneur
de la mémoire
« Le Soulier de satin », de Paul
Claudel, mis en scène par Antoine
Vitez, dans la Cour d’honneur,
en 1987. MARC ENGUERAND
2006 AVIGNON page 5 - Jeudi 6 juillet 2006 - 0 123
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
1
/
14
100%