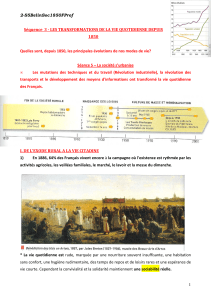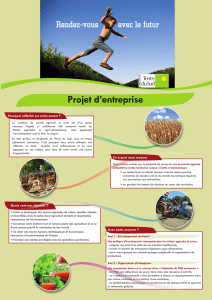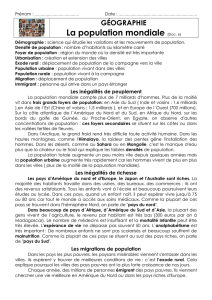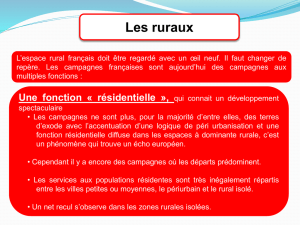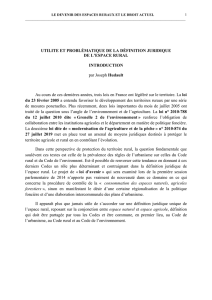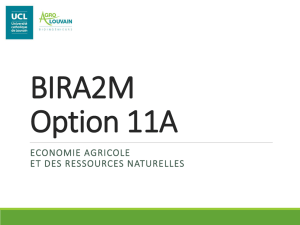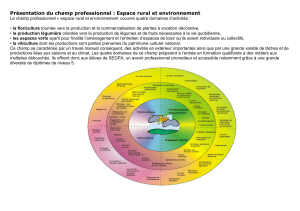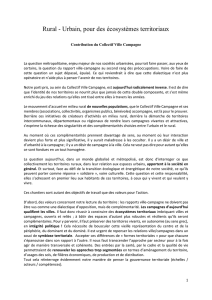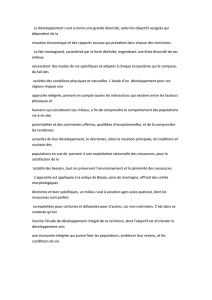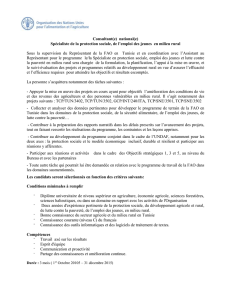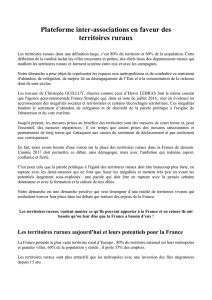conférences Houffalize

disparition des paysans n’est pas une fatalité. C’est l’un des messages que lançait François de
Ravignan dans « L’avenir d’un désert », petit livre paru en 1996, qui analysait l’effet de
l’exode rural sur le sud-ouest de l’Aude et soulignait en même temps l’apport de vitalité que
représente pour ces cantons l’arrivée de néo-ruraux depuis les années 1970.
« Les Amis de François de Ravignan » organisaient, fin juin 2013 à Camps-sur-l’Agly
(Hautes-Corbières), la 2e rencontre en hommage à François de Ravignan, sur le thème « Des
exclusions aux alternatives en milieu rural ». L’association a vu le jour après le décès en 2011
de cet agronome et économiste installé à Greffeil (11), qui a beaucoup travaillé sur
l’agriculture paysanne.
« L’avenir d’un désert » (1), qui a servi de base à la réflexion de l’une des matinées de ces
rencontres, animée par Pascal Pavie, analyse les effets de l’exode rural, à partir de la lecture
de paysage notamment puis d’une étude démographique sur les huit cantons du sud-ouest de
l’Aude (de Limoux à Axat et de Belcaire à Mouthoumet) : après un maximum démographique
vers 1850, la population chute presque de moitié en près d’un siècle. Cette tendance est la
même pour la France rurale dans son ensemble.
Une chute de la population qui ne doit rien au hasard. L’exode rural, explique François de
Ravignan, est la conséquence d’un choix économique, celui de l’industrialisation et de
l’ouverture des marchés.
Exemple : l’ouverture, en 1857, de la ligne de chemin de fer de Bordeaux à Sète permet aux
blés russes, moins chers, de concurrencer les blés audois ; résultat, les prix baissent de 40 %
en un an.
Mais surtout, dans ces terres de montagne, c’est la laine, et l’élevage ovin, qui pâtissent du
traité de libre échange (1860) avec l’Angleterre, lequel permet à la laine de l’hémisphère sud
d’entrer par les ports français avec des droits fortement réduits. Cela entraîne le
développement de l’industrie lainière de Mazamet (Tarn), la laine importée, de Mérinos, étant
plus fine que la laine locale, mais c’est la ruine pour l’élevage ovin de la région, dont les
effectifs seront divisés par quatre en cinquante ans.
Dans la suite logique de cette politique économique, l’intensification de l’agriculture accentue
l’exode rural. En cinquante ans, les huit cantons perdent la moitié de leurs terres labourables,
malgré la mécanisation ou plutôt à cause d’elle. Ce qui signifie 40 % de production de
calories en moins. Un territoire qui était autosuffisant sur le plan alimentaire ne l’est plus.
En 1850, le territoire du sud-ouest audois était autosuffisant sur le plan alimentaire.
Aujourd’hui, malgré la mécanisation, il ne l’est plus. Photo issue du site Photo Libre.
Dans ce contexte économique, les politiques de développement du territoire, qu’elles
proviennent de l’Etat ou des collectivités territoriales, ne peuvent qu’aboutir à l’échec,

estiment les participants à cet atelier : « elles ne peuvent qu’essuyer les plâtres de la politique
économique ».
Ces politiques de développement, dans notre région, favorisent d’ailleurs plutôt le tourisme.
Quand elles s’intéressent à l’agriculture, elles ont leurs limites : la Politique agricole
commune est orientée vers le soutien aux grandes exploitations, de plaine, et n’aide pas
beaucoup la petite installation.
« Que reste-t-il alors, sinon la solidarité ? », se demandent les Amis de François de Ravignan.
On parle beaucoup aujourd’hui de « relocalisation ». L’arrivée, dans le sud-ouest de l’Aude,
de néo-ruraux (dont tous ne vivent pas de la terre) ces quatre dernières décennies est bien une
relocalisation spontanée. Cette « nouvelle économie », d’initiative privée, a apporté une
vitalité indéniable à ces cantons. Elle ne suffit pas toutefois à contrecarrer les effets de la
politique économique.
L’accompagnement de petits projets
La solidarité, c’est l’esprit de l’action de l’Adear (Association pour le développement de
l’emploi agricole et rural) de l’Aude, qu’a présentée son co-président, Frédéric Tedesco. Cette
action, auprès des candidats à l’installation « qui ne rentrent pas dans les clous de
l’installation classique », se concrétise par des formations, de l’entraide, du tutorat et aussi,
depuis peu, une couveuse qui accompagne une dizaine de projets (à Carcassonne et
Galinagues).
« De marginale, l’Adear est devenue un élément important de l’installation », note Frédéric
Tedesco. En 2012, elle a reçu 220 personnes ; elle a accompagné 75 personnes à long terme et
en démarrage d’installation et 50 personnes déjà installées.
Luttes locales dans le monde
Ces rencontres ont été l’occasion de diffuser des informations sur un certain nombre de luttes,
dans le monde, pour la terre et pour le travail. Silvia Perez Vitoria a fait le point sur les
dernières rencontres de Via Campesina, fédération mondiale d’organisations paysannes et de
travailleurs de la terre.
Elle a rappelé les luttes que mène Via Campesina, contre l’Organisation mondiale du
commerce, contre l’accaparement des terres et pour l’accès des paysans à la terre, sur les
semences paysannes, sur le climat (campagne « les paysans refroidissent la planète », qui fait
allusion à l’effet de serre), la récupération des savoirs paysans (création de centres de
formation à l’agroécologie), combats des migrants agricoles, luttes des femmes…
François de Ravignan, souligne-t-elle, avait travaillé sur nombre de ces questions. Il avait en
particulier mis en évidence le fait que seuls les petits paysans peuvent répondre aux questions
de la faim (voir notamment « La faim pourquoi ? », La Découverte, 1983, réédité en 2009).
Le lendemain, Nick Bells, de Longo Maï, a évoqué le combat du Soc (Syndicat des
travailleurs de la terre) en Andalousie pour l’accès au travail (la mécanisation du coton,
notamment, a fait régresser le besoin de journaliers) et l’accès à la terre.
Daniel Cérézuelle, pour sa part, a détaillé les résultats d’une étude sur les jardins familiaux
(voir encadré) et Jacques Prades a dépeint l’évolution de la coopération (voir autre encadré).
Autant de témoignages d’initiatives, alternatives au modèle dominant, qui illustrent la
possibilité d’organiser différemment la société et l’économie. Ces exemples participent à
l’évolution des idées et des modèles en place. Ce qui n’est pas contradictoire avec l’avis de
Jacques Berthelot (2) selon qui « il faut agir à la base, dans le milieu associatif mais aussi

faire pression sur l’Etat » (pour qu’il fasse évoluer sa politique). Jacques Berthelot souligne
notamment le danger que le projet d’accord de libre-échange UE/USA fait courir à
l’agriculture européenne.
Philippe Cazal
1) « L’avenir d’un désert. Au pays de la Haute-Vallée de l’Aude », François de Ravignan, Ed.
Atelier du Gué (www.atelierdugue.com), 1996, réédité et mis à jour en 2003.
2) Economiste, ancien maître de conférences à l’Ecole nationale supérieure agronomique de
Toulouse, Jacques Berthelot a notamment écrit, avec François de Ravignan, « Les Sillons de
la faim » (L’Harmattan, 1980).
Des jardins ouvriers aux jardins familiaux
Daniel Cérézuelle a souligné le rôle des jardins familiaux dans la lutte contre l’exclusion en
milieu urbain. Professeur de philosophie et de sociologie, il est directeur scientifique du
Pades, Programme autoproduction et développement social. Il a réalisé plusieurs études sur le
sujet des jardins familiaux.
Nombreux avant guerre, les jardins familiaux étaient le résultat d’une revendication ouvrière,
et pas seulement le fruit du paternalisme de certains patrons, souligne-t-il. Ils ont, depuis,
largement disparu, laminés par le développement urbain et parce qu’avec l’industrialisation de
l’agriculture et le déploiement de la grande distribution, la production domestique n’avait plus
de sens aux yeux des contemporains.
Pourtant, certains jardins familiaux persistaient, dans les années 70 (D. Cérézuelle avait alors
mené une enquête) : pour ceux qui les cultivaient, ils pouvaient représenter un revenu
complémentaire (« équivalant au moins à un 13e mois de RMI »), et surtout, dit Daniel
Cérézuelle, la motivation principale était la qualité de l’alimentation. « On mange mieux »,
disaient les personnes interrogées et elles parlaient de la qualité des produits mais aussi du
goût. Les jardins familiaux sont par ailleurs l’opportunité, pour les jeunes, « d’une initiation à
la valeur travail. »
« Plus tard, un enjeu est devenu très important », poursuit D. Cérézuelle ; les jardins familiaux
sont devenus « un outil de lutte contre la malnutrition et la malbouffe » (et l’obésité qui va
avec) : « un jardin a rapidement un impact positif sur les pratiques alimentaires et les gens se
remettent à préparer les repas ».
Aujourd’hui, avec la « crise » économique, la demande de jardins familiaux est redevenue très
forte, en particulier dans les cités HLM et pas seulement dans les milieux « bobos ».
Coopératives : « la perte du sens de l’utopie » ?
Jacques Prades, auteur d' »Utopie réaliste. Renouveau de l’expérience coopérative. »
(L’Harmattan, 2012), parle de « profonde régression historique » qui tient à « la perte du sens
de l’utopie », notamment dans le mouvement coopératif.
Il estime que le système coopératif français, plus qu’en Italie ou en Espagne, a perdu son
objectif d’économie solidaire « parce qu’il y a un décalage énorme entre la théorisation et la
pratique de terrain ».
Les SCIC (sociétés coopératives d’intérêt collectif) sont beaucoup plus nombreuses en Italie
qu’en France, dit-il. De même, en France, les coopératives de consommateurs ont presque

disparu.
Jacques Prades explique cela par la perte de l’esprit coopératif (avec des adhérents plus
consommateurs de coopérative qu’acteurs) et propose de refonder la théorie des coopératives
en s’appuyant sur celle des limites : limite de la taille (« il ne faudrait pas dépasser environ
200 adhérents »), de la destruction des ressources naturelles, limite de l’investissement (à
l’inverse de la logique de cotation en bourse)…
L’un des échecs de la coopération, se demande Pascal Pavie, est peut-être « de s’être
cantonnée aux moyens de transformation et de commercialisation, sans avoir abordé la
production ? ».
Pour sa part, Jacques Berthelot évoque l’internationalisation des coopératives en Europe, avec
l’achat de filiales non coopératives, et il cite l’exemple de Tereos (sucre), qui a pris le
contrôle de Guarani, le 3e producteur de sucre et d’éthanol au Brésil, et d’une sucrerie au
Mozambique : « les dividendes de ces sociétés apportent 1 500 à 2 000 € par an à chaque
coopérateur ». Il s’interroge aussi sur les conditions de travail des coupeurs de canne au
Mozambique « qui sont régulièrement en grève ».
Plus de renseignements sur Les Amis de François de Ravignan : L’Ortie, Lasserre du Moulin,
11260 Saint-Jean de Paracol, tél. 04 68 20 36 09, [email protected]
Les 3es Rencontres des Amis de François de Ravignan devraient avoir lieu en novembre
2014.
Lire aussi, dans ce blog, la note de lecture sur « La faim, pourquoi ? », de François de
Ravignan.
Nota : Il n’est pas fait état ici de certaines interventions, auxquelles je n’ai pas assisté.

Les uns fuient le stress. Les autres se plaignent du manque de
confort. D’autres encore ne peuvent plus supporter le coût de la vie
citadine. Quels que soient leurs motifs, les urbains sont de plus en
plus nombreux à quitter la ville pour s’installer à la campagne. Et
demain, grâce à la révolution numérique, la grande famille des néo-
ruraux pourrait encore s’élargir, nous dit Jean-Yves Pineau,
directeur du collectif Ville Campagne.
Vue du célèbre plateau des Millevaches, dans le Limousin, un département qui a su sortir de la crise démographique en attirant les
citadins.
© Babsy / Wikimedia
Tout commence à la fin des années 1960, quand quelques milliers de jeunes urbains, sensibles à
l’écologie et rejetant la société de consommation, choisissent de quitter la ville pour s’installer à la
campagne. Un retour à la terre qui permet, notamment, l’ouverture des premières coopératives
agricoles biologiques. Malgré cette première vague migratoire, les campagnes continuent de se
dépeupler. Puis, au milieu des années 1990, une deuxième vague de départs relance l’économie et la
démographie des campagnes. Cadres, ouvriers, professions intermédiaires… Ces nouveaux migrants
quittent la ville non plus pour des raisons idéologiques mais plutôt parce qu’ils en ont raz-le-bol du
stress, du bruit, de la pollution et des autres désagréments de la vie urbaine. Il s’agit, en majorité, de
jeunes adultes âgés de 30 à 45 ans, souvent accompagnés de leurs enfants en bas âge, qu’ils souhaitent
voir grandir dans un cadre plus naturel que minéral. Souvent, ils s’installent sur un territoire rural lié à
leur histoire familiale ou visité régulièrement durant les vacances. À cette « motivation résidentielle »
s’ajoute un argument beaucoup plus rationnel : le coût de la vie urbaine. La crise économique a ainsi
accentué l’exode urbain, poussant les classes moyennes étouffées financièrement (loyer, école, etc.) à
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
1
/
14
100%