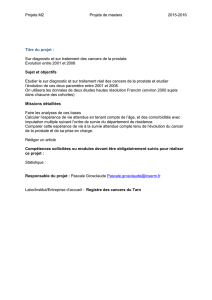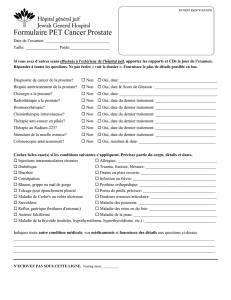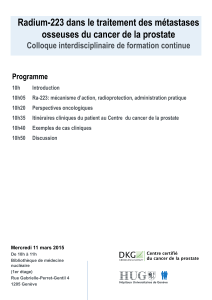TUMEURS GERMINALES Chimiothérapie à hautes doses avec support de cellules souches

Correspondances en Onco-Urologie - Vol. VIII - n° 2 - avril-mai-juin 2017
58
Commentaire. Les données de cette étude rétrospective
monocentrique montrent des résultats intéressants en situa-
tion de rattrapage. Néanmoins, on aurait pu s’attendre à
une SSP plus élevée dans cette cohorte, où les patients ont
une tumeur évolutive plutôt de bon pronostic (une majo-
rité d’entre eux est sensible au cisplatine, peu de tumeurs
médiastinales primitives, peu de lésions cérébrales évolu-
tives). Les études TI-CE du MSKCC et de C.Chevreau et al.
obtiennent des résultats similaires dans une population
plus gravement atteinte(2,3).
Revue de presse
Coordination : Philippe Beuzeboc et Stéphane Oudard (Paris)
TUMEURS GERMINALES
Chimiothérapie à hautes
doses avec support
de cellules souches
périphériques autologues
dans les récidives de
tumeurs germinales :
l’expérience de l’Indiana
University
PÉNIS
Expression fréquente
de PD-L1 dans les cancers
épidermoïdes du pénis
au niveau de la tumeur
primitive et des métastases
REIN
Diabète fulminant de type 1
secondaire à une double
inhibition de points de
contrôle immunitaires
PROSTATE
Étude de phase I/ II
d’une association
cabazitaxel +
abiratérone dans les
cancers de la prostate
métastatiques résistants
à la castration
Mutation activatrice d’AKT :
mécanisme potentiel
de résistance aux inhibiteurs
de PARP dans les cancers de
la prostate à BRCA2 muté
Acétate d’abiratérone
dans les cancers de la
prostate métastatiques
chez les patients ayant
une réponse suboptimale
à l’hormonothérapie initiale
Traitement hormonal
substitutif par testostérone
et risque de cancer de la
prostate : résultats de l’étude
du National Prostate Cancer
Register of Sweden
TUMEURS UROLOGIQUES
Association entre la
longueur des télomères et
le risque de cancer ou de
maladies non cancéreuses :
des implications dans
quelques tumeurs
urologiques ?
VESSIE
Chimiothérapie adjuvante
des cancers urothéliaux
des voies urinaires hautes
localement avancés ou N+
TUMEURS GERMINALES
Chimiothérapie à hautes doses
avecsupport de cellules souches
périphériques autologues
danslesrécidives de tumeurs germinales :
l’expérience de l’Indiana University
L’équipe de l’université d’Indianapolis a publié, le
31 mars 2017 dans le Journal of Clinical Oncology,
les résultats d’une étude rétrospective monocentrique
de 364 patients atteints d’une tumeur germinale
métastatique en rechute, traités en 1
re
ou 2
e
ligne de
rattrapage par 1 ou 2 cycles de chimiothérapie à hautes
doses (HDCT) avec réinjection de cellules souches
hémato poïétiques périphériques (CSHP) [1].
Tous les patients avaient reçu une première ligne de
chimiothérapie à base de cisplatine et présentaient une
progression tumorale dans les 2 ans. Ils avaient une
tumeur primitive testiculaire (87 %), rétropéritonéale
(8 %) ou médiastinale (5 %), et pouvaient avoir une
maladie réfractaire (33 %) ou non (67 %) au cisplatine.
En cas de tumeur réfractaire, ils recevaient directement
la chimiothérapie intensive, sans chimiothérapie stan-
dard au préalable, après recueil des cellules souches
sous facteurs de croissance ; pour les autres patients,
1 ou 2 cycles de VeIP (vinblastine, ifosfamide, cisplatine)
étaient le plus souvent administrés avant l’HDCT afin
de diminuer le volume tumoral (1).
Le nombre de malades traités est important : 364 en
10 ans (de 2004 à 2014) ; les auteurs avaient comme
objectif de traiter tous les patients par 2 cycles de
HDCT associant carboplatine 700 mg/ m2 + étoposide
750 mg/ m2
de J1 à J3, et perfusion des CSHP à J6.
De façon systématique, les patients recevaient un
traitement prophylactique à partir de la veille de
la trans fusion des CSHP, par ciprofloxacine 500 mg
per os × 2/ j, aciclovir 400 mg/j per os, fluconazole
400 mg/ j per os et vancomycine i.v. jusqu’à la sortie
d’aplasie. Les facteurs de croissance étaient admi-
nistrés tous les jours à partir du lendemain de la per-
fusion des CSHP jusqu’à la sortie d’aplasie.
L’objectif de l’étude était d’évaluer la survie sans pro-
gression (SSP) de ces malades. Des analyses univariée et
multivariée ont été réalisées à la recherche de facteurs
prédictifs de la SSP.
L’âge médian des patients traités était de 32 ans
(17-70 ans) ; 285 (78 %) avaient une tumeur germi-
nale non séminomateuse (TGNS). Parmi ceux ayant
une tumeur sensitive au cisplatine, 83 % avaient reçu
un cycle de chimiothérapie standard avant l’intensi-
fication. Seuls 20 patients (5 %) avaient une atteinte
cérébrale évolutive ; 303 patients (83 %) avaient
reçu l’HDCT en première ligne de rattrapage et 341,
les 2 cycles d’HDCT planifiés, soit 94 % des patients.
La médiane entre les 2 cycles était de 28 jours
(18-58 jours). Vingt-trois patients n’ont reçu qu’un
seul cycle d’HDCT, en raison soit d’une progression
(12 patients), soit d’une toxicité (11). Il faut noter que
134 patients ont reçu un traitement d’entretien par
étoposide après l’HDCT.
Avec une médiane de suivi de 3,3 ans, la SSP et la survie
globale (SG) estimées à 2 ans pour l’ensemble de la
population sont de 60 (IC95 : 55-65) et 66 % (IC95 : 60-70),
respectivement. La médiane de rechute après HDCT
est de 4,3 mois (1-30 mois).
La SSP pour les patients traités par HDCT en deuxième
ligne de rattrapage ou plus est de 49 % (IC95 : 36-61)
contre 63 % (IC95 : 57-68) [p = 0,03] pour la première
ligne de rattrapage. La SG est de 60 % (IC95 : 46-71)
contre 67 % (IC95 : 61-72) [p = 0,05].
La SSP et la SG à 2 ans des patients ayant une maladie
réfractaire ne sont pas bonnes. La SSP est de 33 %
(IC95 : 24-41) contre 75 % (IC95 : 69-80) [p = 0,001] pour
ceux ayant une maladie sensible au cisplatine, et la
SG est de 37 % (IC
95
: 30-45) contre 80 % (IC
95
: 75-85)
[p = 0,001].
Parmi les 20 patients ayant des métastases cérébrales
évolutives, 8 n’ont pas eu besoin d’un traitement
chirurgical et/ ou d’une radiothérapie complé mentaire
dans les suites.
En analyse multivariée selon le modèle de Cox, les
facteurs associés à la progression de la maladie sont
la réalisation d’une HDCT en deuxième ligne de rattra-
page, chez les malades réfractaires au cisplatine,
chez ceux ayant une TGNS, une tumeur médiastinale
primi tive, une tumeur de pronostic intermédiaire ou
de mauvais pronostic au diagnostic initial et un taux
d’hCG > 1 000 UI/ l à l’instauration de l’HDCT.
Les toxicités sont celles attendues pour une HDCT,
9 patients étant décédés de toxicités. Cinq patients
ont développé une leucémie secondaire.

Correspondances en Onco-Urologie - Vol. VIII - n° 2 - avril-mai-juin 2017
59
Revue de presse
A. Fléchon, Lyon
1. Adra N, Abonour R, Althouse SK, Albany C, Hanna NH,
Einhorn LH. High-dose chemotherapy and autologous peri-
pheral-blood stem-cell transplantation for relapsed meta-
static germ cell tumors: The Indiana University Experience.
J Clin Oncol 2017;35(10):1096-102.
2. Feldman DR, Sheinfeld J, Bajorin DF et al. TI-CE high-dose
chemotherapy for patients with previously treated germ cell
tumors: results and prognostic factor analysis. J Clin Oncol
2010;28(10):1706-13.
3. Chevreau C, Massard C, Fléchon A et al. Phase II trial of
TI-CE high dose chemotherapy (HDCT) with drug monitoring
for individual carboplatin dosing in patients with relapsed
advanced germ cell tumors: a multicentric prospective
GETUG trial. J Clin Oncol 2017;35(Suppl. 6):401.
4. Loehrer PJ Sr, Gonin R, Nichols CR, Weathers T, Einhorn
LH. Vinblastine plus ifosfamide plus cisplatin as initial
salvage therapy in recurrent germ cell tumor. J Clin Oncol
1998;16(7):2500-4.
5. Kondagunta GV, Bacik J, Donadio A et al. Combination of
paclitaxel, ifosfamide, and cisplatin is an effective second-
line therapy for patients with relapsed testicular germ cell
tumors. J Clin Oncol 2005;23(27):6549-55.
Le nombre de leucémies secondaires est
important et à relier à la dose d’étoposide
utilisée, qui est élevée dans cette étude. Un
traitement standard de rattrapage n’aurait-il
pas apporté la même SSP dans cette
population ? La réalisation de 2cycles d’HDCT
est-elle suffisante ou doit-on aujourd’hui consi-
dérer que le standard est l’administration de
3cycles (4) ?
Nous aurons vraisemblablement les réponses
à toutes ces questions grâce aux résultats
de TIGER, une étude internationale qui vient
de débuter en France. Cette étude compare,
en première ligne de rattrapage chez les
patients atteints d’une tumeur germinale, le
traitement standard par 4cycles de TIP (pacli-
taxel, ifosfamide, cisplatine) au protocole TI-CE
(paclitaxel et ifosfamide) 1ou 2cycles pour le
recueil des CSHP, suivis de 3 cycles d’HDCT par
carboplatine AUC24 et étoposide 1 200mg/ m
2
,
répartis sur 3jours, à leur tour suivis de la
réinjection des CSHP àJ5(5).
PÉNIS
Expression fréquente de PD-L1
dans lescancers épidermoïdes
dupénis auniveau delatumeur
primitive et desmétastases
Les tumeurs du pénis sont rares, liées aux
papillomavirus (HPV). Dans la majorité des
cas, il s’agit de carcinomes épidermoïdes.
Les taux de survie sont faibles aux stades
avancés et métastatiques.
A.M. Udager et al. (1) viennent de rapporter
dans Annals of Oncology que l’expression
de PD-L1 (Programmed Death Ligand 1)
en immuno- histochimie est fréquente
dans les cancers du pénis, avec un taux de
positivité de 62 % (23/ 37) au niveau de la
tumeur primitive. Celle-ci était définie par
le marquage membranaire supérieur à 5 %
des cellules tumorales. Il a été retrouvé
une forte corré lation avec l’expression de
PD-L1 dans les ganglions métastatiques et
des critères clinico patho logiques de haut
risque mais, en revanche, pas de corré lation
entre expression de PD-L1 et altérations
moléculaires spéci fiques (2). Il s’agit de la
première étude sur le sujet. Elle ouvre de
nouvelles perspectives dans un domaine
où les progrès attendus par les traitements
classiques de radiothérapie et de chimio-
thérapie ont été très décevants ces dernières
années (3)…
Commentaire. La cohorte est limitée mais il
faut tenir compte de la rareté de la maladie
dans nos contrées… Ces données devraient
servir derationnel à la mise en place de
traitements parun inhibiteur de points de
contrôle immunologique de type anti-PD-1
ou anti-PD-L1(4)…
Lerationnel est d’autant plus fort que d’autres
tumeurs viro- induites, comme les tumeurs à
cellules de Merkel, ont montré des résultats
importants avec ces nouvelles immuno-
thérapies(5). Des essais sont aussi encours
dans les cancers ducol métastatiques.
P. Beuzeboc, Paris
1. Udager AM, Liu TY, Skala SL et al. Frequent PD-L1 expression
in primary and metastatic penile squamous cell carcinoma:
potential opportunities for immunotherapeutic approaches.
Ann Oncol 2016;27(9):1706-12.
2. McDaniel AS, Hovelson DH, Cani AK et al. Genomic
profiling of penile squamous cell carcinoma reveals
new opportu nities for targeted therapy. Cancer Res
2015;75(24):5219-27.
3. Hakenberg OW, Compérat EM, Minhas S et al. EAU
guidelines on penile cancer: 2014 update. Eur Urol 2015;
67(1):142-50.
4. Al-Ahmadie H. PD-L1 expression in penile cancer: a new
frontier for immune checkpoint inhibitors? Ann Oncol 2016;
27(9):1658-9.
5. Nghiem PT, Bhatia S, Lipson EJ et al. PD-1 blockade with
pembrolizumab in advanced Merkel-cell carcinoma. N Engl
J Med 2016;374(26):2542-52.
REIN
Diabète fulminant de type1
secondaire à une double inhibition
de points de contrôle immunitaires
Le rétablissement de l’efficacité de réponses
immunes T avec les nouveaux inhibiteurs de
points de contrôle s’accompagne d’un risque
de réactions auto-immunes graves et variées,
le plus souvent cutanées, digestives, pulmo-
naires, neuromusculaires et endo crino logiques.
Parmi ces dernières, le diabète fulminant de
type 1 apparaît comme une nouvelle entité
caractérisée par sa rapide progression.
L’intervalle entre les symptômes d’hyper-
glycémie et l’acidocétose est habituelle-
ment inférieur à 7 jours. Une hyperglycémie
associée à un taux normal d’hémoglobine
glyquée (HbA1c) en est la caractéristique bio-
logique principale à laquelle on peut ajouter
des taux bas de peptide C, une élévation des
corps cétoniques, des taux élevés d’enzymes
pancréatiques (amylasémie, lipasémie) et
l’absence d’autoanticorps contre les cellules
β-pancréatiques… En clinique, on retrouve
dans 70 % des cas un syndrome pseudo-
grippal précédant le début de la maladie.
G.H. Teló et al. (1) viennent de rapporter un
cas de diabète fulminant de type 1 chez un
homme, âgé de 51 ans, 45 jours après avoir
reçu une combinaison de première ligne
associant ipilimumab et nivolumab pour
un cancer du rein métastatique. Ce patient
n’avait aucun antécédent personnel ou
familial de diabète.
Après équilibration du diabète, le traitement
a été repris permettant d’obtenir une réponse
partielle toujours durable.
Commentaire. Seulement de rares cas de cette
nouvelle complication ont été décrits dans
d’autres types de tumeurs(2). Elle doit rapidement
être diagnostiquée pour permettre une prise en
charge multidisciplinaire adaptée.
P. Beuzeboc, Paris
1. Teló GH, Carvalhal GF, Cauduro CG et al. Fulminant type 1
diabetes caused by dual immune checkpoint blockade in
metastatic renal cell carcinoma. Ann Oncol 2017;28(1):191-2.
2. Lowe JR, Perry DJ, Salama AK et al. Genetic risk analysis
of a patient with fulminant autoimmune type 1 diabetes
mellitus secondary to combination ipilimumab and nivo-
lumab immunotherapy. J Immunother Cancer 2016;4:89.

Correspondances en Onco-Urologie - Vol. VIII - n° 2 - avril-mai-juin 2017
60
Revue de presse
PROSTATE
Étude de phaseI/ II
d’uneassociation cabazitaxel+
abiratérone dans les cancers
delaprostate métastatiques
résistants à la castration
L’enregistrement dans les cancers de la
prostate métastatiques résistants à la
castration de 6 traitements spécifiques,
dont 2 cytotoxiques (docétaxel et cabazi-
taxel), 2 hormonothérapies de nouvelle
génération (acétate d’abiratérone, enzalu-
tamide), 1 immunothérapie (sipuleucel T) et
1 radiothérapie métabolique (radium 223),
va conduire, dans les prochaines années,
à évaluer différentes combinaisons ou
séquences pour optimiser les résultats.
Le cabazitaxel reste efficace après acétate
d’abiratérone (1) et, de façon plus générale,
après l’utilisation d’une hormonothérapie de
nouvelle génération (2).
C. Massard (3) vient de confirmer dans une
étude de phase I que la combinaison de
cabazitaxel (25 mg/ m2/ 21 jours) et d’acétate
d’abiratérone (1 000 mg/ j) et de prednisone
(10 mg/ j) pouvait être utilisée aux doses stan-
dard (4). Les données pharmacocinétiques
montrent que l’abiratérone ne modifie pas la
clairance d’élimination du cabazitaxel.
Le schéma a pu être poursuivi pour une
médiane de 7 cycles sans qu’apparaissent
des signes de toxicité tardive non attendus.
Les doses de cabazitaxel ont dû être dimi-
nuées chez 24 % des patients. Rappelons
que 2 essais récents de phase III, FIRSTANA
et PROSELICA (5), ont montré qu’une dose de
cabazitaxel de 20 mg/ m2 n’était pas inférieure
en termes de survie globale.
Commentaire. Ces données de sécurité d’emploi
sont importantes pour les futurs essais théra-
peutiques évaluant cette association dans le
cadre d’études stratégiques. Une étude de phaseII
d’expansion est en cours pour évaluer l’efficacité
de la combinaison.
P. Beuzeboc (Paris)
1. Al Nakouzi N, Le Moulec S, Albiges L et al. Cabazitaxel
remains active in patients progressing after docetaxel
followed by novel androgen receptor pathway targeted
therapies. Eur Urol 2015;68(2):228-35.
2. Pezaro CJ, Omlin AG, Altavilla A et al. Activity of cabazitaxel
in castration-resistant prostate cancer progressing after
docetaxel and next- generation endocrine agents. Eur Urol
2014;66(3):459-65.
3. Massard C, Mateo J, Loriot Y et al. Phase I/ II trial of
cabazitaxel plus abiraterone in patients with metastatic
castration-resistant prostate cancer (mCRPC) progressing
after docetaxel and abiraterone. Ann Oncol 2017;28(1):90-5.
4. de Bono JS, Oudard S, Ozguroglu M et al. Prednisone plus
cabazitaxel or mitoxantrone for metastatic castration- resistant
prostate cancer pro- gressing after docetaxel treatment: a
randomised open-label trial. Lancet 2010;376(9747):1147-54.
5. de Bono J, Hardy-Bessard AC, Kim CS et al. Phase III non-
inferiority study of cabazitaxel 20 mg/ m2 versus cabazitaxel
25 mg/ m2 in patients with metastatic castration-resis-
tant prostate cancer previously treated with docetaxel
(PROSELICA). ASCO® 2016 : abstr. 5008.
PROSTATE
Mutation activatrice d’AKT :
mécanisme potentiel derésistance
aux inhibiteurs de PARP
danslescancers de la prostate
BRCA2 muté
L’olaparib a récemment montré, dans l’étude
TOPARP-A (1), son efficacité dans les cancers
de la prostate résistants à la castration méta-
statiques (CPRCm) présentant une altération
au niveau de gènes de réparation de l’ADN,
en particulier en cas de mutation de BRCA2.
Dans les CPRCm, le taux de mutations germi-
nales de BRCA2 retrouvées dans l’étude de
C.C. Pritchard et al. (2) était de 5,2 %. D’autres
altérations de BRCA2 somatiques peuvent
aussi survenir au cours de l’évolution du
cancer de la prostate.
C. Nientiedt et al. (3) ont décrit une réponse
dissociée sous olaparib, avec une réponse
ganglionnaire contrastant avec une progres-
sion osseuse. Surtout, en explorant sur le plan
génomique le mécanisme de la résistance à
l’olaparib, ils ont retrouvé une mutation soma-
tique activatrice au niveau du gène AKT1.
Commentaire. Il avait déjà été rapporté que
l’activation de la voie AKT contrait l’efficacité
de l’inhibition de PARP. Les auteurs ont montré
également que l’inhibition d’AKT pouvait être
combinée de façon “safe” avec l’olaparib pour
induire des réponses thérapeutiques. Une piste de
combinaison potentielle à ne pas méconnaître…
Il faut signaler que d’autres inhibiteurs de PARP
sont en cours de développement dans les CPRCm
présentant des altérations de BRCA2, mais aussi
d’ATM.
P. Beuzeboc, Paris
1. Mateo J, Carreira S, Sandhu S et al. DNA-repair defects
and olaparib in metastatic prostate cancer. N Engl J Med
2015;373(18):1697-708.
2. Pritchard CC, Mateo J, Walsh MF et al. Inherited DNA-repair
gene mutations in men with metastatic prostate cancer.
N Engl J Med 2016;375(5):443-53.
3. Nientiedt C, Tolstov Y, Volckmar AL et al. PARP inhibition
in BRCA2-mutated prostate cancer. Ann Oncol 2017;28(1):
189-91.
PROSTATE
Acétate d’abiratérone
dansles cancers de la prostate
métastatiques chez les patients
ayant une réponse suboptimale
àl’hormonothérapie initiale
L’histoire naturelle des cancers de la prostate
métastatiques hormononaïfs est très variable.
Dans l’essai SWOG 9346 (1), les patients ayant
eu une réponse suboptimale à une hormono-
thérapie d’induction, définie par un taux de
PSA supérieur à 4 ng/ ml après 7 mois de sup-
pression androgénique, ont clairement un
très mauvais pronostic (médiane de survie de
13 mois, versus 75 mois pour ceux présentant
un taux inférieur à 0,2 ng/ ml).
La prise en charge des cancers de la pros-
tate d’emblée métastatiques hormononaïfs
a été modifiée récemment par la possi-
bilité d’associer au traitement standard par
hormonothérapie une chimiothérapie par
docétaxel, notamment chez les patients
présentant un “haut volume tumoral”,
depuis les résultats des essais CHAARTED et
STAMPEDE (2, 3). Dans l’étude CHAARTED, les
médianes de survie globale étaient, pour les
bras suppression androgénique + docétaxel
et suppression androgénique seule, de 57,6
et 44,0 mois. Dans l’étude STAMPEDE, qui a
inclus des patients N+, elles étaient respec-
tivement de 81 et 71 mois.
Il n’y a pas de données concernant les nou-
velles hormonothérapies (abiratérone ou
enzalutamide) en “upfront”. On attend les
résultats des essais LATITUDE (qui seront
présentés au 53e congrès américain en
oncologie clinique) et PEACE 1, étude qui
devrait rapidement clore ses inclusions
(plus de 700 patients sont d’ores et déjà
en cours d’inclusion). En revanche, ces
hormonothérapies de deuxième génération
sont devenues les standards de traitement
en phase de résistance à la castration à la
suite des essais COU-AA-302 (4) et PREVAIL.
>>>

Correspondances en Onco-Urologie - Vol. VIII - n° 2 - avril-mai-juin 2017
62
Revue de presse
L’objectif de cette étude de phase II (5) du
National Clinical Trials Network-Southwest
Oncology Group était de déterminer l’effi
-
cacité potentielle de l’acétate d’abiratérone
(1 000 mg/ j) associé à la prednisone (10 mg/ j)
dans une population ayant un taux de PSA
supérieur à 4 ng/ ml 6 à 12 mois après l’ins-
tauration de la suppression androgénique,
ce taux pouvant être en baisse ou en hausse
au moment de l’inclusion. Quarante et un
patients ont été inclus. Aucun n’avait reçu
de chimiothérapie ou d’hormonothérapie
de deuxième ligne. Le critère de jugement
principal était l’obtention d’un taux de PSA
inférieur à 0,2 ng/ ml. La réponse partielle,
critère de réponse secondaire, était définie
par une baisse du PSA comprise entre 0,2
et 4 ng/ ml.
Au total, 5 patients (13 %) ont obtenu un
taux de PSA inférieur à 0,2 ng/ ml et 13
(33 %), une réponse partielle. La médiane de
survie sans progression a été de 17,5 mois
(IC95 : 8,6-25,0 mois), et la médiane de survie
globale, de 25,8 mois.
Commentaire. Le faible effectif limite la
portée de cette étude, qui montre néan-
moins des résultats encourageants dans une
population ayant un très mauvais pronostic.
L’application de biomarqueurs prédictifs d’une
réponse à l’acétate d’abiratérone pourrait aider
à améliorer l’application clinique d’une telle
approche(6).
P. Beuzeboc, Paris
1. Hussain M, Tangen CM, Higano C et al; Southwest
Oncology Group Trial 9346 (INT-0162). Absolute prostate-
specific antigen value after androgen deprivation is a strong
independent predictor of survival in new metastatic prostate
cancer: data from Southwest Oncology Group Trial 9346
(INT-0162). J Clin Oncol 2006;24(24):3984-90.
2. Sweeney CJ, Chen YH, Carducci M et al. Chemohormonal
therapy in metastatic hormone-sensitive prostate cancer.
N Engl J Med 2015;373(8):737-46.
3. James ND, Sydes MR, Clarke NW et al.; STAMPEDE inves-
tigators. Addition of docetaxel, zoledronic acid, or both to
first-line long-term hormone therapy in prostate cancer
(STAMPEDE): survival results from an adaptive, multiarm,
multistage, platform randomised controlled trial. Lancet
2016;387(10024):1163-77.
4. Ryan CJ, Smith MR, de Bono JS et al.; COU-AA-302
Investigators. Abiraterone in metastatic prostate cancer without
previous chemotherapy. N Engl J Med 2013;368(2):138-48.
5. Flaig TW, Plets M, Hussain MH et al. Abiraterone acetate
for metastatic prostate cancer in patients with suboptimal
biochemical response to hormone induction. JAMA Oncol
2017. [Epub ahead of print]
6. Antonarakis ES, Lu C, Wang H et al. AR-V7 and resistance
to enzalutamide and abiraterone in prostate cancer. N Engl
J Med 2014;371(11):1028-38.
PROSTATE
Traitement hormonal substitutif
par testostérone et risque
decancer de la prostate : résultats
de l’étude du National Prostate
Cancer Register of Sweden
L’existence d’une association entre l’expo-
sition à un traitement hormonal substitutif
par testostérone et le risque de cancer de
la prostate est controversée. S. Loeb et al.
ont utilisé le registre national couvrant la
population suédoise, le National Prostate
Cancer Register of Sweden, pour y mener
une étude cas-témoins (1). Cette étude a
inclus, à partir de ce registre, 38 570 cas
de cancer de la prostate diagnostiqués
entre 2009 et 2012, qui ont été appariés à
192 838 hommes d’âge comparable, sans
cancer de la prostate connu. Une analyse
multivariée spécifique a été réalisée afin
d’étudier l’association entre le traitement
hormonal substitutif par testostérone et le
risque de cancer de la prostate (globale-
ment et en fonction de son pronostic bon
ou mauvais).
Deux cent quatre-vingt-quatre patients
atteints d’un cancer de la prostate (1 %) et
1 378 cas contrôles (1 %) avaient reçu un
traitement hormonal substitutif par testo-
stérone. L’analyse statistique n’a pas mis en
évidence d’association entre le traitement
hormonal substitutif par testostérone et
le risque global de cancer de la prostate
( odds-ratio [OR] = 1,03 ; IC95 : 0,90-1,17).
En revanche, les patients qui avaient reçu un
traitement hormonal substitutif par testo-
stérone ont eu davantage de cancers de la
prostate de pronostic favorable (OR = 0,50 ;
IC95 : 0,37-0,67). L’augmentation du risque
des cancers de la prostate de pronostic favo-
rable a été observée au cours des premières
années sous traitement hormonal substitutif
par testostérone (OR = 1,61 ; IC95 : 1,10-2,34),
alors que la réduction du risque de cancer
de la prostate de pronostic agressif était
observée après 1 an de traitement hormonal
substitutif par testostérone (OR = 0,44 ; IC
95
:
0,32-0,61). Après ajustement en fonction
du résultat des biopsies prostatiques anté-
rieures (utilisé en tant qu’indicateur de
l’activité de recherche du diagnostic), le
traitement hormonal substitutif par testo-
stérone demeurait significativement associé
à la survenue de cancers de la prostate de
pronostic favorable et à une réduction du
risque de cancers de la prostate agressifs.
La conclusion des auteurs est que l’aug-
mentation des diagnostics de cancer de la
prostate de pronostic favorable durant la
première année du traitement hormonal
substitutif par testostérone relève d’un
biais de détection, alors que la diminution
du risque de cancer de la prostate agressif est
une découverte nouvelle qui justifie d’appro-
fondir les investigations.
Commentaire. Les faits rapportés par S.Loeb
et ses coauteurs ne sont pas nouveaux, mais
l’importance et la qualité de la cohorte étudiée
leur donnent un poids sans précédent(1). Les
auteurs rappellent d’ailleurs dans l’introduction
de leur article que 2méta-analyses récentes
ont montré que le traitement hormonal
substitutif par testostérone n’était associé
ni au développement ni à la progression
du cancer de la prostate(2,3). Les études
concernant l’association entre les taux
sériques d’androgènes et le risque de cancer
de la prostate ont également démontré que les
taux normaux et subnormaux de testostérone
n’augmentent pas le risque de développer un
cancer de la prostate(4). Le phénomène de
saturation des récepteurs des androgènes est
la raison actuellement retenue pour expliquer
l’absence d’effet carcinogène d’un excès de
testostérone(5). Enrevanche, l’hypogonadisme
a été associé à un risque accru de développer
un cancer de la prostate de pronostic agressif,
à l’instar de ce que Loeb etal. rapportent dans
leur population témoin(6).
La lecture de cet article du Journal of Clinical
Oncology du 1ermai 2017 apporte donc de
l’eau au moulin des cliniciens, urologues,
endocrinologues ou cardiologues, entre autres,
qui, bien au fait des effets néfastes de l’hypo-
gonadisme, souhaitent prescrire un traitement
hormonal substitutif par testostérone à leurs
patients. Les améliorations du métabolisme
glucidique, lipidique, de la trophicité musculaire,
osseuse, cardiovasculaire, et des fonctions
supérieures des patients attendues d’un tel
traitement ne sont pas contrebalancées par
l’augmentation du risque de développer
uncancer de la prostate agressif(7).
>>>

Correspondances en Onco-Urologie - Vol. VIII - n° 2 - avril-mai-juin 2017
63
Revue de presse
Le dépistage du cancer de la prostate est un
préalable à la prescription du traitement
hormonal substitutif par testostérone unani-
mement recommandé par les sociétés savantes
concernées. L’étude de Loeb etal. montre que
ce dépistage détecte bel et bien des cancers,
avec une information nouvelle et importante : il
s’agit plus fréquemment de cancers de pronostic
favorable. Ce résultat semble être en contra-
diction avec le fait précédemment rapporté
que les patients hypogonadiques (chez qui un
traitement hormonal substitutif par testostérone
est donc justifié) développent des cancers de la
prostate plus fréquemment agressifs. Il n’en est
rien, et ce pour une raison simple : les patients de
l’étude de Loeb etal. sont des hypogonadiques
bénéficiant d’un dépistage ciblé du cancer de la
prostate. Dans les études antérieures, le cancer
de la prostate était déjà diagnostiqué – donc à un
stade plus avancé – et l’étude du statut gonadique
des patients montrait qu’il était déficitaire. La
conséquence pratique est qu’il faut traiter les
patients hypogonadiques par un traitement
hormonal substitutif par testostérone : non
seulement cela leur permettra de bénéficier d’une
qualité et d’une espérance de vie meilleures, mais
cela réduira également leur risque de développer
un cancer de la prostate agressif(8). La prévalence
de l’hypogonadisme est évaluée à 10 à 15 % dans
la population générale de plus de 50ans.
Y. Neuzillet, Suresnes
1. Loeb S, Folkvaljon Y, Damber JE, Alukal J, Lambe M,
Stattin P. Testosterone replacement therapy and risk of
favorable and aggressive prostate cancer. J Clin Oncol
2017;35(13):1430-6.
2. Cui Y, Zong H, Yan H, Zhang Y. The effect of testosterone
replacement therapy on prostate cancer: a systematic review
and meta-analysis. Prostate Cancer Prostatic Dis 2014;
17(2):132-43.
3. Kang DY, Li HJ. The effect of testosterone replacement
therapy on prostate-specific antigen (PSA) levels in men
being treated for hypogonadism: a systematic review and
meta-analysis. Medicine (Baltimore) 2015;94(3):e410.
4. Endogenous Hormones and Prostate Cancer
Collaborative Group, Roddam AW, Allen NE, Appleby P,
Key TJ. Endogenous sex hormones and prostate cancer:
a collaborative analysis of 18 prospective studies. J Natl
Cancer Inst 2008;100(3):170-83.
5. Davidson E, Morgentaler A. Testosterone therapy and
prostate cancer. Urol Clin North Am 2016;43(2):209-16.
6. Botto H, Neuzillet Y, Lebret T, Camparo P, Molinie V,
Raynaud JP. High incidence of predominant Gleason pattern
4 localized prostate cancer is associated with low serum
testosterone. J Urol 2011;186(4):1400-5.
7. Isidori AM, Giannetta E, Greco EA et al. Effects of testo-
sterone on body composition, bone metabolism and serum
lipid profile in middle-aged men: a meta-analysis. Clin
Endocrinol (Oxf) 2005;63(3):280-93.
8. Corona G, Rastrelli G, Monami M et al. Hypogonadism as
a risk factor for cardiovascular mortality in men: a meta-
analytic study. Eur J Endocrinol 2011;165(5):687-701.
TUMEURS UROLOGIQUES
Association entre la longueur
destélomères et le risque
decancer ou de maladies
noncancéreuses : desimplications
dans quelques tumeurs
urologiques ?
Au bout des chromosomes, les télomères
sont des structures ADN combinées à des pro-
téines qui protègent le génome. Marqueurs
physiologiques de l’âge, ils raccourcissent au
cours du vieillissement.
Le raccourcissement des télomères est non
seulement associé aux maladies cardio-
vasculaires, au diabète de type 2 et à diffé-
rentes causes non tumorales de mortalité, mais
aussi au risque de cancer. L’importance de la
magnitude de cette association a fait l’objet
de rapports contradictoires dans les études
observationnelles (1-4). Les individus présen-
tant une dyskératose congénitale, caractérisée
par des mutations avec perte de fonction au
niveau des gènes TERC et TERT composant des
télomérases, possèdent de façon chronique
des télomères courts et présentent un risque
plus élevé d’être touchés par certains cancers,
notamment des leucémies aiguës myéloïdes
et des cancers épidermoïdes cutanés (5, 6).
L’approche méthodologique de cette
très large étude anglaise (420 081 cas,
1 093 105 contrôles) des membres de la
Telomeres Mendelian Randomization
Collaboration (7) était de simuler, dans la
population générale, l’attribution au hasard de
la distribution des génotypes constitutionnels
(comme dans une étude randomisée), indé-
pendamment du style de vie et des facteurs
environnementaux.
Elle a utilisé des variants génétiques germi-
naux comme variables instrumentales de la
longueur des télomères pour aider à clarifier
son association avec le risque de cancer et
d’autres pathologies non néoplasiques. La
première étape a consisté à identifier des SNP
(Single-Nucleotide Polymorphisms) associés
avec la longueur des télomères. La sélection a
porté sur 16 SNP correspondant à 10 régions
génomiques indépendantes comptant col-
lectivement pour 2 à 3 % de la variance des
longueurs des télomères des leucocytes.
Les résultats montrent qu’une longueur des
télomères génétiquement augmentée est
associée avec un OR (IC
95
) plus élevé pour
9 cancers primaires analysés sur un total
de 22 : les gliomes (5,27 ; IC
95
: 3,15-8,81), les
cancers de l’endomètre (1,31 ; IC95 : 1,07-1,61),
du rein (1,55 ; IC95 : 1,08-2,23), du testicule
(1,76 ; IC95 : 1,02-3,04), les mélanomes (1,87 ;
IC
95
: 1,55-2,26), les cancers de la vessie (2,19 ;
IC95 : 1,32-3,66), les neuroblastomes (2,98 ; IC95 :
1,92-4,62), les adénocarcinomes du poumon
(3,19 ; IC
95
: 2,40-4,22) et les cancers séreux de
l’ovaire à faible potentiel de malignité (4,35 ;
IC95 : 2,39-7,94). Cependant, une variabilité
importante d’OR existe entre diffé rents types
de cancers allant de 0,86 (IC
95
: 0,57-1,30) pour
les cancers de la tête et du cou à 5,27 (IC95 :
3,15-8,81) pour les gliomes. Il existe aussi une
variation substantielle pour les différents
types de cancers bronchiques de 3,19 (IC
95
:
2,40-4,22) dans les adénocarcinomes versus
1,07 (IC95 : 0,82-1,39) dans les carcinomes épi-
dermoïdes, mais aussi pour ceux de l’ovaire,
4,35 (IC95 : 2,39-7,94) dans les cancers séreux à
faible potentiel de malignité versus 1,21 (IC95 :
0,87-1,68) dans les formes endo métrioïdes,
1,12 (IC
95
: 0,94-1,34) dans les cancers séreux
invasifs, 1,04 (IC95 : 0,66-1,63) dans les car-
cinomes à cellules claires et 1,04 (IC95 :
0,73-1,47) dans les carcinomes mucineux.
Commentaire. Après avoir effectué une
méta-analyse de régression, les auteurs ont conclu
qu’une longueur des télomères génétiquement
augmentée tendait à être plus fortement associée
avec des cancers rares et des sites ayant des taux
de division de cellules souches plus faibles.
P. Beuzeboc, Paris
1. Ma H, Zhou Z, Wei S et al. Shortened telomere length is
associated with increased risk of cancer: a meta-analysis.
PLoS One 2011;6(6):e20466.
2. Wentzensen IM, Mirabello L, Pfeiffer RM et al. The asso-
ciation of telomere length and cancer: a meta-analysis.
Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2011;20(6):1238-50.
3. Pooley KA, Sandhu MS, Tyrer J et al.Telomere length in
prospective and retrospective cancer case-control studies.
Cancer Res 2010;70(8):3170-6.
4. Hou L, Joyce BT, Gao T et al. Blood telomere length attrition
and cancer development in the Normative Aging Study
cohort. EBioMedicine 2015;2(6):591-6.
5. Armanios M, Blackburn EH. The telomere syndromes. Nat
Rev Genet 2012;13(10):693-704.
6. Armanios M. Syndromes of telomere shortening. Annu
Rev Genomics Hum Genet 2009;10:45-61.
7. Telomeres Mendelian Randomization Collaboration,
Haycock PC, Burgess S, Nounu A et al. Association between telo-
mere length and risk of cancer and non-neoplastic diseases: a
Mendelian randomization study. JAMA Oncol 2017;3(5):636-651.
 6
6
1
/
6
100%