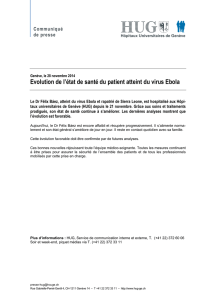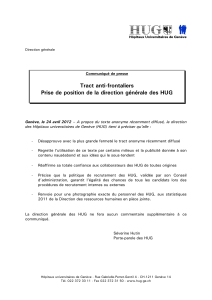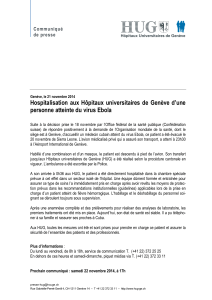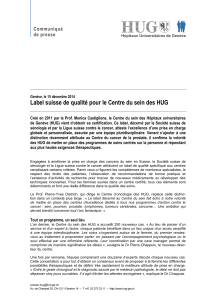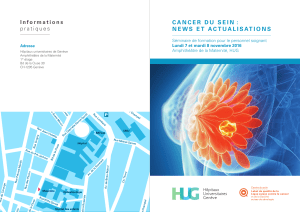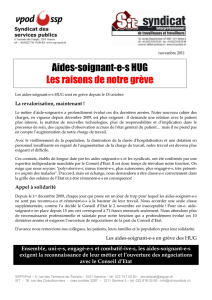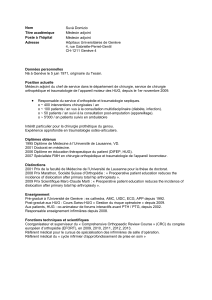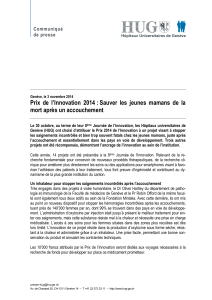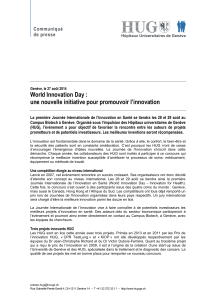Pulsati ns Les HUG face aux défis de demain Centre de

www.hug-ge.ch Journal d’information gratuit Octobre 2010
Pulsati ns
Les HUG face aux
défis de demain
pages I - IV
PLAN STRATÉGIQUE 2010-2015
Route de Saint Julien, 7 - 1227 Carouge
022 307 12 12 - info@oneplacement.com
Centre de
sénologie
ACTUALITÉ
Encourager
l’innovation
DOSSIER
Vaccination
contre la grippe
INTERVIEW
page 3
pages 6 - 12
page 5

Une vision pour 2015
ACCUEIL
D’hier à aujourd’hui…
2Hôpitaux universitaires de Genève Octobre 2010 Pulsations
Beaucoup de bêtises et d’inepties
à propos du soi-disant démantèle-
ment de l’hôpital public à Genève !
Fort heureusement, ces prédictions
populistes ne se réalisent jamais
et n’inquiètent plus personne.
Sornettes !
Les HUG disposent, en femmes et
en hommes, ainsi qu’en moyens
matériels et technologiques, de
ressources importantes sans
commune mesure avec bien des
établissements hospitalo-univer-
sitaires européens comparables.
L’opération d’efficience Victoria –
dont le succès est indéniable – n’a
laissé personne sur le carreau et
a permis d’améliorer encore et
toujours la qualité des soins de
notre organisation. Le bilan final
sera bientôt rendu public.
Qu’en est-il de demain ?
Dans un domaine de la santé
en profonde mutation, les Hô-
pitaux universitaires de Genève
se préparent à faire face aux
défis qui les attendent. Défi de
la capacité d’abord. Celle d’ac-
cueillir une population dont le
profil et les demandes évoluent
rapidement. Défi de l’attractivité
ensuite, dans un domaine que la
concurrence, induite notamment
par la libre circulation des patients
à l’horizon 2012, fait ressembler de
plus en plus à un marché. Défi de
la coopération, encore, tant il est
vrai que l’hôpital doit plus que
jamais jouer la complémentarité
avec les autres acteurs du réseau
de soins, éviter la redondance et
se concentrer sur le cœur de son
métier : les soins spécialisés et les
missions d’intérêt général confiées
par les autorités publiques. Défi
du financement, toujours, dans
un contexte de pression éco-
nomique, encore complexifié par
les nouvelles donnes tarifaires et
légales. Dans cet environnement,
comment anticiper les évolutions
démographiques, sociales et
politiques ? Comment continuer
d’innover, de développer et favo-
riser l’excellence ? Comment être
plus efficient tout en maintenant
une excellente qualité des soins ?
A toutes ces questions, le troi-
sième plan stratégique des HUG,
qui porte sur la période 2010-2015
et fait l’objet d’un cahier spécial
de ce numéro de Pulsations, veut
apporter des réponses concrètes.
Aboutissement de 16 mois
d’une réflexion partici-
pative et pluridiscipli-
naire, il résulte d’une
analyse approfondie
des enjeux à venir,
des missions qui nous
sont confiées, et
des ressources qui
sont les nôtres pour les accomplir.
Structuré en 7 objectifs straté-
giques auxquels correspondent
7 programmes d’actions, il dégage
les lignes de force qui guideront nos
actions futures pendant les cinq
ans à venir ; en précisant objectifs
et valeurs, il entend donner aux
collaborateurs des HUG le moyen
d’orienter leurs activités dans une
direction commune, au service
d’un projet fédérateur et d’une
ambition centrale, la recherche
globale de la qualité.
Bernard Gruson
Président du comité de
direction des HUG
JULIEN GREGORIO / STRATES
www.dondusang.ch
Don du sang
Rue Gabrielle-Perret-Gentil 6 - 1205 Genève - tél. 022 372 39 01
pour une
énergie
renouvelable
la vôtre
donnez
Sommaire
Actualité
Le cancer du sein a son centre 3
Un infarctus, mais pas deux ! 4
Interview
du Pre Claire-Anne Siegrist
Vaccination anti-grippe,
le retour 5
Dossier Innovation
Les HUG, une mine
de talents novateurs 6 - 7
Success story, mode d’emploi 8
Comment éviter les pièges 9
« J’ai gagné un temps
précieux » 9
L’immunothérapie contre
les gliomes 10
Plan stratégique 2010-2015
Les HUG dessinent l’hôpital
de demain I
1 vision • 7 objectifs •
7 programmes d’actions •
52 projets II - III
Une référence internationale IV
Dossier Innovation
Un robinet qui vaut de l’or 11
Dépister plusieurs cancers 12
Un coach pour les chercheurs 12
Actualité
Soutenir les mamans
dans leur choix d’allaiter 13
L’intranet fait peau neuve 15
Culture
A livre ouvert 17
Agenda 18 - 19
www.hug-ge.ch
Editeur responsable
Bernard Gruson
Responsable des publications
Séverine Hutin
Rédactrice en chef
Suzy Soumaille
Courriel : pulsations-hug@ hcuge.ch
Abonnements et rédaction
Service de la communication
Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4
CH-1211 Genève 14
Tél. +41 (0)22 305 40 15
Fax +41 (0)22 305 56 10
Les manuscrits ou propositions
d’articles sont à adresser à la rédaction.
La reproduction totale ou partielle
des articles contenus dans Pulsations
est autorisée, libre de droits, avec
mention obligatoire de la source.
Régie publicitaire
Contactez Imédia SA (Hervé Doussin) :
Tél. +41 (0)22 307 88 95
Fax +41 (0)22 307 88 90
Courriel : hdoussin@imedia-sa.ch
Conception/réalisation csm sa
Impression ATAR Roto Presse SA
Tirage 33 000 exemplaires
Journal d’information
gratuit des Hôpitaux
universitaires de Genève

ACTUALITÉ
Le cancer du sein
a son centre
Multidisciplinarité et coordination des soins :
tels sont les maîtres mots du centre de sénologie
récemment ouvert à la Maternité.
Avec la plus haute incidence de
cancer du sein au monde, Genève
enregistre un triste record. Chaque
année, environ 450 nouveaux cas
sont diagnostiqués dans le canton
et 60 à 70 femmes en décèdent.
Après avoir initié une consultation
multidisciplinaire spécialisée dans
le cancer du sein dès le début des
années 2000, les HUG ont franchi
un pas supplémentaire avec la
création d’un centre de sénologie
localisé à la Maternité. « La prise en
charge optimale de cette maladie
est le fait d’une équipe regroupant
des compétences diverses. On
sait aussi que le cancer du sein
traité dans un centre où il y a une
forte masse critique présente un
meilleur pronostic. En améliorant
encore la coordination des soins,
ce centre offre aux patientes la
garantie du meilleur suivi possible,
du diagnostic à la réhabilitation »,
explique la Pre Monica Castiglione-
Gertsch, responsable du centre.
Une plate-forme d’experts
De nombreuses spécialités sont
impliquées au centre de sénolo-
gie, parmi lesquelles l’oncologie,
la chirurgie gynécologique, la
radiologie, la pathologie clinique,
la chirurgie plastique, reconstruc-
tive et esthétique, la médecine
nucléaire, la radio-oncologie,
l’oncogénétique et la psychiatrie.
Sans oublier les infirmières spé-
cialisées, les physiothérapeutes
et les assistants sociaux. « Tous
ces experts se réunissent avant
le début des traitements et à la
fin, afin de proposer à la femme
une approche globale tenant
compte de ses préférences et
des caractéristiques propres de
sa maladie », précise la Pre Cas-
tiglione-Gertsch, oncologue de
réputation internationale.
Systématisation des étapes
Afin de diminuer la variabilité de la
prise en soins, de standardiser les
bonnes pratiques et d’améliorer la
coordination des soins, un itinéraire
clinique a été introduit. « Il s’agit
d’un instrument majeur pour gérer
la qualité des soins. Concrètement,
on s’assurera que chaque patiente
soit au bon endroit au bon mo-
ment, autrement dit que toutes
les étapes de la prise en charge
aient bien été effectuées et que la
femme ait toujours une personne
de référence à sa disposition lors
des moments difficiles », souligne
la Pre Castiglione-Gertsch. Cet
outil permet également de vérifier
que la planification du traitement
est bien respectée. « Grâce à une
augmentation des plages opé-
ratoires et une amélioration de
l’organisation, les délais d’attente
ont déjà pu être réduits », ajoute le
Dr Georges Vlastos, responsable
chirurgical du centre.
Outre l’accompagnement des
patientes, le centre a aussi pour
missions la formation et la recherche
clinique. « Nous allons développer
la collaboration avec des centres
suisses et étrangers. Nous avons
déjà initié la participation à une
étude internationale sur les thé-
rapies adjuvantes après chirurgie
pour éviter la rechute », indique la
Pre Castiglione-Gertsch qui sou-
haite entamer les démarches de
certification du centre. A noter que
ce dernier complète le dispositif
d’oncologie des HUG avec le centre
de recherche de la Fondation Dr
Henri Dubois-Ferrière Dinu Lipatti
récemment ouvert.
Paola Mori
« Le cancer du sein traité dans un centre où il y a une forte masse critique
présente un meilleur pronostic », souligne la Pre Monica Castiglione-Gertsch.
JULIEN GREGORIO / STRATES
Octobre 2010 Pulsations 33Hôpitaux universitaires de Genève
Atelier en
addictologie
Le service d’addictologie du
département de psychiatrie, avec
le soutien du groupe d’experts
Formation Dépendances, orga-
nise un cycle de cinq ateliers de
deux jours, de décembre 2010
à mai 2011. Objectif : permettre
aux participants d’acquérir et
d’améliorer leurs compétences
en addictologie. Le premier a
pour thème l’Introduction aux
approches orientées solutions
en addictologie. Ces ateliers
s’adressent à tous les profes-
sionnels qui rencontrent dans
leur pratique des personnes
présentant une addiction. Pour
plus d’information et inscription :
http://addictologie.hug-ge.ch
Distinction
Médecin-chef du service des
maladies infectieuses, le Pr Daniel
Lew a été nommé Président de
la Société internationale des
maladies infectieuses pour la
période 2010-2012. Comprenant
plus de 50 000 membres, cette
structure a pour but de former
les médecins et microbiolo-
gistes chargés de soigner des
patients souffrant de maladies
infectieuses. Elle soutient des
projets dans le tiers monde et
s’occupe de prévention et de
l’organisation de congrès. Elle
a également un réseau d’alerte
épidémiologique Pro med mail.
Pour info : http://www.isid.org
Vite lu

ACTUALITÉ 4Hôpitaux universitaires de Genève Octobre 2010 Pulsations
Un infarctus,
mais pas deux !
Destiné à prévenir
la récidive des infarctus,
le programme ELIPS
est lancé le 1er octobre
dans quatre hôpitaux
universitaires suisses,
dont les HUG.
Prévenir la récidive du syndrome
coronarien aigu (SCA) : tel est
l’objectif d’ELIPS, un programme
multidimensionnel destiné aux
patients, aux soignants et aux
médecins traitants qui sera lancé
le 1
er
octobre par les HUG, le Centre
hospitalier universitaire vaudois ainsi
que les hôpitaux universitaires de
Berne et Zurich. Un enjeu de taille
puisqu’en Suisse, chaque année,
quelque 30 000 personnes font
un SCA et qu’une sur sept rechute
dans l’année qui suit. « L’infarctus
est une complication fréquente et
grave d’une maladie chronique :
l’athérosclérose. Les progrès
médicaux ont, certes, amélioré
la prise en charge et diminué la
durée du séjour hospitalier. Tou-
tefois, les récidives dépendent de
la motivation du patient à suivre
son traitement et à modifier son
hygiène de vie. On sait que 30%
d’entre eux n’adhèrent plus à leur
prise en charge dans les 30 jours
suivant la sortie de l’hôpital »,
explique le Dr Pierre-Frédéric
Keller, médecin adjoint au service
de cardiologie.
Une étude multicentrique financée
par le Fonds national suisse de la
recherche scientifique permettra
d’évaluer l’impact de ce pro-
gramme de prévention secondaire.
« Concrètement, on comparera le
devenir à un an de 1200 patients
soignés selon les standards actuels
et de 1200 autres qui vont suivre
ce nouveau protocole », précise
le cardiologue.
Nombreux supports
Ce nouvel outil est constitué d’un
itinéraire clinique de prise en charge
des SCA à l’hôpital, d’un carnet
de sortie dédié au patient et au
médecin traitant, d’un programme
d’éducation thérapeutique ciblé
sur l’entretien motivationnel et
comprenant plusieurs supports
d’information didactiques et nova-
teurs traduits en plusieurs langues.
Parmi eux, citons un film, un site
Internet, des flyers, une fresque
murale interactive où figurent les
sept facteurs de risque modifiables,
à savoir : la sédentarité, l’excès de
poids, le stress, la dépendance au
tabac, l’hypertension, le taux de
cholestérol élevé, le diabète. Une
large palette récemment complétée
par une application pour téléphone
mobile téléchargeable sur le site
Internet. « Pour susciter chez le
patient une envie de changer,
tous les soignants des services
de cardiologie concernés ont été
formés à l’approche motivationnelle.
Un e-learning a été spécialement
créé en prérequis d’une formation
de deux jours. Des supervisions sur
le terrain enregistrées et codées
avec une grille validée sont ensuite
organisées », ajoute le cardiologue.
Un message et des pratiques
uniformes
Enfin, des colloques d’information
ont aussi été prévus pour les
médecins traitants généralistes,
internistes et cardiologues. « Le
programme ELIPS représente une
opportunité unique d’implémenter
au niveau national des méthodes
novatrices de communication avec
le patient durant l’hospitalisation,
ainsi qu’une culture d’unification
des pratiques. Le carnet patient
et les outils d’information unifor-
misés devraient aussi permettre
d’améliorer la communication avec
la médecine ambulatoire. »
Ajoutons que l’étude multicentrique
comporte aussi plusieurs sous-
études de recherche fondamentale
sur de nouveaux marqueurs du
SCA, le rôle des cellules souches
après un SCA ainsi qu’un volet
interventionnel avec imagerie
intracoronarienne.
Paola Mori
Vite lu
Les facettes
des soins
Les hôpitaux constituent des
structures toujours plus com-
plexes. Pour aider un large
public à s’y retrouver, Anne-
Claude Griesser, adjointe à la
direction médicale du CHUV, a
publié aux éditions Lamarre un
Petit précis d’organisation des
soins – interdisciplinarité. Cet
ouvrage très complet aborde
les multiples facettes des soins
et leurs différents modèles
d’organisation, comme les
centres de compétences, le
case management ou encore
les itinéraires cliniques.
Distinction
En juin 2010, Sabine Yerly, bio-
logiste, associée de recherche
au laboratoire de virologie
des HUG, a reçu le Tibotec HIV
Awards 2010 récompensant les
meilleurs travaux de recherche
d’un groupe scientifique suisse
dans le domaine du VIH. Cette
étude parue dans AIDS intitulée
The impact of transmission
clusters on primary drug re-
sistance in newly diagnosed
HIV-1 infection est le fruit d’une
collaboration genevoise et suisse
dans le cadre de l’étude suisse
de cohorte VIH. Cette recherche
a notamment démontré que le
taux de transmission de souches
VIH résistantes d’emblée aux
traitements antirétroviraux
disponibles est importante.
Dernier outil pédagogique créé : une application pour téléphone mobile
téléchargeable sur le site Internet d’ELIPS.
JULIEN GREGORIO / STRATES
SAVOIR +
www.elips.ch

INTERVIEW 5Hôpitaux universitaires de Genève Mai 2010 Pulsations
Vaccination anti-grippe, le retour
Alors que la pandémie de grippe A(H1N1) est
officiellement terminée, la vaccination demeure
d’actualité car elle protège pour une durée limitée.
Aux HUG, la campagne dure tout le mois d’octobre.
Automne 2009, le monde est en
ébullition face à la pandémie de
grippe A(H1N1). Douze mois plus
tard, le soufflé est retombé. Il n’en
demeure pas moins que, comme
chaque année à cette période,
la vaccination contre la grippe
saisonnière redevient d’actualité.
Interview avec la Pre Claire-Anne
Siegrist, experte internationalement
reconnue en la matière, médecin
adjointe agrégée responsable
de l’unité d’immuno-vaccinolo-
gie des HUG et présidente de
la commission fédérale pour les
vaccinations (CFV).
Quel est le rôle
de cette commission ?
> La CFV, qui comporte quinze
membres nommés par le Dépar-
tement fédéral de l’intérieur, a
deux tâches principales : conseiller
scientifiquement les autorités lors de
l’élaboration de recommandations
et assurer la médiation entre les
autorités, les milieux spécialisés
et la population.
Quels sont ses objectifs ?
> L’objectif essentiel de la CFV
est de garantir l’élaboration des
meilleures recommandations pos-
sibles dans le domaine de la vac-
cination. Prenons l’exemple de la
pandémie de grippe A(H1N1) de l’an
dernier. En mai 2009, nous avons
conseillé aux autorités l’acquisition
de deux doses de vaccin par
personne à risque élevé, ce qui
représentait environ 1,5 million de
personnes. En août, nous avons
recommandé à l’Office fédéral de la
santé publique de ne pas procé-
der à une vaccination de toute la
population et établi une liste des
personnes prioritaires. En octobre
et novembre, nous nous sommes
battus pour que soient levées les
restrictions d’utilisation imposées
par Swissmedic, par exemple à la
vaccination des enfants.
Quelles ont été ses relations
avec l’Organisation mondiale
de la santé (OMS) au moment
de la pandémie ?
> Aucune. Comme son nom l’in-
dique, le domaine de compétence
de la CFV se limite strictement à
la Suisse. L’OMS a joué un rôle
essentiel de centralisation des
informations concernant la pro-
gression du virus et sa nature,
mais chaque pays a pris seul ses
responsabilités, y compris dans le
domaine des vaccinations.
Pourquoi l’OMS a-t-elle déclaré,
le 10 août dernier, la fin officielle
de la pandémie ?
> La fin de la pandémie signifie
que le virus circule maintenant à
un niveau épidémique « normal »
et qu’il est suffisamment stable
pour que le risque de mutation
ou de résistance aux antiviraux
ne soit pas plus élevé que pour
un virus de la grippe saisonnière.
Avec du recul, la menace du virus
n’a-t-elle pas été exagérée ?
> La grippe A(H1N1) a été tout aussi
contagieuse que prédit, mais fort
heureusement bien moins grave
que craint. Le risque de décès ou
de complications sévères a été
surévalué au début de l’épidémie
faute de réaliser qu’à côté des
nombreuses hospitalisations ou
décès, notamment au Mexique, il
y avait beaucoup de personnes
qui résistaient à la grippe sans
complications. Nous l’avons compris
en été 2009 : encore à temps pour
ne recommander la vaccination
qu’aux groupes à risques, mais trop
tard pour éviter la commande de
millions de doses dès lors inutiles.
Quelles leçons tirer ?
> Elles sont innombrables. Nous
devons apprendre à mieux éva-
luer la dangerosité d’un nouveau
microbe, à mieux prendre les dé-
cisions avant même d’avoir toutes
les données nécessaires, à mieux
communiquer l’incertitude. Les
stratégies de limitation du virus –
comme fermer les aéroports – ont
démontré leur inefficacité totale
à le contenir.
Si ce virus avait été plus dangereux,
nous nous serions retrouvés dans
une crise sanitaire majeure, bien
loin des accusations actuelles
d’avoir gaspillé du temps et de
l’argent...
L’an passé, il a fallu faire deux
vaccins : un contre la grippe
saisonnière et un contre la grippe
A. Qu’en est-il cette année ?
> Un seul vaccin suffit : le virus de la
grippe A se comporte maintenant
comme un virus saisonnier, il est
donc une des trois souches de
virus contenues chaque année
dans le vaccin contre la grippe.
Les HUG ont choisi un vaccin
traditionnel, sans adjuvant.
Pourquoi se faire vacciner
toutes les années contre
la grippe saisonnière ?
> Il y a deux raisons. D’une part,
les virus mutent régulièrement et
nécessitent des vaccins adaptés.
D’autre part, l’immunité optimale dure
environ six mois. Une vaccination
de rappel est donc nécessaire
chaque année, que les virus aient
changé ou non.
Quand commence la campagne
de vaccination au sein des HUG ?
> Elle a démarré le 27 septembre
et dure tout le mois d’octobre.
L’an passé, 6000 collaborateurs
des HUG se sont vaccinés pour
protéger leurs patients. C’est un
beau geste de solidarité qui mérite
d’être souligné.
Propos recueillis par
Giuseppe Costa
La Pre Claire-Anne Siegrist est présidente de la commission fédérale pour
les vaccinations.
JULIEN GREGORIO / STRATES
SAVOIR +
www.infovac.ch
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
1
/
23
100%