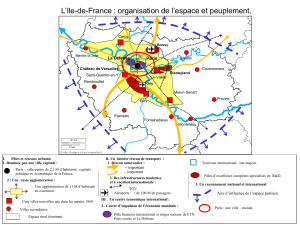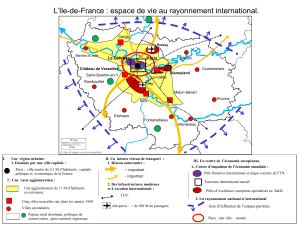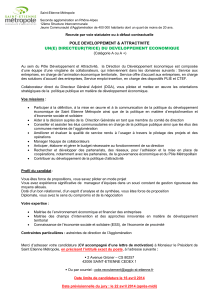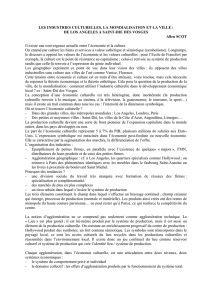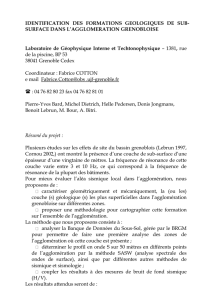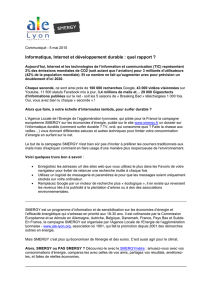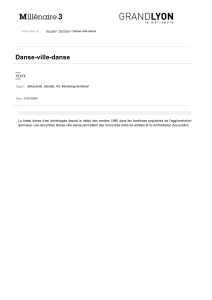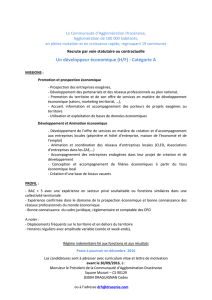LATEC-DT 95-08


n° 9508
AGGLOMERATION, INDUSTRIE ET VILLE
r"""(
Catherine Baumont et Jean-Marie Huriot*
septembre 1995
*Enseignants-chercheurs, Faculté de Sciences économiques et de Gestion
LATEC (URA 342 CNRS)
Dijon

Agglomération, industrie et ville1
Catherine Baumont et Jean-Marie Huriot
"Comme les machines doivent être produites avec des machines et puisque celles-ci sont
le produit de fabriques et ateliers nombreux et variés, de tels équipements ne peuvent
être réalisés efficacement que là où fabriques et ateliers qui s'entraident et collaborent à
une oeuvre sont très proches les uns des autres, c'est-à-dire uniquement dans les grandes
villes."
(VonThûnen, 1826, in Huriot, 1994, 151)
Depuis les origines de la pensée économique on s'interroge sur les raisons de la formation
et de la croissance des villes. La réflexion théorique semble avoir suivi l'évolution des faits.
Ainsi, au XVIIIe siècle, R. Cantillon (1755) ne voit encore dans le bourg qu'un marché et dans
la ville qu'un regroupement de grands propriétaires de terres agricoles cherchant à "jouir d'une
agréable société" et attirant tous les métiers qui sont à leur service. Mais quelques années plus
tard, A. Smith (1776) analyse déjà les avantages que la ville procure à la production, à travers
les gains d'échelle issus de la division du travail. On ignore souvent que von Thûnen (1827),
élevé au rang de père de l'économie spatiale pour sa première construction d'un modèle radio-
concentrique d'utilisation du sol, propose également une analyse pertinente des raisons de
l'agglomération des firmes dans les villes (Huriot, 1994). La citation liminaire évoque bien le
principe de base des économies d'agglomération qui prévaut encore aujourd'hui. A. Marshall
(1890,
1919) fait un apport décisif en reliant, dans une analyse théorique cohérente, économies
externes et avantages de localisation. A. Weber (1909) intègre plus formellement les
économies d'agglomération dans le calcul économique de la localisation optimale des firmes, et
en fait une explication de l'existence des villes. Il donne ainsi naissance au courant weberien qui
est encore présent dans les analyses "standards" actuelles. Mais c'est surtout depuis l'apport de
Mills (1967) que les économies d'agglomération sont définitivement reconnues comme un
facteur majeur de formation des villes.
1 Une première version de ce papier a été présentée au colloque de l'ASRDLF : "Dynamiques
industrielles et dynamiques territoriales", à Toulouse (30 août au 1er septembre 1995).

Les économies d'agglomération sont ainsi au centre d'un ensemble d'analyses suscitées
aujourd'hui par le souci aussi bien empirique que théorique d'expliquer l'origine et l'évolution
de la répartition spatiale des activités économiques. On se situe ici au lieu de rencontre de
l'économie spatiale et de l'économie industrielle, dans une contrée qui, quoi qu'on en dise, n'est
pas une découverte récente, même si son exploitation à l'aide de nouveaux concepts et de
nouvelles méthodes est susceptible de la rendre plus fertile (Rallet et Torre, 1995). S'il y a du
nouveau, c'est plus la découverte de l'espace par l'économie industrielle que l'inverse.
Les économies d'agglomération se manifestent dans les gains réalisés par différentes
entreprises du fait de leur proximité géographique et des rendements croissants externes ainsi
engendrés. Elles expliquent l'agglomération des firmes en des lieux privilégiés, régions
industrielles ou villes, à travers des approches sensiblement différentes. On rencontre en effet
les économies d'agglomération dans les analyses de la microéconomie spatiale à la Fujita et
dans les analyses de la géographie économique à la Krugman, aussi bien que dans des
recherches qui se placent en marge de ce courant standard ou en réaction contre lui, comme les
travaux d'inspiration marshallienne sur les districts industriels ou les systèmes productifs
locaux. Dans ces écrits, on s'intéresse essentiellement à la concentration spatiale de la
production, et l'on raisonne le plus souvent, au moins implicitement, comme si cette
agglomération était suffisante pour former une ville. On trouve même des analyses qui
localisent l'agglomération indifféremment dans une région ou dans une ville : ce qui importe est
seulement de savoir pourquoi les firmes s'agglomèrent. Dans tous les cas, on privilégie les
économies d'agglomération comme facteur de formation des villes et on fait de l'agglomération
des activités de production le fondement de la réalité urbaine.
Nous voici au coeur du problème. Les économies d'agglomération permettent une certaine
compréhension de la concentration spatiale de la production. Par là même on est tenté d'en
faire une clé de l'explication de la formation des villes. La question est de savoir si les deux
phénomènes sont identiques.
Pourquoi la ville est-elle assimilée à une agglomération productive ? On pourrait avoir
l'impression qu'une telle réduction est de nature ad hoc et qu'elle a pour seule justification les
besoins d'une explication par les concepts de l'économie industrielle.
La ville peut-elle se réduire à une agglomération de firmes? L'intuition est que
l'agglomération urbaine est quelque chose de différent d'une concentration spatiale de la
production, même si la première inclut généralement la seconde. Dans ces conditions, l'analyse
de la ville à travers l'agglomération productive n'est pas satisfaisante si elle passe à côté de ce
qui fait la spécificité de l'espace urbain. Quels sont donc les rapports entre ville et production,
entre agglomération urbaine et agglomération industrielle ? Quelles représentations de la ville
fournissent les analyses d'agglomération ?

Ces différents problèmes seront abordés selon la démarche suivante. Une première partie
regroupera quelques réflexions conceptuelles et méthodologiques sur les économies
d'agglomération et le phénomène d'agglomération. On y trouvera des précisions sur les
sources, la nature et le classement des économies d'agglomération et des forces qui peuvent les
contrarier, ainsi que sur la dynamique propre du phénomène d'agglomération. Dans une
deuxième partie, nous examinerons plus précisément l'intérêt et les limites de l'assimilation
entre l'agglomération de la production et la ville, en analysant comment la dimension
productive est liée aux autres dimensions de la ville, notamment la dimension sociale. Nous
chercherons en particulier quelles représentations de la ville on peut obtenir dans un modèle
gouverné par les économies d'agglomération en tentant de montrer comment une concentration
spatiale de la production est une condition d'existence d'une ville.
1. Interactions et agglomération
Tout le problème de l'agglomération est précisément de chercher à savoir pourquoi tout un
ensemble d'individus, identiques ou différents, se regroupe spatialement plutôt que de se
répartir uniformément dans l'espace en une multitude de petits établissements humains. La
réponse fait évidemment appel à l'intérêt que les individus ont à vivre et à produire à proximité
les uns des autres, c'est-à-dire aux avantages qu'apportent à chacun les interactions avec les
autres.
Comprendre comment les économies d'agglomération amènent la concentration spatiale
des activités et la formation des villes nécessite d'abord un détour par quelques mises au point
conceptuelles et méthodologiques. Ainsi nous situerons les économies d'agglomération dans
leur contexte théorique, puis nous chercherons les causes d'agglomération des hommes et des
activités, qui conduisent en particulier à différentes modalités d'économies d'agglomération pas
toujours faciles à distinguer. Les économies d'agglomération, formalisées par une fonction
d'agglomération, engendrent un processus dynamique de concentration ou d'éclatement spatial
dont nous donnerons les principales propriétés et modalités.
1.1. De la microéconomie spatiale à l'agglomération
Un problème théorique
Paradoxalement, alors que la théorie micro-économique représente, par excellence,
l'analyse la plus complète des échanges entre les individus et sur tous les marchés, la façon dont
ces échanges se réalisent "matériellement" a longtemps été négligée (tout du moins dans
l'approche "standard"). Le développement de l'analyse micro-économique spatiale a donné un
premier fondement à la concrétisation de ces échanges en explicitant le rôle de la distance
dans les décisions individuelles : par exemple, les modèles de localisation sont naturellement
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
1
/
31
100%