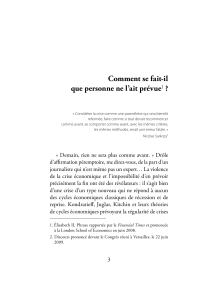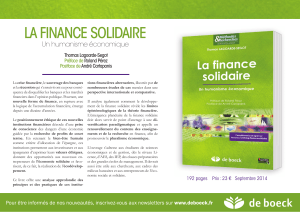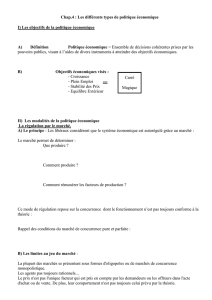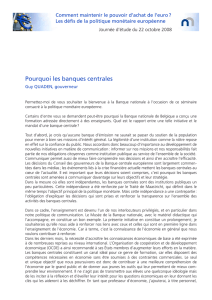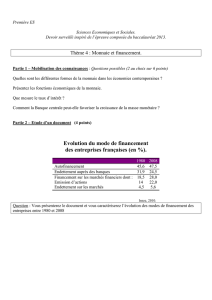Télécharger

dF
Problèmes économiques invite les spécialistes à faire le point
problèmeséconomiques
’
’
:HIKLTH=ZU^VUU:?a@k@b@a@p
"
"
M 01975
- 10H -
F: 9,10 E
- RD
DOM : 9,40 € - MAROC : 100 MAD - TUN 19 DT - CFA 5900 - LIBAN 17500 LBP
comprendre
LA FINANCE
HORS-SÉRIE
SEPTEMBRE 2016NUMÉRO 10

c
ahiers
françai
s
’:HIKPKG=]VUVUV:?k@n@j@e@a"
M 05068
- 394 -
F: 10,10 E
- RD
•
Faut-il réduire la place de l’automobile
dans la société ?
•
Les dernières tendances du numériqu
e
•
La politique de la ville,
un incubateur des politiques territoriales
Cahiers français 394
Septembre-octobre 2016
QUELLES RÉFORMES
POUR LE MARCHÉ
DU TRAVAIL ?
documentation
La
Française
société
économie
débat public
La
revue
de
référence
Bimestriel
En vente en kiosque, en librairie, sur www.ladocumentationfrancaise.fr
et par correspondance : DILA, 26 rue Desaix, 75727 Paris cedex 15
10,10 €

Direction de l’information
légale et administrative
26, rue Desaix
75015 Paris
Rédaction
de Problèmes économiques
Patrice Merlot (Rédacteur en chef)
Markus Gabel
(Analyste-rédacteur, rédacteur
en chef des hors-série)
Stéphanie Gaudron
(Analyste-rédactrice)
Secrétariat de rédaction
Anne Biet-Coltelloni
Promotion
Anne-Sophie Château
29, quai Voltaire
75344 Paris cedex 07
Tél. : 01 40 15 70 00
pe@ladocumentationfrancaise.fr
http://www.ladocumentation
francaise.fr/revues-collections/
problemes-economiques/
index.shtml
Abonnez-vous à la newsletter
Avertissement
Les opinions exprimées
dans les articles reproduits
n’engagent que les auteurs
Crédit photo :
Couverture : Getty Images
© Direction de l’information légale
et administrative. Paris, 2015
Conception graphique
Célia Pétry
Nicolas Bessemoulin
En vente en kiosque et en librairie
(Adresses accessibles en ligne)
# Retrouvez-nous sur
Facebook et sur Twitter
@ ProbEcoPE
Cet imprimé applique l'achage environnemental.
Pour un ouvrage
IMPACT-ÉCOLOGIQUE
www.dila.premier-ministre.gouv.fr
PIC D’OZONE
CLIMAT
IMPACT SUR L’ EAU
141 mg eq CH
24
1,5 g eq PO43-
534 g eq CO2
DONNER DU SENS À LA FINANCE
Personne ne peut véritablement affirmer que la finance ne le concerne pas. Du détenteur
d’un livret A au consommateur achetant des combustibles qui profite du lissage des
prix grâce aux contrats à terme, du salarié qui place ses économies dans une assurance-
vie en vue de la retraite au producteur de myrtilles qui cherche à se couvrir contre le
risque de grêle : des pans entiers de nos vies sont régis – et souvent facilités – par les
mécanismes de la finance. Par ailleurs, aucun État moderne ne peut depuis longtemps
se passer des marchés, qui sont devenus essentiels, comme pour les entreprises, au
maintien de son financement. Mais, comme toute activité humaine, la finance produit
des excès et des abus qui sont à l’origine de la mauvaise presse dont elle « souffre » :
elle serait déconnectée de la réalité, provoquerait la spéculation, l’instabilité et les
crises, serait responsable des pires dérives et, in fine, mettrait en danger l’économie.
En France, il existait en 2014 quelque 490 établissements de crédit. Le total de bilan
cumulé de l’ensemble de ces établissements se montait à environ 8465 milliards d’euros
en décembre 2014, ce qui représente environ quatre fois le montant du produit intérieur
brut (PIB) français. La majeure partie est représentée par le bilan de BNP Paribas – à lui
seul équivalent au PIB français. Le secteur bancaire est un des premiers employeurs privés
français avec 2,3 % du total de l’emploi salarié du secteur privé en France métropolitaine.
Il emploie environ 370000 personnes, néanmoins loin derrière l’Allemagne – plus de
600000 personnes –, ou encore le Royaume-Uni avec plus de 420 000 personnes.
Le secteur de la finance représente en France près de 3 % de la valeur ajoutée totale
et contribue à près de 5 % de l’ensemble des prélèvements obligatoires. En zone euro,
les banques nationales détiennent en moyenne environ 25 % de la dette de leur pays.
La détention de cette dette s’est internationalisée. Alors que, en 1993, seul un tiers de
la dette publique française était détenu par des non-résidents, l’Agence France Trésor
évalue la part de ces derniers à environ 62 % à la fin décembre 2015.
Si on peut ainsi sans hésitation affirmer que la finance est au service de l’économie,
elle demeure source de controverses et d’interrogations dont certaines seront évoquées
dans ce numéro : la finance est-elle un facteur de creusement des inégalités ? Quelle est
la situation des banques centrales après tant d’années de gestion de crise financière ?
Faut-il avoir peur de la finance chinoise ? Pourquoi observe-t-on la fuite des talents
vers Londres ? Comment réguler demain la banque-finance ? Et quel sera l’avenir de la
monnaie ?
Enfin, n’oublions pas que la finance, malgré son apparente technicité et complexité, est
aussi affaire de bon sens utile et peut être très simple. Qui ne connaît pas les dictons
« On n’a jamais rien sans rien » ou « Ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier » ?
Par ailleurs, l’esprit littéraire et la finance ne s’excluent pas, au contraire ! En effet,
l’histoire de la littérature nous fournit une anecdote fort savoureuse. Johann Wolfgang
von Goethe, qui avait toujours une relation un peu tendue avec ses éditeurs, craignant
d’être floué, proposait en 1797 à l’éditeur Hans Friedrich Vieweg un contrat très subtil.
Pour déterminer le montant de ses honoraires, Goethe suggérait de déposer chez un
notaire une lettre mentionnant une somme que l’écrivain voulait au minimum obtenir. Si
la proposition de l’éditeur était inférieure à cette somme, Goethe retirerait son offre et
aucun contrat ne serait ainsi conclu. Dans le cas contraire, l’écrivain s’engageait à ne pas
demander davantage que le montant déposé chez le notaire. Goethe s’en sortait avec un
des honoraires les plus élevés de l’époque – 1000 thalers –; c’était également une bonne
affaire pour l’éditeur car l’œuvre se vendait très bien.
Markus Gabel

COMPRENDRE LA FINANCE
La finance au service de l’économie ?
P. 5 Un siècle de finance : de la première mondialisation
à la globalisation des marchés (Éric Monnet)
P. 12 Comprendre les marchés financiers en 2016 (Laurent Quignon)
P. 20 Investisseurs, assureurs et banques face à la politique
des taux d’intérêt zéro (Jean-Marc Figuet)
P. 27 Finance d’entreprise et finance de marché : une influence
par ricochet (Gunther Capelle-Blancard et Jérôme Glachant)
P. 35 Glossaire : les mots de la finance 1
P. 36 Les principales places financières
Un secteur controversé
P. 37 Inégalités et finance : quelles relations de causalité ?
(Rémi Bazillier et Jérôme Héricourt)
P. 43 Les banques centrales à la peine
(Jézabel Couppey-Soubeyran)

P. 50 La finance chinoise : quelle ampleur, quels risques ?
(Michel Aglietta)
P. 57 S
hadow banking, trading
haute fréquence : l’innovation
financière hors de contrôle ? (Dominique Namur)
P. 64 Les liens finance-États : entre nécessité et abus
(Clémentine Gallès)
P. 71 Étudier à Paris, travailler à Londres : fuite des cerveaux
et allocation des talents (Gunter Capelle-Blancard et Claire Célérier)
P. 78 Glossaire : les mots de la finance 2
La finance de demain
P. 80 FinTech : l’innovation financière au service de qui ?
(Julien Maldonato)
P. 87 Comment réguler demain la banque-finance ? (Laurent Clerc)
P. 96 L’avenir de la monnaie (Jörg Guido Hülsmann)
P. 104 Que devient la globalisation financière ? Avons-nous besoin
d’un Bretton Woods 2.0 ? (Christophe Boucher)
P. 111 Glossaire : les mots de la finance 3
P. 112 De la finance aux FinTech
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114
 115
115
 116
116
1
/
116
100%