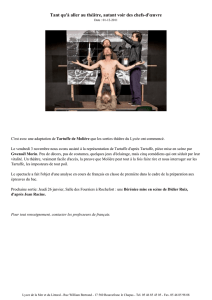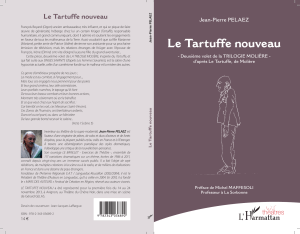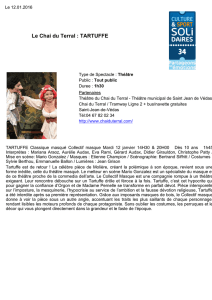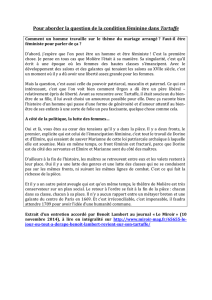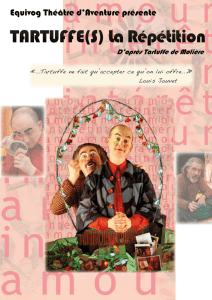ON OD lettre n 18

OD ON
LES BIBLIOTHÈQUES DE L'ODÉON
ERRI DE LUCA
L'APPEL DE NAPLES
Lettre No18
Odéon-Théâtre de l’Europe janvier – février 2016
WILLIAM SHAKESPEARE / THOMAS JOLLY
RICHARD III
DANS LES GORGES
DE LA MORT
MOLIÈRE / LUC BONDY
TARTUFFE
VOIR OU
NE PAS VOIR

2 3
sommaire
p. 2 à 4
RICHARD III
William Shakespeare
Thomas Jolly
DANS LES GORGES DE LA MORT
p. 5 à 7
TARTUFFE
Molière
Luc Bondy
VOIR OU NE PAS VOIR
p. I à IV
LES BIBLIOTHÈQUES
DE L’ODÉON
L'APPEL DE NAPLES
ERRI DE LUCA
FAIRE DE TOUS LES SIÈCLES
UN SEUL PAYSAGE
RICHARD PEDUZZI
ANATOMIE DE NOS CONSOLATIONS
MICHAËL FŒSSEL
p. 8
CLAUDE LÉVÊQUE
UN CLIN D'ŒIL IRONIQUE
À CE QUARTIER
p. 9
AVANTAGES ABONNÉS
Invitations et tarifs préférentiels
p. 10 à 11
ACHETER ET RÉSERVER
SES PLACES
Reprise de Tartuffe
en remplacement d'Othello
Projection du spectacle filmé Henry VI
Paris face cachée
p. 12
SOUTENEZ LA CRÉATION
THÉÂTRALE
LE CERCLE DE L'ODÉON
DU NOUVEAU,
DES NOUVELLES,
DES RÉSEAUX
La revue du web de l'Odéon
SUIVEZ-NOUS
Twitter
@TheatreOdeon
#RichardIII
#Tartuffe
#Bibliodeon
Facebook
Odéon-Théâtre de l’Europe
Retrouvez la lettre et son contenu
augmenté (entretiens, sons, vidéos…)
sur theatre-odeon.eu / le-magazine
Richard III 3
THOMAS JOLLY
RICHARD III
DANS LES GORGES
DE LA MORT
Après la sensation Henry VI, le jeune metteur en scène de la Piccola
Familia ne désarme pas et clôt sa saga avec le dernier volet de la tétralogie
shakespearienne. Thomas Jolly explique comment lui et sa troupe ont
plongé dans cette descente aux enfers d'un manipulateur devenu tyran.
«J'aime bien être là où ça se passe
– «ça», c'est-à-dire l'histoire, avec
un grand et un petit h. Et, de ce
point de vue, RichardIII, de William
Shakespeare, est une pièce idéale.
Pour la petite histoire, celle de notre
compagnie, la Piccola Familia, elle
s'inscrit dans la continuité de notre
trilogie Henry VI, qu'elle conduit à
son terme logique. Et pour la grande
Histoire, on touche à la fin de soixante
ans de troubles qui ont tourmenté
tout un peuple et tout un royaume,
puisque le règne d'Henry commence
en1422 et celui de Richard s'achève
en1485. Mais Shakespeare n'est pas
un historien. Ce qu'il nous propose,
c'est un témoignage poétique, qui
ouvre des questions sans imposer de
réponses. Je n'en apporte pas plus
que lui.
Richard a compris quelque chose. Il
a senti l'air du temps et il va être le
seul à alimenter ce climat délétère
de la fin du règne d'ÉdouardIV pour
monter à son tour sur le trône. Il n'a
pas de programme. S'il a une pensée
politique, elle ne concerne que sa
personne. Sa première force, c'est
d'avoir un désir on ne peut plus clair:
il veut être roi, un point c'est tout. Et
après? Maintenant qu'on a le pouvoir,
on en fait quoi?
Les trois Henry dessinaient une courbe
vers le chaos. Là, nous y sommes. La
chaleur guerrière est retombée, on
entre dans l'ère de l'horreur froide.
En passant du règne d'Henry de
Lancastre à celui d'Édouard d'York,
on change de style. ÉdouardIV est un
paranoïaque. Son pouvoir repose sur
la surveillance constante. Le monde
est technologisé, déshumanisé. Tous
ont du sang sur les mains, sauf peut-
être Lady Anne. Et même elle, n'est
pas parfaite. Elle accepte d'épouser
l'assassin de son époux. Pourquoi ?
Richard a pour lui son éloquence et
la séduction du mal, qu'il hérite sans
doute du Diable médiéval. Ses larmes,
aussi… C'est sa troisième arme :
le théâtre. Il s'appuie sur la terreur,
qu'il impose, et sur la pitié, qu'il sait
susciter. Donc, sur les deux grandes
émotions tragiques.
J'ai tenu à mettre les rôles de femme
en valeur, ils sont particulièrement
importants. Elles sont toutes là,
survivant à leurs conjoints et à leurs
fils. Ce sont elles qui portent la seule
lueur d'espoir. Elles, les femmes, font
vraiment l'expérience de la perte, du
deuil, de la mort. Et elles seules savent
se pardonner. Ce pardon est peut-être
le seul chemin vers un avenir possible.
Mais cet horizon-là n'appartient pas
au monde de la pièce. Il est au-delà.
Il s'agit vraiment ici de «plonger dans
les gorges de la mort». RichardIII est
comme la gueule de bois de la fête de
HenryVI. C'est dans cette atmosphère
que Richard va se manifester. En
fait, son personnage est né à la fin
de Henry VI. C'est une trouvaille
géniale de Shakespeare : au début
de RichardIII, le héros est déjà lancé,
déjà en mouvement. En quelque sorte,
il est né trop tard à lui-même dans
la trilogie, alors il ajoute sa propre
pièce. Cette donnée-là me permet de
proposer un Richard plus complet. Il a
déjà décidé, dans le drame précédent,
de devenir monstrueux. C'est dans
HenryVI que sa foi est brisée. Il est
désormais le seul à ne plus éprouver
aucune crainte devant la justice divine.
L'autoroute du crime s'ouvre devant lui.
Ce qui est difficile à faire comprendre
à partir de RichardIII, parce que les
racines de son attitude sont dans la
trilogie précédente. Mais quand on les
connaît, tout devient clair.
Et pourtant, même Richard garde une
conscience. Ce qui va le perdre, ce
sont les spectres de ses victimes qui
reviennent insinuer l'effroi en lui. Lui
qui disait ne connaître ni l'amour, ni la
pitié, ni la crainte finit pourtant dans
la peur et il le dit. La fêlure devient
sensible dès qu'il devient roi. Qu'est-ce
qui la cause? Nous avons suivi une
piste. Il y a un élément intéressant,
qu'on néglige souvent mais qui à mon
avis doit être rendu sensible: dans la
pièce, toutes les malédictions et les
prophéties se réalisent. Or, l'une d'elles
est comme oubliée en route: Richard
a un enfant, qui ne survit pas. Quand
Lady Anne lance des imprécations sur
sa descendance, à son insu, elle est en
train de maudire l'enfant qui doit naître
de leur union. Cet enfant est une réalité
historique. Shakespeare ne développe
pas, mais nous nous sommes appuyés
sur cette indication. Richard ne peut
pas se perpétuer, ce qui était peut-
être son vrai projet. D'où la fêlure. Son
royaume est désormais fondé, comme
il le dit, sur du «verre fragile» et c'est
la fuite en avant. Concrètement, cela
confirme mon intuition à son sujet. J'ai
le sentiment que chez lui, tout n'est
pas donné d'entrée de jeu. Ni son plan
ni sa totale monstruosité. On croit
pourtant que Richard, boiteux et laid,
est fixé d'avance dans son caractère
et sa silhouette. J'ai choisi de le faire
bouger. Plus il avance, plus il devient
difforme et tyrannique. Mais ce n'était
pas une fatalité.
Le pouvoir met à nu. On en a connu,
de ces animaux politiques qui sont
brillants en campagne et dont la
faiblesse éclate une fois arrivés au
sommet… Le problème de Richard,
c'est que toute son ascension est bâtie
sur le mensonge. On peut jouer un rôle
quand il s'agit d'usurper une place
mais il faut pouvoir l'occuper vraiment
quand on l'a obtenue. Tant qu'il est un
manipulateur, Richard a ses partisans.
Dès qu'il devient un tyran, on ne joue
plus. C'est l'infanticide qui achève
de faire de lui un tyran. Ce crime-là
le hante. Il est allé trop loin,
Lady Anne
accepte
d'épouser
l'assassin
de son mari.
Pourquoi ?
Toute
l'ascension
de Richard
est bâtie sur
le mensonge.
© Nicolas Joubard © Nicolas Joubard

4 5
6 janvier – 13 février 2016
Théâtre de l’Odéon 6e
RICHARD III
de William Shakespeare
mise en scène Thomas Jolly
Cie La Piccola Familia
texte français
Jean-Michel Déprats
adaptation
Thomas Jolly & Julie Lerat-Gersant
collaboration artistique
Pier Lamandé
collaboration dramaturgique
Julie Lerat-Gersant
scénographie
Thomas Jolly
assistant à la mise en scène
Mikaël Bernard
lumière
François Maillot, Antoine Travert
& Thomas Jolly
musiques originales / son
Clément Mirguet
costumes
Sylvette Dequest
assistante aux costumes
Fabienne Rivier
parure animale de Richard III
Sylvain Wavrant
accessoires
Christèle Lefèbvre
vidéo
Julien Condemine
assistante à la vidéo
Anouk Bonaldi
avec
Damien Avice
Mohand Azzoug
Étienne Baret
Bruno Bayeux
Nathan Bernat
Alexandre Dain
Flora Diguet
Anne Dupuis
Émeline Frémont
Damien Gabriac
Thomas Germaine
Thomas Jolly
François-Xavier Phan
Charline Porrone
Fabienne Rivier
durée 4h20
production
La Piccola Familia
production déléguée
Théâtre National de Bretagne – Rennes,
coproduction
Odéon-Théâtre de l’Europe
créé le
2 octobre 2015 au Théâtre National
de Bretagne – Rennes
La Piccola Familia est conventionnée
par la DRAC Haute-Normandie,
la Région Haute-Normandie, la Ville de
Rouen et est soutenue par le Département
de Seine Maritime
Thomas Jolly est artiste associé jusqu’en
juillet 2016 au Théâtre National de
Bretagne – Rennes
INSTALLATION PRÉSENTÉE
SUR LE PARVIS DU THÉÂTRE
DE L'ODÉON
du 6 janvier au 13 février
du mardi au vendredi de 17h à 20h
le samedi de 15h à 20h
le dimanche de 12h à 16h
relâche le lundi
R3m3
PÉNÉTREZ DANS LE BUREAU
DE RICHARDIII
Je crois beaucoup à l'appropriation d'une œuvre par le public.
Venir au théâtre, c'est bien, mais il y a d'autres moyens. Avec
la compagnie, nous cherchons toujours comment faire circuler
autrement les histoires. Ça peut être des teasers, des apéritifs...
Comme si le spectacle était un moteur permettant de générer
d'autres formes. Cette fois-ci, nous avons fabriqué une version
pour deux acteurs, L'Affaire Richard, qui peut se jouer en appar-
tement. Un jeu vidéo, aussi. Et puis nous avons inventé cet objet
bizarre appelé R3m3. Au départ, c'était une pure idée de scéno-
graphie. Comme dans ces films d'aventure où un pan de biblio-
thèque bascule pour découvrir le repaire secret du monstre,
j'avais pensé à un espace dérobé contenant le QG de Richard.
On n'a pas gardé l'idée dans le spectacle. Du coup, nous avons
recréé le bureau de RichardIII dans un container. Il y entasse
tous ses souvenirs depuis l'enfance: ses dentiers, ses prothèses,
son ordinateur. On y assistera aussi à une résurrection inatten-
due… La visite se fait par groupes d'une dizaine de personnes et
dure une vingtaine de minutes. L'ensemble combine de l'artisa-
nat d'art et des éléments numériques. Des capteurs réagissent
aux passages des visiteurs et déclenchent certaines choses…
L'expérience immersive qu'on propose dans R3m3 sert aussi à
rappeler quelques informations. Par exemple, le fait que Lady
Anne et Richard sont des amis d'enfance, qu'ils ont été promis
l'un à l'autre avant qu'elle ne soit fiancée au prince Édouard... On
les verra dans R3m3 jouer sur Skype une scène de dépit amou-
reux tirée de Molière. L'échange marche parfaitement, il n'y a
qu'à changer un prénom… C'est performatif, ludique, tout sauf
inhibant. Je ne veux pas que pousser la porte d'un théâtre soit
intimidant. Je veux lutter contre ça. Thomas Jolly
prisonnier de sa logique. Il
partage ce destin avec Macbeth. La
machine infernale du pouvoir tourne
à vide. Aucune décision royale n'est
prise dans RichardIII, sauf celle de
lever des troupes pour combattre
Richmond… C'est l'itinéraire d'une
damnation assumée. Le désespoir
et la mort… Mais j'ai beaucoup
d'empathie pour ce personnage.
C'est la schizophrénie bien connue:
comme acteur je le défends et je
l'aime, comme metteur en scène je
le condamne. Mais l'acteur est obligé
d'aimer cet homme qui joue sa vie «sur
un coup de dés». Il joue parce qu'il
n'avait pas de vie possible. Son père
est mort, sa mère ne l'aime pas. Faute
d'avoir une place, il se choisit la plus
grande. Comme un enfant non désiré
qui surcompense, avec l'énergie du
désespoir. La réplique qui enclenche
ce mouvement-là, c'est: «Suis-je donc
un homme fait pour être aimé?» Selon
lui, la réponse est forcément négative.
Il l'accepte, il en fait un destin: puisque
je n'ai pas d'amour à perdre, je ne
crains plus de me faire détester. Très
tôt dans la pièce, Shakespeare lui
donne sa chance. Il lui fait croiser
la route de Lady Anne. Mais à peine
l'a-t-il séduite qu'il l'a déjà sacrifiée:
«Je ne la garderai pas longtemps…»
À ce moment-là, il aurait pu se sauver
–mais non. Il se condamne.
Il n'est pas pour autant un serial killer.
Être méchant pour le plaisir d'être
méchant, c'est un cliché un peu limité.
Il prend les problèmes les uns après
les autres. Au besoin, il improvise.
Et ce grand improvisateur est aussi
un grand acteur. Il sait alterner les
différentes mises en scène de soi en
fonction des besoins. Après s'être
montré humble et pieux, il apparaît
en costume de souverain, avec
tous les effets de la télévision, des
concerts, des meetings. Et les gens
applaudissent les deux scènes. C'est
du grand Shakespeare: pour donner
à voir ce procédé politique abject, il
joue de la parenté entre un public et
une foule… Pour moi, la phrase la plus
révélatrice de RichardIII est peut-être
celle-ci: «Qui est assez grossier pour
ne pas voir ce palpable artifice, mais
qui est assez hardi pour dire qu'il le
voit?» La tyrannie est nue et tous se
taisent, tous sont complices. Richard
est habile, intelligent, mais il bénéficie
aussi d'un climat qui lui permet de
manœuvrer. Il prend la place qu'on
lui laisse. Comme le remarque un
greffier : «Le monde est corrompu
et tout va pour le pire.» Richard est
aussi fils de son époque, c'est elle
qui engendre le monstre. Ce n'est pas
étonnant que cette pièce ait retenu
l'attention de Brecht. Et qu'elle nous
paraisse si intéressante aujourd'hui.
Propos recueillis par Daniel Loayza
Paris, octobre 2015
ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION
SUR THEATRE-ODEON.EU
à partir du 9 décembre
(dans la limite des places disponibles)
© Nicolas Joubard
HENRY VI SUR GRAND ÉCRAN
L'intégrale du spectacle filmé
Henry VI au mk2 Grand Palais.
Projections les 16 et 17 janvier 2016.
Plus d'informations page 14
LUC BONDY
TARTUFFE
VOIR
OU NE PAS VOIR
«Justesse confondante», «dévotion au texte», «bonheur de chaque instant»... Mis en scène en 2014 par
Luc Bondy, le chef-d'œuvre de Molière avait emballé. Quand le directeur de l'Odéon, actuellement en
convalescence, a dû se résoudre à remettre d'une saison la création d'Othello, le choix de Tartuffe s'est
tout naturellement imposé. Au cœur d'une distribution en partie renouvelée, on retrouvera dans le rôle-
titre Micha Lescot et sa nonchalance sordide de Machiavel au petit pied. Réflexions du metteur en scène
et regards de critiques sur une pièce d'une réjouissante modernité.
© Thierry Depagne
28 janvier – 25 mars / Berthier 17
e
TARTUFFE
de Molière
mise en scène
Luc Bondy
avec
Victoire Du Bois
Laurent Grévill
Marina Hands
Nathalie Kousnetzoff
Yannik Landrein
Micha Lescot
Yasmine Nadifi
Fred Ulysse
(distribution en cours)
durée
1h55
crée le
26 mars 2014 aux Ateliers Berthier
production
Odéon-Théâtre de l'Europe
représentations avec
audiodescription
20 mars à 15h / 22 mars à 20h
collaborateurs artistiques
à la mise en scène
Marie-Louise Bischofberger
Vincent Huguet
décor
Richard Peduzzi
costumes
Eva Dessecker
lumière
Dominique Bruguière
maquillages/coiffuresc
Cécile Kretschmar
© Doette Brunet

6 7
Faire vivre la pièce. Ne pas surajouter
une énième interprétation du Tartuffe.
Éviter d'expliquer. J'ai de plus en plus
de mal à lire globalement une pièce
avant les répétitions. J'ai horreur des
mises en scène où tout est joué avant
même qu'on ait commencé. Le théâtre,
c'est quelque chose de sensuel : on a
envie de travailler avec tel acteur, telle
actrice… Ma distribution est déjà une
interprétation. Si on se contente du
texte, on peut croire que Molière met
entre parenthèses le rapport entre
Orgon et Elmire. Mais elle est sa
femme et il est son mari! Au plateau,
ce couple existe pleinement. Il n'est
pas totalement ravagé par l'irruption
de Tartuffe. Même quand Tartuffe est
joué par Micha Lescot!
J'aime les histoires de famille.
Le Retour, de Pinter, c'en était déjà
une. Les Fausses Confidences, pas
vraiment. Il y a bien un rapport mère-
fille, mais les hiérarchies sociales
comptent bien plus que la famille.
Le Tartuffe, c'est totalement une
histoire de famille. Le point commun
de ces trois pièces, que j'ai montées
à l'Odéon, c'est la présence d'un
outsider : Ruth chez Pinter, Dorante
chez Marivaux, Tartuffe chez Molière.
Quand il apparaît , l'outsider ébranle le
fonctionnement de ce milieu. Il trouble
les esprits, les désirs.
La famille, c'est un modèle en
réduction de la société. C'est ce qui
me passionne. Chez Orgon, la famille
est détériorée avant même l'arrivée
de Tartuffe. Avant d'être un acteur
du drame, Tartuffe est un révélateur.
Depuis qu'Orgon a perdu sa première
épouse, quelque chose ne marche pas.
Et cela remonte peut-être à encore plus
loin. Molière ne fait que suggérer ces
questions. Il y a beaucoup de non-dits
dans la pièce, jusqu'au dernier acte.
Cette histoire de cassette pleine de
papiers compromettants m'a rappelé
la situation de certains intellectuels
allemands des années70, à l'époque
de la Fraction Armée Rouge. Certains
d'entre eux avaient soutenu Andreas
Baader, Ulrike Meinhof et leurs
camarades. Plus tard, il ne fallait
surtout pas en parler. Être captif d'un
secret plus ou moins honteux, cela
reste tout à fait contemporain.
On sent chez Orgon une fêlure dont un
gourou, un manipulateur peut profiter.
Je n'ai pas voulu tout réduire à une
attirance homosexuelle. Si toute la
famille doit crever parce qu'Orgon est
tombé amoureux d'un jeune homme,
c'est un peu trop évident. Le point
central, c'est tout de même l'influence
de Tartuffe sur Orgon. Le fait qu'un
être puisse à ce point subir l'ascendant
d'un autre.
Pour Molière, Orgon n'est pas qu'un
être faible ou stupide. Ce serait trop
facile… Orgon n'est pas bête du tout.
Il est influençable et manipulable, ce
qui est radicalement différent. Des
gens très intelligents peuvent tomber
dans ce genre de piège. Orgon a
aussi beaucoup de pouvoir. C'est ce
que dit sa fille à l'acte II. Il est «un
père absolu». Il a sur Mariane «tant
d'empire» qu'elle n'a «jamais eu la
force de rien dire». Toujours le non-dit!
Son fils, Damis, a beau exploser tout
le temps, rien n'y fait. L'autorité sans
limites d'Orgon, dans cette famille
patriarcale, devient une tyrannie dès
qu'il fait la connaissance de Tartuffe.
Orgon est victime d'une obsession.
Pour qu'il revienne à la réalité, il
faut littéralement la mettre à nu. Le
Tartuffe, c'est «voir ou ne pas voir» au
lieu d'«être ou ne pas être»… Mais le
grand problème de l'obsédé, c'est qu'il
ne veut pas voir. Voilà pourquoi
«UN TARTUFFE D'UNE CLASSE
MACHIAVÉLIQUE»
«Luc Bondy électrise l'Odéon
dans sa version glacée/enévrée
d'un classique de la littérature
française. Son Tartuffe s'inscrit
avec une justesse confondante
dans notre société minée par le
pouvoir trompeur des postures
et de la parole. L'aspect articiel
des sentiments orchestrés
par Tartuffe trouve un écho
pertinent dans la scénographie
inhospitalière de Richard
Peduzzi. Micha Lescot s'impose
avec une classe machiavélique
dans le rôle titre.»
Thomas Ngo-Hong-Roche
Blog «Hier au théâtre»
31 mars 2014
«TOUT SONNE JUSTE,
TOUT EST JUSTE»
«De lourds rideaux de velours
ouvrent et ferment les grands
dégagements de cet espace
élégant. De beaux sièges, des
tables, des chaises. Un crucix,
une vierge de céramique dans sa
niche. On est dans la demeure
bourgeoise et cossue sans
ostentation d'Orgon.
La scénographie forte et
harmonieuse de Richard Peduzzi
installe immédiatement une
atmosphère et correspond
parfaitement à l'esprit de Tartuffe.
[…]
On ne joue que le texte,
strictement le texte de cette
pièce puissante et grave. Et c'est
au texte que s'en tient d'abord
scrupuleusement Luc Bondy. Mais
que d'imagination dans les gestes,
les humeurs, les mouvements ! […]
Tout sonne juste, tout est juste.
Les interprètes redonnent aux
répliques toute leur pertinence.
C'est un homme de plateau qui
a écrit Le Tartuffe ou l'Imposteur.
Chaque mot correspond à une
action, chaque action est naturelle.
On en oublierait les vers et les
rimes pourtant suivis avec rigueur.
Jamais, et pourtant on en a vu,
des Tartuffe, jamais le sentiment
de la réalité, de la vérité n'avait été
aussi saisissant.»
Armelle Héliot / Le Figaro
28 mars 2014
6 Tartuffe LES
BIBLIOTHÈQUES
janvier – février 2016
OD ON
Portrait d'Erri De Luca par Édith Carron
© Costume3pièces.com
Être captif
d’un secret
plus ou moins
honteux, cela
reste tout à fait
contemporain. Orgon n'est
pas bête. Il est
influençable
et manipulable,
ce qui est
radicalement
différent.
LUC BONDY :
«J'AIME LES HISTOIRES DE FAMILLE»

8 9
ENTRETIEN AVEC RICHARD PEDUZZI
FAIRE DE TOUS LES SIÈCLES UN SEUL PAYSAGE
Par petites touches, les Scènes imaginaires composent le portrait d'artistes à travers ceux qui les ont nourris et ce qui les anime.
En janvier, carte blanche à l'un des plus proches collaborateurs de Patrice Chéreau et Luc Bondy, familier du Théâtre de l'Odéon.
II Les Bibliothèques de l'Odéon
Richard Peduzzi
est né en1943. Scénographe et
peintre, il a signé depuis1970 tous les
décors des productions de Patrice
Chéreau au théâtre et à l'opéra, ainsi
que de nombreuses mises en scène
de Luc Bondy. Directeur de l'École des
arts déco (1990-2002) puis de la villa
Médicis (2002-2008), il est également
l'auteur de nombreuses réalisations
muséographiques, notamment au musée
du Louvre et au Musée d'Orsay.
À lire: Richard Peduzzi, Là-bas, c'est
dehors, Actes Sud, 2014.
Les Bibliothèques de l'Odéon III
Richard Peduzzi, pourquoi avoir choisi
de conclure votre livre, Là-bas, c'est
dehors, sur une photo du ciel de Rome ?
Cette photo, ce sont surtout des oiseaux
dans le ciel. Une image de la fausse
liberté. Faulknerdisaitque l'immensité
toute entière n'est jamais qu'une cage.
L'immensité comme cage, ce n'est pas
un sentiment banal…
Peut-être, mais c'est encore ce que j'ai
éprouvé dans un des derniers projets
de Patrice Chéreau, I Am the Wind, de
Jon Fosse. La scène était comme débor-
dée par quelque chose qu'elle ne pou-
vait pas contenir. Ce sentiment, c'est
peut-être à la mer que je le dois. À l'ho-
rizon vu depuis les quais du Havre, dans
l'enfance… Quand j'étais petit, on m'a
mis dans une école où il fallait colorier
des images. C'est-à-dire mettre des
couleurs à l'intérieur des silhouettes.
Mais je mettais toujours mes couleurs
en dehors du trait. J'ai voulu l'expliquer
à la maîtresse : «Je ne veux pas mettre
les couleurs là, elles ont l'air en prison.»
Ma mère était en prison pour des raisons
politiques –elle avait 20ans.
Mais vous avez toujours aimé le dessin…
Oui, mais le dessin, c'est la ligne, pas
le trait. Le trait referme, la ligne ouvre.
La ligne, le dessin, pour moi, marchent
avec la réflexion. Dessiner, écrire,
prendre des notes, le geste part du
même point. Dans l'écriture aussi, je
cherche la concentration, l'économie,
l'espace naturel –qui n'est pas le vide.
J'essaie toujours de m'arranger pour
trouver un sens. Pour habiter l'espace
sans déranger le vide qu'il y a dans
l'espace.
La ville où vous avez grandi, Le Havre,
vous a donné le sens des cachettes, des
cryptes, des souterrains, des espaces
engloutis…
Mes intuitions d'espace sont très forte-
ment liées aux quinze premières années
de ma vie. Entre 15 et 25ans, autre chose
s'est joué. Et puis j'ai rencontré Patrice
Chéreau, c'est-à-dire le théâtre, et un
ami. Et toute cette anxiété s'est orien-
tée vers un travail. Jusque-là, elle flottait
dans le vide. On a tant de choses dans
la tête, dans le cœur, mais comment les
exprimer ? Il y aurait tellement à racon-
ter… Je n'ai qu'à penser aux gens avec
qui j'ai travaillé.
À qui songez-vous, par exemple ?
Là, cinq personnes me viennent à
l'esprit. Patrice Chéreau et Luc Bondy;
Henri Loyrette, qui a dirigé le Musée
d'Orsay puis le Louvre; Bernard Giraud,
mon plus ancien collaborateur. Cha-
cun d'eux est une somme de souvenirs,
drôles et graves. Et, enfin, le sculpteur
et enseignant aux beaux-arts Charles
Auffret, mon maître. L'ombre du Com-
mandeur. Tout en rigueur, en honnêteté
dans le travail. À son exemple, j'ai appris
à ne pas céder à la facilité, à résister. À
souffrir dans la recherche. Il faut repar-
tir de rien, à chaque fois, sans filet, sans
garantie. Je passe ma vie à regarder, à
essayer de voir, de comprendre. C'est
presque maladif. J'essaie de rassem-
bler tout cela dans ma tête. Tout ce que
j'ai pu essayer de faire dans mon métier
naît de la même forme. De cet informe qui
peut devenir une chaise ou un diamant ou
un décor de théâtre ou quelques lignes,
quelques mots, un dessin.
Une sorte de quête de l'unité ?
Une unité toujours inquiète. Être autodi-
dacte, c'est très compliqué. Vous n'avez
pas les cartes en main. Passer par tel
auteur, commencer par celui-là et non
par tel autre, ces balises vous manquent.
J'ai aimé les surréalistes, et puis pour-
quoi pas Flaubert, Balzac ? Il y a eu des
périodes de ma vie où je ne lisais pas
par peur de ne pas savoir par où com-
mencer. Bon, aujourd'hui, ça va mieux…
J'adore Joseph Conrad, Eudora Welty,
Flannery O'Connor, je relis le Journal de
Delacroix…
Vous aimez donner aux murs et aux
façades de vos décors une patine par-
ticulière. Vous en faites des coquilles
d'existence, le vécu y laisse ses traces…
J'essaie de leur donner un sens. Je
fais très attention aux matières. Dans
Ivanov, par exemple, l'extérieur dans le
premier acte, ce hangar qui débouche
dans la salle, signifie toute une civilisa-
tion, un habitat de gens rouillés, usés,
prêts à partir au loin, embarqués dans
la nef des fous, la nef de rien. Je tenais
à donner cette impression.
Et le décor du Tartuffe ?
Plutôt un intérieur-piège chargé de possi-
bilités d'observer, de regarder, de fuir sans
pouvoir fuir. Quand on en a discuté avec
Luc Bondy, le metteur en scène, l'idée
s'est imposée d'une cuisine de grande
propriété, une salle où l'on se retrouve le
matin pour le petit déjeuner autour d'une
grande table éclatée. Je souhaitais qu'il
y ait un étage aussi, un plafond. Que tout
le volume soit cerné –contrairement à
Ivanov où l'on a eu envie que cette société
prête à s'effondrer soit dans la proximité
de la nature. Chez Tchekhov, on pressent
un changement d'époque. Chez Molière,
le changement est à l'échelle d'une famille.
C'est le patriarche qui fait défaut, c'est à
ce niveau intime que quelque chose ne
fonctionne plus.
Comme vous, Patrice Chéreau était
proche de la peinture.
Oui. Il avait avec elle une relation
profonde et importante. Mais il m'a
dit un jour qu'il ne voulait pas res-
ter en tête-à-tête avec les toiles,
comme son père. Patrice peignait ce
qu'il voulait exprimer en lui. Comme
Coltrane qui va au bout des sentiments
en mettant la musique hors d'elle-
même, Chéreau mettait la scène hors
d'elle-même. On l'a encore vu avec
Elektra. Il pouvait faire ressortir le beau
dans un morceau de charbon mouillé,
avec juste ce qu'il fallait de lumière… Il
épurait son style de plus en plus. Il vou-
lait sans cesse «en enlever». C'est par
là, finalement, qu'il faisait passer ses
visions. Moi aussi, je tente d'aller vers le
dépouillement. Nous avons fait ce che-
min ensemble. Mes premiers décors
étaient chargés de références aux arts
décoratifs, d'enluminures, de détails,
de chapiteaux. Tous les signes des arts
déco y sont passés, toutes les époques.
Ça m'a amusé de mélanger Vitruve et
Palladio, la Renaissance et l'Antiquité
rêvée, le XIX
e
. Au fond, j'ai voulu faire
de tous les siècles un seul paysage. Et
maintenant, j'en arrive un peu au sque-
lette. À l'envie d'en dire le plus avec le
moins.
Votre amitié avec Chéreau a été comme
un coup de foudre…
C'est ça, un coup de foudre d'ami-
tié. Lui avait reçu une bonne éduca-
tion, très universitaire, moi pas du tout
–mais on s'est rejoints sur une sensi-
bilité, une façon commune de poser le
regard. Notre œil voyait la même chose.
On l'a très vite senti. Et chacun apportait
à l'autre ce qui lui manquait.
Un peu comme dans certains groupes
de rock ?
Oui. C'est drôle, quand Patrice est mort,
Luc a écrit un texte… Il y dit à peu près
que Richard et Patrice, c'était comme
les Beatles.
Propos recueillis par Daniel Loayza
Paris, octobre 2015
Grande salle
SCÈNES IMAGINAIRES
animé par Arnaud Laporte
réalisé par Baptiste Guiton
Richard Peduzzi
samedi 30 janvier / 14h30
© Pénélope Chauvelot
ERRI DE LUCA
L'APPEL DE NAPLES
Depuis la parution de son premier roman, l'écrivain, qui sera
présent sur la scène de l'Odéon le 18 janvier, a façonné une
œuvre tout entière empreinte des souvenirs et fantasmes
de sa ville natale. La chercheuse Caterina Cotroneo nous
éclaire sur cette obsession.
Affirmer que toute ville exerce sur
l’écrivain qui l’a vu naître une influence
prépondérante, que ce soit dans la
construction de l’homme ou dans
celle de l’œuvre, peut paraître un lieu
commun. Cette influence peut prendre
des formes multiples : origines connues
et assumées, refusées et combattues
ou encore oubliées et ignorées. Mais
qui pourrait prétendre lire une œuvre
sans situer l’auteur dans le contexte de
son époque, sans rien savoir du cadre
qui a bercé l’enfance de l’écrivain ?
Traiter du rapport de cet écrivain avec
sa ville s’inscrit donc dans l’analyse
d’un des aspects centraux de son
écriture. Naples est présentée d’une
façon quasi obsessionnelle dans
certains ouvrages d’Erri De Luca, alors
que celui-ci a quitté sa ville à l’âge de
18ans, en partant comme on tourne la
page. Alors pourquoi continuer de la
raconter ?
Pourtant étranger en sa ville, Erri De
Luca veut se libérer du joug napolitain
d’une enfance malheureuse. Cette
décision a des accents de fuite et
elle manifeste le profond désir de
changement de vie, voire de négation
de ses origines. Or, il apparaît très vite
que Naples prend une part importante
dans son écriture, comme si l’auteur,
s’en étant physiquement éloigné, ne
cessait de la rejoindre par le biais
de l’imaginaire. Il ne s’agit pas, de
manière nostalgique, d’idéaliser
une ville perdue. Un profond travail
d’évocation, de réinterprétation et de
métamorphose s’opère tout au long
de ses écrits. Tout se passe comme si
l’écrivain, entre l’expérience réelle de
la ville, la Naples de l’après-guerre, et
ses souvenirs mythifiés, cherchait à
retrouver une harmonie perdue. La cité
semble se construire comme image
irréelle dans l’anthropologie intime
d’Erri De Luca et dans sa dynamique
poétique : la ville agit à la fois comme
point d’ancrage dans le réel et comme
source vive de création littéraire.
Erri De Luca retrace son enfance
dans une perception dualiste toute
singulière : d’une part, l’enfermement
dans un appartement exigu, dans
une ruelle sombre ; d’autre part, la
libération qu’offre le spectacle de la
mer. Il affirme qu’il n’y a rien à voir,
que la ville est un étroit cagibi. Seuls
les sons d’une ville bruyante semblent
lui parvenir et l’obséder. Le souvenir
constant de l’enfance mythifie la
ville dans un prisme architectural
narcissique et l’écriture développe
d’autres récits : celui du ghetto
sombre dans lequel il vit, s’attachant
notamment au vicolo, le cul-de-sac, en
contraste avec l’île mythique de ses
vacances, Ischia et la mer. Celui aussi
de la mythification de la souffrance de
l’écrivain, enfant «étranger» dans une
ville qui lui répugne et qui le hante mais
qui se sent responsable de tous les
actes de barbarie commis, comme par
exemple la guerre qui a détruit Naples
et ruiné ses parents.
Adulte, militant activiste du mouve-
ment communiste révolutionnaire
Lotta Continua, maçon sur les chan-
tiers, bénévole dans des convois
humanitaires, Erri De Luca se réfère
toujours à Naples. Tout est prétexte à
parler de sa ville : à Rome, le quartier
de la Garbatella en révolte évoque les
nuits de la Saint-Sylvestre à Napleset
la description de la prison de Rebib-
bia fait écho à celle de Naples; l’Etna
lui rappelle le Vésuve; les enfants de
Mostar, les scugnizzi napolitains.
Comme dans son métier de maçon, Erri
De Luca écrivain façonne la matière et
les mots. Il chante le tuf volcanique
de son enfance et il célèbre aussi la
mémoire de sa ville. À Paris, dans une
galerie souterraine, à la recherche
de l’entrée d’un égout, c’est le vicolo
stretto de son enfance qu’il revit. C’est
encore l’immenso vicolo cieco auquel
il fait allusion quand, malade et souf-
frant de fièvres, il est alité en Tanzanie.
À l’usine, il évoque des détails de la
vie napolitaine comme points de réfé-
rence : la plateforme de la machine-
outil sur laquelle travaille l’ouvrier
Erri De Luca à l’usine Fiat est longue
et étroite comme le balcon de l’en-
fance, les gestes mécaniques des
ouvriers postés à la chaîne de mon-
tage évoquent les gestes répétitifs
des garçons de café, le sifflement des
machines fait écho à celui du ferry-
boat de Naples.
Ce permanent retour à un passé
fantasmé enracine l’écrivain dans ses
origines. Erri De Luca continue de
façonner et de modeler Naples à son
gré, en essayant de réconcilier l’enfant
et l’homme, l’homme et l’écrivain.
Si Naples devient transcription de
l’imaginaire fantasmé de l’homme,
elle est plus encore l’expression
métaphorique de l’acte d’écriture
de l’écrivain. Au fur et à mesure des
périples d’Erri De Luca, elle s’efface
derrière le discours et devient prétexte
à cet acte essentiel qu’est, pour
l’homme de lettres, la métamorphose
du réel. En redessinant les contours
de la ville, en la mythifiant par de
multiples recréations, il nous offre
toute la singularité et la poésie de son
écriture.
Caterina Cotroneo
Nice, novembre 2015
Caterina Cotroneo
a reçu le prix de la Fondation Erri De
Luca, en 2013, pour sa thèse consacrée
à l'écrivain. Elle vient de publier Deux
études sur Erri De Luca où elle prolonge
sa recherche et expose le thème de
l’immigration, sujet cher au Napolitain.
couverture de Montedidio d'Erri De Luca, collection «I Narratori»,
éditions Feltrinelli, Milan, 2002
Grande salle
LIV(R)E ; UN AUTEUR,
UNE ŒUVRE
animé par Sylvain Bourmeau
Erri De Luca
lundi 18 janvier / 20h
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
1
/
9
100%