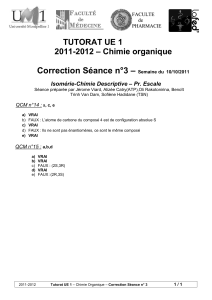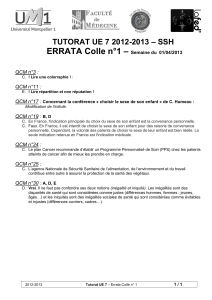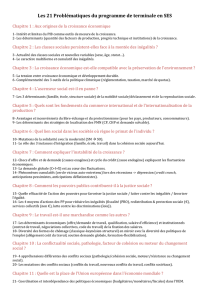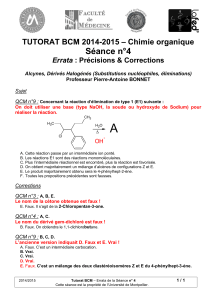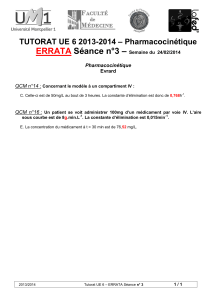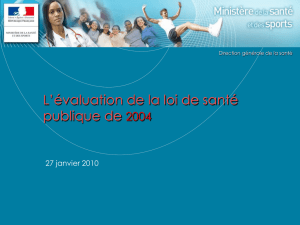CORRECTION Séance n°12 – TUTORAT UE 7 2011-2012 – SSH

2011-2012 Tutorat UE 7 SSH – Correction n° 12
1 / 6
TUTORAT UE 7 2011-2012 – SSH
CORRECTION Séance n°12 –
Semaine du
30/04/2012
SIDA, Histoire des maladies chroniques, Inégalités de
santé, Violence et Médecine
Pr Sotto - Lavabre Bertrand - Visier – Baccino
Séance préparée par Julie Couffignal, Clémentine Estric et Margaux Rivière
QCM n°1 : a, c
a) Vrai
b) Faux. Dans un premier temps, le préservatif n’était utilisé que comme moyen de contraception.
Puis avec l’épidémie de Sida, il s’est peu à peu tourné vers un objectif de prévention des MST.
c) Vrai
d) Faux. Le Sida connaît d’abord une phase très mortelle (maladie aigue) puis au fil des années,
avec l’arrivée des trithérapies en 1996, la prise en charge se chronicise.
e) Faux. Aujourd’hui le sex ratio est 1.9 H > F. Il y a eu une envolée massive chez les homosexuels
probablement par diminution de prévention des MST.
f) Faux
QCM n°2 :
a
a) Vrai ; On parle aussi de gay pneumonia.
b) Faux. La stigmatisation a toujours été collective avec les termes de « groupes à risque », de fléau
collectif et de retour à l’ère des épidémies.
c)
Faux. La stigmatisation persiste encore aujourd’hui. On incrimine encore les pratiques sexuelles à
risque. A l’hôpital, on observe un certain rejet et une peur des malades par certains soignants.
d) Faux. Les associations ont fait évoluer les concepts mais on ne parle plus de « groupes à
risque » mais de “pratiques à risque”.
e) Faux. Le toxicomane n’est pas rendu responsable de sa maladie et bénéficie comme tout malade
d’une prise en charge médicale et non pénitentiaire et doublement faux car c’est un usager de
drogue.
f) Faux
QCM n°3 :
c, e
a) Faux. L’annonce de la séropositivité engendre un retentissement psychologique,
socioprofessionnel et sentimental fort ; mais la déclaration de la maladie est obligatoire.
b) Faux. Les associations ont lancé seules les premières campagnes de prévention.
c) Vrai
d) Faux. La découverte des modes de transmission a bien permis une prévention efficace, mais la
contamination se fait par voie sexuelle, sanguine ou de la mère à l’enfant.
e) Vrai
f) Faux
QCM n°4 : c,
d, e
a) Faux. Le rôle actif du malade est assez mal accepté par le médecin pour le choix des traitements
ou pour la recherche.
FACULTE
De
PHARMACIE

2011-2012 Tutorat UE 7 SSH – Correction n° 12
2 / 6
b)
Faux. C’est l’inverse. La structuration des associations gay a permis celle de la recherche
clinique.
c) Vrai
d) Vrai
e) Vrai
f) Faux
QCM n°5 :
a, b, c, d
a) Vrai
b) Vrai
c) Vrai
d) Vrai
e) Faux. La Sida n’est pas une science. Ce sont les traitements et la prise en charge pluridisciplinaire
qui sont au confluent entre la médecine, les sciences fondamentales (virologie…) et les sciences
politiques, économiques et humaines, sociales.
f) Faux
QCM n°6 : a, d
a) Vrai
b) Faux, la violence peut être involontaire et causé par soi (auto mutilation)
c) Faux, il est possible de faire mettre sous tutelle une personne grâce à un recours en justice.
d) Vrai
e) Faux, il est tenu de le respecter même en prison.
f) Faux
QCM n°7 : a, b, c, d
a) Vrai
b) Vrai
c) Vrai
d) Vrai
e) Faux, il n’empêche pas la récidive.
f) Faux
QCM n°8: c, e
a) Faux, c’est une situation où il est mis à mal.
b) Faux, il ne faut pas confondre vieillesse est vulnérabilité qui ne sont pas législativement associés.
c) Vrai
d) Faux, le signalement se fait auprès de l’autorité judiciaire.
e) Vrai
f) Faux
QCM n°9 : a, b, c, e
a) Vrai
b) Vrai
c) Vrai
d) Faux, ces violences peuvent aussi être psychiques.
e) Vrai
f) Faux
QCM n°10 : d, e
a) Faux, le diagnostic de la maladie d’Alzheimer comporte plusieurs étapes et est parfois incertain au
début.
b) Faux, l’évolution de la maladie n’est pas précisément prédictible. Elle dépend de chaque malade.
c) Faux, ces deux représentations n’ont aucun fondement biologique.
d) Vrai
e) Vrai
f) Faux

2011-2012 Tutorat UE 7 SSH – Correction n° 12
3 / 6
QCM n°11 : a, b, c, d, e
a) Vrai
b) Vrai, surtout pour les aidants.
c) Vrai, il existe d’ailleurs un plan Alzheimer.
d) Vrai, surtout dans les périodes d’angoisse profonde.
e) Vrai
f) Faux
QCM n°12 : b, c, e
a) Faux. elles sont sociales
b) Vrai. ainsi que l’exclusion sociale ou la petite enfance
c) Vrai
d) Faux. les hommes ont moins tendance à consulter et sont confrontés à plus de risques
e) Vrai. les répartitions dans les populations féminines sont plus homogènes.
f) Faux
QCM n°13 : b
a) Faux, les inactifs sont plus exposés à des facteurs comme le tabagisme ou l’obésité ce qui réduit la
qualité de leur santé.
b) Vrai, les deux augmentent simultanément.
c) Faux, elle est dépendante, moins l’accès sera bon plus les malades n’iront pas se soigner.
d) Faux, elle ne comble pas le fossé, il persiste des inégalités comme celles liées à l’éducation ou à
l’accès dans les zones défavorisées.
e) Faux, 20pourcents de la population ce qui légitime la CMU.
f) Faux
QCM n°14 : a, c
a) Vrai
b) Faux, le microscope optique
c) Vrai
d) Faux, Watson et Crick
e) Faux, Claude Bernard.
f) Faux
QCM n°15 : a, e
a) Vrai
b) Faux, Curie grâce à l’utilisation de rayons X.
c) Faux, en 1975, on découvre la cellule au milieu du 19
ème
.
d) Faux, elle la fait avancer.
e) Vrai
f) Faux
QCM n°16 : a, c, d
a) Vrai
b) Faux, elle était d’abord conçue comme une maladie externe, agressive, métaphore épique
avec les pinces du cancer (ontogenèse distincte)
c) Vrai
d) Vrai, les techniques apportent des preuves scientifiques à la théorie médicale.
e) Faux, les ramoneurs sont plus touchés par le cancer pulmonaire causé par les poussières
toxiques de leur milieu professionnel : il existe donc un impact de la société et
l’environnement.
f) Faux
QCM n°17 :
b
a) Faux, cette définition pose problème par exemple avec le cancer.
b) Vrai

2011-2012 Tutorat UE 7 SSH – Correction n° 12
4 / 6
c) Faux, d’abord psychologique et sociale avant d’être physiologique et biologique.
d) Faux, c’est l’asthme.
e) Faux, par exemple le SIDA en France est beaucoup mieux maîtrisé qu’à l’échelle
mondiale.
f) Faux
QCM n°18 :
a, b, d
a) Vrai
b) Vrai
c) Faux, désormais il convient de parler d’accompagnement.
d) Vrai
e) Faux, dans le modèle de la maladie chronique le malade a certes plus de droits
(notamment grâce à la loi Kouchner), mais aussi plus de devoirs, dont un devoir « de
santé ».
f) Faux
Question rédactionnelle :
« Les déterminants de santé sont des caractéristiques individuelles ou collectives capables
d’influencer l’état de santé des populations. Innés ou acquis, ils changent le développement de
chacun tant au niveau physique, mental, que social. Ceci est d’ailleurs à l’origine de multiples
inégalités interindividuelles et intrasociétales. »
Déterminants de santé : définition se trouve dans les 2 premières phrases, référe aux principes de Santé
Publique, 5 types, classés en innés ou acquis, indiv ou collectifs, sont trouvés à partir d’indicateurs pour établir
des plans ministériels pour réduire les inégalités
Caractéristiques individuelles ou collectives
Influencer l’état de santé des populations : centrer le sujet sur la santé, bien premier, idée de norme, en quoi
cela va influence ?, individus considérés en masse
Physique, mental, que social : référence à la déf de l’OMS sur la santé
Inégalités interindividuelles et intrasociétales : mise en liens des inégalités avec les déterminants indiv ou
collectifs
La santé est un bien premier, nécessaire à l’exercice de l’autonomie de l’individu, dont la
répartition dépend de déterminants individuels et collectifs. En quoi les cinq déterminants de
santé publique englobent-ils l’ensemble des inégalités rencontrées dans nos sociétés
actuelles?
Nous aborderons d’abord les inégalités individuelles révélées par les déterminants
biologiques et liés aux habitudes de vie; pour ensuite étudier les inégalités collectives
sociales, liées à l’environnement et au système de soin. Nous détaillerons dans chacune des
deux parties précédentes les tentatives de réponse à ces inégalités.
I) Inégalités individuelles
1) Liées aux déterminants biologiques
. Les déterminants biologiques sont source d’inégalités individuelles. Ils s’illustrent par la
prédisposition génétique dans certaines pathologies chroniques (15% des cancers du sein
sont liés à la mutation BRCA1/BRCA2). Afin d’éviter les inégalités de naissance avec
l’apparition de maladies héréditaires graves et incurables, les DPI et DPN sont pratiqués
dans des centres spécialisés pluridisciplinaires ; après consentement libre et éclairé (arrêt
Teyssier) respectivement du couple ou de la mère. Ils respectent les principes éthiques
définis dans les lois de Bioéthique (94/04/11).
. En France, plus de 15 millions de personnes sont atteintes de maladies chroniques, dont
l’émergence sociale au 20e siècle est due à l’augmentation de l’espérance de vie de la
population. L’augmentation de l’incidence des maladies de vieillesse traduisant le Papi Boom
(comme le cancer et Alzheimer) a révélé la nécessité d’une prise en charge en maisons de

2011-2012 Tutorat UE 7 SSH – Correction n° 12
5 / 6
vie. On peut aussi les accompagner en fin de vie. C’est aux médecins de peser la balance
bénéfice/risque tout en respectant les principes éthiques d’autonomie et de justice pour
proposer des soins palliatifs ou continuer des thérapeutiques actives coûteuses (Loi
Leonetti 2005).
. Les maladies chroniques d’évolution progressive et systémique sont très consommatrices
de temps médical et paramédical. Pour réduire les coûts d’une Big Medecine toujours à la
tête de progrès scientifiques et technologiques, la prise en charge ambulatoire se révèle
être une solution adaptée (attention à la baisse de temporalité dans la relation
médecin/malade).
. La santé publique joue un rôle important dans la lutte contre les inégalités afin de
promouvoir la santé (Charte d’Ottawa) et de prévenir la maladie (loi de santé publique).
Les actions passent par la prévention primaire (vaccination), secondaire (dépistage comme
entrée dans le parcours de soin) et tertiaire (éducation thérapeutique pour améliorer la
qualité de vie et réduire les handicaps). La loi Kouchner du 4/3/2 place toutefois le curatif et
le préventif au même niveau montrant que l’explosion sociale des maladies chroniques n’a
pas effacé la prévalence des maladies aiguës.
2) Liées aux habitudes de vie
. Les habitudes de vie sont des déterminants acquis, ils se fondent sur l’expérience et
l’interaction de l’individu avec l’environnement et la société. A titre d’exemple, la
suralimentation qui peut engendrer l’obésité (il existe une part génétique mais mineure face
aux habitudes de vie) va justifier la mise en place de moyens d’encadrement collectifs ayant
une action sur la santé des populations (même si déterminant individuel !) ou le port du
préservatif en prévention du VIH.
. La prévention primaire avec le PNNS (plan national nutrition santé) et la promotion de la
santé équilibre en font partie. Parmi les moyens d’encadrement individuels, on retrouve
l’action du médecin traitant durant les visites de routine, ou durant le continuum de soin
dans la prise en charge d’une maladie chronique, de manière à contrôler la santé du patient
au long terme( fond de santé). Cette dernière est nécessaire à l’exercice de l’autonomie de
l’individu et au bon fonctionnement de la société (Théorie fonctionnaliste, Parsons). La santé
étant un bien premier, elle engendre la question de justice selon des clés de répartitions
(les déterminants!) qui seront façonnés par les politiques de santé (donc différentes
conceptions de la notion d’égalité, différents systèmes de santé cf II).
. L’encadrement par la société des pratiques individuelles engendre la notion de société du
risque et de précaution voulant toujours plus prévenir, et le concept d’aléa moral
(infantilisation de l’individu). Au final, vouloir contrôler toujours plus les habitudes de vie
n’engendrerait-il pas une volonté de transgression des normes de conduite ?
Les habitudes de vie peuvent être individuelles, de part la capacité de normativité de
l’individu (Canguilhem) mais elles peuvent être aussi collectives l’individu voulant se
confondre dans un cadre construit par la société.
II) Inégalités collectives
1) Liées à l’environnement
. On retrouve des déterminants liés à l’eau, mais aussi à l’air, notamment avec le problème
de tabagisme passif engendrant des exacerbations d’asthme ou des cancers
pulmonaires (mesure ministérielle interdisant de fumer dans les lieux publics). De plus le
fait d’habiter en ville ou à la campagne amène à des expositions différentes à la pollution. On
peut aussi s’intéresser à l’exposition au soleil, facteur de risque prédominant du cancer de la
peau. Il existe ainsi un plan cancer s’axant entre autre sur la prévention face à ses facteurs
de risques. La qualité de l’eau est aussi un enjeu mondial de santé, l’OMS tente de
l’encadrer grâce à des missions visant à apporter de l’eau potable dans les régions en
manquant.
2) Liées aux déterminants socioculturels
 6
6
1
/
6
100%