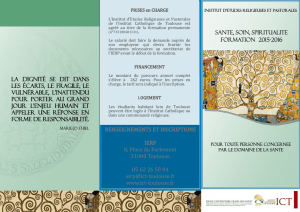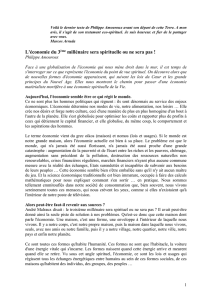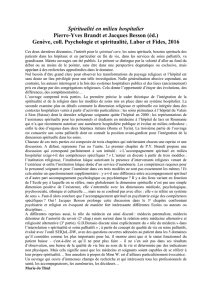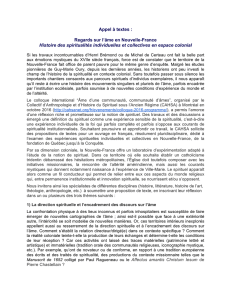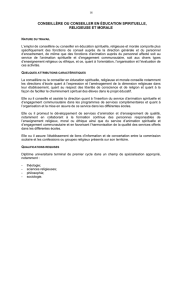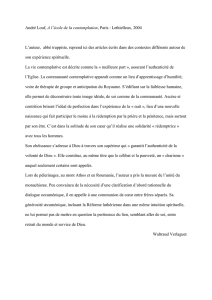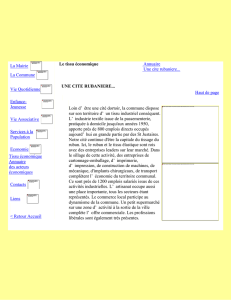Peut-on quantifier la spiritualite´ ? Un regard d`outre-Rhin a

ARTICLE ORIGINAL
Peut-on quantifier la spiritualite
´?
Un regard d’outre-Rhin a
`propos de l’actuelle discussion
franc¸aise sur la place du spirituel en psycho-oncologie
Can you quantify spirituality?
A look at Germany’s perspective on the current debate in France
about the place of spirituality in psycho-oncology
E. Frick
Re
´sume
´:L’actuelle discussion franc¸aise s’interroge sur la
place du spirituel en psycho-oncologie dans le contexte des
principes de laı
¨cite
´applique
´s au monde hospitalier. Les
psycho-oncologues et d’autres professionnels de sante
´
doivent rechercher un e
´quilibre entre la protection de la
liberte
´spirituelle des malades et leurs besoins d’accompa-
gnement et de soutien. L’auteur propose la me
´thode de
l’anamne
`se spirituelle afin de faire place aux pre
´fe
´rences de
la personne malade et d’amorcer un dialogue the
´rapeutique
dans ce domaine.
Abstract: The current debate in France about the place of
spirituality in psycho-oncology is strongly influenced by
the principles of secularity (laı
¨
cite
´) as applied to the
hospital world. Psycho-oncologists and other health
professionals need to strike a balance between protecting
patients’ spiritual freedom and meeting their need for care
and support. The author proposes the method of a
spiritual anamnesis to embrace the preferences of the
patient and start a therapeutic dialogue in this area.
Keywords: Spirituality – Psycho-oncology – Secularity –
Spiritual anamnesis – Patients’ needs
Le moment est bien choisi !
Les pages suivantes apporteront une re
´flexion a
`partir de la
pratique psycho-oncologique en Allemagne ou
`les ques-
tions autour de la spiritualite
´rec¸oivent une attention de
plus en plus grande de la part des cliniciens et des
chercheurs. La situation allemande dans ce domaine, est,
bien su
ˆr, fort diffe
´renteducontextefranc¸ais ou
`l’on vient
de comme
´morerlecentenairedelaloide1905,uneloiqui
se
´pare l’E
´glise et l’E
´tat, le spirituel et le se
´culier, et qui est a
`
l’origine de la laı
¨cite
´franc¸aise. Cette laı
¨cite
´afortement
influence
´tous les milieux de la socie
´te
´franc¸aise (y compris
la me
´decine et la the
´ologie catholique). Cette laı
¨cite
´est une
des raisons pour laquelle le the
`me de spiritualite
´se pose
dans le contexte tout a
`fait se
´cularise
´de l’oncologie.
A
`juger d’apre
`slefaitme
ˆme du the
`me choisi pour le re
´cent
congre
`s de la SFPO, le temps est venu pour dialoguer avec
nospatientssurlesquestionsexistentiellesqu’ilsse
posent : questions existentielles a
`propos du sens face a
`
l’absurdite
´inflige
´e par le cancer, a
`propos de l’espe
´rance
face a
`l’espoir de
´faillant, a
`propos de la transcendance face
aux limitations brutales impose
´es par la maladie.
Effectivement, le temps semble venu pour une ve
´ritable
« spiritualite
´de la laı
¨cite
´» [11], un terme qui paraı
ˆt
contradictoire au premier regard. Cependant, une telle
spiritualite
´ne s’opposera pas (dans un revanchisme religieux
quelconque) aux consensus re
´publicains. Elle conside
´rera, au
contraire, le contexte social de la laı
¨cite
´comme une chance
d’une pluralite
´religieuse et spirituelle exprime
´e dans l’espace
public et, en particulier, a
`l’ho
ˆpital. Les principes de laı
¨cite
´ne
Confe
´rence faite au XXII
e
Congre
`sdelaSocie
´te
´franc¸aise
de psycho-oncologie (Lille, 2 de
´cembre 2005)
Texte re
´vise
´pour la publication
Eckhard Frick ()
Je
´suite psychiatre et psychanalyste
CHU de Munich
E-mail : frick@psychoonkologie.org
Rev Francoph Psycho-Oncologie (2006) Nume
´ro 3: 160–164
©Springer 2006
DOI 10.1007/s10332-006-0140-4

peuvent nullement justifier que les besoins et les attentes
spirituelles des patients oncologiques soient ne
´glige
´s, voire
me
´prise
´s. Il s’agit donc de de
´crire et de conceptualiser les
exigences spirituelles des soins, de la relation soignant/
malade, de la formation du corps me
´dical et infirmier dans le
domaine spirituel.
Le spirituel : une nouvelle te
ˆte de l’hydre
catholique ?
La sociologie a longtemps e
´voque
´un processus de se
´culari-
sation en Europe, largement diffe
´rent des E
´tats-Unis
d’Ame
´rique ou
`le spirituel est tre
`spre
´sent dans la vie
publique. Le de
´clin religieux est cependant contrebalance
´par
deux tendances oppose
´es entre elles : un « croire sans
appartenance » et un « ressaisissement » chre
´tien interne
[8]. Les courbes franc¸aises des e
´tudes europe
´ennes de valeurs
montrent des e
´volutions religieuses diffe
´rentes selon les a
ˆges.
Les ge
´ne
´rations ne
´es apre
`s la guerre expriment une croyance
augmente
´eenDieuetenunevieapre
`slamort,a
`la diffe
´rence
des ge
´ne
´rations ante
´rieures. En revanche, l’appartenance
religieuse n’augmente pas. Les « croyances sans apparte-
nance religieuse » sont souvent e
´tiquete
´es de « spirituelles »
par les sujets qui s’y retrouvent.
En France, les ame
´nagements progressifs de la laı
¨cite
´
aboutissent a
`un chasse
´-croise
´e
´tonnant entre le se
´culier et
le spirituel :
–D’unco
ˆte
´,laRe
´publique et ses institutions doivent se
resituer par rapport aux religions, non seulement par rapport
a
`« l’hydre catholique », aux autres de
´nominations chre
´tien-
nes et au judaı
¨sme, mais, de manie
`re plus aigue
¨encore, par
rapport a
`l’islam [10, 11]. Parmi les institutions re
´publicaines,
ce sont l’ho
ˆpital et les soignants qui s’inte
´ressent beaucoup
plus qu’auparavant a
`la spiritualite
´de leurs patients. Et
beaucoup de soignants sont en train de de
´couvrir une
spiritualite
´personnelle, qui n’est pas force
´ment chre
´tienne
mais bouddhiste, e
´clectique, e
´sote
´rique...
–L’autreco
ˆte
´du chasse
´-croise
´est les milieux spiri-
tuels qui rejoignent les re
´alite
´s cruelles de la souffrance
humaine et des soins. L’auteur de ces lignes n’est pas le
seul praticien soucieux d’associer son appartenance
religieuse et l’accompagnement de la que
ˆte spirituelle des
malades tout en respectant la neutralite
´religieuse indis-
pensable aux professionnels de la sante
´.
Cependant, la Direction de l’hospitalisation et de
l’organisation des soins, dans sa circulaire du 2 fe
´vrier 2005
[3], vient d’expliciter avec fermete
´le principe de laı
¨cite
´a
`
l’ho
ˆpital.«Toutenaffirmantlaliberte
´d’action et
d’expression des patients dans le domaine religieux », la
circulaire rappelle : « Ces droits s’exercent dans le respect de
la liberte
´des autres. Tout prose
´lytisme est interdit, qu’il soit
le fait d’une personne accueillie dans l’e
´tablissement, d’une
personne be
´ne
´vole, d’un visiteur ou d’un membre du
personnel. » Le texte interdit formellement l’exte
´riorisation
vestimentaire d’une croyance par un agent hospitalier, en
parlant du voile musulman mais non pas expresse
´ment de
l’habit religieux chre
´tien, de la croix au revers, ni de la kipa
juive. La circulaire prote
`ge la liberte
´religieuse d’une manie
`re
pluto
ˆt formelle et de
´fensive en pre
´cisant que les malades
«rec¸oivent, sur demande de leur part adresse
´ea
`l’adminis-
tration de l’e
´tablissement, la visite du ministre du culte de
leur choix ». Elle ne dit pas, en revanche, comment le
personnel peut e
ˆtre forme
´dans le dialogue inter-religieux,
dans le de
´pistage des besoins, des attitudes et des pre
´fe
´rences
spirituels des patients (qui ne se manifestent que rarement
« sur demande de leur part adresse
´ea
`l’administration de
l’e
´tablissement »). Au-dela
`de la tole
´rance conce
´de
´epar
rapport aux ministres des cultes, la circulaire ne de
´finit pas
non plus le cadre me
´dico-le
´gal d’e
´ventuelles « interventions»
spirituelles « de la part des soignants ».
Le caracte
`re de
´fensif de la circulaire est d’autant plus
surprenant si l’on conside
`re les donne
´es des recherches qui
existent a
`l’e
´chelon international [2] et franc¸ais [1]. C’est
ainsi que les recommandations de la Haute Autorite
´de
sante
´concernant les soins palliatifs parlent a
`la fois du
« respect » des convictions des patients et d’une prise en
compte des proble
`mes spirituels qui devrait « favoriser »
leur expression (et non pas me
´ticuleusement parer aux
e
´ventuelles entorses a
`la laı
¨cite
´):
« Il est essentiel d’aborder les questions spirituelles
(sens de la vie, culpabilite
´,peurdelamort,pertede
contro
ˆle des e
´ve
´nements, aspects religieux) avec les
patients en favorisant l’expression des croyances et
repre
´sentations, en particulier lors de l’aggravation de
maladie et/ou a
`l’approche de la mort. Il est recommande
´
un accompagnement e
´claire
´, une assistance affective et
spirituelle, dans le respect des convictions du patient :
respect des opinions philosophiques et religieuses, respect
de sa dignite
´et de son intimite
´jusqu’au bout, dans la
discre
´tion, la confidentialite
´.L’e
´laboration d’une re
´flexion
au sein de l’e
´quipe est fondamentale afin d’e
´tablir une
relation de confiance et d’engagement entre l’e
´quipe
soignante, le patient et son entourage et de rechercher le
soutien le plus adapte
´dans le respect de sa vie prive
´e»
(ANAES, 2002).
La confe
´rence de consensus « L’accompagnement des
personnes en fin de vie et de leur proche » re
´unie en 2004
(accessible sous www.anaes.fr) est porte
´e par le me
ˆme souci
de re
´concilier les bonnes traditions de la Re
´publique en
matie
`re de laı
¨cite
´et les besoins spirituels des patients et de
leurs proches. A
`noter qu’une interpre
´tation trop unilate
´rale
du principe de neutralite
´peut restreindre l’expression de la
spiritualite
´aux seuls repre
´sentants religieux tole
´re
´sdansles
services hospitaliers alors que – avec un paternalisme
paradoxal qui pre
´tend pre
´server les liberte
´sciviques!–les
spiritualite
´s non religieuses seraient condamne
´es au silence
en faveur des religions « officielles » :
« La personne malade et ses proches doivent e
ˆtre
reconnus dans leurs convictions. Ne pas re
´pondre aux
161

besoins spirituels (religieux, philosophiques et autres) peut
ge
´ne
´rer une ve
´ritable souffrance. Les professionnels de sante
´
et les membres d’associations de be
´ne
´voles peuvent e
ˆtre
sollicite
´s dans un tel accompagnement. Ils doivent y satisfaire
avec respect et retenue sans jamais imposer leurs propres
syste
`mes de valeurs. Il convient de faciliter les pratiques
religieuses au me
ˆme titre que les attachements culturels. »
Entre le spirituel et le religieux
Le de
´bat sur la de
´finition du terme « spiritualite
´» est loin
d’e
ˆtre clos [5]. Dans la discussion psycho-oncologique
actuelle, le terme « spirituel » est plus ample que le terme
«religieux» qui de
´note l’aspect institutionnel et commu-
nautaire, les contenus partage
´s avec une tradition a
`laquelle le
sujet appartient [2]. La spiritualite
´,quanta
`elle, « n’est pas
re
´ductible a
`une cate
´gorie du penser. Elle est l’expression
me
ˆme de la vie, de toute vie ; elle est consubstantielle a
`la
nature humaine. Parce qu’il n’y a pas d’homme unique, il n’y
a pas de spiritualite
´unique : celle-ci sera religieuse, philoso-
phique, culturelle ou esthe
´tique [4] ».
Le mot spiritualite
´est en me
ˆme temps tre
`sre
´cent et
ancien. D’une part introduit en psycho-oncologie autour
desquestionsexistentiellesdesens,d’espe
´rance et de
transcendance, d’autre part remontant jusqu’au latin
spiritualitas au V
e
sie
`cle.
Malgre
´l’e
´largissement re
´cent, il s’agit a
`l’origine d’un
terme religieux. Le Dictionnaire de spiritualite
´asce
´tique et
mystique, publie
´en 16 tomes et pendant plus de soixante
ans,ente
´moigne. Ce dictionnaire distingue trois sens
principaux [13] :
1. religieux, applique
´a
`la vie spirituelle de
`sleV
e
s.,
s’oppose a
`carnalitas/animalitas,
2. philosophique, un mode d‘e
ˆtre, de connaı
ˆtre (XII
e
),
s‘oppose a
`corporalitas,
3. juridique : biens et fonctions eccle
´siastiques,
s‘oppose a
`temporalitas.
Un des premiers textes en franc¸ais, la Vie de sainte
E
´lisabeth de Hongrie et de Thuringe, date du XIII
e
s., il utilise
encore l’orthographe archaı
¨que « spiritalite
´»:
« ensi lor monstra et lor dist
l’oeuvre que li dous Jhe
´su fist.
Totsonparler,totsonpense
´
Tornoit a spiritalite
´»
Cette citation utilise principalement le sens religieux qui
pre
´domine de nos jours bien que le terme « spiritualite
´»
s’oppose de plus en plus a
`la religion, cette dernie
`re e
´tant
comprise au sens d’une appartenance institutionnelle,
d’une croyance codifie
´e socialement et dogmatiquement
et d’une re
´ve
´lation socialement reconnue. Rappelons aussi
que les significations secondaires peuvent nuancer l’usage
de la notion de spiritualite
´, par exemple le spiritisme et tout
le champ se
´mantique des « mauvais esprits » ou bien le sens
«face
´tieux » d’humour et de finesse intellectuelle, tel que le
franc¸ais l’exprime dans la notion du « mot d’esprit ».
Ajoutons que la racine latine « spiritual » reprend le grec
«pneumatikos», elle renvoie donc a
`l’esprit au sens
philosophique mais aussi religieux, c’est-a
`-dire au souffle
divin qui anime le corps humain d’Adam, de cet e
ˆtre gle
´beux
pris de l’adamah (la terre) et fabrique
´sur le tour de potier :
ADONAI Elohı
ˆmformelegle
´beux – ‘Ada
ˆm, poussie
`re
de la gle
`be – ‘Adamah. Il insuffle en ses narines haleine de
vie : et c’est le gle
´beux,une
ˆtre vivant.
(Gene
`se 2,7, d’apre
`s la traduction d’Andre
´Chouraqui)
La spiritualite
´, cette « expression me
ˆme de la vie, de
toute vie » (Dupont, 2005) se rec¸oit et se donne tant que
nous vivons. D’ou
`l’heureuse formule du training autoge
`ne
de Schultz : « C¸a me respire ».
Spiritualite
´veut donc dire Re-Spiritualite
´, accueillir et
transmettre le souffle vital.
Non, on ne peut pas quantifier ce qui...
Est-ce qu’on peut capter le rayon de soleil spirituel avec
une re
`gle[9]?Ilyaun«non»fermea
`cette question
provenant de deux directions:
1. Le spirituel est conside
´re
´comme le non-mate
´riel, donc
le non-mesurable. Il ne peut pas e
ˆtre objet de me
´thodes
empiriques. D’ou
`la re
´ticence classique des sciences me
´di-
cales (axiologiquement neutres) [15] par rapport a
`tout ce qui
touche les croyances, la religion et la spiritualite
´.
2. Un « non » vient aussi de la part des sciences
religieuses qui craignent une perte du sacre
´[7], le sacre
´
e
´tant ce qui e
´chappe a
`notre main-mise et ce qui ne fait pas
nombre avec d’autres facteurs qui puissent influencer la
sante
´. Cette deuxie
`me re
´servepeutadmettrelaquantifi-
cation de comportements et d’attitudes mais non pas de
l’objet transcendant de la spiritualite
´en tant que tel.
Si, on peut la quantifier (deux modes)
Ces re
´serves se traduisent sur le plan clinique par le
respect face aux convictions d’autrui, que ce soient le
patient, le colle
`gue et en particulier le membre d’une autre
tradition spirituelle que la mienne. Sur le plan me
´thodo-
logique, nous nous retrouvons devant le proble
`me de la
validite
´, autrement dit : Est-ce que la proce
´dure employe
´e
mesure vraiment ce qu’elle pre
´tend mesurer ?
Deux me
´thodes ont e
´te
´propose
´es :
–Lese
´chelles valide
´es, dans la plupart des cas des
adaptations d’e
´chelles nord-ame
´ricaines ou bien des
e
´chelles europe
´ennes. Le nouveau module du QLQ-C30
[14] en est un exemple.
–Lesme
´thodes qualitatives qui peuvent e
ˆtre quanti-
fie
´es dans un deuxie
`me temps. Permettez-moi de m’arre
ˆter
un instant a
`ce cas de figure.
162

Il y a plusieurs projets, anglo-saxons en majorite
´, d’une
anamne
`se spirituelle. Je voudrais mentionner tout spe
´cialement
les travaux de Christina Puchalski [12]. Dans notre recherche, a
`
Munich, nous essayons d’adapter sa me
´thode d’un entretien
spirituel clinique a
`la re
´alite
´allemande et europe
´enne.
Voici les quatre domaines a
`explorer avec le patient et, ce
qui est crucial, selon sa terminologie (Tableau 1). L’inter-
rogatoire fait partie d’une observation clinique de base. Il
ne
´cessite un minimum de temps (entre quinze et trente
minutes environ). Un travail de re
´flexion pre
´alable par le
professionnel de sante
´est souhaitable. L’anamne
`se spirituelle
se fait selon les re
`gles de neutralite
´, de respect et de non-
inge
´rence ge
´ne
´ralement admises en de
´ontologie me
´dicale. De
`s
le de
´but, l’entretien laisse une large place « au patient » et a
`sa
manie
`re de de
´finir les concepts. C’est ainsi que la question
d’introduction utilise le terme gla
¨ubig qui correspond aux
mots franc¸ais « croyant » et « ayant une foi ». En allemand,
cette manie
`re ample, visant le champ de la confiance, nous
semble mieux ouvrir l’entretien que les concepts de spiritualite
´
et de religion. Il faut noter que ces deux concepts sont riches en
connotations et risquent de cre
´er des malentendus selon
l’appartenance linguistique, culturelle et religieuse de chacun
des interlocuteurs. Au-dela
`de sa de
´finition personnelle de
«spiritualite
´», c’est le patient qui de
´cide de l’intensite
´de
l’entretien, des questions aborde
´es et, surtout, du ro
ˆle qu’il veut
octroyer au professionnel de sante
´dans le champ spirituel :
Dans notre e
´tude de phase I sur la faisabilite
´clinique
du SPIR [6], nous aboutissons aux conclusions suivantes :
Un de
´pistage des besoins et des pre
´fe
´rences spirituelles
est juge
´utile et non intrusif par patients et me
´decins.
SPIR et d’autres approches qualitatives sont adapte
´es a
`
la pratique clinique et peuvent e
ˆtre e
´value
´es quantitativement.
Le « diagnostic » spirituel, la coope
´ration interdisci-
plinaire et les interventions spirituelles sont des ta
ˆches
me
´dicales incessibles.
Peut-on... ? Mais qui est « on » ?
L’anamne
`se spirituelle pratique
´e par le me
´decin rassure un
grand nombre de patients dans le domaine de la spiritualite
´,
car ils conside
`rent le me
´decin comme objectif et neutre. Et ce
sont justement ces attitudes exige
´es par la de
´ontologie
professionnelle qui favorisent un dialogue spirituel au sein
de la relation me
´decin/malade. Le fait qu’ils ne doivent
craindre aucune re
´cupe
´ration religieuse aide les patients a
`
donner un ro
ˆle d’accompagnateurs aux professionels de
sante
´(dernier domaine du SPIR, idem). Une comparaison
des re
´sultats obtenus par des groupes professionnels divers
(me
´decins, infirmie
`res, psychologues et agents pastoraux)
va e
ˆtre publie
´e prochainement. Par ailleurs, nous pre
´parons
une e
´tude interculturelle et interreligieuse avec l’e
´quipe
de C. Puchalski.
Toutefois, il est e
´vident que l’option d’une me
´thode
d’anamne
`se spirituelle comporte a
`la fois des chances et
des risques. La plupart des risques sont relatifs, et il n’est
pas trop difficile d’y reme
´dier:manquedecompe
´tence
des professionnels de sante
´et absence de travail d’e
´quipe
dans le domaine spirituel, possibilite
´s limite
´es de donner
suite a
`une demande spirituelle suscite
´e par l’interroga-
toire qui repre
´sente, en me
ˆme temps, une intervention
(principedere
´activite
´). Tenir compte d’une approche
inter-subjective au sein du monde hospitalier n’est pas
sans risque. Les professionnels de la sante
´oseront-ils
prendre en compte la subjectivite
´du malade qui va de
´finir
«sa»spiritualite
´et celle de son entourage social et qui va
assigner de nouveaux ro
ˆles dans le domaine spirituel ? Ou
les me
´decins, les infirmie
`res et les psycho-oncologues
pre
´fe
´reront-ils,aucontraire,s’enteniraux«garde-fous»
des circulaires et des bonnes traditions laı
¨cales ? Il n’est
pas su
ˆr que le proble
`me de fond soit la protection du sujet
malade contre la re
´cupe
´ration spirituelle. Car, au-dela
`du
juste e
´quilibre entre les re
`gles de neutralite
´et d’autonomie
axiologique d’un co
ˆte
´et les besoins spirituels des patients
de l’autre, comment re
´agiront les enque
ˆteurs a
`se voir
confronte
´s avec leurs convictions, leurs expe
´riences, leurs
appartenances, leurs re
´voltes... ?
Il serait du moins ha
ˆtif de confondre laı
¨cite
´et laı
¨cisme
antispirituel. En ce qui concerne la religion, la loi de 1905
e
´tait « soucieuse, certes, d’empe
ˆcher le cure
´de sortir de
son domaine, mais aussi de l’y trouver quand on a besoin
de lui » (J. Rive
´ro, cite
´par Poulat, [11]). Dit d’une fac¸on
actualise
´e : il faut empe
ˆcher toute manipulation spirituelle
du malade, mais aussi l’aider a
`be
´ne
´ficier de tout ce dont
il a besoin dans ce domaine.
Conclusion: ces me
´decins et psycho-oncologues
qui se mettent au spirituel...
A
`la fin de cette re
´flexion, il est donc important de rappeler
le conflit qui existe entre une prise en charge spirituelle du
malade cance
´reux et la laı
¨cite
´des institutions et des
professionnels de me
´decine et de psychothe
´rapie. A
`trop se
maintenir a
`la seule laı
¨cite
´,onrisque«deme
´connaı
ˆtre une
part importante des aspirations des patients atteints de
maladies graves. [...] La me
´connaissance de la dimension
Tableau 1. Brouillon d’une version franc¸aise du Sche
´ma d’anamne
`se
spirituelle « SPIR » [6].
Spiritualite
´:Est-ce que vous diriez – au sens plus large des mots –
que vous avez une spiritualite
´, une religion, une foi ou une croyance ?
Place dans la vie : Est-ce que ces convictions ont de l’’importance
pour votre vie et, en particulier, pour votre manie
`re de faire face
a
`la maladie ?
Inte
´gration : Est-ce que vous faites partie d’’une communaute
´
spirituelle ou religieuse ?
Ro
ˆle du professionel de sante
´:Comment de
´sirez-vous que je (en tant
que me
´decin, infirmie
`re, the
´rapeute...) ge
`re les questions que nous
venons d’aborder ?
163

spirituelle peut e
ˆtre responsable d’une insuffisance de
priseenchargedeladouleur,del’angoisseetdela
de
´pression [15] ». Si, au contraire, les principes de laı
¨cite
´
sont bafoue
´s, on risque de violer l’intimite
´de la personne
malade dans le domaine des valeurs, des convictions et des
pratiques spirituelles.
Cela e
´tant dit, les recommandations officielles telles
quelacirculairedu2fe
´vrier 2005 [3], tout en privile
´giant
unilate
´ralement le po
ˆle « laı
¨cite
´» du conflit e
´voque
´,font
une place insuffisante aux besoins spirituels des patients
oncologiques [15].
L’importance accorde
´e au spirituel dans les soins
oncologiques pose le proble
`me de la subjectivite
´des
patients et des soignants. La ta
ˆche de ces derniers ne se
limite pas a
`e
ˆtre gardiens de la laı
¨cite
´mais d’accompagner
la que
ˆte spirituelle des patients qu’elle soit proche ou
lointaine des positions du sujet-soignant. Ce qui compte,
c’est que le soignant accueille cette que
ˆte avec sa
subjectivite
´(qui peut tout a
`fait e
ˆtre celle d’un athe
´e).
Un nouvel e
´tat d’esprit, moins militant et plus profession-
nel, devrait « rede
´finir la laı
¨cite
´, non pas comme deux
mondes, celui de la me
´decine et celui de la foi, qui
cohabiteraient en s’ignorant, mais comme des acteurs
d’une histoire existentielle et spirituelle en train de se jouer
et ou
`le bien du malade exige reconnaissance et ouverture,
sans cependant confusion des ro
ˆles » (idem).
La me
´thode d’anamne
`se spirituelle peut comple
´ter les
e
´chelles valide
´es de spiritualite
´. L’anamne
`se spirituelle est un
moyen d’explorer les pre
´fe
´rences et les besoins de la personne
malade. En me
ˆme temps, elle instaure un dialogue inter-
subjectif. Celui-ci, certes, n’est pas sans exigences. Le projet
d’anamne
`se spirituelle peut, en particulier, motiver les
professionnels de sante
´a
`aller plus loin dans leur formation
dans le domaine de la spiritualite
´.
Re
´fe
´rences
1. ANAES (2002) Modalite
´s de prise en charge de l’adulte ne
´cessitant
des soins palliatifs. www.anaes.fr
2. Breitbart W (2005) Spirituality and meaning in cancer. Rev
Francoph Psycho Oncol 4: 237-40
3. DHOS (2005) Direction de l’hospitalisation et de l’organisation des
soins: Circulaire DHOS/G no 2005-57 du 2 fe
´vrier 2005 relative
a
`la laı
¨cite
´dans les e
´tablissements de sante
´.
4. Dupont BM (2005) Spiritualite
´et puissance du corps. Rev Francoph
Psycho Oncol 4: 249-52
5. Frick E (2005) Sich heilen lassen. Eine spirituelle und psychoana-
lytische Reflexion [Se laisser gue
´rir. Une re
´flexion spirituelle et
psychanalytique]. Echter, Wurtzbourg
6. Frick E, Riedner C, Fegg MJ,etal.(sous presse) (2006) A clinical
interview assessing cancer patients’ spiritual needs and preferences.
Eur J Cancer Care 15: 238-243
7. Hill PC, Pargament KI, Hood RW, et al. (2000) Conceptualizing
religion and spirituality: Points of departure. J Theory Soc Behav
30: 51-77
8. Lambert Y (2004) Des changements dans l’e
´volution religieuse
de l’Europe et de la Russie. Rev Fr Sociol 45: 307-38
9. Lederberg MS, Fitchett G (1999) Can you measure a sunbeam with a
ruler? Psycho Oncol 8: 375-77
10. Mongin O, Schlegel JL (2005) La question de 1905. Esprit: 85-91
11. Poulat E (2005) Faut-il changer la loi de 1905 ? Esprit: 92-99
12. Puchalski CM (2004) Spirituality in Health: The role of spirituality
in critical care. Crit Care Clin 20: 487
13. Solignac A (1990) Spiritualite
´- 1. Le mot et l’histoire. In:
Viller M (ed), Dictionnaire de spiritualite
´. 14: p 1142-50
14. Vivat B, Young T, de Graeff A,etal.(2005) Report on phases 1 and 2
of the construction of a spiritual wellbeing module. EORTC 13: 39-46
15. Zittoun R (2005) Comment re
´pondre aux attentes des malades
atteints de cancer en matie
`re de croyance et de spiritualite
´?Rev
Francoph Psycho Oncol 4: 296-98
164
1
/
5
100%