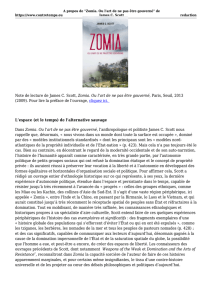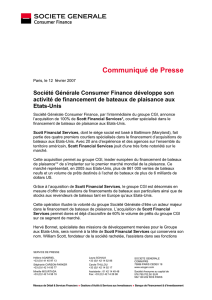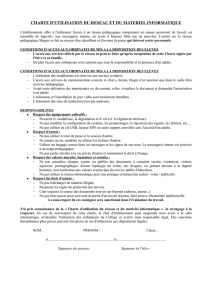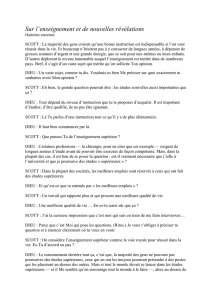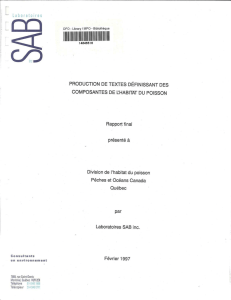charger la s?ance au format pdf

Synopsis
Suite à un passage en pleine mer dans une nappe de brouillard radioactif, Scott Carey voit
avec effarement son corps rapetisser. D’abord incrédules, les médecins s’avouent impuis-
sants malgré leurs recherches sur ce phénomène improbable, provoqué par une réaction
chimique rarissime entre des particules radioactives et les pulvérisations d’un insecticide.
Scott est donc condamné à changer constamment d’échelle, passant progressivement de
la taille d’un adulte à celle d’un enfant, puis d’un petit animal. Sa femme l’installe alors
dans une petite maison de poupée dans un coin de l’appartement : il ne mesure alors que
vingt centimètres… Mais un jour, alors que sa femme est sortie, Carey est attaqué par le
chat de la maison.
Fiche technique du film
Titre original : The Incredible Shrinking Man
Pays : USA
Durée : 1h21
Année : 1957
Réalisation : Jack ARNOLD
Scénario : Richard MATHESON
Image : Ellis W. CARTER
Effets spéciaux : Clifford STINE
Décors : Russel A. GAUSMAN
Musique originale : Joseph GERSHENSON
Production : Albert ZUGSMITH pour Universal International
Distribution en France : Les Films du Paradoxe
Avec : Grant WILLIAMS, Randy STUART, April KENT, Paul LANGTON.
> Philosophie > Terminales L/S/ES/STT/STI
“Identité et changement” dans
L’homme qui rétrécit de Jack Arn o l d
La Séance du mois
Mai 2006

Qu’est-ce que rester le même ? Est-ce mon sentiment ou le re g a r d des autres qui définissent celui que je suis ?
On peut rappeler brièvement que le terme identité vient du latin identitas, de idem, qui signifie “ le même ”.
Peut-on changer et conserver son identité ? On pourra dans un premier temps interroger les élèves sur les
d i ff é rents changements qui sont intégrés dans mon identité ou qui au contraire la menacent.
Jusqu’à quel point la modification est-elle intégrée, assimilée par l’individu dans un processus évolutif et
quand est-ce qu’au contraire la métamorphose devient intolérable ? Le propre de l’homme est de devoir
changer pour rester le même. Mais ce changement est défini, notamment selon une certaine évolution
biologique et psychologique déterminées. Lorsque je change en sortant de ces cadres, on peut dire que ce
changement bouleverse mon identité, la met en péril.
Quels sont alors les marqueurs de mon identité ? On peut distinguer la présence phénoménale, mon appa-
rence et le sentiment de mon corps, de la présence psychologique, la présence à soi, le sentiment que j’ai
d’être toujours le même.
-mon corps ou mon sentiment corporel
Le plus déroutant dans cette expérience de Scott, c’est que son corps qui le trahit en rétrécissant n’aban-
donne pas pour autant ses fonctions essentielles. Il continue à jouer son rôle de support existentiel et de guide
perceptif. Le sentiment corporel de soi, qu’on nomme parfois proprioception, n’a pas disparu. Scott continue
à ressentir la faim, la soif, la douleur. Il se blesse, tombe malade…Cette situation d’un être dont l’existence est
à la fois confirmée et remise en question par son corps (puisque Scott s’éprouve comme être vivant, mais que
son rétrécissement en fait progressivement un être invisible) souligne les limites de l’affirmation du philosophe
empiriste Berkeley selon lequel “être, c’est être perçu”. Ici, Scott se perçoit lui-même alors que les autres
cessent progressivement de le percevoir.
On pourrait faire un parallèle avec la déroute (inverse) de l’individu dont le corps ne correspond pas au sen-
timent qu’il en a, à ce qu’il ressent corporellement, à sa proprioception. Cf. Oliver Sacks, L’homme qui pre -
nait sa femme pour un chapeau, Points Seuil, 1988, voir les textes du chapitre 1 “”Pertes”, notamment La
femme désincarnée, Fantômes, Au niveau. p. 101 : “Si la proprioception est complètement détruite, le corps
devient pour ainsi dire sourd et aveugle à lui-même – et (comme le suggère la racine latine proprius), il cesse
de “ s’appartenir ”, de s’éprouver comme étant lui-même.”
- la présence à soi psychique :
Scott n’a pas le sentiment d’avoir changé intérieurement. Mais cette réduction physique est une diminution
au sens moral. Scott se sent diminué dans tous les sens du terme. Sans que son corps ne se soit véritablement
affaibli, ses possibilités ne sont plus les mêmes qu’auparavant. Il fait finalement l’expérience banale de l’hom-
me malade, dont les possibles sont réduits, le rythme de l’existence ralenti.
D’une certaine manière, cette expérience est en accéléré celle du vieillissement et de la disparition. C’est
sans doute pour contrecarrer cette idée, celle d’être en train de disparaître que Scott décide de rédiger son
journal. Pour créer par l’écriture une continuité et une visibilité que son expérience concrète lui refuse de plus
en plus. Il essaie par ce récit qu’il reconstruit d’ordonner une existence qui se déroule à contre-courant, en
contestant la suite logique qui lie le passé à l’avenir et qui construit normalement l’identité d’un individu,
comme le rappelle Leibniz : “L’avenir de chaque substance a une parfaite liaison avec le passé. C’est ce qui
fait l’identité de l’individu.” (Nouveaux essais sur l’entendement humain, GF, liv.2, chap.1, §12, p. 91.)
- l’apparence
Scott ne se fait d’illusion sur ce que donne à chacun son identité dans la vie en société. C’est l’apparence
physique qui constitue l’un des écrans sur lesquels les autres projettent leurs attentes ou leurs désirs à notre
égard. Il sait qu’en rétrécissant, il est condamné à perdre l’affection et la considération de ses proches,
quelque soit leur bonne volonté.
Il le signifie très clairement à sa femme Louise dans la scène de la voiture : “ Tu aimes Scott Carey, il a une
taille, une forme, une façon de penser. Tout cela est en train de changer”. Alors que Louise tente de le ras-
surer (“Il y a une chose qui ne changera jamais, c’est moi. Le jour où je t’ai épousé, j’ai prononcé un vœu.
Aussi longtemps que tu porteras cet anneau, je serai à toi.” ) l’anneau tombe de l’annulaire de Scott, deve-
nu trop fin.
On pourrait faire le rapprochement avec le texte suivant de Pascal extrait des Pensées : “ Celui qui aime
quelqu’un à cause de sa beauté, l’aime-t-il ? Non : car la petite vérole, qui tuera la beauté sans tuer la per -
sonne, fera qu’il ne l’aimera plus. Et si on m’aime pour mon jugement, pour ma mémoire, m’aime-t-on ? moi
? Non, car je puis perdre ces qualités sans me perdre moi-même. Où est donc ce moi, s’il n’est ni dans le corps
ni dans l’âme ? et comment aimer ce corps ou l’âme, sinon pour ces qualités, qui ne sont point ce qui fait le
moi, puisqu’elle sont périssables ? car aimerait-on la substance de l’âme d’une personne, abstraitement, et
quelques qualités qui y fussent ? Cela ne se peut, et serait injuste. On n’aime donc jamais personne, mais
seulement des qualités.” Pascal, Pensées (1670), fragment 688 ou 323, Seuil, 1964, p. 591.
I Les critères de l’identité

Il semble donc que mon identité change avant tout parce que le regard des autres sur moi change. C’est
moins mon sentiment que l’image que les autres me renvoient de moi-même qui influe sur la construction
mentale de mon identité. L’image que j’ai de moi est comme déformée par le jugement d’autrui. Scott est
doublement prisonnier du regard des autres. Parce que ce regard l’enferme dans une identité monstrueuse
qu’il récuse et parce que ce regard le condamne à rester reclus chez lui. Paradoxalement l’invisibilité que va
lui conférer progressivement son rétrécissement lui offrira une forme de liberté qui lui manque alors. Le regard
d’autrui me fait être tel que je ne veux pas être. Il est l’expérience d’une reconnaissance douloureuse.
“Autrui est le médiateur indispensable entre moi et moi-même : j’ai honte de moi tel que j’apparais à autrui.
Et, par l’apparition même d’autrui, je suis mis en mesure de porter un jugement sur moi-même comme sur un
objet, car c’est comme objet que j’apparais à autrui. Mais pourtant, cet objet apparu à autrui, ce n’est pas
une vaine image dans l’esprit d’un autre. Cette image en effet serait entièrement imputable à autrui et ne
saurait me “toucher ». Je pourrais ressentir de l’agacement, de la colère en face d’elle, comme devant un
mauvais portrait de moi, qui me prête une laideur ou une bassesse d’expression que je n’ai pas ; mais je ne
saurais pas être atteint jusqu’aux moelles : la honte est, par nature, reconnaissance. Je reconnais que je suis
comme autrui me voit.”Sartre, L’être et le néant (1943) Gallimard, Tel, p. 265.
Ce qui est mis en évidence dans cette expérience extraord i n a i re de Scott, c’est l’essence ord i n a i r e du devenir.
En vieillissant, je deviens plus jeune. Celui que j’étais devient plus jeune que celui que je suis. Le rapport au
temps est relatif, la qualification temporelle de l’individu est sans cesse mouvante. Le temps nous modifie dans
tous les sens, notre identité passée n’est pas figée, elle est constamment remodelée par le présent.
Dans le roman dont a été adapté le film, Matheson compare Scott à l’Alice de Lewi Carroll. Il semble que
l’analyse que Gilles Deleuze propose de l’expérience d’Alice offre des axes de réflexion qui peuvent accom-
pagner l’étude du film. Le devenir selon Deleuze n’opère pas seulement dans un sens, il redéfinit rétro s p e c t i-
vement celui que j’étais. Ce qui manifeste finalement la situation extraordinaire de Scott, ce n’est jamais que
la matérialisation visible d’une situation qui est en réalité la notre, sans que nous n’y prêtions attention, à savoir
notre impossibilité à vivre dans le présent, à s’arrêter dans le temps. Notre être est perpétuellement en deve-
nir, il n’est jamais fixé, défini d’une manière fixe et ce n’est qu’une illusion que de croire à identité stable. Le
monde mouvant de Scott n’est rien d’autre que le monde dans lequel nous vivons mais dont l’instabilité nous
est sans cesse dissimulée par la constance des choses. Parce que le monde matériel est stable, identique à
lui-même, je crois que le monde des hommes l’est aussi. Or il n’y a pas pour l’homme de fondement stable,
de certitude établie, il n’y a que du changement et la nécessité de s’y adapter. Comme Alice tentant de
courir après un monde qui avance en même temps qu’elle, Scott essaie de rattraper un monde qui devient
toujours trop grand, au fur et à mesure qu’il tente de s’adapter à ses nouvelles dimensions. Ce n’est là qu’une
métaphore de la situation de chacun d’entre nous. A chaque fois que je crois m’établir dans une forme de
stabilité, le changement m’apparaît dans toute son évidence.
“Quand je dis “Alice grandit”, je veux dire qu’elle devient plus grande qu’elle n’était. Mais par-là même aussi,
elle devient plus petite qu’elle n’est maintenant. Bien sûr, ce n’est pas en même temps qu’elle est plus gran -
de et plus petite. Mais c’est en même temps qu’elle le devient. Elle est plus grande maintenant, elle était plus
petite auparavant. Mais c’est en même temps du même coup, qu’on devient plus grand qu’on n’était, et
qu’on se fait plus petit qu’on ne devient. Telle est la simultanéité d’un devenir dont le propre est d’esquiver le
présent. En tant qu’il esquive le présent, le devenir ne supporte pas la séparation ni la distinction de l’avant
et de l’après, du passé et du futur. Il appartient à l’essence du devenir d’aller, de tirer dans les deux sens à la
fois : Alice ne grandit pas sans rapetisser, et inversement. […] Platon nous conviait à distinguer deux dimen -
sions : 1°) celle des choses limitées et mesurées, des qualités fixes, qu’elles soient permanentes ou temporaires,
mais toujours supposant des arrêts comme des repos, des établissements de présents, des assignations de
sujets : tel sujet a telle grandeur, telle petitesse à tel moment ; 2°) et puis, un pur devenir sans mesure, véritable
devenir-fou qui ne s’arrête jamais, dans les deux sens à la fois, toujours esquivant le présent, faisant coïncider
le futur et le passé, le plus et le moins…”Deleuze, Logique du sens (1969) Minuit, p. 9.
L’homme, à l’instar de Scott, est condamné à ce devenir-fou. Comme lui, il doit renoncer à la stabilité du
monde qui l’entoure, à l’illusion de sentiments éternels, à celle de sa propre identité comme constante. Les
relations au monde, aux autres, à soi ne peuvent pas faire autrement qu’évoluer. Scott doit accepter de
perdre l’affection de son frère, l’amour de sa femme. Mais il vit chaque détachement comme un arrache-
ment, sans voir encore qu’il est la condition d’un autre lien possible (avec la femme “miniature”) par exemple.
II L’identité relative
1 Le devenir
2. Le regard des autres

Désemparé par sa taille qui ne cesse de rétrécir, Scott dit de lui-même qu’il n’est plus un homme, mais qu’il
n’est désormais plus que la “caricature d’un homme”. Il faudrait s’interroger sur l’humanité d’hommes nor-
maux, comme la “meute” de journalistes dans le jardin. Quelles sont les caractéristiques, non pas physiques,
mais morales, d’un homme normal ? Peut-on seulement les définir ? Qui est humain, qui est inhumain ?
Mais plus encore, il faudrait analyser ce qui définit le psychisme de l’homme normal. C’est notamment un
certain nombre de certitudes, des assurances, qui lui permettent d’envisager l’existence avec une certaine
sérénité. L’homme normal a cette confiance dans la vie que Scott a perdu.
“Il faut admettre que l’homme normal ne se sait tel que dans un monde où tout homme ne l’est pas, se sait
par conséquent capable de maladie, comme un bon pilote se sait capable d’échouer son bateau, comme
un homme courtois se sait capable d’une “gaffe”. L’homme normal se sent capable d’échouer son corps
mais vit la certitude d’en repousser l’éventualité. S’agissant de la maladie, l’homme normal est celui qui vit
l’assurance de pouvoir enrayer sur lui ce qui chez un autre irait à bout de course.”Canguilhem, Le normal et
le pathologique, (1966), PUF Quadrige, p. 216.
Or ce qui est refusé à Scott, c’est précisément l’assurance d’enrayer ce processus et l’espoir d’une réversibi-
lité. Au moment où les médecins pensent avoir trouvé un antidote au processus de rétrécissement, Scott réa-
lise qu’il ne pourra de toute façon jamais retrouver sa taille initiale. Il est condamné à une autre forme de vie.
Comme l’homme malade, Scott doit accepter la nouvelle allure de sa vie, plus lente et plus pénible.
Scott refuse les traitements humiliants qu’évoque par exemple son frère qui lui suggère de vendre son histoire
aux journalistes. Pour Scott, il est hors de question de s’exhiber comme un animal de foire. Paradoxalement,
c’est auprès d’une femme “miniature” rencontrée sur une foire qu’il trouvera un peu de compréhension et
d’affection pendant quelques temps.
Ici on pourra faire un parallèle avec les films Freaks (1932) de Tod Browning ou Elephant Man (1980) de David
Lynch sur l’humanité des “monstres” et l’inhumanité de ceux qui les utilisent, les jugent ou les rejettent.
Pourquoi cette violence à l’égard de ces êtres ? Parce que leur difformité nous menace et nous touche au
plus profond de nous-mêmes, parce qu’elle matérialise une possibilité qui reste la notre. On peut mettre en
parallèle ces analyses et le texte de Canguilhem sur la monstruosité :
“Un échec de la vie nous concerne deux fois, car un échec pourrait nous atteindre et pourrait advenir par
nous. C’est seulement parce que, hommes, nous sommes des vivants qu’un raté morphologique est à nos
yeux vivants, un monstre. Supposons-nous pure raison, pure machine intellectuelle à constater et à rendre des
comptes, donc inertes et indifférents à nos occasions de penser : le monstre ce serait seulement l’autre que
le même, d’un autre ordre que l’ordre le plus probable.”
La suite du texte de Canguilhem semble pouvoir être contestée par l’étude du film. Canguilhem affirme que
la monstruosité est du côté de l’agrandissement démesuré d’un être (le géant) et non pas dans son rapetis-
sement. Il faudrait étudier en particulier le passage souligné ici :
“Il y aurait un éclaircissement à tenter sur les rapports de l’énorme et du monstrueux. L’un et l‘autre sont bien
ce qui est hors de la norme. La norme à laquelle échappe l’énorme veut n’être que métrique. En ce cas pour-
quoi l’énorme n’est-il accusé que du côté de l’agrandissement ? Sans doute parce qu’à un certain degré de
croissance la quantité met en question la qualité. L’énormité tend vers la monstruosité. Ambiguïté du gigan-
tisme : un géant est-il énorme ou monstre ? Le géant mythologique est prodige, c’est-à-dire que sa grandeur
“annihile la fin qui constitue son concept” (Kant, Critique du jugement, § 26). Si l’homme se définit par une
certaine limitation des forces, des fonctions, l’homme qui échappe par sa grandeur aux limitations de l’homme
n’est plus un homme. Dire qu’il ne l’est plus c’est d’ailleurs dire qu’il l’est encore. Au contraire, la petitesse
semble enfermer la qualité de la chose dans l’intimité, dans le secret. La qualité est d’autant mieux préservée
qu’elle est moins exposée.”Canguilhem, La connaissance de la vie, (1965), “La monstruosité et le mons-
trueux”, Vrin, Poche, pp. 219-220
3 Qu’est-ce qu’un homme normal ?
4 Humanité et monstruosité

III “ L’homme est la mesure de toutes choses ”
Tentant d’échapper au chat qui le poursuit, Scott, réduit à la taille d’une souris, fait une chute et atterrit dans
la cave. Sorte de Robinson sur une île hostile, peuplée d’objets désormais inutiles, qui ne sont par leur déme-
sure que des obstacles, Scott doit tenter de survivre. Seul dans la cave, il se retrouve au milieu des “vestiges
d’une civilisation perdue”, comme il le dit lui-même. Comme après une sorte d’apocalypse. Ce qui disparaît
en effet avec autrui, c’est le processus psychologique d’identification.
“[Autrui] peuple le monde d’une rumeur bienveillante. Il fait que les choses se penchent les unes vers les
autres, et de l’une à l’autre trouvent des compléments naturels. Quand on se plaint de la méchanceté d’au -
trui, on oublie cette autre méchanceté plus redoutable encore, celle qu’auraient les choses s’il n’y avait pas
d’autrui. Il relativise le non-su, le non-perçu ; car autrui pour moi introduit le signe du non-perçu dans ce que
je perçois, me déterminant à saisir ce que je ne perçois pas comme perceptible pour autrui. […] Tout est
implacable. Ayant cessé de se tendre et de se ployer les uns vers les autres, les objets se dressent menaçants
; nous découvrons alors des méchancetés qui ne sont plus celles de l’homme. On dirait que chaque chose,
ayant déposé son modelé, réduite à ses lignes les plus dures, nous gifle ou nous frappe par derrière.”
Deleuze, Logique du sens, pp. 355-356.
Le héros devient comme mort, dès lors qu’il échappe au re g a r d d’autrui. Dans la cave. Sans le re g a rd d’autrui,
je suis comme mort. Je n’ai plus d’existence, la mort de Scott Carey est annoncée à la télévision. Son frère
dans la cave manque de l’écraser. Plus personne ne le voit ni ne l’entend.
“Il n’est que les morts pour être perpétuellement objets sans devenir sujets – car mourir n’est point perdre son
objectivité au milieu du monde : tous les morts sont là, dans le monde autour de nous : mais, c’est perdre toute
possibilité de se révéler comme sujet à autrui.”Sartre, L’être et le néant, p. 344.
Pourtant, la disparition d’autrui est également une forme de libération. En changeant d’échelle, Scott chan-
ge de point de vue sur les choses. C’est lorsqu’il se libère du regard qu’il avait auparavant sur les choses, de
la manière dont il les envisageait, qu’il voit apparaître en elles d’autres usages et à travers elles d’autres pos-
sibles. Le sens du monde et des choses est lui-même est relatif. Ainsi les choses de l’environnement familier
semblent d’abord se muer en obstacles qui paralysent l’action et contraignent Scott à réduire sa liberté d’ac-
tion et de déplacement : le stylo devient trop gros pour écrire, les marches trop hautes pour être escaladées.
Mais progressivement, il réalise la nécessité de convertir le sens des objets, afin qu’ils cessent de s’opposer à
ses projets et les servent. Ainsi, l’aiguille de couturière, sur laquelle l’image se fixe au début de film, devient-
elle une lance, moyen de défense efficace puisqu’il permet de tuer l’araignée.
Il semble que la réflexion de Sartre sur ce qu’il nomme le complexe d’ustensilité de la chose peut s’inscrire
dans cette analyse. C’est l’homme qui crée le “complexe d’ustensilité”, c’est-à-dire qui décide de l’eff i c a c i t é,
de l’utilité de la chose. Au début, Scott tente de se servir des choses selon le même sens que celles qu’elles
avaient dans le monde précédent. Puis il les détourne de leur utilité première et crée ainsi un nouveau com-
plexe d’ustensilité.
“Nous percevons la résistance des choses. Ce que je perçois quand je veux ce verre à ma bouche, ce n’est
pas mon effort, c’est sa lourdeur, c’est-à-dire sa résistance à entrer dans un complexe-ustensile, que j’ai fait
paraître dans le monde.[…] L’ustensilité est première ; c’est par rapport à un complexe d’ustensilité originel
que les choses révèlent leurs résistances et leurs adversités. La vis se révèle trop grosse pour se visser dans
l’écrou, le support trop fragile pour supporter le poids que je veux soutenir, la pierre trop lourde pour être sou -
levée jusqu’à la crête du mur…”Sartre, L’être et le néant, p. 373.
La résistance des choses qui m’entourent à mon projet n’est finalement définie que par mon projet lui-même.
Ainsi le même rocher pour s’avérer un obstacle ou un support propice selon que je souhaite le déplacer ou
l’escalader. Tout dépend du regard que je porte sur la chose et de ce que j’en attends.
“Le coefficient d’adversité des choses ne saurait être un argument contre notre liberté, car c’est par nous,
c’est-à-dire par la position préalable d’une fin, que surgit ce coefficient d’adversité. Tel rocher qui manifeste
une résistance profonde si je veux le déplacer sera, au contraire, une aide précieuse si je veux l’escalader
pour contempler le paysage. En lui-même, […] il est neutre, c’est-à-dire qu’il attend d’être éclairé par une fin
pour se manifester comme adversaire ou comme auxiliaire. Encore ne peut-il se manifester de l’une ou l’autre
manière qu’à l’intérieur d’un complexe-ustensile déjà établi.” Idem, p. 538-539.
1 L’autre, repère du monde
2 Changer d’échelle
 6
6
1
/
6
100%

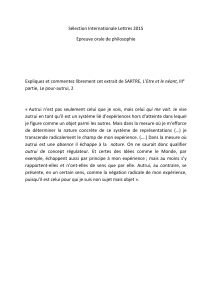

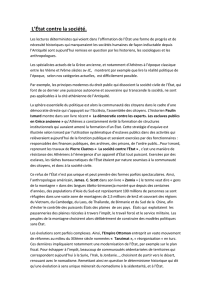
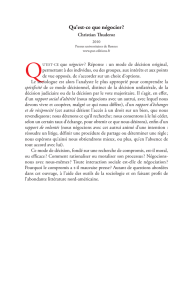
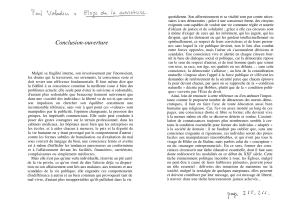
![Inscription de la séquence dans les programmes[1] de l](http://s1.studylibfr.com/store/data/007119161_1-080fc5b72510279fdade3b1afa55e3c0-300x300.png)