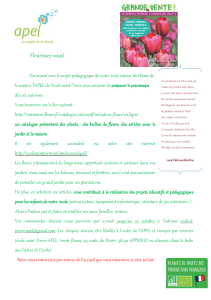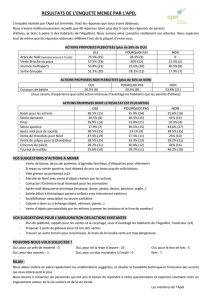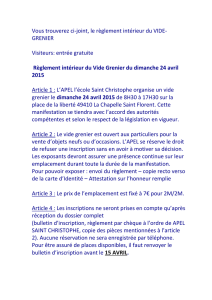Penser avec... et contre.... La pragmatique transcendantale

1
UNIVERSITE DE NANTES
ECOLE DOCTORALE : Cognition, Education, Interactions
Thèse pour le Doctorat de Philosophie soutenue le 24 juin 2010 par
Martine LE CORRE CHANTECAILLE
« Penser avec…et contre… ».
La pragmatique transcendantale de Karl-Otto Apel : une
théorie et une pratique de l’intersubjectivité.
Sous la direction de
Monsieur le Professeur André STANGUENNEC
Membres du Jury :
M. Christian BERNER, Professeur à l’Université Charles de Gaulle, Lille III
M. Jean-Marie LARDIC, Professeur à l’Université de Nantes
M. Gérard RAULET, Professeur à l’Université Paris-Sorbonne
M.André STANGUENNEC, Professeur émérite à l’Université de Nantes

2
Remerciements
Cette thèse est le fruit d’un travail qui doit beaucoup à ce que Karl-Otto APEL nomme des
« impulsions stimulantes ». Qu’elles soient intellectuelles ou affectives, sans elles, ce travail
n’aurait pu être mené à son terme.
Je remercie ainsi personnellement Karl-Otto APEL d’avoir constitué, lui-même, la première
d’entre elles par ses écrits, comme par l’entretien qu’il a généreusement accepté de
m’accorder en 2004.
Bien entendu, cette thèse doit aussi beaucoup à André STANGUENNEC qui l’a dirigée
pendant plusieurs années. Je tiens à le remercier très chaleureusement pour ses
encouragements et ses précieux conseils.
Je remercie également Jean-Marie LARDIC, qui a accepté de présider le jury ainsi que
Christian BERNER et Gérard RAULET, rapporteurs de ma thèse.
Je remercie, enfin, toute ma famille et, tout particulièrement, Antoine, Charles et Juliette pour
m’avoir apporté, au quotidien, un soutien constant si nécessaire.

3
« Penser avec…et contre… ». La pragmatique transcendantale de Karl-Otto Apel : une théorie
et une pratique de l’intersubjectivité.
__________________________________________________________________________________
Né en 1922, Karl Otto Apel a développé, durant la seconde moitié du XXe siècle, l’idée d’une
« transformation de la philosophie » kantienne substituant l’intersubjectivité au sujet solipsiste. Il a
ainsi élaboré une « pragmatique transcendantale » dont l’ambition est de fonder ultimement la raison
par la réflexion sur les présuppositions de l’argumentation. En dévoilant les conditions de validité des
connaissances théoriques et les normes fondamentales d’une « éthique de la discussion », la
pragmatique transcendantale se présente comme une réponse au relativisme, défi majeur pour Apel.
Or, c’est au sein d’une pensée qui s’est explicitement construite à l’aide de multiples reconstructions et
confrontations que cette reconnaissance théorique d’une intersubjectivité transcendantale s’effectue.
De la pensée de Heidegger à la philosophie de la libération de Dussel, en passant par l’humanisme ou
la philosophie analytique, Apel ne présente, en effet, jamais sa philosophie « sans » se référer à celle
des autres mais part, au contraire, systématiquement de leur pensée pour développer la sienne. De sa
dissertation doctorale de 1950 aux derniers essais publiés dont nous disposons, c’est ainsi la pratique
constante d’un « penser avec et contre » qui caractérise ses écrits. Depuis l’exigence herméneutique
initiale de la compréhension des points de vue divers à la nécessité méthodologique et éthique de la
confrontation des idées, c’est l’examen de la cohérence interne entre la théorie et la pratique
philosophique de Apel qui servira de fil conducteur à l’étude de la genèse et du développement de la
pragmatique transcendantale.
__________________________________________________________________________________
« Thinking with…and against ... ». Karl-Otto Apel’s transcendental pragmatics : a theory and a
practice of intersubjectivity
__________________________________________________________________________________
Born in 1922, Karl Otto Apel has developped, during the second half of the 20
th
century, the idea of a
“transformation” of the kantian philosophy, substituting intersubjectivity for the solipsist subject. He
has, thus, elaborated a “transcendental pragmatics” whose ambition is to provide an ultimate
foundation of reason by the reflection on the necessary presuppositions of argumentation. By
disclosing the pre-conditions of the scientific validity and the fundamental norms of a “discourse
ethics”, “transcendantal pragmatics” presents itself as a response to relativism which is a main
challenge for Apel. Now, this theoretical recognition of a transcendantal intersubjectivity takes place
in a thought which has always constructed itself with the help of many reconstructions and
confrontations. From Heidegger’s hermeneutics to Dussel’s philosophy of liberation, from humanism
to analytical philosophy, Apel never presents his philosophy without refering to the other ones but, on
the contrary, he systematically starts from their thought to develop his own. From his doctoral
dissertation of 1950 to the last edited essays we have at our disposal, it is the constant practice of “
thinking with...and against...” that characterizes Apel’s writings. From the initial hermeneutical
requirement to understand different points of views to the methodological and ethical necessity of the
confrontation of ideas, it is the examination of the internal coherence between Apel’s theory and
practice that will serve as the main thread in the study of genesis and development of transcendental
pragmatics.
_______________________________________________________________
Philosophie
___________________________________________________________________________
Mots clefs : Apel - Pragmatique transcendantale - Ethique de la discussion – Herméneutique–
Philosophie analytique - Intersubjectivité –
_________________________________________________________________________________
Key words : Apel - Transcendental pragmatics - Discourse ethics – Hermeneutics- Analytical
philosophy- Intersubjectivity.
___________________________________________________________________________
U.F.R Lettres et Langages, département de philosophie

4
Table des Matières
INTRODUCTION GENERALE
…………………………..................... p.8
PREMIERE PARTIE
VERS LA PRAGMATIQUE TRANSCENDANTALE : SENS ET APPORT
DES PREMIERES RECONSTRUCTIONS
…………………………………………… p.13
Introduction de la Première Partie
…………………………………………………………………… p.14
Chapitre I : La reconstruction initiale : Dasein et connaissance : une interprétation de la
philosophie de Martin Heidegger du point de vue de la théorie de la connaissance
…
p.16
Introduction : la double finalité de la reconstruction………………………………………………………… p.16
1- L’élargissement du questionnement kantien comme voie d’une transformation et non d’une destruction
de la philosophie transcendantale…………………………………………………………………………….. p.17
2 - La critique de la raison finie et l’importance de la temporalité…………………………………………. p.23
3- Les perspectives tracées…………………………………………………………………………………… p.38
a- la contribution à l’interprétation de Heidegger
…………………………………………………... p.39
b- la contribution à la fondation d’une théorie existentiale de la connaissance
………................ p.41
Conclusion……………………………………………………………………………………………………… p.46
Chapitre II : L’orientation linguistique des prolongements historiques et systématiques de
la reconstruction initiale de Etre et Temps
………………………………………………… p.50
Introduction …………………………………………………………………………………………………… p.50
1- Les trois reconstructions de 1955……………………………………………………………………….. p.52
a- La reconstruction de l’histoire du « comprendre »
…………………………………………… p.52
b- La reconstruction de l’idée du langage chez Nicolas de Cues
……………………………….. p.54
c- La reconstruction de la phénoménologie
………………………………………………………. p.59
2- Le langage dans les écrits systématiques : l’investigation de la « raison concrète » et l’idée du langage
comme « technognomie »……………………………………………………………………………….. p.63
a- Le projet d’une concrétisation anthropologique de la philosophie transcendantale comme
réponse au problème de l’ « ipse sensu »
……………………………………………………. p.63
b- Le détour par la physique moderne
……………………………………………………………. p.67
c- L’éclairage de la microphysique pour la constitution du monde préscientifique comme
pour celle des sciences de l’esprit et de la philosophie : la médiation du sens du monde
par la praxis
………………………………………………………………………………………. p.71
d- L’ « excursus historique »de l’article de 1958: de l’avoir-un-corps à l’être-un-corps
….. p.74
e-Le langage : « technognomie la plus fondamentale »
………………………………………… p.76

5
f-Langage et vérité
…………………………………………………………………………... p.79
Conclusion……………………………………………………………………………………………. p.85
Chapitre III : Un exemple privilégié de reconstruction-prolongement : l’étude de l’idée du
langage dans la tradition de l’humanisme de Dante à Vico
………………………… p.89
Introduction : l’enjeu de la reconstruction………………………………………………………… p.89
1- Le diagnostic de la situation de la philosophie du langage du XXème siècle…………….. p.92
a- Les apories de la philosophie analytique
……………………………………………… p.92
b- Du côté de la philosophie transcendantale allemande : le passage de la critique de la
conscience à la critique du langage
…………………………………………………… p.96
2- La préhistoire respective des deux conceptions opposées du langage : quelques
indications………………………………………………………………………………………… p.101
3- A la croisée du Moyen Age et de la modernité : Dante et son écrit programmatique De
Vulgari Eloquentia………………………………………………………………………… p.105
4- L’humanisme linguistique : sa préhistoire romaine, son développement, ses délimitations… p.112
a- La préhistoire romaine de l’humanisme : le rôle déterminant de Cicéron
…………….. p.112
b- Le développement de l’humanisme italien : de la phase latine à l’umanesimo volgare
… p.115
c- L’humanisme en France et en Allemagne
……………………………………………………… p.121
5- L’humanisme linguistique et le système naturel des sciences de l’esprit…………………… p.125
a- L’humanisme et la conception empiriste-nominaliste du langage de Bacon
……………… p.126
b- L’humanisme dans l’approche scientifique de Leibniz
……………………………………… p.127
c- « Le développement transcendantal-philologique de la philosophie secrète de l’humanisme
(romano-italien) du langage chez Vico », véritable « chouette de Minerve de la culture italienne
de la Renaissance »
……………………………………
p.131
Conclusion…………………………………………………………………………………………… p.139
Chapitre IV : une reconstruction-confrontation décisive : l’apport de la philosophie
analytique dans le cheminement de Apel
……………………………………………………. p.141
Introduction………………………………………………………………………………………………. p.141
1-Les apories des approches syntaxico-sémantiques du sens……………………………………… p.148
a- La métaphysique de l’atomisme logique et les apories du Tractatus logico-philosophicus de
Wittgenstein
………………………………………………………………………………… p.150
b- La métaphysique cachée du positivisme logique
……………………………………………. p.167
2-La diversité des approches pragmatiques du sens………………………………………………… p.180
a- La sémantique cachée des pragmatiques béhavioristes : penser avec Morris contre Morris
…p.182
b- L’approche pragmatique du dernier Wittgenstein et son dépassement du solipsisme
méthodique : « penser avec Wittgenstein contre Wittgenstein »
………………………………… p.187
Conclusion…………………………………………………………………………………………………… p.203
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114
 115
115
 116
116
 117
117
 118
118
 119
119
 120
120
 121
121
 122
122
 123
123
 124
124
 125
125
 126
126
 127
127
 128
128
 129
129
 130
130
 131
131
 132
132
 133
133
 134
134
 135
135
 136
136
 137
137
 138
138
 139
139
 140
140
 141
141
 142
142
 143
143
 144
144
 145
145
 146
146
 147
147
 148
148
 149
149
 150
150
 151
151
 152
152
 153
153
 154
154
 155
155
 156
156
 157
157
 158
158
 159
159
 160
160
 161
161
 162
162
 163
163
 164
164
 165
165
 166
166
 167
167
 168
168
 169
169
 170
170
 171
171
 172
172
 173
173
 174
174
 175
175
 176
176
 177
177
 178
178
 179
179
 180
180
 181
181
 182
182
 183
183
 184
184
 185
185
 186
186
 187
187
 188
188
 189
189
 190
190
 191
191
 192
192
 193
193
 194
194
 195
195
 196
196
 197
197
 198
198
 199
199
 200
200
 201
201
 202
202
 203
203
 204
204
 205
205
 206
206
 207
207
 208
208
 209
209
 210
210
 211
211
 212
212
 213
213
 214
214
 215
215
 216
216
 217
217
 218
218
 219
219
 220
220
 221
221
 222
222
 223
223
 224
224
 225
225
 226
226
 227
227
 228
228
 229
229
 230
230
 231
231
 232
232
 233
233
 234
234
 235
235
 236
236
 237
237
 238
238
 239
239
 240
240
 241
241
 242
242
 243
243
 244
244
 245
245
 246
246
 247
247
 248
248
 249
249
 250
250
 251
251
 252
252
 253
253
 254
254
 255
255
 256
256
 257
257
 258
258
 259
259
 260
260
 261
261
 262
262
 263
263
 264
264
 265
265
 266
266
 267
267
 268
268
 269
269
 270
270
 271
271
 272
272
 273
273
 274
274
 275
275
 276
276
 277
277
 278
278
 279
279
 280
280
 281
281
 282
282
 283
283
 284
284
 285
285
 286
286
 287
287
 288
288
 289
289
 290
290
 291
291
 292
292
 293
293
 294
294
 295
295
 296
296
 297
297
 298
298
 299
299
 300
300
 301
301
 302
302
 303
303
 304
304
 305
305
 306
306
 307
307
 308
308
 309
309
 310
310
 311
311
 312
312
 313
313
 314
314
 315
315
 316
316
 317
317
 318
318
 319
319
 320
320
 321
321
 322
322
 323
323
 324
324
 325
325
 326
326
 327
327
 328
328
 329
329
 330
330
 331
331
 332
332
 333
333
 334
334
 335
335
 336
336
 337
337
 338
338
 339
339
 340
340
 341
341
 342
342
 343
343
 344
344
 345
345
 346
346
 347
347
 348
348
 349
349
 350
350
 351
351
 352
352
 353
353
 354
354
 355
355
 356
356
 357
357
 358
358
 359
359
 360
360
 361
361
 362
362
 363
363
 364
364
 365
365
 366
366
 367
367
 368
368
 369
369
 370
370
 371
371
 372
372
 373
373
 374
374
 375
375
 376
376
 377
377
 378
378
 379
379
 380
380
 381
381
 382
382
 383
383
 384
384
 385
385
 386
386
 387
387
 388
388
 389
389
 390
390
 391
391
 392
392
 393
393
 394
394
 395
395
 396
396
 397
397
 398
398
1
/
398
100%